Accueil > Culture générale et expression en BTS > Seuls avec tous > La Société des individus, de Norbert Elias
Quel rapport entre « nous » et « je » ?, pour étudiants et adultes
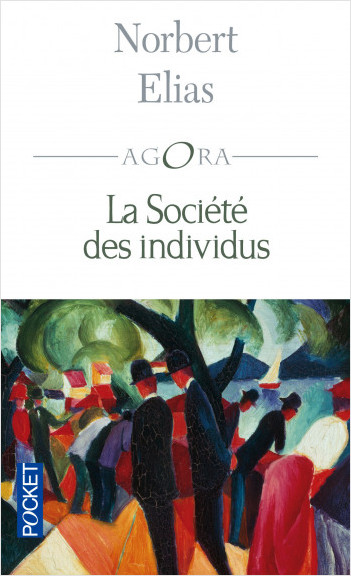 La Société des individus, de Norbert Elias
La Société des individus, de Norbert Elias
Pocket, 1987, 304 p., 8,3 €.
samedi 6 avril 2019
La Société des individus de Norbert Elias (1897-1990) est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « Seuls avec tous ». C’était l’occasion de lire un classique de la sociologie. Ce livre est très particulier à cause des relations compliquées de son auteur avec la société allemande. En effet, juif, Elias, bien qu’il ait combattu pour l’Allemagne pendant la Première Guerre, est obligé de s’exiler et ne peut soutenir sa thèse dans les débuts du nazisme. Cet exil le sauve, et ses parents publient la première partie du livre en allemand, tandis que lui s’est réfugié en Suisse puis en France, enfin en Angleterre. Il enseigne en Angleterre puis à Amsterdam, et retourne enseigner en Allemagne en 1975 ! Le livre est donc constitué, fait rare, de trois parties de cent pages chacune à peu près, conçues à des époques éloignées. La première partie qui constituait à l’origine une conclusion inédite de Sur le processus de civilisation, essai majeur de l’auteur publié en 1939, est complétée par une seconde partie écrite dans les années 1940 et 50, puis une 3e partie écrite en 1987. Ce processus lent d’écriture permet à l’auteur d’affiner ses idées et de tenir compte d’une part de la Seconde Guerre mondiale, qu’il ne pouvait qu’envisager dans la 1re partie, puis de la construction européenne et des institutions supra-nationales qui modifièrent le rapport entre individu et société durant tout le XXe siècle. La thèse principale de l’auteur est « de révoquer en doute une opposition donnée ou pensée comme évidente : celle qui sépare l’individu et la société » (avant-propos de Roger Chartier, p. 11). Cette thèse est liée à l’abandon par l’auteur de la philosophie pour la sociologie : « Cet abandon de la conception dominante de l’homme – de l’homme hermétiquement fermé au monde extérieur, de l’homo clausus – et ce passage à la conception opposée, la conception de l’individu fondamentalement en relation avec un monde, avec ce qui n’est pas lui-même ou elle-même, avec d’autres objets et en particulier avec d’autres hommes fut pour moi le résultat d’un long processus intimement lié à mon abandon de la philosophie » (p. 22).
Un des problèmes majeurs de la sociologie
Dans sa préface, Norbert Elias pose le problème : « Au cours de mon travail sur le précédent ouvrage, je voyais constamment resurgir le problème du rapport entre l’individu et la société. La marche de la civilisation s’est étendue sur des générations. Elle a été rendue tangible par les témoignages d’une modification des seuils de la pudeur et de la gêne » (p. 32). Il décide donc de retrancher cette partie de l’ouvrage de son livre paru en 1939. La publication de ce livre en trois étapes fait partie intégrante de son sujet, puisque la réflexion sur une société en mutation est elle-même en mutation. Le paragraphe de conclusion de la préface doit être cité intégralement : « Cette évolution trouve ici son expression dans la notion d’équilibre je-nous. Elle signifie que le rapport entre identité du je et identité du nous chez l’individu pris isolément n’est pas fixé une fois pour toutes, mais soumis à des variations spécifiques. Dans les petites tribus encore relativement primitives, ce rapport est autre que dans les grandes sociétés industrielles de notre temps, il est autre en temps de paix que dans les guerres contemporaines. Nous ouvrons ainsi la porte à une approche et à une analyse du problème du rapport de l’individu avec la société qui reste inaccessible tant que l’on se représente l’individu, et que l’on se définit par conséquent soi-même, comme un je sans nous » (p. 34).
Partie I : La Société des individus (1939)
La problématique est exprimée au début : « Qu’est-ce donc que la structure de cette « société » que nous constituons tous ensemble et que pourtant personne d’entre nous, ni nous tous réunis, n’avons voulue ni projetée telle qu’elle existe aujourd’hui, et qui n’existe pourtant que par la présence d’une multitude d’hommes et ne continue de fonctionner que parce qu’une multitude d’individus veulent et font quelque chose, mais dont la construction et les grandes transformations historiques ne dépendent cependant manifestement pas de la volonté des individus ? » (p. 37). Plusieurs métaphores filées sont utilisées successivement pour désigner le rapport entre société et individu : « Aristote recourt à un exemple simple, celui du rapport de la pierre à la maison. C’est effectivement une image facile pour montrer que de nombreux éléments isolés forment par leur réunion une unité dont la structure ne s’explique pas par les différents éléments. Car il est certain qu’on ne comprend pas la structure de toute la maison en considérant chacune des pierres qui ont servi à la construire isolément et pour soi ; on ne la comprend pas non plus si l’on considère par la pensée la maison comme une unité sommative, comme si c’était un tas de pierres ; il n’est peut-être pas tout à fait inutile pour la compréhension de l’ensemble de procéder à un relevé statistique de toutes les particularités des pierres pour établir ensuite la moyenne, mais cela non plus ne mène pas très loin ». Il allègue la « Gestalttheorie » et d’autres métaphores : « la mélodie qui ne se compose de rien d’autre que de ses différentes notes et représente pourtant autre chose que leur somme, ou encore le rapport des mots et des sons, de la phrase et des mots, du livre et des phrases » (p. 41-42). Conclusion : « L’interrogation débouche sur un débat dont les tiraillements ne nous sont que trop familiers. L’une des plus grandes polémiques de notre temps est la querelle entre ceux qui affirment que la société dans ses différentes manifestations, division du travail, système étatique ou quoi que ce soit d’autre, ne représente jamais qu’un « moyen » dont la « fin » serait le bien-être de chaque individu, et ceux qui affirment que l’individu est secondaire, que « le plus important », la véritable « fin » de la vie individuelle serait d’assurer la perpétuation de la collectivité sociale dont l’individu constitue l’une des parties. N’est-ce pas déjà prendre parti dans ce débat que commencer à chercher dans les relations telles que celles qui existent entre la pierre et la maison, entre les notes et la mélodie ou entre la partie et le tout, des illustrations et des références pour comprendre le rapport de l’individu avec la société ? » (p. 43). « Pour ceux qui raisonnent ainsi et ne voient littéralement plus la forêt à force de voir des arbres, la comparaison avec le rapport de la pierre à la maison et, d’une façon générale, de la partie au tout peut être d’une certaine utilité intellectuelle. Dire que les individus sont plus « importants » revient tout simplement, dans la bouche de ceux qui défendent cette opinion, à dire qu’ils accordent plus d’importance aux individus et moins d’importance au groupe formé par ces individus, la société. Dire qu’« en réalité » la société n’existe pas et qu’il n’existe qu’une multitude d’individus isolés signifie à peu près la même chose que prétendre qu’en réalité la maison n’existe pas, qu’il n’y a qu’un grand nombre de pierres, un tas de pierres » (p. 47).
Je cite dans la foulée une autre métaphore filée qui reprend cette idée : « Que l’on songe par exemple, pour appréhender cette forme de corrélation, à la structure dont est issue la notion d’entrecroisement, un système réticulaire. Un filet est fait de multiples fils reliés entre eux. Toutefois ni l’ensemble de ce réseau ni la forme qu’y prend chacun des différents fils ne s’expliquent à partir d’un seul de ces fils, ni de tous les différents fils en eux-mêmes ; ils s’expliquent uniquement par leur association, leur relation entre eux. Cette relation crée un champ de forces dont l’ordre se communique à chacun des fils, et se communique de façon plus ou moins différente selon la position et la fonction du fil dans l’ensemble du filet. La forme de chaque fil se modifie lorsque se modifient la tension et la structure de l’ensemble du réseau. Et pourtant ce filet n’est rien d’autre que la réunion de différents fils ; et en même temps chaque fil forme à l’intérieur de ce tout une unité en soi ; il y occupe une place particulière et prend une forme spécifique. […] C’est effectivement ainsi que l’individu issu d’un réseau de relations humaines qui existait avant lui s’inscrit dans un réseau de relations humaines qu’il contribue à former » (p. 71).
Cela amène un constat sur le statut existentiel de l’homme : « L’ordre invisible, l’ordre de cette vie sociale que l’on ne perçoit pas directement avec ses sens, n’offre à l’individu qu’une gamme très restreinte de comportements et de fonctions possibles. Il se trouve placé dès sa naissance dans un système de fonctionnement de structures très précises ; il doit s’y soumettre, s’y conformer et, le cas échéant, en poursuivre lui-même l’élaboration. Même ses possibilités de choix entre les fonctions existantes sont relativement limitées ; elles dépendent dans une large mesure de la place où il est né et où il grandit dans ce réseau humain, de la fonction et de la situation de ses parents, de l’éducation qu’il reçoit en conséquence. Et tout cela aussi, tout ce passé, est directement présent en chacun des êtres qui vont et viennent dans la foule des rues de la grande ville. Il se peut certes qu’un individu ne connaisse personne d’autre dans cette foule, mais quelque part il a lui aussi des connaissances, des amis intimes et des ennemis, une famille, un cercle de relations auquel il appartient, ou bien, désormais seul, il n’a que des amis perdus ou défunts qui ne sont restés vivants que dans sa mémoire.
Chacun des êtres qui se croisent ainsi dans la rue, apparemment étrangers et sans relations les uns avec les autres, est, ainsi, lié par une foule de chaînes invisibles à d’autres êtres, que ce soient par des liens de travail ou de propriété, des liens instinctifs ou affectifs. Des fonctions de l’ordre le plus divers le rendent, ou l’ont rendu, dépendant des autres et rendent, ou ont rendu, les autres dépendants de lui. Il vit et a vécu depuis sa plus petite enfance dans un réseau de dépendances qu’il ne peut rompre ni modifier d’un coup de baguette magique, qu’il peut uniquement changer dans la mesure où la structure même de ce réseau le permet ; il vit dans un tissu de relations fluctuantes qui entre-temps se sont, au moins partiellement, imprégnées en lui et font sa marque personnelle » […] « C’est de cette façon que chaque individu est tenu à l’action ; il y est tenu par le fait qu’il vit constamment dans un rapport de dépendance fonctionnelle avec d’autres individus ; il fait partie des chaînes que constituent les autres, et chacun des autres – directement ou indirectement – fait partie des chaînes qui le lient lui-même. Ces chaînes ne sont pas aussi visibles et tangibles que des chaînes de fer. Elles sont plus élastiques, plus variables et changeantes, mais elles n’en sont pas moins réelles et certainement pas moins solides. Et cet ensemble de fonctions que les hommes remplissent les uns par rapport aux autres est très précisément ce que nous appelons « la société ». C’est une sphère de l’être d’un genre particulier. Ses structures sont ce que nous appelons les « structures sociales ». Et lorsque nous parlons de « lois de fonctionnement des sociétés », nous ne voulons désigner rien d’autre que les lois spécifiques régissant les relations entre les individus » (p. 52).
Norbert Elias rectifie donc une erreur fréquente : « À demi consciemment, à demi inconsciemment, la plupart des hommes véhiculent avec eux jusqu’à ce jour un mythe original de la création : ils imaginent qu’au « commencement » il n’y eut d’abord qu’un individu au monde et que les autres ne se joignirent à lui qu’en un second temps » […] « On dirait que tous les adultes lorsqu’ils se penchent sur leur origine, oublient sans le vouloir que tous les adultes ont été des petits enfants quand ils sont venus au monde » (p. 57).
« Les différents individus peuvent être très différents les uns des autres par leur constitution naturelle à la naissance. Toutefois seule la société fait du petit enfant avec ses fonctions psychiques encore malléables et relativement indifférenciées un être distinct de tous les autres. C’est uniquement dans la relation avec les autres et par cette relation que la créature désemparée et sauvage qu’est l’être humain à sa naissance devient un être psychiquement adulte qui possède une personnalité individuelle et mérite le nom d’individu adulte. Coupé de ces relations, il devient au mieux une bête humaine à demi sauvage : il peut devenir physiquement adulte, mais il reste psychiquement semblable au petit enfant » (p. 58).
« […] ce que nous qualifions ici d’« interpénétration », voulant illustrer par là l’ensemble des rapports de l’individu à la société, ne s’expliquera jamais tant que l’on se représentera la « société » essentiellement comme une société d’adultes, d’individus achevés, qui n’ont jamais été des enfants et jamais ne mourront ; or c’est ainsi qu’on se la représente trop souvent aujourd’hui. Nous ne parvenons à une conception indiscutablement claire du rapport de l’individu et de la société qu’à partir du moment où l’on inclut dans la théorie de la société le processus d’individualisation, le devenir permanent des individus au sein de cette société. L’aspect historique de toute individualité, le processus de croissance et de maturation joue un rôle clef dans la recherche de définition de la « société ». La nature intégralement sociale de l’homme n’apparaît qu’à partir du moment où l’on mesure l’importance des relations avec les autres pour le jeune enfant.
L’enfant n’est pas seulement plus influençable que l’adulte, il a besoin de l’influence des autres, il a besoin de la société pour accéder à la maturité psychique » (p. 62-63). « Même Robinson porte la marque d’une certaine société, d’un certain peuple et d’une certaine catégorie sociale. Coupé de toute relation avec eux, perdu sur son île, il adopte des comportements, forme des souhaits et conçoit des projets conformes à leurs normes ; il adopte donc ses comportements, forme ses souhaits et conçoit ses projets tout autrement que Vendredi, même si sous la pression de la situation nouvelle, ils font tout pour s’adapter l’un à l’autre et se transforment mutuellement pour se rapprocher » (p. 64).
« C’est précisément parce que la commande des relations humaines s’est largement dégagée des rails de l’inné et des automatismes organiques que la voie est ouverte à un véritable jeu des mécanismes d’interaction sociale. Seule la relative libération de l’organisme de la contrainte des automatismes innés, seul le passage très progressif, et avec de multiples transitions, du stade de l’« inféodation à l’instinct » au stade de la commande « psychique » autonome du comportement vis-à-vis des autres, confère tout son poids à la loi résultant de l’indissociabilité et de l’interdépendance inéluctables des individus.
C’est justement parce que dans la forme des relations entre eux et avec le reste du monde, les hommes sont moins étroitement liés que les autres animaux à des schémas comportementaux prédéterminés organiquement qu’ils produisent à l’intérieur de l’interdépendance de leurs activités des lois et des structures de nature spécifique. Et c’est justement pourquoi se déclenchent dans le cadre de cette interdépendance des mécanismes de changement, des modifications historiques qui ne prennent pas leur source dans l’appareil réflexe inné, qui ne sont pas non plus voulus ni projetés – dans leur ensemble, tels qu’ils se déroulent réellement – par des individus isolés, et qui sont pourtant tout sauf fortuits ; c’est justement pourquoi se produisent avec l’inéluctable imbrication des actes, des besoins, des pensées et des instincts de multitudes d’hommes, des structures et des changements structurels allant dans le sens d’un ordre et d’une direction particuliers, qui ne sont ni « naturels et animaux », ni « spirituels », ni « rationnels », ni « irrationnels » – le sens d’un ordre social.
Ce caractère spécifique du psychisme humain, sa malléabilité, son besoin d’une empreinte sociale et son adaptation naturelle à cette empreinte expliquent finalement aussi que l’on ne puisse fonder sa réflexion sur l’individu isolé pour expliquer les structures respectives des relations des individus, des structures de leur société, et que l’on doive, à l’inverse, partir des structures respectives des relations entre les individus pour expliquer la structure du « psychisme » d’un individu isolé » (p. 78).
« Les hommes font partie d’un ordre naturel et ils font partie d’un ordre social. Les considérations qui précèdent ont montré comment était possible cette double appartenance. L’ordre social, pour si peu naturel qu’il soit au sens où peut l’être celui des organes à l’intérieur d’un corps, doit son existence même à une particularité de la nature humaine. Il doit son existence à la souplesse et à l’adaptabilité par lesquelles la commande du comportement humain se distingue de celle du comportement animal. Par son intermédiaire doit se constituer chez l’individu humain, uniquement à partir du moment où il vit en société et au travers de la société des autres, ce qui est en majeure partie donné par la nature chez l’animal : un schéma fixe de commande du comportement dans la relation avec les autres et avec les objets ; par son intermédiaire entrent en jeu dans l’imbrication des aspirations et des actes de nombreux individus des lois, des automatismes et des processus, que nous qualifions de « sociaux », à la différence des lois organiques naturelles. La levée de l’emprise de l’appareil réflexe sur la commande du comportement humain est elle-même le résultat d’un processus d’évolution naturelle. Mais grâce à elle interviennent dans la vie collective des individus des processus et des changements qui ne sont pas inscrits dans la nature de l’homme ; grâce à elle les groupes sociaux et les individus au sein de ces groupes ont une histoire qui ne relève pas de l’histoire naturelle. Ils forment, dans le cadre général de la nature, une continuité autonome de type spécifique » (p. 82).
« La situation reste fondamentalement assez simple, si complexes que puissent devenir la structure des fonctions sociales et par conséquent les tensions entre les différents groupes fonctionnels. Même dans les sociétés les plus primitives que nous connaissions, il existe une forme de répartition des fonctions entre les hommes. Plus cette répartition des fonctions a progressé à l’intérieur d’un groupe, plus les hommes en sont remis à un rapport d’échange, plus ils se sentent étroitement liés par le fait que chacun ne peut assurer sa subsistance et son existence sociale qu’en relation avec beaucoup d’autres. Lorsque, par l’exercice de la violence dont ils détiennent les instruments, les uns peuvent refuser aux autres ce dont ces derniers ont besoin pour assurer et accomplir leur existence sociale, lorsque les uns sont constamment en mesure de menacer, de soumettre et d’exploiter les autres, ou même lorsque la réalisation des objectifs des uns exige le déclin de l’existence sociale et physique des autres, il se produit dans le réseau d’individus interdépendants, entre les groupes de fonctions et les peuples, des tensions, certes de nature et d’intensité très variables, mais présentant à chaque fois une structure très claire et précisément définissable.
Ce sont les tensions de cet ordre qui, lorsqu’elles prennent une certaine intensité et une certaine forme, agissent dans le sens des modifications structurelles de la société. C’est grâce à elles qu’au sein de chaque groupe les formes de relation et les institutions ne se reproduisent pas toujours à peu près de la même façon de génération en génération. C’est grâce à elles que certaines formes de vie collective tendent toujours à se dépasser dans une certaine direction pour opérer des modifications spécifiques sans qu’intervienne pour autant aucun moteur extérieur » (p. 86).
Cela aboutit à une vision de l’histoire : « L’Histoire apparaît alors comme un de ces fleuves puissants qui roulent toujours leurs eaux dans une certaine direction, qui toujours se pressent vers la mer certes, mais n’ont pas encore un lit bien établi et bien tracé et qui coulent sur un vaste terrain où ils doivent encore chercher leur place, sur lequel, en d’autres termes, s’offrent encore à eux différentes possibilités d’établir leur lit dans la direction qui est la leur » (p. 89).
« Il n’est pas d’individu, quelles que soient l’envergure de sa personnalité, la puissance de sa volonté, la pénétration de son intelligence, qui puisse briser la loi du réseau humain dont son action est issue et où elle s’inscrit. Si forte que soit sa personnalité, aucun individu, fût-il à la tête d’un très grand empire féodal fondé sur la stricte économie naturelle, pour ne prendre qu’un exemple au hasard, ne peut surmonter, autrement que de façon passagère, la puissance des forces centrifuges inhérentes à ce système sur une pareille étendue ; il ne peut pas transformer d’un coup sa société en société absolutiste ou industrielle ; il n’est pas en mesure par la seule action de sa volonté d’instaurer la division du travail bien plus différenciée, la nouvelle structure de l’armée, la monétisation et la réforme totale des rapports de propriété qui seraient nécessaires pour que s’établissent des institutions centrales durables. Il est et reste lié aux lois des tensions entre serfs et seigneurs féodaux d’un côté, entre seigneurs féodaux rivaux et suzerains centraux de l’autre » (p. 92). On dirait que les « GAFA » ont donné tort à Norbert Elias sur ce point : le créateur de Facebook n’a-t-il pas « brisé la loi du réseau humain » par la « pénétration de son intelligence » ?
« Mais même si, là comme partout ailleurs dans le tissu social, une marge de liberté s’offrait et s’offre encore à la décision individuelle, il n’y a pas de formule générale permettant précisément de calculer pour toutes les phases de l’Histoire et pour tous les types de sociétés la largeur de la marge individuelle. Et le fait même que la nature et la largeur de la marge de décision offerte à l’individu dépendent de la constellation historique du groupe humain dans lequel il vit et agit est justement caractéristique de la position de l’individu au sein de la société. Aucun type de société n’exclut totalement ces marges individuelles » […] « Lorsque par exemple la puissance sociale des individus ou des groupes d’un même espace social est extrêmement inégale, lorsque des couches sociales très faibles et occupant par conséquent un rang très inférieur sans grande chance d’élévation dans l’échelle sociale sont liées à d’autres qui ont des chances incomparablement plus grandes d’accéder au pouvoir social et dont c’est le monopole, la marge de décision individuelle des représentants des catégories sociales les plus faibles est extrêmement restreinte ; les talents exceptionnels, les personnalités les plus fortement marquées chez les représentants de ces groupes les plus faibles ne peuvent pas se développer, ou ne le peuvent que dans une direction qui ne saurait être considérée que comme « asociale » du point de vue de la structure sociale existante. Ainsi pour les membres des catégories les plus faibles de la paysannerie, vivant au bord de la famine, l’abandon de leur terre et le passage à une existence de « brigands » représentent-ils souvent l’unique issue et en même temps le seul moyen de promotion, puisque la position dans la nouvelle catégorie, celle de chef de bande ou de « capitaine des brigands » est en l’occurrence la seule chance d’initiative personnelle un tant soit peu plus grande » (p. 93-95). Idée à appliquer sans doute au trafic du cannabis dans les cités…
« Ruse de la raison », c’est une expression tâtonnante, encore perdue dans un rêve éveillé, pour dire que la loi propre à l’entité à propos de laquelle un individu peut dire « nous » est plus puissante que le projet ou l’objectif que se fixe n’importe quel sujet isolé. L’interdépendance des besoins et des intentions d’une multitude d’individus soumet chacun d’entre eux à des effets inévitables qui n’étaient dans les intentions d’aucun d’entre eux. Les actes et les œuvres des individus pris dans la trame du tissu social revêtent constamment une allure imprévue. C’est pourquoi les hommes se trouvent constamment devant les résultats de leurs propres actes comme l’apprenti sorcier devant les génies qu’il invoque et dont il ne sait plus se rendre maître une fois qu’il les a invoqués : ils regardent avec étonnement les méandres et les dépôts du fleuve de l’Histoire qu’ils alimentent eux-mêmes sans savoir le maîtriser » (p. 106).
Partie II : Conscience de soi et image de l’homme (1940-50)
Nous passons à la 2e partie, écrite dans les années 1940 et 50. Le poids de l’Histoire, à laquelle l’auteur a échappé par miracle, imprègne la réflexion sociologique qui ne parvient pas à dominer le chaos : « Si nous avons tant de mal à faire abstraction des manifestations de notre trouble, de nos fantasmes de désir et d’angoisse, lorsque nous réfléchissons sur le problème de l’homme, n’est-ce pas parce que nous restons pris dans le cercle des dangers que les hommes font peser les uns sur les autres, sous une forme ou sous une autre, et parce que nous n’avons pas d’autre moyen de nous défendre de ces menaces, que nous n’avons pas d’autre moyen de nous rendre supportable notre propre impuissance devant la marche de l’histoire de l’humanité, constamment ponctuée de catastrophes, que de déguiser cette impuissance, ou de la chasser de la conscience ? » (p. 121). Conclusion : la solution fait partie du problème ! « Autrement dit, les sciences humaines et, d’une façon tout à fait générale, l’idée que les hommes se font d’eux-mêmes en tant qu’« individus » et en tant que « sociétés » sont déterminées dans leur forme actuelle par une situation où les hommes en tant qu’individus et en tant que sociétés font peser sur la vie les uns des autres des menaces et des angoisses largement incontrôlables ; et ces formes de connaissance et de réflexion sur l’homme contribuent à leur tour à la perpétuelle reproduction de ces menaces et de ces angoisses : elles font partie intégrante de la situation, non seulement parce qu’elles sont déterminées par elle mais parce qu’elles la déterminent.
Comme autrefois dans le domaine des phénomènes naturels, le degré d’insécurité, de menace et de vulnérabilité confère des fonctions spécifiques aux fantasmes collectifs et à des pratiques semi-magiques. Là encore ces fantasmes et ces pratiques aident les hommes à rendre plus supportable l’insécurité d’une situation qu’ils ne sont pas capables de maîtriser. Ils empêchent la pleine accession à la conscience de dangers face auxquels ils sont impuissants. Ce sont des armes offensives et défensives dans leur rapport les uns avec les autres. Elles renforcent la cohésion des groupes sociaux et donnent à leurs membres une illusion de pouvoir sur des événements qu’en réalité ils ne peuvent guère contrôler. Il est dangereux d’en dénoncer l’aspect fantasmatique, c’est du moins un acte ressenti comme dangereux voire hostile. C’est que l’efficacité sociale de ces éléments repose précisément sur le fait qu’ils ne sont pas considérés comme des fantasmes mais comme des idées objectives. Et comme ils ont un effet social dans la mesure où ce sont des fantasmes collectifs – à la différence des fantasmes purement personnels – ils constituent en même temps une part de la réalité sociale.
Ce que nous avons dit de la fonction sociale des représentations mythiques et des pratiques magiques à propos des phénomènes naturels vaut également pour leur fonction dans le cadre de la vie sociale. Là aussi, ces modes de pensée et de comportement affectifs contribuent à ce que restent tolérables les dangers et les angoisses qu’ils sont censés conjurer, et ils contribuent même peut-être simultanément à les renforcer. La conviction collective de leur objectivité leur confère une force et une résistance que l’on ne saurait ébranler par la contradiction qu’apportent les faits, pas plus que l’on ne peut ébranler ainsi les représentations magiques et mythiques des sociétés primitives.
Ainsi par exemple les idéologies nationales et la conviction générale de la valeur particulière, de la grandeur et de la supériorité de la tradition nationale qui s’y rattache, explicitement ou sans que ce soit dit, contribuent d’un côté à renforcer la cohésion entre les ressortissants d’un État et à leur faire serrer les rangs dès qu’un danger menace ; mais d’un autre côté, elles attisent l’ardeur des oppositions et des tensions entre les nations et entretiennent ou même aggravent les dangers contre lesquels les nations cherchent précisément à se protéger » (p. 125-126).
Norbert Elias pointe le fait que les concepts « individu », « société », « personne », « collectivité », constituent souvent comme des « formules magiques » dans le cadre de « doctrines » (p. 128).
L’analyse descend jusqu’à l’influence des changements de perception de la société en littérature : « Que l’on songe par exemple à l’évolution du roman depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Dans les œuvres en prose des siècles antérieurs – et cela ne vaut certainement pas uniquement pour les œuvres en prose – l’auteur se fixe essentiellement pour tâche de raconter au lecteur ce qu’ont fait des individus, ce qui s’est passé. Peu à peu l’auteur s’est attaché non seulement au récit de ce qui s’était passé, mais aussi à la façon dont les individus qui se trouvaient pris dans les événements avaient vécu ces événements » […] « Ces formes littéraires témoignent effectivement de la lente accession à un autre niveau de conscience que l’on observe dans toute une série de sociétés » (p. 147).
Une parabole explique la pensée du philosophe Hume sur la conscience de l’homme : « la parabole des statues pensantes : sur la berge d’un large fleuve, ou sur la pente abrupte d’une haute montagne se trouvent toute une série de statues. Ce sont des statues de marbre. Elles ne peuvent pas bouger leurs membres, mais elles ont des yeux et elles y voient. Peut-être ont-elles même des oreilles pour entendre. Et elles ont la faculté de penser. Elles ont de l’« entendement ». On admet qu’elles ne se voient pas les unes les autres, même si elles savent que d’autres existent. Chacune est pour soi. Chacune pour soi, isolément, perçoit qu’il se passe quelque chose de l’autre côté du fleuve ou du ravin, elle essaie de se représenter ce qui se passe et se demande dans quelle mesure ce qu’elle se représente correspond à ce qui se passe réellement. Certaines pensent que leur idée reflète tout simplement ce qui se passe de l’autre côté. D’autres pensent qu’une bonne part est le produit de leur propre pensée ; finalement on ne peut pas savoir ce qui se passe réellement de l’autre côté. Chaque statue se fait sa propre opinion. Tout ce qu’elle sait est issu de sa propre expérience. La statue est là où elle est, telle qu’elle a toujours été. Elle ne change pas. Elle y voit. Elle observe. De l’autre côté, il se passe quelque chose. Elle y réfléchit. Mais on ne peut pas savoir si le produit de sa réflexion correspond à ce qui se passe de l’autre côté. Elle n’a aucun moyen d’en obtenir la certitude. Elle ne peut pas bouger. Elle est isolée. Le ravin ou le fleuve est profond. Il y a donc un gouffre infranchissable » (p. 161). « L’image des statues pensantes laisse au moins deviner pourquoi l’idée que la conscience, les sentiments, l’entendement ou même le véritable « soi » auraient leur siège « à l’intérieur » de l’individu semble si convaincante, au moins aux représentants de certains groupes sociaux. On constate que l’on a affaire en l’occurrence à la perception d’individus à qui leur mode de vie collective et sociale et les formes d’éducation qui en résultent imposent un très haut degré de réserve dans l’action. Certes il y a dans toutes les sociétés, quelles que soient les formes qu’ils prennent, des éléments régulateurs du comportement. Mais dans beaucoup de sociétés occidentales, depuis quelques siècles, la régulation est particulièrement intensive, particulièrement diversifiée et omniprésente ; et le contrôle social est plus que jamais lié au contrôle de soi, à la répression que s’impose l’individu lui-même » (p. 162).
« Un filet aux mailles très fines s’étend uniformément non seulement sur certains domaines de l’existence humaine mais sur tous, ce sont autant de régulations qui sous une forme ou sous une autre – et trop souvent sous des formes contradictoires – sont inculquées par l’exemple, par la parole et par l’action des adultes à l’individu qui grandit. Ce qui était au départ une prescription sociale devient – pour commencer par l’intermédiaire des parents et des maîtres – finalement suivant l’expérience individuelle du sujet une « deuxième nature » : « Ne touche pas ça », « tiens-toi tranquille », « ne mange pas avec les doigts », « tu n’as pas de mouchoir ? », « ne te salis pas », « ne le bats pas », « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît », « tu ne peux pas attendre ? », « fais tes devoirs de calcul », « tu n’arriveras jamais à rien », « travailler, travailler, travailler », « penser avant d’agir », « pense à ta famille », « pense à ton travail », « pense au parti », « pense à l’Église », « pense à l’Allemagne », ou selon le cas à « la Russie, l’Angleterre, l’Inde, l’Amérique », « pense à Dieu », « tu n’as pas honte ? », « mais tu n’as donc pas de principes », « un homme sans aucune morale » (p. 163).
« un nombre de plus en plus important d’activités qui faisaient intervenir à l’origine l’individu tout entier avec tous ses membres se limitent aux yeux – même s’il est vrai que l’excès de cette restriction peut toujours être corrigé par exemple par la danse ou la pratique du sport. Au fur et à mesure que les mouvements du corps se restreignent, l’importance de la vision augmente : « tu peux regarder, mais n’y touche pas », « un joli corps », « s’il vous plaît pas trop près ». Ou en tout cas l’importance de la parole augmente : « on a quand même bien le droit de protester, si on n’a pas celui de frapper », « les mots ne font pas de mal », « ne pas en venir aux mains ». Les plaisirs des yeux et des oreilles deviennent toujours plus intenses, plus riches, plus subtils et plus répandus. Les plaisirs des membres sont de plus limités par des commandements et des interdits, et limités à des domaines restreints de l’existence. On perçoit beaucoup de choses sans bouger. On pense et l’on s’observe, sans se toucher. La parabole des statues pensantes est exagérée, mais elle exprime bien ce qu’elle était censée exprimer : les statues voient le monde et s’en donnent une représentation. Mais elles sont dans l’incapacité de bouger. Elles sont de marbre. Leurs yeux perçoivent la réalité, et elles peuvent se faire une idée de ce qu’elles perçoivent. Mais elles ne peuvent pas approcher les choses. Leurs jambes ne peuvent pas marcher, leurs mains ne peuvent rien attraper. Elles regardent de l’extérieur à l’intérieur d’un monde ou de l’intérieur vers l’extérieur – on peut l’exprimer de deux façons – un monde dont elles restent séparées » (p. 166).
« Ces relations, le mode de vie collective dans son ensemble évoluent de plus en plus vers un contrôle omniprésent de l’affectivité, vers la répression et la modification de l’instinct. Au cours de cette transformation sociale, les hommes sont de plus en plus portés à dissimuler au regard des autres, voire à se dissimuler à eux-mêmes, au point qu’ils n’en prennent généralement même plus conscience, des dispositions, des pulsions instinctives et des désirs qui pouvaient jadis s’exprimer ouvertement ou n’étaient contenus que par la peur des autres.
Ce qui se présente d’un côté comme un processus d’individualisation croissante est en même temps, de l’autre côté, un processus de civilisation. Et l’on peut considérer comme caractéristique d’une certaine phase de ce processus l’accentuation des tensions entre les contraintes que s’impose l’individu sous l’effet des commandements et des interdits sociaux et les impulsions spontanées qu’il réprime. C’est, comme nous l’avons dit, cette contradiction à l’intérieur de l’individu, cette « intériorisation », le fait que certaines sphères de la vie sont exclues du commerce social et entourées de sentiments d’angoisse, de pudeur et de gêne d’origine sociale, qui fait naître chez l’individu l’impression d’être « intérieurement » quelque chose pour soi tout seul, qui existerait sans rapport avec les autres, et n’entrerait en contact avec les autres, « à l’extérieur », qu’« a posteriori » » (p. 170).
Il existe des « enclaves réservées à la jeunesse » : « La marge de liberté qui lui est accordée en l’occurrence est sans rapport avec l’étroitesse, la régularité et la réglementation de la vie que connaîtra le plus souvent le jeune individu une fois adulte » (p. 172). L’adulte qui a dû faire des choix lors d’un « nombre extraordinaire d’embranchements » a parfois des regrets : « Maintenant, je suis parvenu à cette position, j’ai donné ceci ou cela aux autres, je suis devenu spécialiste de telle ou telle chose. Mais n’ai-je pas laissé s’étioler tous les autres talents qui m’étaient donnés ? N’ai-je pas laissé de côté beaucoup de choses que j’aurais voulu faire ? » (p. 180).
« Les sociétés plus primitives offrent moins de solutions, moins de possibilités de choix, une moindre connaissance des liens de corrélation entre les événements, elles font donc courir moins de risques de se trouver « raté » lorsqu’on considère rétrospectivement les choses. Dans les sociétés les plus primitives, l’homme n’a le plus souvent dès l’enfance qu’une seule voie, toute tracée – une pour les femmes, une autre pour les hommes ». Elias se livre alors à une évocation du type d’existence que peuvent avoir ces sociétés primitives : « On vit au jour le jour. On mange, on a faim, on danse, on meurt. Et la possibilité de laisser de côté quelque chose que l’on se sent poussé à faire hic et nunc au profit d’une satisfaction qui ne s’obtiendra que dans une semaine ou dans un an est tout aussi incompréhensible, de même que ce que nous appelons « le travail ». Pourquoi se livrerait-on à une dépense musculaire sans rapport à un besoin présent et immédiat ?
Ce mode d’existence a commandé la vie sociale des ancêtres de tous les êtres qui vivent aujourd’hui pendant une période bien plus longue que les formes de vie sociale dont nous avons gardé des témoignages écrits au cours de cette brève phase de l’évolution de l’humanité que nous dénommons l’« Histoire ». Même le temps où des groupes d’hommes commencèrent ici ou là à mettre régulièrement et intentionnellement dans la terre des graines et des plantes sauvages dans l’espoir d’en obtenir une nourriture qui ne viendrait que quelques mois plus tard, ou d’élever de petits animaux sauvages pour en tirer profit à l’avenir, ne remonte qu’à dix mille ans en arrière. Toutes les étapes importantes dans ce sens, que ce soit le passage des sociétés de cueillette aux sociétés d’agriculteurs sédentaires, des sociétés de chasseurs aux sociétés d’éleveurs, le passage de l’utilisation de la pierre ou de l’os aux métaux comme matière première pour la fabrication des outils et des armes avec tous les secrets de leur utilisation qui n’étaient accessibles qu’à des spécialistes, ou encore des milliers d’années plus tard la transformation des industries artisanales en industries mécanisées – l’orientation générale de ces transformations et de tant d’autres du même ordre resta à certains égards identique au travers de millénaires.
Chacune d’elle supposait et produisait à son tour un développement de la prévision à long terme. Le délai entre le premier pas vers un certain objectif et le dernier, celui de la réalisation où l’on accédait au but, se prolongeait de plus en plus en même temps que se multipliaient les étapes intermédiaires. Ce délai était encore relativement bref au sein des groupes humains où les adultes se livraient eux-mêmes – et le plus souvent ensemble – à toutes les activités nécessaires à la satisfaction des besoins sous la forme usuelle dans leur société ; ils possédaient toutes les techniques requises, que ce fût pour le travail de la pierre ou de l’os, pour tirer du sol leur nourriture, construire un abri contre le vent, faire jaillir de la pierre ou du bois l’étincelle d’un feu. Peu à peu le délai augmenta. Les instruments furent mieux adaptés à leur utilisation ; le nombre d’outils spécialisés augmenta et avec eux la multiplicité des techniques. La comparaison des outils qui nous restent du premier âge de la pierre taillée avec ceux de la période moyenne ou de la fin de l’âge de la pierre offre une très bonne illustration de cette différenciation, qui se produisit du reste bien plus lentement que la différenciation, et la spécialisation des outils et des techniques dans les sociétés industrielles de notre temps. Il serait difficile de dire à quel moment, au cours de des cinq cent mille années – à moins que ce n’ait été six cent ou sept cent mille – où tel type de pierre était considéré comme la matière première la plus noble pour la fabrication des outils et où tous les adultes maîtrisaient encore toutes les techniques pratiquées dans leur société, des spécialistes de certaines techniques se détachèrent des autres.
Quoi qu’il en soit, au fil du temps, non seulement entre la première et la dernière d’une série d’actions les étapes intermédiaires se multiplièrent, mais il fallut aussi un nombre d’hommes de plus en plus important pour assurer toutes ces étapes. Et dans leur déroulement un nombre d’hommes de plus en plus important se trouvèrent dépendre les uns des autres, comme liés par d’invisibles chaînes. Chacun était un maillon, un spécialiste avec une fonction bien délimitée ; il était pris dans un tissu d’actions au sein duquel entre la première démarche vers un objectif social donné et l’accession à cet objectif s’intercalaient un nombre croissant de fonctions spécifiques et d’hommes possédant les techniques qui permettaient d’assurer ces fonctions » (p. 182).
Ce passage assez long que j’ai voulu reproduire me fait penser à la page fameuse du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de Rousseau : « Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu’ils se bornèrent à coudre leurs habits de peaux avec des épines ou des arêtes, à se parer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou à embellir leurs arcs et leurs flèches, à tailler avec des pierres tranchantes quelques canots de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de musique, en un mot tant qu’ils ne s’appliquèrent qu’à des ouvrages qu’un seul pouvait faire, et qu’à des arts qui n’avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux ».
La civilisation peut aussi bien régresser selon Elias : « La structure spécifique de comportement que nous avons coutume de qualifier de « civilisé » ou « individualisé » peut à nouveau faire place à des formes de comportement et de perception soumises à des pulsions animales à plus court terme » (p. 184).
« Progressivement, la part de contrôle individuel dans l’adaptation aux autres et à leurs activités devint de plus en plus importante et alla de soi. L’utilisation de plus en plus répandue de pendules et de montres en fut un signe, pour ne citer qu’un exemple. En effet, quelle que puisse être leur importance en tant qu’instruments de mesure d’un phénomène naturel extérieur à l’homme, dans l’utilisation quotidienne qu’en fait une société, ce sont avant tout des instruments de coordination à distance des activités d’une multitude d’individus, tous capables d’un assez haut degré de contrôle de soi » (p. 187).
« À la satisfaction qu’apporte à un nombre relativement réduit d’individus l’accession à un tel objectif, la réussite dans la lutte de rivalité entre les individus et surtout la réalisation de quelque chose d’inhabituel qui précisément sort de l’ordinaire, s’oppose, ressentie plus ou moins confusément, l’insatisfaction d’un nombre bien plus grand d’individus qui, dans les concours éliminatoires à plus ou moins grande échelle, ne réalisent pas de performances suffisantes à leurs propres yeux, qui en vieillissant demeurent en deçà de leurs propres aspirations et des espoirs qu’ils avaient fondés sur leur propre vie dans leur jeunesse. Et au sentiment de l’accomplissement, d’un côté, s’opposent bien souvent, de l’autre, des sentiments d’inaccomplissement, d’ennui, de vide, d’abattement et de culpabilité, voire d’absurdité de l’existence en général » (p. 197).
Partie III : Les transformations de l’équilibre « nous-je » (1987)
« Les langues de l’Antiquité n’avaient donc pas d’équivalent de la notion d’« individu ». […] Alors que les connotations négatives du terme grec idiotes permettent de se faire une idée de ce que pensaient les Grecs de l’époque classique de quelqu’un qui se tenait en dehors des affaires publiques de l’État. Parmi les nuances que recouvre cette notion on trouve aussi bien des sens correspondants à peu près à ce que serait aujourd’hui la « personne privée » ou le « profane » que des significations comme l’« original », l’« être inculte » ou le « fou ».
Le terme latin persona pourrait être considéré comme équivalent au vocable moderne « individu ». Mais ce terme latin est loin de posséder le même degré de généralité, de se situer au même niveau de synthèse que les notions actuelles de personne et d’individu. Le terme persona se rapportait encore à quelque chose de tout à fait spécifique et tangible. Il désignait pour commencer le masque à travers lequel les acteurs déclamaient leur texte. Quelques spécialistes tendent à penser que le mot persona viendrait du verbe personare, en quelque sorte « résonner à travers quelque chose ». C’est fort possible, mais ce n’est qu’une hypothèse. À partir de la donnée concrète du masque se développèrent ensuite d’autres sens, persona désignant par exemple aussi le rôle d’un acteur ou le caractère du personnage qu’il jouait. Mais, dans l’Antiquité, la notion de persona reste limitée à ce degré de spécificité assez grande, elle reste, par rapport à ce qu’est aujourd’hui la notion de personne, à un assez faible degré de généralité.
Le terme individuum lui-même est inconnu du latin classique. Bien sûr, les Romains de l’Antiquité savaient, aussi bien sans doute que tous les autres hommes, que chaque personne humaine a ses particularités. Il savaient que Brutus était différent de César, d’Octave et d’Antoine, et savaient aussi en quoi. Mais dans leur société, et plus particulièrement dans les classes d’où était issue la langue, surtout chez les représentants de la langue écrite, on ne ressentait manifestement pas le besoin d’une notion globale et universelle exprimant que chaque homme, quel que fût le groupe auquel il appartînt, constituait une personne indépendante, unique, différente de tous les autres hommes, et qui rendît compte en même temps de l’extrême valeur accordée à cette unicité. L’identité collective de l’individu, son identité du nous, du vous, du ils ou elles, jouaient dans la pratique des sociétés antiques un rôle encore bien trop important par rapport à celui de l’identité du je pour qu’ait pu se manifester ce besoin d’un concept universel désignant la personne humaine en tant qu’être quasiment détaché de tout groupe » (p. 210-211).
L’emploi du terme individuus comme symbole d’une unité insécable entraîna sans doute dans la communication entre érudits de l’époque une poursuite de l’évolution qui nous a amenés à la notion moderne de l’« individu ». Le terme individuum était employé en logique formelle pour exprimer le cas particulier, le représentant d’une espèce, et non pas uniquement de l’espèce humaine, mais de toutes les espèces. Mais de l’observation d’un cas particulier on ne peut rien déduire. Les individua étaient donc considérés comme imprécis et vagues. […] Le concept médiéval d’individuum ne s’appliquait en aucune façon spécifiquement à l’homme. Il lui fut seulement appliqué à une étape ultérieure de son élaboration, au XVIIe siècle ; on assista à la re-spécialisation d’un concept qui avait été utilisé précédemment sur un mode universel en logique et en grammaire. Les philosophes de l’Église avaient bien vu que toute chose en ce monde était unique à un certain égard et constituait donc un individuum (p. 213-4).
Norbert Elias souligne alors l’impuissance croissante de l’individu face au développement d’États planétaires, et sa responsabilité d’intellectuel. « Certains de mes lecteurs souhaiteraient peut-être ne voir évoqués ici que des aspects positifs et réjouissants de l’évolution de l’humanité. Mais une telle sélection correspondrait très exactement à ce qu’il faut entendre par la trahison des clercs. On peut se féliciter ou non de l’intégration croissante de l’humanité. Mais une chose est certaine, c’est qu’elle commence par renforcer l’impuissance de l’individu face à ce qui se déroule au niveau supérieur de l’humanité » (p. 220). Pour réfléchir à cet état ultime, il revient à l’état le plus ancien des sociétés humaines : « Pour trouver la clé de ce problème, il est indispensable de retrouver le mode de vie sociale de nos ancêtres lointains qui étaient biologiquement identiques à nous, mais vivaient encore pratiquement sans protection, sans maisons, sans colonies de peuplement fixes qu’ils auraient eux-mêmes fondées, dans un perpétuel combat de survie avec d’autres créatures, créatures qui étaient leurs proies ou dont ils risquaient d’être les proies. Il n’est pas inutile d’essayer de se représenter la vie de groupes d’hommes qui s’abritaient dans des cavernes naturelles et nous ont laissé dans certaines de ces cavernes, en particulier en Dordogne, de grandes peintures d’animaux qui ont l’air tout à fait vivants. Je sais bien que l’on ne s’identifie généralement pas avec ces hommes. Des expressions comme « l’homme des cavernes », « l’homme de l’âge de pierre », « le primitif » ou encore « le sauvage » montrent bien la distance que l’on établit artificiellement entre soi-même et ces autres hommes et le mépris non négligeable avec lequel on considère habituellement, du haut d’un savoir étendu et de la domination qu’il permet d’exercer sur eux, la plupart des représentants de ces stades anciens qui vivent encore aujourd’hui. […].
Ces groupes qui trouvaient refuge de façon plus ou moins continue au creux d’une falaise ou, lorsqu’il y en avait, au fond d’une caverne qui les protégeait de la pluie, du vent et des animaux sauvages, étaient sans doute des groupes de parenté ne dépassant pas vingt-cinq à cinquante membres. Peut-être existait-il déjà des formes d’organisation permettant de faire vivre ensemble pendant une assez longue période une centaine d’individus. En tout cas, ces effectifs traduisent un état de choses qui a son importance pour la compréhension du rapport entre individu et société. Dans ce monde où le rapport de forces entre les groupes humains et les représentants bien plus nombreux de la nature extérieure à l’homme n’était pas encore équilibré, où le rapport de forces entre créatures humaines et autres créatures n’avait pas encore aussi résolument penché en faveur de l’homme qu’il le fit par la suite avec les groupes humains occupant des habitations et des colonies sédentaires qu’ils avaient eux-mêmes fondées, le groupe revêtait pour l’individu une fonction protectrice absolument indispensable en même temps qu’indéniable. Dans un monde où les hommes étaient perpétuellement soumis à la menace d’animaux physiquement plus puissants et parfois même plus rapides et plus agiles, un individu seul entièrement remis à lui-même n’aurait guère eu de chances de survie.
Comme chez beaucoup de singes anthropoïdes, la vie collective revêtait donc aussi chez l’homme une indispensable fonction de survie. Les représentants de notre espèce vécurent dans cette situation, dans cette dépendance élémentaire de l’organisation collective, pendant une période bien plus étendue que celle à laquelle nous donnons le nom d’Histoire : on est peut-être en dessous de la vérité en l’estimant à quarante mille ou cinquante mille ans, soit une période de toute façon dix fois plus longue que le temps historique » (p. 224-5).
Voici des réflexions utiles sur le tabou attaché à la notion de pays sous-développés : « Ainsi s’interdit-on par exemple de parler de pays « sous-développés » pour ne pas offenser leurs ressortissants, et emploie-t-on à la place la notion hypocrite et vague de « pays en voie de développement » – comme si les pays plus développés n’étaient pas pris eux aussi dans un processus d’évolution et n’étaient donc pas eux aussi des pays en voie de développement. Mais ce n’est pas une façon d’aider à la poursuite de l’évolution des pays sous-développés que de soustraire au débat public les structures qui en sont caractéristiques et par là même les problèmes du passage d’un stade à l’autre. […]
Dans les pays relativement moins développés, le rapport de l’individu à la famille, à la communauté et à l’État est généralement très spécifiquement différent de ce même rapport dans les pays développés. Dans les premiers, l’individu est normalement plus étroitement lié à sa famille, qui prend dans la plupart des cas la forme d’une famille très étendue, et à son village ou à sa ville natale. Dans la plupart de ces pays, même si ce n’est pas vrai pour tous, l’État représente un niveau d’intégration comparativement récent La famille étendue et le village natal sont les anciens foyers de l’identité personnelle du « nous » chez les membres de ces sociétés.
Si l’on considère le rapport entre identité du je et identité du nous, on pourrait dire que les deux existent dans tous les pays, développés et moins développés, mais alors que dans les premiers l’accent est mis plutôt sur l’identité du je, dans les pays moins développés il est mis sur l’identité préétatique du nous, que ce soit celle de la famille, du village natal ou de la tribu. Chez les représentants des générations anciennes, dans les pays qui ont accédé à l’indépendance à une date assez récente, l’identité du nous relative à l’État ne bénéficie guère d’une appréciation positive. Chez les représentants des générations plus jeunes, les choses sont en train de changer, sans que disparaisse pour autant le lien affectif très fort avec la famille, le clan, le lieu de naissance ou la tribu. […]
On peut aussi illustrer la modification de l’identité du nous qui se produit lors du passage d’un stade d’évolution à l’autre par un conflit d’engagement moral. La conscience morale traditionnelle, l’éthique traditionnellement propre à l’attachement à ces unités de survie qu’étaient la famille, ou le clan – bref, le cercle de la parentèle plus ou moins étendue – veulent qu’un membre du groupe plus riche ou mieux placé ne refuse pas son aide à un parent, même éloigné, lorsque celui-ci le sollicite. Les fonctionnaires les plus haut placés des États nouvellement indépendants ont donc du mal à refuser leur soutien à des parents, dès lors que ceux-ci cherchent à obtenir un des emplois officiels tant convoités, même si c’est à un niveau très bas. Du point de vue de l’éthique et de la conscience morale des pays développés, la faveur accordée à des parents pour la nomination à des postes officiels dans le domaine de compétence d’un haut fonctionnaire est une forme de corruption. Du point de vue de la conscience morale des sociétés pré-étatiques, c’est un devoir et aussi longtemps que chacun le fait, dans les luttes de pouvoir et de rivalité traditionnelles entre les clans, une nécessité. Le passage à un autre niveau d’intégration provoque donc des conflits d’engagement moral et des conflits de conscience qui sont en même temps des conflits de l’identité personnelle ». Norbert Elias en vient à avertir les chercheurs eux-mêmes de la nécessité de se détacher d’évidences liées à la société dans laquelle ils vivent. Conclusion : « Le sous-entendu fréquent selon lequel il serait méprisant de parler de « pays sous-développés » est tout à fait erroné. En vérité, c’est tout le contraire. C’est adopter une attitude de mépris que de ne pas parler de ces pays de cette façon et se barrer ainsi l’accès à la structure du changement que connaissent ces groupes humains en tant que sociétés et en tant qu’individus au cours du passage d’un stade d’évolution à l’autre » (pp. 234-6).
Norbert Elias remarque dans la suite de cette troisième partie l’importance du visage comme moyen de communication dans les sociétés humaines : « Nous ne savons pas non plus quels facteurs récurrents ont œuvré au fil des millions d’années pour conférer à l’homme les dispositions biologiques d’une configuration physionomique hautement individualisée avec un appareil de muscles peauciers de la face extrêmement modelable qui prend des formes différentes en fonction de l’expérience individuelle. […] De tous les êtres vivants connus jusqu’à ce jour, les hommes sont […] la seule espèce connue dont une partie du corps est susceptible de prendre une forme si individuellement distincte qu’elle suffit à différencier des centaines d’individus pendant une longue durée et sur toute une vie, et de les identifier en tant que tels » (p. 251). Trente ans après ce texte, on peut se demander si par exemple les logiciels de reconnaissance du visage ne seraient pas capables de distinguer des têtes animales autres qu’humaines ? En tout cas voici pour l’année 2018-19, un point commun avec le thème du corps. L’auteur fixe alors un objectif aux chercheurs : « On peut laisser au XXIe siècle – avec alors, il faut l’espérer, la participation de tous les habitants de tous les continents – le soin de trouver une réponse satisfaisante à la question de savoir dans quelles conditions un processus d’évolution naturelle non programmé a pu produire entre des êtres vivants une forme de communication aussi unique que la langue propre à un groupe social donné et, en étroite relation avec ce processus, une telle diversité et une telle malléabilité des parties des yeux, du nez et de la bouche que, surtout à l’intérieur d’un même groupe, un simple coup d’œil suffit pour identifier un individu comme une personne bien déterminée, différente de toutes les autres et présentant des traits de caractère qui lui sont propres » (p. 253). Je n’avais jamais trouvé exprimée cette idée que parfois j’ai eu honte de ressentir, par exemple face à une foule de Chinois ou de Somaliens, la difficulté de les reconnaître seulement au visage, c’est-à-dire s’ils ne présentent pas de différences visibles de corps, de vêtement ou d’âge. Il m’est souvent arrivé de confondre dans une classe des étudiants de même origine, pour peu qu’ils se ressemblent, ce qui parfois les vexe, mais heureusement, il m’arrive aussi de confondre des blancs…
Les dernières pages constituent une sorte de conclusion : « Le fait que beaucoup de relations au nous qui revêtaient à des stades antérieurs le caractère d’une contrainte extérieure à vie et inamovible aient perdu de leur permanence fait ressortir plus fortement le je, autrement dit sa propre personne, comme le seul élément permanent, la seule personne avec laquelle on soit tenu de vivre jusqu’à sa mort. On le voit très clairement si on passe d’un niveau d’intégration à l’autre. Beaucoup de relations familiales qui revêtaient jadis pour la plupart des individus un caractère obligatoire, définitif, et constituaient une contrainte extérieure prennent de plus en plus aujourd’hui l’aspect de relations délibérément choisies et révocables, qui sollicitent davantage les capacités de contrôle individuel du comportement et les capacités de contrainte que l’individu exerce sur lui-même, et ce pour les deux sexes également » (p. 264).
« On pourrait dire que les princes et la noblesse considéraient pratiquement l’État comme leur appartenant en propre, une unité du nous limitée à eux-mêmes, tandis que le reste de la population se composait d’individus avec lesquels on ne s’identifiait pas. Eux seuls constituaient l’État parce qu’ils étaient les autorités en place. La masse de la population n’était jamais perçue que comme « eux », une masse de marginaux. Encore sur la fin du XIXe siècle et même au début du XXe des secteurs entiers de la population, pour commencer les paysans, puis essentiellement la masse ouvrière de l’industrie, étaient exclus par les classes dirigeantes de la bourgeoisie et de la noblesse de l’identité du nous des citoyens nationaux. Et ces exclus étaient toujours dans le cas de considérer l’État comme quelque chose dont on disait « eux » et non pas, ou guère, « nous » » (p. 269).
Dans une longue note se trouve une analyse sur la question de l’immigration : « Certains représentants de la deuxième génération d’immigrants restent pour l’essentiel à l’intérieur de leur groupe d’origine, qui est en même temps le groupe de leurs parents et de la parentèle. Le détachement des immigrants de leur groupe d’origine à la deuxième, si ce n’est à la troisième génération pose quelques problèmes, ne serait-ce que parce que les dispositions d’accueil et en dernier ressort, la capacité d’accueil des ressortissants traditionnels du pays d’immigration sont limitées – ce pays étant devenu en même temps, il faut le préciser, le pays de naissance et la patrie des immigrants de la deuxième ou troisième génération. Les difficultés et les conflits ne surgissent pas seulement très régulièrement dans les rapports de ces générations avec les ressortissants du pays d’accueil, ils surgissent aussi très fréquemment à l’intérieur du groupe d’immigrés et surtout des familles d’immigrés. Le problème du comportement sexuel des jeunes filles est un exemple des plus frappants à cet égard » (p. 279). Il évoque aussi rapidement avec quelques exemples la subsistance de « nombreux groupes témoins d’un stade d’évolution préétatique, qui continuent d’exister dans le cadre d’une société étatique ». Les exemples sont les « Hutterer » du Canada (voir sur Wikipédia Huttérisme), moins connus que les mormons, mais aussi la mafia américaine.
C’est ainsi que ce termine notre pêche dans cet essai fort riche retraçant une vie entière de chercheur inscrite dans un siècle de bouleversements.
Voir en ligne : Article de Wikipédia sur le livre
© altersexualite.com 2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com