Accueil > Classiques > XXe et XXIe siècles > Clochemerle, de Gabriel Chevallier
De la vie sexuelle des blédards, pour lycéens et adultes
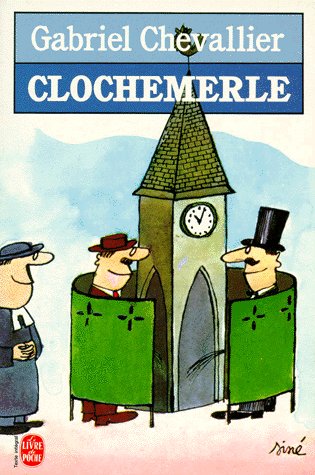 Clochemerle, de Gabriel Chevallier
Clochemerle, de Gabriel Chevallier
Le Livre de Poche, 1934, 440 p.
samedi 11 avril 2015
Tout le monde connaît l’expression Clochemerle, passée dans le langage courant pour désigner un village ou une petite ville agité par des querelles insolubles et des cancans. Le roman dont le titre est passé dans le langage courant est moins connu dans notre génération, alors qu’il avait bénéficié d’un succès énorme à sa parution en 1934. Plus fiers que les habitants de la ville de Tulle où se passe l’histoire du Corbeau de Clouzot, les habitants de Vaux-en-Beaujolais ont revendiqué avoir nourri l’inspiration de l’auteur de Clochemerle. Pourtant, le nombre de Clochemerlins affiché dans le roman, 2800, ne correspond pas au nombre d’habitants du Vaux de l’époque, 800. Si le ton de ce roman choral est acerbe, dénonçant sans retenue la nullité et l’arrivisme des politiques, des religieux et des militaires, avec une digression finale sur la guerre de 14-18, la sexualité extra-conjugale, et donc quelque peu altersexuelle, tient une place de choix dans l’œuvre, même si on ne sort jamais du cadre étroit de l’hétérosexualité. Cela m’a donc donné envie de consacrer un article à ce classique, suivi de quelques mots sur l’adaptation de Pierre Chenal en 1947.
Un monde né d’une pissotière
Il est rare qu’un roman trouve son origine dans une pissotière, eh bien c’est le cas de Clochemerle. Le maire de Clochemerle-en-Beaujolais, Barthélémy Piéchut, radical et propriétaire des plus belles pentes viticoles du village, fomente avec l’instituteur Ernest Tafardel, la construction d’un urinoir, pour moderniser la commune, lequel édicule sera édifié à côté de l’église, non pas pour choquer, mais parce que c’est le centre du village, construit sur un plan linéaire. Le jour de l’inauguration, le poète Bernard Samothrace déclame quelques alexandrins, qui laissent froid l’ancien ministre Bourdillat, fils du pays, parfait exemple de parvenu : « En fait de vers, dit-il, je ne connais bien que les vers de terre » (p. 102 ; bon extrait à lire à des élèves en marge d’un cours sur la métrique). L’urinoir donne satisfaction à la gent masculine, pour diverses raisons, déjà parce qu’en traversant la rue depuis l’auberge Torbayon, on peut « jeter en passant un coup d’œil sur Judith Toumignon », la plus belle femme du village après l’Adèle Torbayon, et qu’en s’y rendant par deux, puisqu’il y a deux places, on peut « éprouver ces deux grands biens inséparables : boire bien à sa soif et uriner ensuite jusqu’à la dernière goutte, en prenant son temps, dans un lieu frais, bien aéré, lavé jour et nuit à grande eau » (p. 117). Le problème ne vient pas de l’église ou du curé, qui se satisferait plutôt qu’on ne pisse plus contre son mur, mais de la vieille fille Justine Putet, qui se délecte derrière son rideau du spectacle de ces hommes qui se rebraguettent devant les petites enfants de Marie qui passent juste devant à ce moment-là. Comme les hommes se rendent compte de son manège, ils s’amusent à la provoquer par « les dernières indécences » (p. 134) exécutées en bande sous ses fenêtres. La vieille fille s’en vient trouver le maire, en vain hélas, mais la guerre est déclarée alors entre les « urinophiles » et les « urinophobes » (p. 146). La guerre va battre son plein jusqu’à remonter au ministère, grâce aux appuis des uns et des autres, et le roman est surtout prétexte à évoquer des personnalités locales hautes en couleur. Tafardel se lance dans des attaques lyriques contre les urinophobes : « La lumière s’étend, le progrès marche irrésistiblement, le peuple pissera désormais dans des édifices appropriés, je tiens à vous l’affirmer. L’urine humectera l’ardoise et coulera dans des canalisations, monsieur ! » (p. 243). L’histoire se terminera par la folie érotique de Justine Putet, s’exhibant nue dans l’église. Son portrait n’est guère affriolant : « Des côtes en cercle de tonneau, une poitrine comme de la vieille chaussette, pareillement vide et pendante, un ventre pointu et râpeux, qu’avait jamais servi qu’à faire de la digestion » (p. 397).
Les trognes de Clochemerle
Le curé Ponosse est un bon gros curé bien débonnaire, qui en vient à se taper sa bonne Honorine, qui lui apprend qu’elle soulageait aussi son prédécesseur de ses envies impies. Il se confesse à son camarade de séminaire, qui en fait autant dans un village voisin, jusqu’à ce que l’âge lui en ôte l’envie, au grand dam d’Honorine.
Judith Toumignon est la plus belle femme du village, qui tient avec son mari les Galeries Beaujolaises, et inspire à l’auteur un portrait dithyrambique : « Les destins malicieux l’avaient placée au centre du bourg, en situation de commerçante au bon accueil, ce qui n’était qu’insuffisante apparence car son rôle principal, occulte mais profondément humain, était celui d’initiatrice aux transports amoureux. Encore qu’elle fût pour son compte agissante, et qu’elle y allât de bon cœur, sa participation à la somme des étreintes clochemerliennes doit être tenue pour peu de chose, comparativement à la fonction allégorique et suggestive qu’elle assumait dans le pays. Cette radieuse, cette flambante était torche, vestale opulente et prêchant d’exemple, chargée par une divinité païenne d’entretenir à Clochemerle la flamme génésique » (p. 57). Elle trompe son mari avec Hippolyte Foncimagne, greffier qui loge en face, à l’auberge Torbayon. Elle parvient à manipuler les dénonciations pour faire croire à son mari que ce ne sont que calomnies, et celui-ci défie les jaloux en invitant l’Hippolyte autant qu’il veut dans son magasin !
Son mari François Toumignon obtient le titre de « Premier Biberon » de Clochemerle (p. 179), c’est-à-dire celui qui torche le plus de verres de vin en une nuit, ce qui lui travaille la cirrhose. Cette distinction est attribuée le 16 août à la fête de Saint-Roch, patron de Clochemerle, qui est d’autre part l’occasion d’un échangisme généralisé : « les Clochemerlins séparés de leur femme s’occupaient de celle des autres, ce qui fait que tout allait par deux, d’une manière peut-être un peu fantaisiste, mais qui ne laissait rien désirer quant à la symétrie » (p. 180). C’est dans un état d’ébriété avancé que le François s’en prend à Nicolas, le Suisse de l’église, au moment même où le curé Ponosse, aiguillonné par la Justine Putet, s’était enfin résolu à prêcher contre l’urinoir.
Nicolas a brigué ce statut à cause d’« une parfaite réussite corporelle, dont il était redevable au mystérieux travail de la nature dans ses membres inférieurs » (p. 192). Malgré sa puissance, il ne parvient pas à venir à bout de l’ivrogne, et se fait attaquer violemment sa virilité, qui enfle et devient le grand souci des femmes du bourg.
Poilphard le pharmacien est veuf, et courtisé par toutes les vieilles filles et les veuves, qui tâchent de lui faire des allusions lorsqu’elles viennent se fournir à la pharmacie. S’il reste de glace c’est qu’il satisfait une paraphilie particulière pour les femmes qu’il installe dans un scénario mortuaire. Il jouit en voyant une femme couchée sur un lit, recouverte d’un suaire. Il se rend chaque semaine à Lyon et paie une jeune femme pour renouveler ce scénario. Un beau jour, il fait subir les derniers outrages nécrophiles à une des vieilles filles de Clochemerle venue le relancer dans sa boutique, à qui il administre un somnifère. S’ensuit un scandale public, et le pharmacien est soigné en asile, guéri, puis doit s’exiler.
Claudius Brodequin est un fils de vigneron qui fait son service, et a engrossé la Rose Bivaque, une de ces enfants de Marie, en la forçant un peu. Il doit l’épouser pour étouffer le scandale, et cela arrange les affaires de son père, qui espère en profiter pour arracher au père Bivaque une terre qu’il guignait depuis longtemps : « Le rôle des garçons est de faire fauter les filles : à elles de se garder » (p. 168). Sa mère veut juste savoir la vérité : « Est-ce que te l’as biquée ? — Je l’ai ben un peu biquée, ce printemps… » (p. 166). La Rose est raide dingue de son Claudius. Celui-ci fréquente une fois par semaine les prostituées de la garnison, mais il est pris de tendresse pour les filles de Clochemerle, « qui ne sont pas des traînées, des rien-du-tout, des lève-la-cuisse et des fout-la-vérole » (p. 153). Claudius a été initié par l’Adèle : « Adèle Torbayon a joué un rôle secret, le rôle que peut assigner un garçon de dix-huit ans à une femme qui a passé la trentaine, et dont les avantages naturels, abondants, sont des points de repère qui ne laissent pas la rêverie s’égarer dans des voies stériles » (p. 154). Ils se marieront, et dans l’épilogue, Rose sera une épouse comblée.
Adèle Torbayon est l’aubergiste, initiatrice des puceaux, mais à part ça relativement fidèle jusqu’à son aventure avec Hippolyte. Pour faire marcher le commerce elle « a été amenée à moins s’inquiéter de ce qui se passe du côté pile de sa personne », lorsque une immigrée s’est installée à l’autre bout du village et s’est laissée palper à pleines mains : « Une seule fesse de l’Adèle, ça fait largement les deux de la Marie-salope du haut bourg, et les fins connaisseurs restent fidèles aux appas de l’Adèle, bien que le pelotage n’aille jamais jusqu’à lui manquer de respect » (p. 157). Lorsque Foncimagne est cloué au lit, elle lui apporte sa médication, et arrive ce que doit, elle pique son amant à la Judith. Cela dure longtemps, jusqu’à l’arrivée des soldats, qui fait changer le dévolu de l’infidèle. Une lettre de dénonciation de la Putet précipitera le dénouement, car l’Arthur Torbayon, qui n’avait pas vu l’évidence, sera furieux de la découvrir soudain, et fera un scandale qui, par ricochet, fera un mort, l’innocent du village, et des blessés. Vision de l’Adèle dans ces entrefaites : « Rien que l’idée de trouver du nouveau, des fois pas grand-chose, attendu que ça change guère au fond, ça nous tourneboule, je dis pour nous, les hommes, parce que pour les femmes, c’est différent. Tant qu’on leur donne leur content, elles sont pas curieuses de ce côté-là. Mais c’est rare qu’elles aient tout leur content, à la longue, et ça leur travaille la caboche sans arrêt, parce qu’elles ont rien de plus important à penser, si on veut bien réfléchir. C’était comme ça pour l’Adèle, bien sûr. Voilà une belle jument qu’avait jamais eu d’avoine et qui se met à s’en goinfrer, et qu’on laisse sans, ensuite » (p. 360). Ce chapitre est dévolu au garde champêtre Beausoleil, dont le point de vue est très connoté ; par exemple il se livre à une sorte d’éloge du viol : « Les femmes – les vraies, je dis bien – elles ont toutes plus ou moins rêvé de gueuler d’épouvante devant un beau gars qui leur ferait tout voir sans façon, à l’improviste, parce que l’épouvante leur met le ventre en bonnes dispositions » (p. 361). Sa philosophie est frappée au coin du bon sens : « Le plaisir qu’on prend avec les derrières, c’est peut-être bien le premier plaisir sur la terre, et le bon Dieu n’avait qu’à s’arranger de façon que le meilleur plaisir ne se prenne pas par là, pas vrai ? » (p. 379).
Noémie Piéchut, la femme du maire, a droit à un portrait éloquent : « Autre avantage de la Noémie : elle n’a aucune jalousie. C’est une femme qui se désintéresse absolument de la question du lit, si importante souvent dans les ménages. Au lit, elle ne s’y est jamais amusée. Dans les premiers temps de son mariage, naturellement, elle a voulu savoir. Curiosité d’abord, vanité ensuite, puis avarice, comme toujours dans son cas. Ayant épousé, riche, Barthélémy Piéchut, qui n’avait pour biens que son physique de grand beau garçon et sa renommée d’homme capable, elle ne voulait pas être roulée. Mais elle dut convenir que Barthélémy était régulier en affaires. Il l’avait prise pour ses sous, chose probable, mais il en donnait pour l’argent, surtout dans les débuts. En quoi il avait du mérite, car Noémie, ne prenant pas d’agrément à la chose, n’en procurait pas non plus. Pourtant elle se crut, pendant quelques années, obligée de toucher exactement ce revenu de sa dot. Jusqu’au jour où, ses deux enfants nés, le Gustave et la Francine Piéchut, elle engagea Barthélémy à la laisser bien tranquille désormais » (p. 221). Elle persiste pourtant à faire lit commun, pour l’entretenir de projets, et aussi par économie de chauffage !
Le sénateur Prosper Louèche, dont Piéchut guigne la place, est un amateur de fillettes, et ce n’est pas un cas isolé au Parlement, ce qui nous vaut des pages au vitriol : « Le vieillard s’intéresse aux fillettes d’une façon très bienveillante qui ne peut cependant se dire philanthropique. On doit périodiquement l’enfermer dans une maison de santé, afin de le soustraire à des courroux indignés et à des demandes d’argent compensatrices, pour de jeunes mineures, de l’ignorance que leur ont fait perdre des exhibitions clandestines, d’ailleurs purement spectaculaires » (p. 223). Il décédera au bordel, et les journaux embelliront l’affaire : « Ce grand travailleur est mort à la tâche, alors qu’il étudiait très avant dans la nuit un dossier traitant de questions sociales » (p. 406), ce qui entraîne la réaction suivante : « Le fameux dossier […] c’était la jeune Riri ».
Les Girodot sont la famille bourgeoise type du notaire. Les amours ancillaires de celui-ci pour les beaux nichons de sa bonne Maria Fouillavet sont contrariées par le fait que le fils Raoul s’en déniaise aussi bien (p. 280). La belle Hortense, fille du notaire, se laisse enlever en moto par un apprenti poète, qui l’emmène à Paris. Dans l’épilogue, le Raoul entretient une fille qui, reconnaissant dans le père de son Jules un ancien amant, saura exploiter sa volonté de discrétion jusqu’au dernier sou. Le père Girodot décède d’apoplexie, en s’exclamant : « La salope m’a pompé ! » (p. 426).
La baronne de Courtebiche, retirée des affaires, a été une fière luronne. Elle tient son rôle d’aristocrate, méprise les croquants ainsi que son genre Saint-Choul, tellement nul qu’elle espère en faire un député de leur république. C’est elle qui arrangera les affaires de la petite Bivaque, en se remémorant sa folle jeunesse.
Petitbidois est un personnage secondaire, mais doté d’un portrait propre. C’est le sous-sous-chef de bureau du ministère de l’intérieur, qui devra prendre une décision au nom du ministre, au sujet de Clochemerle. Il souffre d’un complexe d’infériorité : « la nudité de Petitbidois eût fait sourire les dames, toujours portées à s’assurer au premier coup d’œil du sort qui les attend » (p. 328). Du coup, il décide d’envoyer la gendarmerie à Clochemerle. Ces pages constituent une longue digression permettant à l’auteur se régler quelques comptes, notamment avec les militaires, puisqu’il finit par faire intervenir l’armée à Clochemerle, avec un parfait couillon parvenu à un poste d’officier. Un retour en arrière permet de montrer ce personnage qui a gagné ses galons grâce à l’alcoolisme, qui lui a permis d’avoir à son corps défendant un comportement héroïque (cf. p. 351). Gabriel Chevallier avait déjà exprimé dans La Peur sa vision dépourvue de tout héroïsme de la guerre de 14-18. « Ce qui fait que le gain de la bataille fut disputé en pleine forêt par deux troupes de fous furieux, stupéfaits d’épouvante, qui ne savaient pas du tout ce qu’ils étaient venus faire là, et qui se battaient comme des sauvages, hurlant, tirant, courant, piquant, assassinant au petit bonheur, avec un bien sincère désir de foutre le camp à toutes jambes, une révoltante envie de ne pas crever tout de suite, et la conviction qui commençait à se faire jour en eux que les grands capitaines de toutes les armées du monde sont certainement les plus beaux fumiers de la création, et qu’ils auraient éprouvé une bien grande volupté, eux combattants, à leur casser la gueule aux grands capitaines, à la leur casser avec raffinements, oui vraiment, à leur enfoncer leurs testicules tranchées (sic) dans la bouche, en suprême hostie, plutôt que de casser la gueule à ces pauvres cons d’ennemis qui faisait (sic) comme eux cet invraisemblable métier d’il-y-a-pas-de-bon-Dieu, qui consistait à venir se faire découdre la paillasse, à s’arracher les intestins du ventre, à semer son foie, sa rate, son cœur, son gésier et jusqu’à ses couilles au beau milieu de la campagne, et à se dire, avec une dernière gargouillade de l’âme, que des dégueulasses, occupés à se gorger de belles putains bien cochonnes et de mangeailles ragoûtantes, et d’honneurs, de compliments d’admiration, nom de Dieu ! que ces dégueulasses abrités, ces sadiques, ces patriotards à bénéfice avaient monté cette sacrée vacherie d’apocalypse de merde pour avoir meilleure part, tandis qu’il y avait sous le soleil encore plein de poissons dans les rivières, plein d’oiseaux dans les arbres et de lièvres dans les sillons, plein de grains en terre et de fruits aux branches, plein de pays quasi vides et partout plein de femmes toutes moites de désirs solitaires qui manquaient d’un beau mâle à s’envoyer, alors qu’on saignait les plus beaux mâles comme des porcs. Voilà ce qu’ils auraient pensé, ceux de la forêt, s’ils n’avaient été follement fous aux dernières limites de l’inconcevable, ou morts. Et ces derniers n’avaient plus besoin de rien, que d’un peu de terre sur le ventre, non pas tant pour eux, qui s’en foutaient totalement et bien éternellement d’être ou non sépulturés, que pour les vivants, qui ne voulaient tout de même pas se laisser emboucaner par les macchabs » (p. 345).
Le film de Pierre Chenal
Gabriel Chevallier mouille sa chemise pour l’adaptation de Pierre Chenal sortie en 1948. Il signe le dialogue, et fait la voix du narrateur. Les aspects les plus provocateurs sont gommés, la pédophilie du sénateur par exemple, mais l’adaptation est extrêmement fidèle, et fort plaisante. On goûte la prestation de Jean-Roger Caussimon en Bernard Samothrace, dont le rôle est fondu avec celui de l’amant de l’Hortense Girodot. Le film étant tourné en studio, on change le plan du bourg, qui au lieu de linéaire, s’arrondit. Le film s’ouvre et se ferme sur un théâtre de guignol, bonne idée qui donne le ton.
– Il semble qu’on puisse visionner le film ici.
– Voir une entrevue de Gabriel Chevallier en 1963, pour la publication de Clochemerle-les-Bains, seconde suite à son succès, après Clochemerle-Babylone en 1954. L’Envers de Clochemerle suivra en 1966.
– Pour un Ponosse moins caricatural, voir les amours tragiques du jeune abbé Serge dans La Faute de l’abbé Mouret de Zola.
– Du même auteur, lire La Peur (1930).
Voir en ligne : Le site de Clochemerle
© altersexualite.com 2014
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com