Accueil > Livres pour les jeunes et les « Isidor » HomoEdu > Théâtre, Poésie & Chanson > Bucolique, Élégiaque, de Robert Vigneau
Aussi essentiel que la bénédiction du Gange
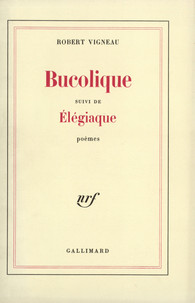 Bucolique, Élégiaque, de Robert Vigneau
Bucolique, Élégiaque, de Robert Vigneau
À lire et relire à chaque deuil
mercredi 31 mai 2017
Lors de mon voyage en Inde de 2003, je n’avais pas encore fait la connaissance de Robert Vigneau. Dans les premiers jours de ce nouveau voyage en 2017, j’ai été saisi d’une bête culpabilité d’avoir abandonné à Paris ma « MAV » Catherine, avec son crabe qui la ronge à nouveau et aux dernières nouvelles s’agitait fort. Le spectacle de la mort étant omniprésent en Inde, je ruminais ces idées noires, et me maudissais de ne pas avoir glissé dans ma valise Bucolique, suivi de Élégiaque, recueil de deux poèmes que Robert Vigneau composa en 1974 et 1976 et publia en 1979 sur son expérience indienne et la mort de son père, (Gallimard, 56 p.). Je finis par retrouver le moral grâce aux mots de Loti, Moravia et Pasolini sur Bénarès notamment, puis me trouvai dans un état d’esprit étrange, proche de leur expérience, par cet apprivoisement de la mort qui s’offre à vous sur les ghats de Varanasi. Au point que sur la barque qui nous ramenait à notre point d’embarquement, comme le guide proposa à nos camarades fumeurs une cigarette indienne, j’en pris une et la fumai, première (et seule) cigarette de ma vie ! Comme je m’étonnais de ne pas m’étouffer en fumant comme lors de mes autres tentatives, on m’expliqua que ce n’était pas une vraie cigarette, pas du tabac… Je me précipitai donc dès mon retour sur ces poèmes de la mort et de l’Inde, dont les titres nous plongent à l’origine même de l’acte poétique. Le vers n’est-il pas le sillon que le bœuf trace en boustrophédon sur la tablette d’argile ?
Bucolique (1974)
« L’avion soudain chute vers la mer
J’ai vu monter la mort
Ultime instant étrangement tranquille
Pensée peuplée de vaches
Vaches de ma vie soudain levées de la mémoire
L’avion s’est redressé
Sursis.
Sursis de vivre pour chanter ce soir ces vaches mêlées en moi. »
Ainsi commence ce 1er poème, méditation sur l’Inde sans doute plus proche de celle de Moravia et de Pasolini que l’Inde désemmisérisée d’aujourd’hui. Méditation sur la mort, qu’il m’amuse de retrouver si proche de celle de Gilgamesh dans la version d’un autre Robert Silverberg, que le hasard me donne à lire aussi à mon retour. Gilgamesh qui renonce à sa longue quête de l’immortalité après la mort de son ami Enkidou.
« Regrets et rebuts
où l’âme se blesse
mourir est le but
de toute sagesse. »
Le texte prend des allures de pantoum pour évoquer la vache vue comme un fossile :
« Comme la vie continue
depuis les prairies fossiles !
Je te sens, vache, tendue
d’une inquiétude immobile
à l’affût des grands voraces
surgis des géologies »
La vache libre de l’Inde s’oppose aux « bestiaux brevetés » des abattoirs, qui détruisent même la ponctuation :
« Cellule. Étable-prison. Impossible marcher. mangeoire devant. tapis roulant derrière. hygiène. évacuation des déchets. lampe infrarouge. tourteau. farine de poisson. soja. tourteau. manger. chier. manger. beaucoup. encore. chier moins. hormones. piqûres. grossir. encore. 80. 100. 120 kilos. encore. 150. bizenès. encore. »
Hugo est trait d’un de ses traits pour satiriser l’époque :
« Quel dieu quel garçon laitier de l’éternel été
a jeté du nescouic dans le champ des étoiles
pour y tracer la voie lactée
sans aviser l’Aménagement du Territoire ? » [1]
L’urine et la bouse sont célébrées, ainsi que les cendres des morts dont se vêtent les ascètes du Gange :
« Aussi nous soit très sainte de la bouse la cendre
blanche fille de la vache et du feu, artisans des civilisations.
J’ai vu autour de moi des fronts, des cous et des poitrines
marqués de signes cinéraires. »

On rêve à des vaches envahissant Paris, plus pacifiques que les loups de Reggiani :
« Beaux bœufs blancs sans étable paissant aux Tuileries
ils sortiraient par la Concorde écartant le flot des bagnoles
nouveaux moïses de la mer mécanique aux embruns de pétrole. »
Des souvenirs d’enfance remémorent les trains roulant « des hommes vers des fours en Allemagne ». C’est que le poète logeait dans une gare dont son père était chef. Le poème se referme sur des évocations mythologiques du taureau fécondateur :
« Il est couché sur le flanc de la planète le fauve cornu de la grande destruction
Ses testicules reposent sur des volcans
Sous lui il sent la terre chaude et molle et soumise comme une nouvelle épouse
Il en jouit, il la pénètre
Son membre creuse un sillon vierge
et lui, lance sa semence au sein des sols »

Élégiaque (1976)
« Il fait si froid dans l’univers
Je sens de profonds courants d’air
— « Ton père à minuit s’est éteint.
Enterrement Aubert lundi. »
Le télégramme du matin
T’agenouille ici mercredi. »
Ainsi commence Élégiaque, par l’annonce de la mort du père, « Paysan du siècle, une vie à labourer l’Europe dans les sillons des gares », dont le poète expatrié rate les funérailles. Il le « ressuscite » donc dans ses vers, labour pour labour, comme poignées de terre jetées au vent : « Mon père unique, homme de peu de conséquence / 1905-1976 ». Les octosyllabes disent la vie ordinaire dont on ignore tout : « Je ne sais rien de toi, mon père / Bon époux, bon père et le reste », et les versets tentent de saisir l’indicible, à travers des associations d’idées :
« Mélancolique réseau des quatre dimensions effleurées au sitar à travers les années en un geste des doigts
Car je regarde maintenant un très vieux professeur de musique
Ses doigts bondissent sur les cordes du même galop que le vent sur les rails
Les quarts-de-note dérivent en aiguillages ferroviaires
Et me font surgir des express fendeurs d’espace »
Les souvenirs surgissent, aussi frêles que « l’aimable cristal [qui] tintait dans les placards sous la ruée des rapides ». De l’incongru d’hier surgit l’inattendue nostalgie :
« Aurore sur les lavabos :
Il s’y débouchait les naseaux
En coryziens cocoricos.
Son nez lui faisait des problèmes. […]
Ces bruits m’agaçaient. J’avais tort.
Maintenant je trouve ça beau. »
Et le regret de n’avoir pas assez aimé, ou trop haï un père trop ordinaire :
« Car j’avais tort, mon cher Laïos ferroviaire,
Toi qui prenais l’existence, oh ! l’existence à plein nez
Les jours au sérieux gagne-petit
Une poignée de terre sur tes narines pour le malheur que je t’ai apporté
Et de la boue sur mon âme
Pour les regrets jamais murmurés devant tes genoux vifs. […]
Me pardonneras-tu d’avoir désespéré
Que tu ne sois Zorro mais un homme ordinaire
Quelque innocent héros d’heures supplémentaires […]
Les mots d’amour meurtri à l’âge dit ingrat
« Famille je vous hais » de la littérature
Ousqu’on cause pas de fin de mois. »
Un épisode trivial prend des allures de geste héroïque :
« Un coup de poing il nasarda
Un seul coup de poing dans sa vie
Mais cet uppercut assouvit
Son héroïsme de soldat
Sur la gueule d’un sous-off. »
Le poète regrette les rites funéraires anthropophages de l’Inde :
« Peuples nus et gourmands qui mangiez vos ancêtres
En l’orgie de leur chair savouriez leur force et goûtiez vos craintives tendresses
Je vous envie, j’envie vos cuisines de funérailles
Moi l’enfant des tribus civilisées
Je n’accorde pas à mon père le linceul des épices ni l’appétit de mes dents ni le tombeau de mon ventre
Moi des civilisations
Je jette mon père à manger aux vers à la vermine aux pourritures
Mon père ne se lèvera pas en moi au battement du balafon
Ni son père jamais dévoré ni le père de son père ni notre entier totem d’ancêtres ni dévorés ni debout sur mes jambes vivantes.
Je ne les porterai jamais en mes boyaux comme des enfants de vigueur
Je ne leur donnerai pas mes pieds pour danser ressuscités aux batteries de mon sang dansant »

À ce cannibalisme funéraire fait écho une scène clé du film de John Boorman, La Forêt d’émeraude. Décimés par une razzia de la tribu des Féroces, ce qu’il reste des Invisibles, menés par Tomme, alias Tommy, le fils de l’ingénieur, incinèrent leurs morts sur un bûcher semblable à ceux du Gange, puis déterrent une urne en bois anthropomorphe, contenant des cendres de leurs ancêtres depuis la nuit des temps (photo ci-dessus). Ils y ajoutent une poignée des cendres des morts du jour, puis prélèvent une poignée de l’urne, la mélangent à une boisson dans un bol de bois, et chaque membre du cercle des guerriers en avale une gorgée, avant de repartir au combat. Réécriture de La Prisonnière du désert de John Ford, ce film, avec cette scène, rétablit le chaînon manquant entre les trois peuples différents qu’on appelle « Indiens » par le monde. Voir la fiche pédagogique sur le site Transmettre le cinéma. Le déterrement des morts ainsi que le thème de la construction d’un barrage en opposition à un mode de vie primitif fait écho à Délivrance (1972).
Il termine sur ses « propres enfants », qui ne seront jamais ses « tombeaux pleins de rires ». Le petit-fils Pierre, distingué par le grand-père, permet une fin en rime masculine sur une féminine :
« Dont les joues gonflées perpétuent
Le souffle ouvrier qui s’est tu. »
En 2019, Robert Vigneau publie Calendriers, recueil de 30 poèmes de 12 quatrains qu’il avait pris l’habitude d’envoyer à ses relations pour la nouvelle année. Le dernier de ces Calendriers revient, au quatrain du mois d’août, sur les funérailles du père :
« J’ai regretté de n’avoir pas
mangé mon père en funérailles
Déméritais-je ce repas
qui m’aurait offert ses entrailles ?
Voir un autre extrait des Calendriers dans cet article.
– Quelques semaines après mon retour m’est donné à lire Winter is coming, de Pierre Jourde (Gallimard, 2017), dont le sujet est à l’inverse, une élégie d’un père sur son enfant mort, d’autant plus émouvante que l’enfant meurt à vingt ans, plein de promesses évanouies. Une phrase de ce livre pourrait fournir un beau sujet de bac : « Mais les larmes versées sur la fiction n’insultent-elles pas celles qui coulent pour la réalité ? »
– De Robert Vigneau, lire Planches d’anatomie et Une Vendange d’innocents. Lire aussi L’Inde sans les Anglais, de Pierre Loti (1903) ; Une Certaine idée de l’Inde, d’Alberto Moravia, et L’Odeur de l’Inde, de Pier Paolo Pasolini.
Voir en ligne : Site de Robert Vigneau
© altersexualite.com 2017. Reproduction interdite.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] On aura reconnu la dernière strophe de Booz endormi.
 altersexualite.com
altersexualite.com