Accueil > Cours & documents pédagogiques > Leçons de linguistique 1943-1944 série A, Esquisse d’une grammaire descriptive (...)
Fiche de lecture, maîtrise de langue française
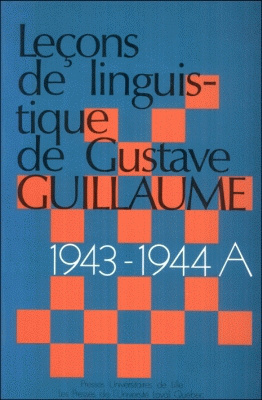 Leçons de linguistique 1943-1944 série A, Esquisse d’une grammaire descriptive de la langue française II, de Gustave Guillaume
Leçons de linguistique 1943-1944 série A, Esquisse d’une grammaire descriptive de la langue française II, de Gustave Guillaume
Librairie A.-G. Nizet, 1971, 379 p., épuisé.
mercredi 25 avril 2018
Au fond de mes tiroirs dormait cette fiche de lecture réalisée dans le cadre du séminaire de langue française que je suivais pour une maîtrise en 1997. Voir l’article Étude sur les périphrases verbales de la langue française, de Georges Gougenheim.
« Ainsi, impossible d’imaginer notation plus ténue, plus insignifiante que celle du « temps qu’il fait » (qu’il faisait) ; et pourtant, l’autre jour, lisant, essayant de lire Amiel, irritation de ce que l’éditeur, vertueux (encore un qui forclôt le plaisir), ait cru bien faire en supprimant de ce Journal les détails quotidiens, le temps qu’il faisait sur les bords du lac de Genève, pour ne garder que d’insipides considérations morales : c’est pourtant ce temps qui n’aurait pas vieilli, non la philosophie d’Amiel. »
Roland Barthes, Le Plaisir du texte.
Fiche de lecture sur Leçons de linguistique 1943-1944 série A, Esquisse d’une grammaire descriptive de la langue française II, de Gustave Guillaume (1883-1960).
1. D’une leçon à sa publication.
Pourquoi cette citation de Roland Barthes en tête d’une fiche de lecture sur les leçons de linguistique de Gustave Guillaume de l’année 1943-1944 ? Qu’il s’agisse d’un roman ou d’un ouvrage didactique, on ne peut faire l’économie d’une inscription de l’œuvre dans le temps, fût-il objectif ou subjectif. Il peut paraître surprenant que ces années d’Occupation aient laissé se développer à Paris des occupations si abstraites que celles de la haute linguistique enseignée à l’École Pratique des Hautes Études par Gustave Guillaume. Comme l’époque actuelle semble éloignée de ces préoccupations de haute volée ! Et pourtant, à une époque où les temps paraissaient si fermés, de même que les salles de cinéma ne désemplissaient pas pour la projection de films résolument tournés vers les époques passées pour détourner la censure, peut-être était-ce une juste consolation que de philosopher sur l’architectonique des temps et la façon dont le sujet peut inscrire son activité dans un temps qui s’ouvre devant lui.
Sans vouloir critiquer les dix personnes, pas moins, nommées en avant-propos, grâce auxquelles nous avons la chance de disposer d’une édition des manuscrits de ces leçons fondatrices — fruit d’une collaboration des Presses Universitaires de Lille en France et de Laval, au Canada — les lecteurs que nous sommes avant tout regretteront que les 44 pages de tables analytiques qui suivent et redoublent les leçons n’aient pas été remplacées par quelques souvenirs et considérations de témoins survivants de ces leçons sur la performance de l’auteur et la réception du public. D’autant plus que ces tables font doublon avec un excellent index exhaustif. Cependant ces indications que je regrette figurent peut-être dans un autre des 10 volumes de leçons précédents.
Les rares traces de l’époque qui subsistent dans les Leçons acquièrent donc d’autant plus d’importance. Je n’en ai relevé que trois : un passage raturé signalé page 63, faisant un éloge peu opportun d’une subtilité de la langue allemande, une allusion à un ancien élève étranger « au temps où il y avait des étrangers à la Sorbonne et aux hautes études » (p. 225), un exemple portant sur la nourriture : « une phrase qui a je ne sais quelle allure de gens bien nourris. On ne doit plus l’entendre très souvent dans les temps actuels. » ; par contre, p. 66, une liste des vues doctrinales basées sur le suffixe -isme, ignore le nazisme dans l’énumération du socialisme, du catholicisme ou du communisme.
Ce qui intéresserait l’étudiant de la fin du XXe siècle, c’est de savoir comment se déroulait un cours à l’École Pratique des Hautes Études il y a cinquante ans : s’agissait-il d’une lecture ex-cathedra de feuillets intégralement rédigés, comme certains professeurs le pratiquent encore à Paris IV, et quelle part y était faite à l’improvisation, à la réaction de l’auditoire, et au « temps qu’il fait » pour reprendre le propos de Roland Barthes. Ainsi, quand le cours commençait un 11 novembre, jour évidemment non férié sous l’occupation, quelle était la part d’émotion circulant entre la salle et la chaire ? De même lorsque le cours finissait le 15 juin, juste après le débarquement de Normandie et le massacre d’Oradour, avec cette promesse :
« J’aime à penser que nous nous retrouverons ici en novembre prochain, et c’est en caressant cette idée agréable que je vais travailler pour vous et pour moi pendant ces vacances. » On se doute que le public avait en tête d’autres idées non moins agréables, et que l’ambiance aura eu changé fortement en un été. Bref, autant que certaines considérations forcément vieillies — non pas comme celles d’Amiel par caducité, mais pour avoir été depuis intégrées dans la linguistique française, une fois émondées de l’aspérité propre à la pensée en train de se créer — on aimerait avoir une description de « la matérialité même du cela a été » pour citer encore la même page de Barthes, savoir par exemple si déjà à l’époque, les étudiants parisiens étaient atteints de cet étrange stoatropisme qui les fait dans une salle de cours aux trois quarts vide s’agglutiner près de la porte et du couloir, obligeant les retardataires à se faufiler bruyamment vers les fenêtres, comme s’ils fuyaient la lumière ou craignaient, au cas où le cours serait mauvais, de ne pouvoir s’éclipser les premiers ?
2. Méthode du professeur Guillaume.
C’est la première fois dans ma carrière d’étudiant que j’ai l’occasion de me plonger directement dans un texte de Guillaume, et pourtant il est peu de grammairiens que j’aie entendu plus souvent invoquer par tel ou tel professeur ou maître de conférences. Bien sûr ce décalage est avant tout imputable à la position défavorable des études de langue dans un cursus littéraire, comme en témoigne le faible coefficient de l’épreuve de grammaire à l’agrégation de lettres modernes, mais aussi à la particularité de Gustave Guillaume, qui n’a guère publié que deux ouvrages théoriques : Le Problème de l’article et sa solution dans la langue française en 1919 et Temps et Verbe en 1929, suivi de L’Architectonique du temps dans les langues classiques, en 1945, qui doit beaucoup aux Leçons. Lui-même s’en explique dans la leçon du 18 novembre, où il conclut ainsi sa propre bibliographie : « Tels sont nos travaux imprimés. Ce n’est pas là tout ce que j’ai fait, et le meilleur, certainement, je l’ai donné ici dans les années précédentes sous une forme non définitive, mais peut-être plus vivante, car on y surprenait mieux le jeu de ma pensée en face des difficultés affrontées avec une témérité qui ne m’a jamais desservi. » En effet, tout au long de cette année le lecteur voit se développer et s’affiner non seulement une pensée mais aussi une langue particulière, sans cesse reprise et redéfinie, appuyée sur les années précédentes mais aussi en attente d’évolutions postérieures signalées par les éditeurs en notes. Guillaume proposait deux séries de cours, puis trois. La série A était consacrée à « une connaissance de ce qu’est systématiquement la langue française » (p.1), et la série B à des questions de linguistique comparée.
3. Synopsis de la série de cours.
Le programme de l’année est copieux, et souffre, comme tout enseignement de haut niveau, d’une hypertrophie des préliminaires et d’une atrophie accélérée de la fin, qui se répercute d’ailleurs sur l’année suivante. Ainsi les premières leçons sont-elles consacrées à une théorie fort complexe de la structure du mot français en linguistique comparée, débouchant sur une étude de la notion de personne, laquelle introduit enfin le panorama complet de l’architectonique du temps, ou représentation spatialisée du temps, dont la fin est quelque peu précipitée. À plusieurs reprises Guillaume proclame qu’il « en a terminé » avec telle ou telle question, sans que cela l’empêche d’y revenir encore et encore (ex. p. 106, à propos de la personne, puis p. 125 à propos de la nature du temps linguistique).
Cette allure précipitée de la fin est inhérente à la méthode avouée de Guillaume, méthode déductive exposée au cours de la première leçon du 11 novembre. Pour lui, la linguistique souffre d’un excès de positivisme qui risquerait à terme de la réduire à « un catalogue de faits dont il serait impossible d’embrasser le mécanisme d’ensemble ». Le problème est que le linguiste opère sur un terrain mouvant : « la variation intrinsèque du système accroît la difficulté d’une exacte observation ». Le problème se résout si l’on considère que « l’objet à observer n’est plus un système, mais une consécution systématique de systèmes ». Et Guillaume de prôner « la réflexion abstraite prenant ou non la forme mathématique ». Ce n’est donc qu’après de longues pages de théories sur les faits de langue souvent difficiles à démêler pour des étudiants peu habitués aux ouvrages fondamentaux de linguistique, que Guillaume passe à des aperçus désormais limpides sur les faits de langage ou de discours, appuyés sur des exemples frappants. On peut d’autre part observer à l’œuvre une pédagogie du ressassement systématisée par Guillaume, qui consacre une part importante de chaque leçon à résumer et reformuler, de façon souvent éclairante, la ou les leçons précédentes. Cette pédagogie va de pair avec un appel fréquent à la réalisation d’une grammaire descriptive élémentaire du français, qui rectifierait nombre d’erreurs de la grammaire traditionnellement enseignée.
4. Glossaire des notions fondamentales utilisées durant l’année de cours.
— Sémantèse
C’est l’opération de création du mot. En français, elle comprend deux phases génétiques, une phase de particularisation croissante (déductive) logée dans la première partie du mot (base), et une phase de particularisation décroissante (inductive) logée dans la seconde partie du mot (suffixes). Contrairement à l’anglais, le français se caractérise par l’implétion de la seconde phase, « qui confère à la suffixation française ses vastes possibilités. » (p.35) D’où un transport partiel de la sémantèse vers la seconde phase. À la fin de son étude de la structure systématique du mot français (p.70), Guillaume appellera ces deux phases : « période de compréhension et période d’appréhension ».
— Appréhension / Compréhension
La compréhension et l’appréhension sont les deux systèmes qui régissent la formation d’un mot et son insertion dans la phrase. En français, l’appréhension est en partie inhérente au mot, c’est la partie du discours, et en partie externe, sous forme de mots grammaticaux (article, préposition). Cependant, la préposition peut également entrer, sous forme de préfixe, dans le système de la compréhension. Se définit ainsi une force de propulsion du préfixe intervenant dans la sémantèse du mot. L’ectopie enfin, « consiste à transporter une parcelle de compréhension dans la phase d’appréhension », sous forme de suffixe (ex : al + té dans loyauté)
— Incidence
C’est une « situation éventuelle retenue dans le mot par anticipation et qui s’attache à […] la personne. » L’adjectif a une incidence externe, car il inclut une personne d’accord et exclut la personne propre. De même, le verbe incorpore une personne d’accord, et peut donc « se dire de toute sorte de supports. » Au contraire, « Le substantif incorpore une personne propre : la troisième, et, du même coup, son incidence est interne. » De là découle une théorie intéressante de l’attribution : les copules attributives permettraient « le passage d’une incidence extra-temporelle à une incidence intra-temporelle » (ce bel enfant / cet enfant est beau). La notion trouve en marge p. 133 une définition plus extensive : « direction suivant laquelle une notion de langue en rencontre une autre, lui servant de support. »
— Temps opératif
« Temps pendant lequel la pensée opère la construction de l’image-temps. » De manière plus générale, temps nécessaire à la construction d’un matériel signifiant.
— Chronogénèse
Opération de pensée qui se déroule pendant le temps opératif, et consistant dans une spatialisation du temps.
— Chronothèse
Coupe transversale interceptive de la chronogénèse livrant un état plus ou moins avancé de la construction de l’espace-temps, correspondant aux modes infinitif, subjonctif puis indicatif.
— Cinétisme ascendant / descendant
« Le temps descendant est l’image objective du temps. […] le temps apparaît prendre naissance dans le futur éloigné, s’écouler de là en direction du présent, et dès lors fuir irrévocablement dans le passé. À cette image strictement objective du temps s’oppose une image inversée, subjective : celle du temps qui s’ouvre devant nous pour que nous puissions y inscrire notre activité et notre durée persistante. » (sens ascendant).
— Chronotype
C’est sans doute la notion la plus confuse dans cette série de leçons. En effet, elle est introduite sans définition à la page 156, et ne sera jamais réexpliquée. Elle correspond à deux niveaux en opposition verticale dans une chronothèse. L’indicatif français est constitué en deux chronotypes, le chronotype supérieur alpha, comprenant le présent, le passé simple ou prétérit défini, et le futur simple ou futur catégorique ; et le chronotype inférieur oméga, composé de l’imparfait et du futur hypothétique. Entre le latin et le français, il y a interversion du rôle et de la forme du parfait latin avec le prétérit défini français et le passé composé. Grossièrement, le chronotype supérieur correspond au cinétisme ascendant des temps permettant l’inscription de l’activité humaine dans le temps, et le chronotype oméga correspond au cinétisme descendant et à une vision objective du temps.
5. Développement de la réflexion.
Après un affinement critique de la théorie de Saussure sur diachronie et synchronie, mettant en évidence une relation dialectique entre ces deux notions, Guillaume établit la nécessité d’étudier le système du verbe français relativement au système du verbe latin. Pour lui, « un mot devient en français un verbe dès qu’il prend la marque de la personne ». Se pose alors la question de la catégorie de mots, ou partie du discours, qui donne lieu à un exposé de haute volée, résumé du cours de l’année précédente sur les autres catégories, et annonce « d’un ouvrage destiné à paraître quand je sentirai que mes idées ne progressent plus en moi. »
La catégorie du mot naît d’un échange entre universel et particulier, réglé différemment par des langues comme le chinois et le français. C’est là qu’intervient la fascinante définition du temps : « C’est l’écoulement de la vision universelle à travers l’étroitesse relative de la personne humaine » (p. 47). Si dans le passage du latin au français, le nom a vu son système d’appréhension porté à l’extérieur de lui par la disparition de la déclinaison, le verbe au contraire a conservé en grande partie son système d’appréhension interne sous forme de flexion. La personne se trouve donc exprimée à la fois en dehors et à l’intérieur du verbe, mais le nombre n’est pas à proprement parler une catégorie verbale, le nous et le vous n’étant pas le pluriel du je ou du tu. La personne extérieure au verbe joue le rôle de personne support, ou assiette d’incidence, et elle n’est que ça dans les tournures impersonnelles du type Il pleut. La personne incorporée n’est que personne d’accord. La définition de la personne prend en cours d’année une grande extension : elle « est le support que toute signification produite est tenue de se trouver, soit au dedans (substantif) soit en dehors d’elle-même (adjectif, verbe). » « Le substantif étant pris comme point de départ, on peut dire des catégories de l’adjectif et du verbe qu’elles en expriment respectivement deux étapes d’éloignement. » (p. 105).
Contrairement à l’adjectif, qui trouve son incidence dans un substantif, le verbe trouve son incidence à l’extérieur, c’est-à-dire déjà dans le moi de la personne qui parle, puis revient au hors-moi, et par la déclinaison personnelle, va du moi au toi, du toi au lui, et jusqu’à la troisième personne du pluriel, en passant par les personnes doubles. On distingue personne locutive (je), allocutive (tu) et délocutive (il) ; de plus, la personne délocutive est toujours associée aux deux autres, car « il est toujours parlé d’une personne », même si c’est la même que celle qui parle ou à qui on parle.
C’est à partir du 3 février qu’est enfin abordée la question de la représentation du temps, avec ce point de départ : « la simple représentation du temps qui fuit, si élémentaire soit-elle, emporte déjà avec elle une image linéaire qui est indubitablement un commencement de spatialisation. La ligne est un élément d’espace. » Suit p. 137 un schéma de l’architectonique des temps en latin, permettant l’introduction des notions de temps opératif, chronogénèse, chronothèse et cinétisme. On passe alors aux temps du français, lequel ne contient plus que cinq formes à l’indicatif, le conditionnel n’étant qu’un temps du mode indicatif, rebaptisé futur hypothétique. Les formes composées ne sont pas des temps, mais indiquent un changement d’aspect, notion dont Guillaume regrette qu’elle ne soit indiquée dans aucune grammaire du français.
Au passage, Guillaume établit qu’une langue en devient une autre lorsqu’elle change de système en ses parties principales. En ce qui concerne le français, il note que les deux langues ont été utilisées en parallèle pendant le temps remarquablement court où le français s’est substitué au latin, preuve qu’il ne s’agit pas de la même langue.
La chronothèse initiale du français contient l’infinitif, ou image verbale in posse (verbe n’ayant rien dépensé de sa puissance) ; le participe présent, image verbale in fieri (puissance en partie dépensée, en partie inaccomplie) ; le participe passé, image verbale in esse (verbe ayant fait dépense entière de sa puissance).
Guillaume s’attarde longuement sur la différence entre les deux futurs, le futur hypothétique exprimant non le futur, mais le présent ouvert sur le futur (Si je le faisais, je réussirais). Pour expliquer la concordance des temps, il introduit la notion de futur hypostatique, catégorique par le sens mais hypothétique par la forme.
Le prétérit défini est caractérisé par sa « composition particulaire », qui l’empêche d’opposer intérieurement l’accompli à l’inaccompli, construisant une vision aperspective du temps propre au cinétisme ascendant de chronotype alpha (c’est-à-dire qu’on n’assiste pas en lui à la conversion du futur en passé). De la sorte, il s’oppose stylistiquement à l’imparfait, forme perspective ouvrant une vue sur l’avenir. Guillaume analyse longuement certaines utilisations stylistiques d’imparfaits substitués à des prétérits définis pour exprimer des actions successives. Le rôle de ces imparfaits perspectifs « est de piquer la curiosité du lecteur en lui faisant pressentir que quelque chose de singulier et d’inattendu se prépare. » Ils accroissent « le sentiment de tension perspective […] d’une manière propre […] à tenir en haleine la curiosité du lecteur, et à lui faire voir dans les faits relatés non pas des événements conclusifs chacun pour leur compte, mais, tout au contraire, des événements qui ne concluent pas et qui orientent l’esprit vers une conclusion inattendue, qui se prépare et qu’on sent venir » (p. 202). Ces explications de petits faits marginaux ont été pour moi les pages les plus passionnantes de l’ouvrage, en ce sens que je n’avais jamais trouvé auparavant ces faits si minutieusement analysés.
Plus généralement, l’imparfait perspectif se propage de l’ancien français au français moderne en acceptant une base spatiale plutôt qu’une base temporelle, de façon « à éliminer le temps de survenance du verbe au bénéfice du temps d’existence du sujet. » Sont ensuite analysés les imparfaits de discrétion, de discours indirect libre (le terme libre n’est pas utilisé), hypocoristique et de concordance.
Le passé composé, ou prétérit indéfini, est expliqué à partir de l’analyse du style de rapport ; « l’on emploie le passé composé partout où il est senti utile d’inscrire les faits au passif ou à l’actif d’une situation présente implicitement considérée. » Son emploi induit donc une oscillation de l’esprit entre le présent et le passé.
De manière générale, les temps composés sont analysés comme versant l’action qu’ils expriment « au compte d’une époque subséquente. », « par l’effet d’un penchement à droite ». Ce n’est plus « le procès lui-même qui constitue le propos, mais la subséquence présente du procès. » Les temps composés expriment donc l’aspect transcendant du temps simple correspondant, et les temps surcomposés, l’aspect bi-transcendant. Les temps simples expriment l’aspect immanent. Et Guillaume de préciser : « Antérioriser, c’est porter en dehors du propos, ce n’est pas établir une chronologie laborieuse entre verbes » (p. 305).
« Le plus-que-parfait implique la division du passé en un passé d’en-deçà dépassé et un passé d’au-delà au compte duquel on inscrit le passé d’en-deçà. »
Guillaume développe ensuite dans la conjugaison française la « combinaison savante de discriminations connexes d’espèce différent » : époque, temps et aspect. Le présent est une synthèse de deux époques, le passé et le futur ; alors que le passé et le futur sont des époques qui analysent chacune deux temps, dans les deux chronotypes. Suit un exposé des valeurs, notamment les valeurs modales, du futur antérieur et du conditionnel passé.
L’étude des formes surcomposées, puis du subjonctif, donne lieu à des considérations intéressantes sur une facilité de la grammaire descriptive consistant à justifier une décadence d’emploi de certaines formes par des raisons de cacophonie (il eut eu / je chantasse). Pour Guillaume, « ce que l’on croit qui déplaît à l’oreille est, d’une manière générale, ce qui déplaît à l’esprit. » Ainsi, la décadence de l’imparfait du subjonctif en français s’expliquerait plutôt par le fait que le subjonctif est surtout un mode de cinétisme ascendant, ayant contrairement au latin, des affinités avec le futur, alors que l’imparfait du subjonctif, de cinétisme descendant, se construit paradoxalement au premier groupe avec les terminaisons à thème-voyelle en -a propres au passé simple et au futur. Le subjonctif présent contient un présent large, qui ne sépare pas mais contient les trois époques, contrairement à l’indicatif présent. Le subjonctif tend actuellement à devenir un mode à forme temporelle unique. Si l’on développe l’idée contenue dans la dernière leçon du 15 juin, on pourrait penser que l’élimination de l’imparfait du subjonctif serait la dernière étape qui sortirait définitivement le français de la gangue du latin. En effet, ce temps ne se maintient jusqu’à présent que par l’usage littéraire de la langue, fortement teinté d’études classiques.
Avec un schéma définitif rassemblant les temps de l’indicatif et du subjonctif, le cours se termine sur une perspective alléchante, qui pourrait être interprétée comme la porte ouverte à la notion de motivation du signe : « j’estime qu’il suffirait de reprendre les faits phonétiques connus à la lumière des grands faits de système que j’ai mis en lumière pour qu’il s’ensuive en grammaire historique phonétique, un nouveau classement des faits […] et, de ce chef, de nouvelles découvertes se rapportant à la congruence, bien plus étroite qu’on ne le suppose à l’accoutumée, entre les faits physiques de parole et les faits de pensée liés. »
6. Conclusion.
La façon dont j’ai longuement cité certaines explications de Gustave Guillaume suffit à montrer mon admiration pour la langue même de l’éminent linguiste, inséparable de son propos. Si certains développements sont difficiles à suivre, c’est évidemment qu’un tel univers ne s’aborde pas innocemment en n’importe quel point. Dans les leçons de l’année 1943-44, on retiendra surtout les analyses fascinantes de l’imparfait et des formes composées de l’indicatif. Les aperçus sur la sémantèse auront sans doute été mieux expliqués dans d’autres années de cours. Cependant je puis témoigner que mon expérience de 15 années d’enseignement en collège m’a fréquemment opposé à l’incompréhension des élèves, voire de collègues instituteurs ou professeurs, quand je leur proposais la vision simple des temps de l’indicatif contenant le conditionnel, et les temps composés comme des variations aspectuelles des temps simples. Il serait temps, après soixante ans, que les ouvrages de conjugaison courants et les grammaires (voire Wiktionnaire !), cessent de répéter éternellement les mêmes tables inutilement surchargées. Même dans un bon collège, la moitié des élèves de cinquième ne maîtrise pas le présent de l’indicatif, alors comment voulez-vous faire avec des grammaires encombrées de soi-disant conditionnel passé deuxième forme ? Comment se fait-il qu’en lettres il y ait un tel décalage entre la recherche et l’enseignement de base ?
© altersexualite.com, 2018.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com