Accueil > Culture générale et expression en BTS > « De la musique avant toute chose ? » > De l’aube à l’aube, d’Alain Bashung
La petite entreprise d’un rockeur bidouilleur
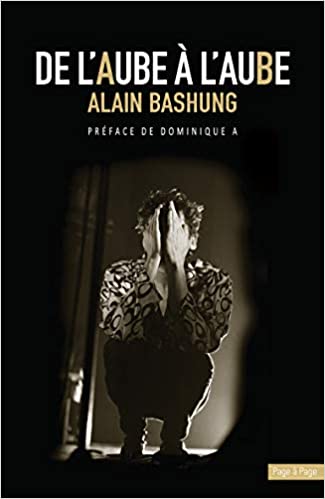 De l’aube à l’aube, d’Alain Bashung
De l’aube à l’aube, d’Alain Bashung
Page à Page, 2018, 252 p., 19 €
samedi 10 octobre 2020, par
De l’aube à l’aube (2018) d’Alain Bashung (1947-2009) est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « De la musique avant toute chose ? ». Je l’ai choisi en contrepoint à Let’s Talk About Love. Pourquoi les autres ont-ils si mauvais goût, qui traite de Céline Dion. Si les deux chanteurs ne sont pas parmi mes favoris, j’ai un a priori bien plus positif sur Bashung, dont la voix me touche davantage. Je l’avais vu au Printemps de Bourges en 1985 (j’avais 19 ans et j’y étais allé surtout pour Francis Lalanne), sans que cela m’ait laissé un souvenir précis. J’éprouve toujours du plaisir à écouter ses chansons quand je tombe dessus, sans jamais avoir cherché à en savoir plus, mais ce livre m’en fournit l’occasion. Il est crédité Alain Bashung, mais c’est en fait la retranscription intégrale de la série de dix émissions intitulée « De l’aube à l’aube » de Gérard Suter et David Golan diffusée pour la première fois sur France Inter en 2010 (voir lien en bas de l’article), qui retrace le parcours personnel & artistique du chanteur à travers ses propres paroles extraites de diverses émissions, ainsi que les souvenirs d’une quarantaine d’intervenants de son entourage professionnel, familial et amical. Je ne pense pas que ce soit un chanteur ni un type de musique favori de nos étudiants, mais la culture générale n’est-elle pas là pour ouvrir leurs horizons ?
Le livre est préfacé par Dominique A, qui insiste sur la polysémie tous azimuts chez Bashung, autant dans ses discussions que dans ses chansons ou dans ses rapports avec ses musiciens : « Même topo pour l’auditeur : je ne vais pas EN PLUS lui dire ce qu’il doit entendre. […] Beaucoup de gens ne goûtent pas à cette liberté qu’on leur donne, elle les rebute. Ils veulent qu’on les prenne par la main, qu’on leur dise où s’asseoir. Avec Bashung, c’était placement libre » (p. XV).
L’Alsace
Les origines familiales de Bashung ont engendré un certain complexe. Il n’a jamais connu son prère biologique, dont l’identité relevait d’un secret de famille. Ses parents l’ont donné à élever pendant dix ans à partir de un an et demi à une grand-mère aslsacienne. Ses consins qui parlent avec un fort accent alsacien (il faut écouter l’émission) expliquent que Bashung ne parlait pas français et qu’il fallait un traducteur d’alsacien pour qu’il puisse parler avec sa mère qui venait aux grandes vacances. Cela a de quoi étonner car à ma connaissance, l’école était obligatoire et francophone !
La chanson « Elsass Blues » témoigne de cette enfance alsacienne. Le clip de 1981 est pourri, mais cela vaut le coup de voir ce Bashung des débuts aux paroles (de Boris Bergman) elliptiques : « Elsass blues, Elsass blues / Ça m’amouse / Va falloir, va falloir que je recouse ». Souvenir d’enfance : « j’habitais dans un petit village et il y avait un oncle ou quelqu’un d’autre qui avait oublié un violon. Ce violon est resté sur une armoire et je regardais ce violon, je n’avais pas le droit d’y toucher et peut-être que le fait d’avoir été frustré ou de ne pas avoir eu le droit de toucher à ce violon a aiguisé mon envie de faire de la musique » (p. 26). Personne ne parle à Alain de sa bâtardise, ce qui entretient ma conviction que le fait de taire ses origines à un enfant est une bombe à retardement ; mais affirmer cela dans le cadre de l’« homoparentalité » n’est pas politiquement correct, ça n’est audible que dans un cadre hétéro ! « Ce qui a beaucoup blessé Alain, ce n’est pas forcément que son père ne soit pas son vrai père, c’est de ne pas l’apprendre par la bouche des principaux intéressés, c’est-à-dire sa mère et son beau-père. C’est peut-être, si on doit chercher la fameuse fracture, c’est peut-être là qu’on doit chercher, dans la manière dont il a appris les choses » (p. 31).
Le rock n’roll & les débuts
Quand il revient à Paris, c’est sa marraine qui a une situation plus aisée que ses parents, qui l’amène « aux concerts d’Édith Piaf » et de « Jeane Manson » (sic !) Il découvre le rock, avec « Be-Bop-A-Lula », qu’il déclare dans une archive ne plus pouvoir écouter : « Non, j’ai trop d’émotions… Je l’entendais comme s’il racontait tous nos tourments d’adolescents et en même temps il chantait des mots très simples, mais comme c’était en anglais, on ne comprenait pas tout, on s’imaginait plein de trucs. C’est peut-être ça qui a déclenché à un moment donné le fait d’écrire des choses, c’est tout ce que je ne comprenais pas que j’essayais de raconter avec des images mélangées avec des impressions » (p. 35). Cela fait penser aux propos de Nietzsche sur la chanson populaire. Voici le premier enregistrement video de la chanson en 1958.
Après le décès de sa mère d’une cirrhose, Bashung « a rompu complètement avec sa famille, avec tous ses amis d’enfance » (p. 38). C’est étonnant, car les cousins participent à l’émission. Il enregistre ses premiers disques de façon frustrante, soit avec un groupe, les « Sharks » (« Je les trouvais plutôt bons mais je n’avais pas encore le courage de les pervertir »), soit avec des arrangeurs, qui font le travail à la chaîne : « on ne pouvait pas approfondir, on ne pouvait pas rendre spécifique, casser les choses » (p. 46). Le parolier Michel Bernard évoque sa façon de travailler : « Quand je lui ai amené, sur une de ses musiques, un texte que j’avais écrit dans ma mouture habituelle, il me soulignait tout de suite les choses trop conventionnelles en me disant : « Ça, ce serait mieux de le dire autrement, je ne sais pas mais il faudrait trouver un autre phrasé, que ça sonne phonétiquement. » C’était la phonétique qu’il recherchait » (p. 48). Le même Michel Bernard expose le rapport de Bashung à la musique : « l’expression était tout pour lui, plus que la musique. La musique a été le tremplin de son expression mais dire qu’elle a été plus que tout, je n’en suis pas persuadé. Il s’est servi de la musique pour arriver à exprimer son intériorité, il avait besoin d’être perçu, je pense, en tant qu’être humain, par rapport à son émotion personnelle, à son vécu personnel, par rapport à ses doutes, à ses angoisses, à ses amours déçues, à ses espérances déçues, par rapport à tout ce qui vibre à l’intérieur d’un homme et qu’on a envie d’exprimer » (p. 51). Bashung rencontre le chanteur Christophe, qui l’enregistre au Revox et bidouille avec lui : « quand j’entendais la voix d’Alain, tout à coup, j’ai eu cette sensation-là qu’il pourrait chanter Tannhäuser. Et puis on a travaillé avec Karl-Heinz Schäfer pour les cordes, donc c’est quelque chose que j’avais un peu réalisé. De toute façon, ce sont tous ces essais sur cette route de la musique et de la création qui font qu’on trouve sa propre couleur » (p. 49).
Une interview de Bashung me fait penser à Répétition d’orchestre, de Federico Fellini : « En fait, je me suis occupé de ses enregistrements à un moment donné, je faisais le producteur. C’était mes premières expériences en studio, j’étais assez gamin, j’avais vingt-deux, vingt-trois ans.
Je me retrouvais devant un orchestre, c’était parfois des musiciens de l’opéra et donc ce n’était pas des mauvais au départ mais je crois qu’ils avaient un mépris terrible pour tout ce qui n’était pas du classique. Ils devaient traîner des pieds, même à l’Opéra, je crois.
Moi je pensais rencontrer des gens passionnés et des fous, là je voyais des types… ils m’ont fait un plan un jour, j’ai failli les tuer. Il y avait des séances de trois heures et admettons que ça démarre à neuf heures du matin pour se terminer à midi. Il y avait plusieurs chansons à enregistrer, faire des cordes, il y avait vingt-cinq musiciens à peu près et on devait faire une dernière prise à midi moins trois, donc le temps de la chanson. J’écoute et j’entends des sons bizarres, c’était faux, il y avait des choses qui sonnaient faux. J’ai découvert par la suite qu’il y avait deux-trois violonistes qui s’étaient légèrement désaccordés. Pourquoi ? Pour pouvoir bénéficier d’une autre séance de trois heures et ça, c’était une catastrophe. Après on me dit que je suis devenu rebelle, et ben par exemple, c’est pour ce genre de choses. J’avais envie de tuer, je voyais parfois des types écouter le match au transistor pendant l’enregistrement, c’était effarant. Le pianiste avait un polar, il lisait son polar et quand c’était rouge, il jouait et ce n’était pas un mauvais. Ça, c’était mes premières expériences de studio » (p. 57).
Gaby : premier succès
Le parolier Daniel Tardieu évoque la façon de travailler avec Bashung : « Alain trouvait des phrasés et moi au bout d’un moment j’avais le phrasé d’Alain dans la tête quand j’écrivais. Il fallait qu’il y ait une pulsation rythmique, que ce soit ternaire ou binaire, que ce soient des alexandrins ou des heptasyllabes. C’était douze pieds, c’était onze pieds, c’était sept pieds ou même des trucs très courts mais il y avait toujours quand même chez Alain ce sens du phrasé, de faire chanter le français à l’américaine quelle que soit la rythmique » (p. 70).
Cette chanson « Bijou » qu’on voit ci-dessus interprétée en public sans doute bien après sa création, est une chanson de rupture et une chanson très érotique. Daniel Tardieu raconte que lui aussi était sorti d’une rupture à cette époque, il cherchait des paroles un peu macho : « je cherchais un côté qui ne soit pas Gainsbourg mais qui soit quand même une sorte de distanciation par rapport à nos mésaventures amoureuses. « Trésor, poupée », ça n’allait pas, alors j’ai trouvé « Bijou ». » (p. 72).
selon Boris Bergman (parolier), « Les Français adorent la country mais ils ne veulent pas qu’on appelle ça comme ça, parce que ça ne fait pas chic, ça fait musique de red neck, de mecs d’extrême droite, et je suis désolé si ça les dérange, mais les plus grandes mélodies d’Alain, enfin celles qui ont fait des grands succès, ce sont des mélodies country » (p. 75).
Le producteur Gérard Baquet explique comment « Gaby » a été enregistré grâce au reliquat d’un budget prévu pour un chanteur qui enregistrait vite : « et avec les… je crois que c’était un peu moins de 40 000 francs qu’il nous restait sur le budget de Paul Mauriat, on a produit Gaby, oh Gaby » (p. 77). La création de ce tube, selon Boris Bergman, relève d’ailleurs des méandres de l’inspiration : « Alain, à juste titre, savait très bien que s’il ne faisait pas un succès rapidement, on allait nous congédier.
Et Alain a dit : « Voilà, moi je ne peux pas. »
Musicalement il a repris un texte d’une chanson qui n’était pas sur l’album parce que le play-back ressemblait beaucoup à celui de Bijou, bijou. Il l’avait donc virée et il me dit : « Voilà, j’ai refait un texte sur L’après-midi d’un Max Amphibie. »
Il avait perdu l’essentiel du texte et il m’a dit : « Il faut refaire un refrain. »
À l’époque, on se moquait un petit peu de l’éditeur Max Amphoux, on se moquait un petit peu de lui par rapport à son homophobie latente, homophobie light mais homophobie quand même. C’est dur la vie d’un amphibie, etc., de là je suis parti sur « amphibie, gaboune, Gaby ». […]
Les Gaby, ce sont les homosexuels, les gabounes, c’est une expression… vous l’avez dans le royaume du milieu, c’est une vieille expression de truand, de l’époque des Apaches. C’est très vieux comme expression, c’est comme « meuf » et « keuf », ça date de l’époque du verlan » (p. 78). Il ajoute que la phrase « À quoi ça sert la frite si t’as pas les moules, ça sert à quoi le cochonnet si t’as pas les boules » a été griffonnée pendant que Bashung qui buvait beaucoup de bière allait pisser, comme une plaisanterie pour qu’il se mette à rire et se trompe en la chantant, mais il l’a chantée telle quelle et « il ne s’est pas trompé, la prise que vous avez sur le disque, c’est celle-là, c’est une seule prise ». L’article de Wikipédia confirme cette histoire, mais le texte de la chanson est hermétique et il est impossible de comprendre à froid qu’il s’agit de l’histoire d’un gay en environnement homophobe ! D’ailleurs deux pages plus loin, il est fait allusion à une certaine Gaby, une fille d’Alsace appréciée par Bashung. On se demande s’ils ne s’amusent pas à nous raconter des craques ! Gérard Baquet reconnaît que c’était hermétique, mais « Là, ils ont réussi à faire sonner des mots. Ça ne voulait pas forcément dire grand-chose mais c’était extrêmement porteur, c’était une nouvelle expression rock’n’roll » (p. 85). Et de conclure qu’il aura « fallu 15 ans à Alain pour arriver à trouver le bon amalgame, le bon alliage » (p. 86).
La maturité : Play blessures, etc.
Bashung a désormais les moyens de travailler en studio comme il le souhaitait : « Alain était dans une période où il voulait presque chasser la mélodie de chant de sa musique. Il disait : « Je rêve de faire une chanson sur un accord. » Il y est arrivé sans trop se forcer, il y est arrivé. En plus de travailler sur les ambiances, les ruptures, c’était un mélange d’impros et de trucs qu’Alain avait plus ou moins préparés dans sa tronche. C’était la magie, ça partait souvent évidemment d’Alain mais ça pouvait partir d’un riff de guitare qu’on faisait pour des leçons, puis : « tiens pépère, continue ». Je ne vais pas dire qu’on était co-compositeurs mais c’était vraiment un travail de groupe » (p. 99). Une rupture de trois ans avec Bergman intervient à cause d’une phrase dans Libération disant : « Boris Bergman, l’homme à qui Alain Bashung doit 50 % de son succès » (p. 103). La collaboration avec Gainsbourg pour l’album Play blessures (1982) donne lieu à des anecdotes : « C’est vrai que Serge avait tendance, avec Jeannot qui était à l’époque le rouleur attitré, à envoyer des bédos, des pétards à tout va » (p. 109). Alcoolisme & gamineries sont aussi au rendez-vous, mais fait notable, c’est « la seule fois où Gainsbourg va cosigner des textes » (p. 111).
La rencontre avec la 2e épouse de Bashung, Chantal Monterastelli, racontée par elle-même, ne manque pas de piquant. Invités à dîner chez la même personne, il est « bourré comme un coing », mais à la fin du dîner : « Alain m’attrape et me roule une pelle devant tout le monde, y compris devant ce mec, et me dit : « Je t’appelle. » » (p. 116). Ça serait aujourd’hui, il aurait toutes les chances de tomber sur une connasse qui en ferait un livre et du fric avec « balance ton porc ». Autres temps, autres mœurs !
L’album Passé le Rio Grande atteint le summum de l’autodérision avec la chanson-calembour « Helvète Underground », qui me passe un peu au-dessus de l’entendement. Dans le même genre, « L’arrivée du tour » provient d’une vanne de bas étage avec Bergman (réconcilié) : « c’est un mec qui arrive chez lui et il y a une partouze. Et sa femme lui dit : « C’est pas du tout ce que tu crois, c’est un tomahawk dans l’armoire. » Voilà, c’était un peu à l’ouest, un peu à l’anglaise » (p. 126). Bien, il faut en effet aimer l’humour anglais ! Marc Besse, biographe de Bashung, différencie la méthode de travail du chanteur : « Dans sa collaboration avec Bergman, les musiques étaient faites avant, la ligne de chant était donnée dans un langage qu’on appelle « le yaourt », qui est ni plus ni moins qu’une somme de mots qui n’ont aucun sens mais qui donnent le rythme, qui donnent les tonalités, qui donnent les toniques, et qui permettent de définir une ligne de chant.
Ça, c’était fait avant et les textes de Boris venaient s’enchâsser, s’adapter, à cette ligne de chant.
Avec Fauque, c’est complètement différent, ce sont les mots qui donnent leur musicalité, le texte devient plus important dans le sens où il est posé avant. Une valise de mots est définie, c’est une déambulation, une circulation du sens qui se met en place et qui finit par structurer un texte avec une tête, une queue et la musique vient s’agréger derrière » (p. 132).
L’aventure américaine
Bashung enregistre à Memphis avec des pointures étasuniennes, dans un studio mythique où Elvis a enregistré entre autres. Anecdote : « Alain s’était mis en tête de faire la reprise de Piaf, Les amants d’un jour, avec ce truc très français où en tout cas européen, avec le même système qu’on retrouve dans La valse à mille temps de Brel où il y a une valse qui accélère. Et là, ils étaient paumés.
Pourtant, la valse, ils connaissaient un peu chez les Tex-Mex, ils connaissaient bien car dans la country il y a beaucoup de valses mais alors là, cette valse qui accélérait, ils devenaient fous et Alain n’arrivait pas à les arrêter : « Eh, les mecs, écoutez, on a peu de temps, faut vraiment qu’on passe à autre chose. » Non, ils se faisaient un point d’honneur, je me souviens d’Éric Clermontet en train de battre la mesure et de leur montrer les trucs pour l’accélération. Crazy french song is not possible ! et tout. Et les mecs, ils luttaient, genre « On va l’avoir, on va l’avoir ». On a passé l’après-midi, la soirée, et Alain se disait : « Merde, j’aurais jamais dû faire ça putain, on ne peut plus les arrêter. » (p. 139). Pour tout vous dire, ça ne se sent guère à l’écoute, enfin pour un ignare en musique comme votre serviteur…
Mais le grand succès, c’est la chanson Osez, Joséphine, avec une anecdote sur la vente : « À l’époque des gens viennent dans les magasins de disques en disant : « On voudrait le disque où il y a le clip avec le cheval dans le cirque. » Quand même, c’est juste incroyable, les gens ne viennent pas demander le dernier album de Bashung, ils demandent l’album où il y a la musique avec le cheval dans le clip, c’est quand même dingue ! » (p. 144). Le bidouillage, à cette époque, atteint des sommets : « Là, il va commencer à s’amuser et ses albums vont devenir des castings incroyables, des castigns pléthoriques, on va avoir des dizaines de guitaristes, de cordes, de batteurs, etc.
Pour chaque chanson, il va prendre seulement quelques notes ou tout ce qu’ils ont enregistré et faire des petites peintures en prenant les musiciens comme des couleurs et en faisant des tableaux, où chacun amène sa touche, son originalité.
Dans sa façon de travailler, il y a toujours ce côté instinctif, par exemple, il n’y a pas de partitions, il n’y a même pas de grilles d’accords, on baigne dans sa musique » (p. 147). Procédure confirmée par l’ingénieur du son Phil Delire : « Sur un même titre, on faisait intervenir dix guitaristes différents et on se retrouvait avec dix arrangements de guitare et cinq arrangements de basse pour un même titre. Au final, on avait les peintures, on choisissait les couleurs, on créait le tableau et c’était vraiment fascinant parce qu’on arrivait à de belles choses. » Le musicien Jean-Marc Lederman confirme : « C’était une façon très particulière de visualiser l’apport de chacun dans la mesure où certaines couches musicales sur lesquelles il travaillait étaient très expérimentales, c’était vraiment du son brut, voire du bruit organisé par moments, alors que d’autres couches étaient très consensuelles, comme la guitare par exemple. Et donc quelque part, c’est ce qui me fascinait dans la musique d’Alain, quand j’ai commencé à connaître un peu plus sa musique, c’est que c’était vraiment une balade constante entre les choses acceptables et les choses inacceptables mais mises sous un jour qui les rendait diluables et supportables pour une plus grande audience » (p. 151). Pascal Nègre, président d’Universal Music, raconte l’origine du titre de l’album Chatterton : la chanteuse Björk, qui faisait partie de son écurie, lui raconte l’histoire drôle du cochon d’Inde qu’en entoure de chatterton pour qu’il n’explose pas quand on l’encule. Quand il rapporte l’histoire à Bashung, celui-ci en fait le titre de son album, évidemment avec d’autres idées en tête, qu’il explique en entrevue : « je voyais ce ruban adhésif qui partirait de la Terre jusque sur une autre planète… J’avais aussi l’impression qu’il était difficile de faire des vraies révolutions, j’avais l’impression qu’on réparait des petites choses, vous savez comme une fuite, on ne veut pas changer le tuyau vraiment, alors on met un petit bout… » (p. 154).
L’album Fantaisie militaire (1998) est l’occasion d’une surenchère dans le bidouillage, autorisé je crois par les progrès techniques : « Alors, c’est là qu’Alain est très malin, c’est qu’il demande ça aux Valentins mais il demande ça à d’autres compositeurs aussi, ce qui fait qu’on se retrouve pour la même chanson avec trois chansons où la mélodie et le texte marchent à chaque fois mais avec des harmonies différentes. Une fois qu’on avait enregistré ces trois versions, Alain me disait : « Dis donc, les violons de Richard sur le refrain ne sont pas mal, on pourrait peut-être les coller avec les couplets des Valentins qui sont super et prendre encore le pont de l’autre version. » Alors on rentrait les trois arrangements dans la machine digitale, on les superposait si je puis dire, et ensuite on jouait avec les ouvertures d’arrangements pour colorer la chanson et la construire » (p. 166). Avec L’Imprudence (2002), ça va encore plus loin : « On avait loué un micro qu’on pouvait plonger dans l’eau. On avait pris une bassine d’eau, il faisait bouger des chaînes dans l’eau sur des prises de chansons que je mettais deux octaves en dessous. On mettait la bassine d’eau avec le micro dans l’eau, devant la grosse caisse, et on avait vraiment un son « bassine d’eau », c’était fantastique. On faisait des clapotis. Simon avait ses guembris marocains, ses basses mexicaines, ses baby basses contrebasses, Mino Cinelu jouait des casseroles – Mino jouait de toutes ces percussions dont il est complètement maître. Ludovic Bource avait repéré le punching-ball dans la salle de sport d’ICP, il avait commencé à faire tourner ça et on avait descendu un micro pour enregistrer le bruit que provoquait la chaîne en tournant avec le punching ball. Chaque délire qui avait du sens était important » (p. 192).
Gérard Manset évoque Comme un Lego, paroles et musique de Gérard Manset interprété par Bashung sur l’album Bleu pétrole, à l’encontre du bidouillage : « Il était très fatigué, il me l’a dit après. Il était très content, il l’a faite en une prise effectivement, mais évidemment qu’on l’a faite en une prise, on le comprend et c’est élémentaire. Les mots s’enfilent les uns aux autres, ce qui était son cas, il n’a pas articulé comme moi mais il se l’approprie parce qu’il est méticuleux et parce qu’il a cette voix, comme Johnny qui a une voix phénoménale s’approprie les titres, comme Piaf s’appropriait les trucs j’imagine.
Là on est simplement dans le phénomène vocal, certains ont cette particularité, cette qualité, on naît avec, il avait la voix, les cordes vocales pour une diction qui rendait l’auditoire addictif, accro, c’est pour ça que j’en jubilais. Chaque mot qu’il pose, c’est une pierre, mais une pierre lourde et épaisse, il le sait lui-même, il n’y a pas de fioriture à faire, il n’a pas à rouler des mécaniques, il suffit qu’il dise les mots syllabe par syllabe et, à chaque fois, c’est un clou enfoncé.
La réussite absolue pour moi, avec les titres que j’avais ; c’est Vénus. Là effectivement, il a apporté une dimension que personne ne m’a jamais apportée sur une chanson que j’ai pu donner » (p. 213).
Un témoignage du chanteur Joseph d’Anvers révèle le pinaillage verbal de Bashung : « […] il y avait Tant de nuits qui finalement figurera sur l’album quelques mois plus tard et pour lequel Alain me dit en préambule : « Voilà, j’aime beaucoup ce texte mais il y a quelque chose qui me gêne. » Et il me dit : « Dans ta première phrase " Mon ange je t’ai haï ", il y a le verbe " haïr ", je ne connais pas la haine, je connais plein d’autres sentiments périphériques mais pas celui-là, je vais donc avoir du mal à le chanter, je n’ai quasiment jamais employé ce verbe dans mes chansons, comment on pourrait faire pour changer ça ? » Là, j’ai commencé à me dire : « Ça va être compliqué » et ça a duré une bonne heure, une heure et demie où on a discuté juste de ce mot et de cette phrase. On a essayé de trouver d’autres choses, on a essayé de tourner autour. Je lui expliquais chaque mot du texte, pourquoi je les utilisais et je savais qu’en me confrontant à Bashung, je me devais d’avoir une explication pour le sens, pour la sonorité, pour tout, donc j’étais préparé.
Au bout du compte, il m’a dit : « OK, tout ce que tu me racontes me va, je chanterai ce verbe-là, je vais l’accepter et je vais essayer de l’interpréter comme il se doit. » Ça, c’était sur une phrase et je me suis dit : « Effectivement, on n’a pas fini » mais le reste du texte a coulé de source et une semaine ou dix jours après, il m’appelle et me dit : « Est-ce que tu peux passer prendre le café, j’ai quelque chose à te faire écouter. » […] [Il lui fait écouter la maquette, son texte sur un instrumental] « C’est un instru d’un jeune mec qui s’appelle Arman Mélies, qui a trois-quatre ans de plus que toi mais qui est de la même génération et en fait, j’ai collé les deux, c’est-à-dire j’ai mis ton texte sur son instru et ça marche. » Et là je lui dis : « Il me semble que tu as changé un truc dans le texte. » Il me dit : « Oui j’ai changé " des angles un peu noircis " en " des ongles un peu noircis ", est-ce que tu m’en veux ? » Je réponds : « Non, absolument pas. » Il me dit : « Je trouvais qu’il manquait un côté organique aux paroles et si c’est OK pour toi, on ne touche plus au texte. » En fait, il a juste changé cette lettre et enlevé des phrases (le refrain était plus étoffé), il n’a gardé que « si loin de moi » et c’était vachement mieux, il n’y avait rien à dire et je me suis dit : « Le bonhomme a tout décortiqué, il s’est dit " si je change cette lettre la chanson sera mieux " » et c’était le cas. Pour une deuxième ou troisième rencontre, c’était déjà une leçon » (p. 216).
La fin : Comme un Lego
Le dernier chapitre propose plusieurs témoignages sur les dernières années, la lutte contre le cancer, et les concerts héroïques où Bashung surmonte la maladie dans une sorte de transe, persuadé que la musique va le sauver. Pascal Nègre résume : « Drôle d’histoire tout ça… Il finit son album, il découvre qu’il a un cancer, il fait une tournée, il fait toutes ses dates, il n’en rate pas une. Jusqu’à la dernière minute, vous ne savez pas s’il vient aux Victoires. Il dit au revoir à la fois au public et au métier, il dit au revoir à sa maison de disques et je peux vous dire que ce soir-là, dans sa loge, on a ri, mais vraiment ri. Trois jour après il part en studio écouter le live, il donne son feu vert sur le live. Vingt-quatre heures après, il part à l’hôpital et deux jours après il est mort » (p. 231). Sa dernière épouse Chloé Mons revient sur Comme un Lego : « Cette chanson, elle est terrible, Comme un Lego. Cette chanson, quand je l’ai écoutée la première fois, c’était à Bruxelles et on s’est engueulés parce que pour moi, s’il chantait ça, c’est qu’il voulait en finir. Comme quoi je ne me suis pas complètement gourée. Quand je l’ai entendue, je suis sortie, je lui ai dit que s’il chantait ça — c’était magnifique, je ne critiquais pas la chanson — mais s’il chantait ça, c’est qu’il était prêt à partir. Il n’a rien répondu quand je lui ai dit ça parce qu’il savait très bien, on se comprenait très bien sans trop se parler mais j’étais révoltée. C’est une très belle chanson mais c’est quoi ? C’est complaisant ? C’est la fin du monde ? T’as envie de mourir ? Il ne disait rien et je pense qu’il y avait un peu de ça, il y avait une fatigue. C’était un homme usé, usé par les rapports humains, par les rapports de force, le monde. C’est une chanson magnifique, effectivement, monumentale et totalement désespérée. C’est terrible, c’est une chanson qui touche à quelque chose de très profond » (p. 238).
Je vous laisse apprécier le texte de Gérard Manset. En effet…
Voir en ligne : Écouter la série de 10 émissions sur France Inter
© altersexualite.com 2020
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com