Accueil > Culture générale et expression en BTS > Paris, ville capitale ? > Le Grand Paris, d’Aurélien Bellanger
La banlieue fait-elle partie du Grand Paris ?
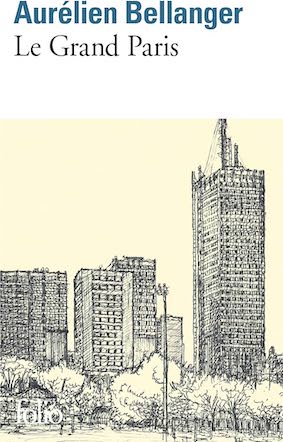 Le Grand Paris, d’Aurélien Bellanger
Le Grand Paris, d’Aurélien Bellanger
Gallimard, 2017, 480 p., 22 €
samedi 20 janvier 2024, par
Le Grand Paris d’Aurélien Bellanger figure sur la liste du BO pour le thème « Paris, ville capitale ? » au programme de l’épreuve de BTS de Culture Générale & Expression en 2024. Je l’ai choisi parmi les 8 livres désormais traditionnels sur lesquels je fais un article, parce qu’Aurélien Bellanger est un des auteurs du Tout-Paris actuel dont je n’avais encore rien lu, et parce que le thème du Grand Paris est incontournable ; il fait par exemple l’objet d’une exposition majeure à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à Paris, jusqu’au 2 juin 2024 : « Métro ! Le Grand Paris en mouvement », que j’ai vue juste après avoir tourné la dernière page du livre !
Je ne sais pas trop quoi penser du bouquin. Il ne m’a pas enthousiasmé. Il brasse les fantasmes sur la population d’origine immigrée musulmane en Île-de-France et le « choc des civilisation » sans jamais fouiller sous les dessous de cette opération de communication des « néocons ». Il pratique une forme atténuée de « name dropping » en affublant les personnages et quelques lieux de noms plus ou moins transparents, de façon pas très convaincante parce qu’il les noie parmi des noms réels. Son affectation d’user sans discontinuer du mot « Prince » pour désigner la crapule connue sous le nom de Sarkozy, ainsi que son ironie qui se veut houellebecquienne n’a pas vraiment percuté mon sens de l’humour. Mais sans doute me trompé-je, et il faudrait que je me familiarise davantage avec l’auteur. En tout cas l’aspect documentaire du livre est intéressant et concerne notre sujet, puisque le projet de « Grand Paris » se veut continuateur de l’histoire de Paris. Pourtant à aucun moment l’auteur ne remet en cause le fait que, à notre époque de prétendue « décentralisation », le sort de la région Île-de-France demeure le fait du « Prince » justement, alors qu’il ne devrait nullement le concerner. Imagine-t-on un instant le chancelier allemand se préoccuper du « Grand Berlin » davantage que du « Grand Munich » ?
Le narrateur se présente : Alexandre Belgrand, natif de Colombes en région parisienne, descendant lointain d’Eugène Belgrand, qui participa à la rénovation de Paris voulue par Napoléon III, en tant que directeur du service des eaux de Paris, dont il renouvela totalement les égouts. Son grand-père était un architecte, chargé par Paul Delouvrier (représentant du gouvernement français en Algérie entre 1958 et 1960), du programme des « Mille villages » qui fut un fiasco. Il suivit Delouvrier en France, et participa à la Réorganisation de la région parisienne en 1964 (effective le 1er janvier 1968), qui vit la création des départements actuels qui constituent l’Îe-de-France en redécoupant le « département de Paris » d’alors, qui était déjà une sorte de grand Paris, et la Seine-et-Oise, dans lequel il était enclavé comme le Lesotho dans l’Afrique du Sud (p. 20). Même si cela n’est pas développé dans le roman de Bellanger, j’ajoute ici un document pédagogique pour notre thème en BTS, qui est la fascinante carte des départements de Seine-et-Oise et de Paris en 1790. On prélèvera le fichier optimal sur l’article Seine-et-Oise.
Il semble inutile de chercher à identifier cette généalogie fictive. Ce grand-père ne peut être identifié ni à Fernand Pouillon ni à Albert Ballu ni à Henri Prost et tant d’architectes ayant œuvré en Algérie. Les parents du narrateur étaient des architectes moins glorieux. L’enfant s’intéresse à l’architecture ; il est amené à fréquenter la patinoire de Saint-Ouen, dont il omet sciemment de préciser qu’elle est l’œuvre de Paul Chemetov : « Le bâtiment, composite, semblait résumer trente ans d’échec de la politique de la ville. C’était l’équivalent architectural d’une succession d’incivilités qui déboucheraient inexorablement sur une émeute. Entièrement recouverte de tôle, comme tous les entrepôts hâtifs de la banlieue parisienne, la chose se refusait absolument à adopter une forme, et accueillait même, pour mieux se défendre de toute soumission par rapport à une fonction, un supermarché sous sa couverture métallique » (p. 24).
Le jeune homme rejoint l’ESSEC : « J’ai ainsi rejoint, et j’y ai vu un signe du destin, un hommage à ma mère, la deuxième du classement, l’ESSEC de Cergy-Pontoise. J’ai compris, dès la semaine d’intégration, que les années qui s’ouvraient devant moi seraient les plus heureuses de ma vie — la présentation de l’école qui nous avait été faite pendant ces jours alcoolisés avait été très claire. Nous en sortirions surdiplômés et on s’arracherait nos compétences, acquises auprès des meilleurs économistes et des cadres dirigeants des plus beaux fleurons du CAC. Nous irions en stage, nous irions à l’étranger, nous irions en stage à l’étranger ou nous prendrions le temps, grâce à des sponsors, de faire le tour du monde ou de pratiquer un sport extrême au niveau compétition. Dix pour cent d’entre nous créeraient une entreprise dans les cinq ans à venir, dans vingt ans les meilleurs d’entre nous dirigeraient des multinationales. Le bureau des élèves nous dispenserait, enfin, des plaisirs illimités, qui convergeraient, comme tous les ans, vers la mythique Nuit de l’ESSEC, la plus grande discothèque de France, dont ce serait cette année la vingt-cinquième édition. Officiellement, l’ESSEC était l’école de commerce parfaite. Officieusement, c’était un baisodrome — c’était le terme qu’avait utilisé l’étudiant qui m’avait fait visiter les lieux. J’ai ainsi fait l’amour pour la première fois au deuxième jour du week-end d’intégration — l’image est demeurée instable : c’était avec Chloé, dans son studio, et je crois me souvenir que sa colocataire était dans la pièce d’à côté — ou bien peut-être à l’étage du lit superposé. La deuxième fois a dû avoir lieu dans les toilettes du grand amphithéâtre, la suivante sur une pelouse du campus au lendemain d’une fête. Tout était alors évident, facile et animal. Nous étions deux jeunes adultes ivres lâchés à travers la machine désirante d’une ville nouvelle, d’une ville construite autour de nous, autour de nos désirs, d’une ville construite pour satisfaire la prophétie autoréalisatrice qui voulait qu’en l’an 2000 l’agglomération parisienne compte 15 millions d’habitants, d’une ville offerte aux enfants étourdis des baby-boomers et aux corps mélangés d’une libération sexuelle dont nous étions en ce matin du nouveau millénaire, les plus impatients des bénéficiaires — comme si nous pressentions déjà, dans le petit jour gris, que la fête était finie, que la courbe du progrès humain ne pourrait pas tenir éternellement, que la crise dont on nous parlait depuis l’enfance possédait des causes plus structurelles que conjoncturelles et que, derrière la déception démographique de savoir que Paris n’avait finalement pas dépassé les 12 millions d’habitants à la date fatidique, on pouvait entrevoir la terrifiante idée du déclin de la France et d’un lent décrochement de la péninsule européenne » (p. 42).
– « Je serais en tout cas entré dans un paradis étudiant. C’était la fête trois à quatre soirs par semaine et nous avions tous notre corps de vingt ans, un corps que nous soumettions sans fatigue à un régime accéléré de nuits blanches, de sports de contact et de fêtes ininterrompues. J’ai d’ailleurs dû glisser très vite et sans m’en rendre compte dans le clan de ceux qui allaient finalement considérer la fête comme leur seule pratique sportive – et elle était un sport extrême » (p. 45).
Alexandre fait connaissance à l’ESSEC de son futur mentor, Machelin, professeur de culture générale, « décalqué sur Patrick Buisson » d’après plusieurs articles sur le livre, dont celui-ci, signé Denis Bidaud. « Son enseignement était en tout cas d’un conservatisme si absolu qu’il nous apparaissait révolutionnaire, à nous qui, malgré les efforts que nous déployions pour ressembler à des étudiants modèles et aux cadres dynamiques de demain – à des individus radicalement modernes et qui auraient atteint un stade de l’efficacité si extrême qu’il conférait presque à la cruauté –, étions demeurés les enfants du vieil humanisme républicain. Nous étions, politiquement et historiquement, d’une innocence à peu près totale ; nous ne savions rien, sinon que la démocratie était le meilleur des régimes et que la Cinquième République en était l’apothéose » (p. 52). Alexandre accepte la proposition de Machelin de faire « une thèse sur les enceintes de Paris » (p. 54), en quittant l’ESSEC pour l’université. L’enseignement disons privé dudit Machelin, dispensé lors de rencontres informelles à son domicile, semble pour le moins fumeux, et c’est le problème de ce livre : on a du mal à savoir si c’est du lard ou du cochon. « C’est là que Machelin a commencé à me délivrer ce qu’il appelait son enseignement ésotérique. Il disait que Paris n’avait pas encore livré tous ses secrets. Il y avait sous cette conviction quelque chose de presque homérique, de virgilien, la croyance en un génie des lieux, en une divinité dormante et séquenoise, tutélaire et magique. Je devais retrouver cette structure presque oubliée en exhumant son squelette, ses cernes de croissance successifs, les lignes de vie de ses anciennes fortifications, les traces d’impact sur le sol de ce qu’avait été essentiellement Paris : le foyer de toutes les révolutions, la capitale de la modernité, la doublure sombre de Jérusalem » (p. 56).
La formule « divinité dormante et séquenoise, tutélaire et magique » laisse pantois : l’auteur nous fourgue 4 épithètes, pas moins, dont une improbable « séquenoise », invention ou erreur pour « séquanaise » ou « séquanienne », dont le correcteur de Gallimard a laissé tacher cette page. C’est ce genre de gloubiboulga qui me laisse insensible au style de cet auteur, même si je concède de belles pages comme celle-ci :
« Réfugié à la BNF, conçue avec ses quatre tours, sa cour centrale inaccessible et son pont-levis au-dessus de la Seine comme un château fort, le dernier qu’on aurait construit en France, j’ai minutieusement compulsé des centaines de livres, anciens et modernes, sur l’art des fortifications, sur la technique du siège et, plus spécifiquement, sur les enceintes successives de Paris. Celles-ci, dans l’étourdissement de l’étude, ont commencé à m’apparaître moins comme un système défensif que comme les expressions, naïves et presque spontanées, de Paris – comme un ensemble de signes arrachés à la stupeur du temps, de longues phrases circulaires laissées là, sous leur forme enfantine et cursive, à l’appréciation de ses futurs exégètes. Je commençais, lentement, à concevoir Paris comme une gigantesque créature autonome – une créature froide, pensive et déterminée, une créature que j’invoquais en répétant son nom, le nom de « Paris », dont les deux syllabes, la première, très lourde, et la seconde, un peu traînante, m’évoquaient un animal lent, aux pas sourds et réguliers, qui tirait derrière lui le long appendice caudal des dragons ou des dinosaures : le démon de la modernité était tout près de reprendre vie et d’avaler le monde, de s’enrouler autour de lui comme une grande amanite fossile » (p. 57).
On songe bien sûr au fameux incipit de Ferragus de Balzac : « Paris est le plus délicieux des monstres : là, jolie femme ; plus loin, vieux et pauvre ; ici, tout neuf comme la monnaie d’un nouveau règne ; dans ce coin, élégant comme une femme à la mode »…
Il y a aussi des points de vue intéressants : « J’analysais ainsi la Commune comme une réaction désespérée visant à rétablir, pour la dernière fois et pour un temps très court, l’équilibre perdu entre les lieux et leur génie : en s’emparant des dernières fortifications naturelles de l’intra-muros, des hauteurs de Montmartre et de Belleville, les dernières buttes témoins laissées largement intactes par l’urbanisme contre-révolutionnaire d’Haussmann, les Parisiens avaient tenté de rétablir le lien brisé entre la ville et son site. Mais en négligeant d’occuper le mont Valérien, la colline qui commandait la vallée aval de la Seine et permettait de contrôler tous les points de passage entre Paris et Versailles – les deux capitales rivales du pays en proie à la guerre civile –, les communards avait précipité leur défaite. Paris avait non seulement perdu une guerre, événement normal appelé à se reproduire, mais il avait surtout, événement inédit et critique dont il n’allait peut-être jamais se relever entièrement, échoué à mener une révolution à son terme » (p. 61).
– Je relève un passage intéressant en cela qu’il revient sur un moment historique, dont voici une estampe ci-dessus pour rappel : « Le supplice de Damiens, cher à Foucault, était en tout cas largement dépassé en horreur, avait précisé Machelin, on avait même égalé, dans un obscur laboratoire du Texas, le supplice chinois des cent morceaux – supplice dont Machelin m’avait avoué, ce soir-là, qu’il possédait un échantillon rare. Il avait alors sorti une plaque de verre fumé d’un tiroir de ton bureau. Je n’avais pas compris d’abord de quoi il s’agissait, on ne voyait rien, sinon la tache vaguement inquiétante d’un test de Rorschach. Machelin avait alors disparu dans sa chambre, dont il était ressorti avec un petit appareil binoculaire, semblable à ceux qu’on vendait dans les boutiques autour de Notre-Dame ou au pied du Sacré-Cœur. La plaque avait pris ses dimensions réelles, et j’avais vu, au milieu d’une foule indescriptible, le corps, d’un homme démembré, d’un homme dont les yeux ouverts et la bouche déformée ne laissaient pourtant aucun doute sur le fait qu’il soit encore vivant » (p. 93). Les curieux iront sur cet article de Wikipédia : Lingchi, qui montre que le mot « démembré » n’est pas vraiment adéquat.
– J’apprécie ce passage complotiste, ou du moins qui révèle l’origine de l’intérêt de la « presse » pour certains sujets : « Très étendu, mais aux perspectives absorbées par ses profondes soupentes, [l’appartement de Machelin] était caractéristique d’un certain mode de vie, un peu orientalisant, qui avait été popularisé, avant l’invention des magazines de décoration, par les portraits intimes des intellectuels que publiait alors Le Nouvel observateur en pleine page. Cette évolution de l’habitat, vers moins de hauteur sous plafond mais plus d’épures horizontale, avait été rendue possible, m’avait expliqué Machelin un jour, par la fin de la domesticité citadine, qui, en libérant les septièmes étages de leurs occupants traditionnels, avait permis à une génération éprise de liberté de partir à la conquête de la dernière aventure immobilière d’un Paris enclos dans des gabarits du baron Haussmann, et de disposer là, au hasard de son inspiration, ses meubles bas chinés. Ce mode de vie devait aussi beaucoup, ce constat avait été comme une de mes premières incursions dans le champ urbanistique, à l’apparition émancipatrice du sanibroyeur, dont les engrenages avaient résolu, dans ces étages, traditionnellement privés d’eau courante, le problème de l’évacuation des excréments solides – sanibroyeur dont l’inventeur n’était autre que le propriétaire du Nouvel observateur, le promoteur principal d’une French Théorie justement ouverte sur les béances organiques du champ psychanalytique » (p. 95). Il s’agit de Claude Perdriel, toujours cliniquement vivant ; pourquoi ne pas le nommer ?
On a droit à des analyses normopathes d’émission de télévision, dont on se demande s’il faut les prendre pour argent comptant ou si c’est pour démontrer la bêtise de ce type de personnage, parce qu’ils croient au veau d’or de la télé ; en tout cas c’est une belle démonstration du mécanisme actuel de validation de la « vérité » non pas en fonction de la recherche de la vérité dont il n’est à aucun moment question dans l’extrait, mais en fonction de la délivrance des autorisations de s’exprimer dans les médias du pouvoir dont l’auteur et son éditeur sont partie prenante. « J’avais assisté ainsi, depuis le petit moniteur de retour vidéo de la loge, à l’invention de Thierry Meyssan. Ardisson et Machelin, même dans ce que j’ai vu de l’émission avant le montage définitif, l’avaient laissé parler sans interruption, validant même à plusieurs reprises l’un ou l’autre de ses propos, comme si, à défaut de les endosser eux-mêmes, ils prenaient plaisir à les entendre proférer. Thierry Meyssan avait en tout cas été complaisamment présenté par Ardisson comme un défenseur acharné de la liberté d’opinion, fils d’un proche de Chaban-Delmas et de la responsable des Œuvres du diocèse de Bordeaux » (p. 107).
Suivent des appréciations sympathiques (mais dont on ne sait toujours pas si c’est du lard ou du halouf) toujours basées uniquement sur le spectacle télévisuel, et jamais sur une analyse ou des connaissances géopolitiques sur le mouvement néocon par exemple, sur la fabrication de l’islam comme « nouveau nom du mal ». Il est vrai que si l’auteur se penchait sur la question, il serait obligé de s’intéresser non pas à la personne de Thierry Meyssan, mais à son discours…
Le narrateur part pour un séjour formateur en Algérie : « Non, je n’étais pas en train d’accomplir mon Grand Tour, ou plutôt, s’il y avait bien un peu de ça – le contrat était clair, je devais revenir en France avec une solide expérience de terrain et un diplôme d’urbanisme valide –, mon voyage dans cette ancienne doublure coloniale de la France, dans ce pays truqué par le secret-défense, la guerre civile et les coups d’État invisibles, devait servir à me dévoiler, plutôt que les merveilles de l’art, celles de la politique — en laquelle s’incarnaient les plus précieuses facettes du génie humain » (p. 127).
– Page 127, je relève une allusion vague à un accident d’essai nucléaire qui aurait eu lieu juste après les accords d’Évian (18 mars 1962) dans les environs de Tamanrasset. Le narrateur évoque une « anecdote sans doute apocryphe », alors qu’en une minute de recherche on apprend l’existence on ne peut plus avérée de l’accident « Béryl », du nom du 2e essai nucléaire souterrain français. J’avoue ne pas comprendre les raisons de l’auteur d’embrouiller des choses simples.
Voici à l’occasion d’une sortie du « Prince » au commissariat de la Dalle d’Argenteuil, la description du lieu : « Je connaissais les lieux, c’était l’un des plus fascinants quartiers surélevés d’Europe, issus, comme celui de la Défense, d’une conception fonctionnaliste et ségrégationniste des flux de circulation : en haut, les piétons, en bas, les voitures, système à l’origine plutôt utopique, qui plaçait l’habitat et le loisir au-dessus du transport et du travail, tout en préservant de vastes espaces vides où la vie sociale pourrait s’épanouir. La chose, à l’exception notable de la Défense, avait plutôt échoué, les habitants des tours construites au-dessus des dalles ne parvenant pas à habiter ces espaces publics mal protégés du vent, les automobilistes eux-mêmes ayant tendance à contourner, en raison de leur caractère anxiogène, les tunnels qui leur étaient attribués. Seuls les espaces intermédiaires, réservés en principe aux techniciens ou aux évacuations d’urgence – les doubles planchers des dalles, les escaliers de secours, les conduits d’aération ou les locaux à poubelles –, avaient fait l’objet d’une réelle appropriation, soit comme logements pour les SDF, soit comme caches pour les différents trafics qui s’opéraient dans la semi-clandestinité du bâti. C’était en tout cas ainsi que j’avais toujours entendu parler de la Dalle d’Argenteuil : comme d’une usine inversée destinée à désosser les scooters volés dans les Hauts-de-Seine voisins, comme d’une plate-forme logistique qui contrôlait le marché de la drogue dans l’Ouest parisien » (p. 130).
De nombreuses allusions vagues sont jetées en pâture au lecteur, mais comme des on-dits, dont on ne peut rien tirer : « L’un d’eux aimait aussi évoquer un complot fomenté par le Mossad, qui visait, en exacerbant les tensions intercommunautaires, à provoquer un exode massif des juifs de France vers Israël » (p. 146).
Voici une description de Clichy-sous-Bois : « Le grand ensemble de Clichy-sous-Bois, une butte témoin qui offrait à ses tours le contrôle stratégique de tout le 93, était ainsi devenu, depuis que les émeutes l’avaient exondé, le décalque parfait de ces arrière-pays problématiques, de ces hauts plateaux hors du temps, de ces forteresses minérales d’où le monde ancien, miraculeusement préservé, continuait à exercer son orgueilleuse contestation des valeurs modernes.
La cité avait pourtant été conçue par l’un des meilleurs architectes et urbanistes de son époque, Bernard Zehrfuss, à qui la France devait les majestueux voiles de béton du CNIT et le solennel plan-masse de la Défense. Tout avait été disposé avec un soin minutieux, selon les préceptes rationnels de la charte d’Athènes, pour accueillir 20 000 habitants, la population d’une ville moyenne, sur un plateau boisé qui dominait l’Est parisien. La grammaire moderne de l’urbanisme avait articulé ici ses phrases les plus simples, son langage le plus compréhensible, fait d’une alternance de barres et de tours, de pleins et de vides, de murs rideaux, de toits-terrasses de plateaux superposés laissés en partage entre terre et ciel. Chaque propriétaire – il s’agissait d’une copropriété et non d’une résidence HLM gérée par un bailleur social – posséderait là, en plus de l’eau courante, de l’électricité et du chauffage, un point de vue privilégié et exclusif sur les tours voisines, sur la cité et sur l’agglomération parisienne, point de vue qui redéfinirait progressivement l’espace social en offrant à ses bénéficiaires une expérience démocratique complète, ouverte et égalitaire, mais qui saurait en même temps, grâce aux proportions majestueuses et monumentales de l’ensemble, éviter le piège orwellien du phalanstère » (p. 155).
Un paragraphe consacré à Mireille Matthieu, non nommée, est révélateur de la condescendance de l’auteur, qui semble ignorer par exemple que la chanteuse est réellement une vedette en Allemagne par exemple, mais aussi en Russie ; peut-être est-il jaloux ? On connaît le mépris des écrivaillons pour les chanteurs populaires ; voir à ce sujet La Chanson exactement. L’art difficile de Claude François, de Philippe Chevallier. « Le Prince avait fait monter sur scène une vedette oubliée de la chanson, une vedette dont on ne savait plus si elle était vivante ou morte – ou si la carrière internationale qu’on lui prêtait pour expliquer sa disparition complète n’était pas pire que la mort. Elle avait alors entonné d’une voix glaciale une chanson inconnue, et ses cheveux noirs étincelants – elle était plus associée, au fond, chez ceux qui se souvenaient d’elle, au nom d’une coupe de cheveux qu’à une chanson particulière — avaient presque autant brillé que le pyramidion doré de l’obélisque. J’avais vu la foule tenter de reprendre en vain les paroles de cette chanson angoissante qui voyait son interprète réclamer des milliers et des milliers de colombes – la chose évoquait plus un rituel de sorcellerie qu’un chant d’espoir, et la foule avait été rassurée qu’aucun lancer de colombes n’ait été prévu. La cérémonie présentait quelque chose d’immensément funeste et il n’y avait peut-être plus que le prince qui puisse alors en comprendre la signification profonde » (p. 194).
Après l’élection, le narrateur obtient un poste aux contours flous : « Nommé conseiller technique aux grands projets d’aménagement, j’étais l’un de ceux-là – ce titre étrange avait été préféré à celui, plus habituel mais trop restrictif, de conseiller technique à l’architecture, à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire. J’étais relativement bas dans la hiérarchie du cabinet, mais il était entendu que c’était un leurre, car le Prince me réservait une place privilégiée – j’avais ainsi été gardé au palais, à sa disposition immédiate. Le président voulait à ses côtés un philosophe, pas un technicien, quelqu’un d’audacieux et de libre, pas un juriste ni un technocrate. Il voulait que je l’aide à dessiner quelque chose qui porterait son empreinte et qui marquerait sa place dans l’histoire de France » (p. 197).
Laïus intéressant sur la hiérarchie des architectes : « Il existe, malgré les fulgurances transdisciplinaires du Corbusier, designer, architecte et urbaniste, une hiérarchie évidente qui place l’architecte d’intérieur au-dessous de l’architecte et qui subordonne celui-ci à l’urbaniste. Le niveau supérieur serait alors occupé par ce que les philosophes nomment de façon grandiloquente le politique : la ville envisagée en tant que cité, en tant que lieu d’exercice d’une citoyenneté exemplaire et glaciale. J’avais eu en réalité à Adrar moins le sentiment de parler directement à Dieu que de pourvoir au bon aménagement de ce palais philosophique à ciel ouvert – d’exercer là le métier un peu ingrat d’architecte d’extérieur » (p. 206).
Passage original sur l’étymologie : « J’avais vu, là-bas, beaucoup de villages abandonnés au sommet des promontoires rocheux sur lesquels on les avait construits. Une étymologie trompeuse en faisait les témoins des heures glorieuses de l’Algérie – Algérie, Al-Djazair, les îles –, étymologie qui voulait que le Sahara algérien ait été, au temps de sa splendeur, une seconde Méditerranée, un immense lac transparent d’eau douce sur les rives morcelées duquel s’était établie une civilisation lacustre dont l’Antiquité aurait fait ses mythiques Atlantes – des Atlantes qui n’auraient pas été engloutis, mais qui auraient vu l’océan disparaître.
La décrue, ici aussi, avait peut-être commencé. L’Île-de-France partageait en tout cas avec l’Algérie. cette étymologie océanique trompeuse, et l’idée de décrue était omniprésente » (p. 210). Sur l’étymologie du nom « Algérie », on peut lire un livre très savant, qui postule que cela vient de la géographie d’Alger, avec deux hypothèses. Quant à celle d’« Île-de-France, elle repose sur deux hypothèses, soit déformation du saxon « Liddle Franke » (petite France), soit allusion aux nombreux fleuves de la région. L’auteur en tire des images poétiques : « Paris avait été longtemps l’hologramme lumineux de son sous-sol, une ville diffractée par ses couches géologiques profondes et comme une image de ville flottant au-dessus de son site naturel. Le Bassin parisien avait levé partout comme une pâte blanche, on avait vu remonter du sous-sol des palais voûtés et des églises de plus en plus hautes — la ville avait été comme une lentille taillée dans le plus clair des calcaires souterrains, un calcaire évidé en rosaces jusqu’aux limites de sa résistance physique, un calcaire devenu presque transparent et plus léger que l’air, en quelques points choisis où on l’avait laissé monter jusqu’au ciel sous la forme mousseuse et effervescente des cathédrales gothiques » (p. 212).
Un projet délirant n’est pas si loin des délires de certains branquignols du macronisme le plus extrémiste drogués aux congrès du WEF (tels que les reprend le texte 3 de ce corpus de BTS sur la maison idéale) : « J’avais calculé que l’agglomération parisienne, ce que les géographes appelaient l’unité urbaine de Paris, et qui correspondait à peu près à la tache lumineuse qu’on voyait du ciel quand on survolait la métropole, aurait permis, si on avait appliqué partout, jusqu’à l’extrême pointe de chacune des branches de cette constellation terrestre, la même densité qu’intra-muros, de concentrer là toute la population française, le reste du territoire pouvant, dans cette hypothèse d’un exode rural massif, demeurer parfaitement vide. J’ai poussé l’expérience de pensée jusqu’à son terme, prenant le terme d’Île-de-France au premier degré et imaginant le confinement de toute la population métropolitaine derrière la voie rapide de la Francilienne, le troisième périphérique parisien, conçue pour relier entre elles les villes nouvelles, villes qui seraient devenues soudain les postes avancés de la civilisation, avant le territoire ensauvagé de la plus grande réserve biologique d’Europe » (p. 212).
Confidence du « Prince » : « Je vais vous dire, je suis un fils d’immigré, moi, j’ai pas de réseau et en plus, je ne bois pas d’alcool : ça fait beaucoup pour un seul homme. C’est quelque chose, hein, la convivialité de l’alcool ici. Parfois je me dis que je suis mieux avec l’émir du Qatar, qui est d’ailleurs devenu un ami, qu’avec un membre de ma majorité qui représente je ne sais pas laquelle de nos régions viticoles. Le vrai réseau, en France, c’est la convivialité de l’alcool, c’est Mitterrand, ses amis vignerons, ses tournées dans le Morvan avec ce type dont j’oublie le nom, alcoolique au dernier degré, et qui a fini par se faire exploser le crâne dans le bureau que vous occupez » (p. 228).
« Toute l’énergie de Paris lui est venue des entreprises multinationales de l’ouest et des villes multiculturelles de l’est, parce qu’il faut bien, j’ai pas honte de le dire, qu’il y en ait qui fassent des mômes et qui se lèvent tôt pour faire tourner tout ça. Eux, heureusement qu’ils sont là des fois. Ça fait dix ans, ça fait trente ans qu’on a abandonné Paris aux Parisiens, et c’est le désastre que l’on sait. Paris est devenu une ville de gauche, avec ses nouveaux ghetto, écologiste ici, homosexuel là-bas, ghetto bobo à la Bastille, ou même ghetto de droite, si l’on veut, avec ces arrondissements de l’ouest qu’on va visiter le dimanche en famille homoparentale pour se moquer des mères de famille à serre-tête. Et de la Gay Pride à la techno parade, de Paris Plages à la Fête de la musique, vous pouvez me citer une réalisation du nouveau maire de Paris qui soit pas une fête ? Il vaut pas mieux que Chirac, lui, en fait si, peut-être, il coûte moins cher au contribuable en alcool. Mais la voie rapide Georges-Pompidou, ce n’est pas rien quand même, réussir à faire passer une autoroute au cœur de Paris sans rien dénaturer de son site. La transformer en plage, avec du sable et des parasols, c’est profondément honteux, quand on y pense. On a pas fait cinq mille ans d’histoire pour en arriver là. Bonbons, caramels, esquimaux, et tant qu’on y est, coquillages et crustacés. Ça tourne plus très rond chez les intellos de gauche » (p. 230).
Alexandre est censé élaborer tout seul dans son coin le projet de « grand Paris » du « Prince ». On se demande si le romancier se fout ouvertement de notre gueule, car il ne prend même pas la peine d’évoquer l’atteinte à la répartition des pouvoirs, la décentralisation, etc. « J’avais, à l’inverse, identifié des vides mystérieux qui pouvaient faire l’objet de grands programmes d’urbanisme. C’était une façon de mettre définitivement fin à l’utopie des villes nouvelles, destinées au départ à préserver un anneau de verdure entre elles et Paris. Mais la réserve naturelle avait depuis longtemps disparu pour laisser place aux rectangles colorés des magasins géants et aux constructions basses des entrepôts logistiques – des bâtiments architecturalement si neutres que nous refusions encore d’admettre qu’ils étaient les seuls vrais monuments de notre époque indécise : les grands témoins de la mondialisation des échanges, de la désindustrialisation de la France et d’une idée de la fin de l’histoire en réalité plus heureuse que tragique. Il ne devrait plus y avoir de vieux Paris ni de villes nouvelles, de banlieues difficiles ou de glacis pavillonnaire, mais un seul espace, une seule métropole, la métropole du Grand Paris. Je rêvais de réconcilier Paris et sa banlieue, d’abolir les vaines distinctions entre intra-muros, petite et grande couronne. J’avais ainsi imaginé de lever la vieille malédiction des enceintes et du périphérique, à travers un vaste programme de réhabilitation des portes de Paris, lieux restés jusque-là délaissés, et qu’on devrait apprendre à considérer comme les places du Grand Paris plutôt que comme les portes du Paris historique. Je voulais aussi réouvrir le ciel de Paris aux tours, redevenues, depuis que l’Asie s’était mise à battre des records américains, les objets iconiques de la modernité architecturale » (p. 270).
Mitterrand se fait tailler un costard, mais l’auteur oublie le principal problème, le fait que pas plus que Sarkozy ou je ne sais qui, il n’avait à se mêler des affaires de la ville de Paris : « Mitterrand est ainsi resté dans l’imaginaire français comme un président bâtisseur, un Louis XIV républicain, un pharaon démocrate. La chose avait en tout cas été parfaitement mise en scène, mais l’aventure manquait singulièrement d’audace. Le président avait en réalité survolé son sujet, posant ici ou là des monuments facilement spectaculaires, comme l’Arche ou la pyramide du Louvre, mais n’était jamais véritablement intervenu dans le plan de la ville, pas plus qu’il n’avait tenté d’en changer les dimensions : son Paris restait celui des touristes et des provinciaux, un Paris pour les yeux et pour les enfants, destiné a finir en diapositives dans la coque en plastique colorée d’un appareil photo factice vendu à Montmartre. On entendait presque les clics du bouton-poussoir entre les monuments » (p. 273).
Belgrand prend conscience du véritable enjeu : « D’une certaine manière, les infrastructures étaient moins importantes que l’architecture institutionnelle de la chose […] L’infrastructure organisationnelle, c’était l’enjeu majeur. Trouver à faire fonctionner le Grand Paris, ses milliers d’élus, ses centaines de conseillers municipaux, ses huit conseils généraux, ses instances régionales qui contrôlaient les transports et, au-dessus d’elles, l’État qui supervisait les fonctions stratégiques de l’ensemble. L’infrastructure institutionnelle devait être remise à plat, les cartes rebattues, le mille-feuille écrasé. Le Grand Paris devait être repensé dans une perspective nouvelle – perspective anomale et sans point de fuite, perspective cavalière de cette ville faite de quatre cents communes juxtaposées, toutes rivales et toutes haïssant Paris, la ville de tous les privilèges et l’unique centre, pourtant, d’une agglomération sans lui dysfonctionnelle et anonyme » (p. 280).
On se demande encore si c’est du lard ou du halouf : « Il s’agissait […] d’une nouvelle libération de Paris, de la fabrique d’un dragon européen, de la relance soudaine de la ville sur la rampe verticale de la modernité : Paris, comme un nouveau Séoul, comme un nouveau Shanghai, comme une machine à ridiculiser New York et Londres » (p. 281).
Le narrateur revient sur la création des départements actuels : « de Gaulle avait dû créer les trois départements de la petite Couronne et offrir l’un d’entre eux, le plus pauvre, le plus ouvrier, au parti communiste » (p. 283).
Est alors introduit un personnage secondaire qui m’intéresse, Michel Pornier : « Il avait pourtant été l’un des plus jeunes ministres du gouvernement Balladur – celui dont le Prince avait été le ministre du Budget et le porte-parole. Lui avait été, en tant qu’unique maire de droite d’une commune du 93 – Vaubron, sur les contreforts du plateau de Clichy-sous-Bois –, nommé ministre de la Ville. Pornier, qui avait fait de sa ville une enclave d’ordre au milieu du chaos, semblait alors l’homme de la situation » (p. 284). Ce nom fictif est la chimère de Vaujours et Coubron, les deux plus petites villes de Seine-Saint-Denis, et il se trouve que j’ai habité pendant 8 ans à Coubron, et que je traversais Vaujours pour aller au boulot ! Quelques pages plus loin est évoquée « l’une des plus importantes carrières de gypse à ciel ouvert de France » exploitée par « Placoplatre », ce que l’on peut vérifier sur ce site avec un article récent.
Le narrateur s’apprivoise progressivement à la Seine-Saint-Denis, qu’il vit d’abord comme un territoire hostile. Je dois préciser que sa vision du département me paraît un peu caricaturale, avec des composantes véridiques quand même. C’est un département où j’ai habité entre 1972 et 1990, puis entre 1993 et 2001, à Villemomble, à Neuilly-Plaisance puis à Coubron, et où j’ai travaillé dans 1 collège puis 2 lycées pendant 23 ans, jusqu’en 2018, à Tremblay, Aubervilliers et Saint-Ouen. Je dois ajouter que quand j’étais petit, ma mère, qui exerçait comme éducatrice dans un service d’aide à l’enfance, m’amenait souvent avec elle le mercredi dans ses bureaux situés dans une cité HLM de… Clichy-sous-Bois, et dans ses visites à ses familles. Il s’agit donc d’un département que je connais relativement bien, en tout cas mieux que 99 % des gens qui en parlent dans les médias, et je prends avec recul des propos comme celui-ci : « Impressionné par le travail du plasticien, je lui avais demandé de me servir de guide à travers ce 93 où je n’osais toujours pas me rendre seul, et il avait accepté de m’emmener sur l’emplacement de l’une des futures gares du Grand Paris Express, à Noisy-le-Grand. Située à la pointe sud de la Seine-Saint-Denis, la ville relevait d’ailleurs moins, pour les urbanistes comme pour ses habitants, du trop sensible 93 que de l’environnement urbanistique apaisé de Marne-la-Vallée – la plus mystérieuse des villes nouvelles – dont j’avais découvert un jour, cela avait été comme la première illumination de ma carrière d’urbaniste, qu’il n’avait jamais existé de ville de ce nom, et que la ville nouvelle n’était qu’un projet d’aménagement qui n’avait jamais coïncidé avec aucune entité stable » (p. 316).
Au cours de son exploration de la Seine-Saint-Denis, on découvre l’existence d’un métro hectométrique, le Métro de Noisy-le-Grand, qui a été construit en 1993 et jamais exploité ! Inutile de demander où sont passés les millions. Ils sont quand même forts, car je n’avais jamais entendu parler de ce scandale. Il en visite les ruines.
Le narrateur est limogé de son poste, mais prépare sa candidature à l’EPAD (Établissement public pour l’aménagement de la région de la Défense), en avalant tous les éléments de langage sur « la transition énergétique » (p. 328). Il fait de l’auto-ironie lors d’une séquence humiliante où on lui propose de faire une sortie à vélo avec le « Prince ». Il ne fait pas de vélo, mais en achète un de compétition : « Mais il s’agissait d’un investissement, peut-être l’investissement le plus important de ma vie, bien plus important que l’achat de mon appartement ou mon séjour en Algérie. Je me voyais déjà devenir le nouvel ami cycliste du président, je me voyais tourner avec lui chaque dimanche à Longchamp ou dans le polygone de Vincennes, et entre le fort de Brégançon et le cap Nègre » (p. 329). Mais patatras, pas plus de balade à vélo que de beurre au cul, et : « J’ai appris le lendemain que le fils du Prince, qui venait de fêter ses 23 ans, était candidat à la présidence de l’EPAD. J’étais de facto écarté » (p. 331). Il s’agit du fils Sarkozy, l’affaire avait fait plus de bruit à l’époque qu’aujourd’hui la nomination de l’ex d’Attal, inculte et analphabète, comme ministre des Affaires étrangères.
Le narrateur raconte un périple improbable, à vélo d’abord, puis à pied, où il se tape sans matériel un nombre considérable de kilomètres, pour pénétrer dans « le département le plus dangereux de France – après celui de la Guyane » (p. 368). Apparemment il ne connaissait pas Mayotte ! Il arrive à l’aqueduc de la Dhuis (qui passe par Coubron, et son parcours était mon lieu de balade favori quand j’y habitais !), et aboutit à Clichy-sous-Bois, où il tombe par hasard sur Pornier, qui le prend dans sa voiture, alors qu’il est dans un état physique lamentable. Il lui raconte son expérience de maire lors des émeutes de 2005 : « Mais moi, pendant ce temps-là, sur le terrain, j’avais l’étincelle à éteindre. La famille et les amis à consoler. Les appels au calme à lancer. Les commerçants à rassurer, les chauffeurs de bus, en larmes, les bibliothécaires en plein syndrome de stress pré- ou post-traumatique, les policiers municipaux qui faisaient valoir leur droit de retrait, les principaux des collèges qui réclamaient des portiques électroniques et les directeurs d’école des sacs de sable, les chefs d’entreprise qui dormaient dans leur bureau avec un fusil de chasse de peur qu’on ne brûle ou qu’on ne vandalise leur outil de travail. Sans parler de ma base électorale – Vaubron est très résidentielle, c’est un peu le Neuilly du 93 –, qui parlait déjà de monter des milices citoyennes armées, et pourquoi pas, s’il n’y avait plus que ça à faire, de recruter des skinheads pour les entraîner. J’ai pris 30 kilos de graisse en trois semaines juste à cause du stress et j’en perdais autant en eau tellement je transpirais, j’en étais, quand le calme est revenu, à cinq chemises par jour. Mais on a tenu bon. On a été des bons maires » (p. 375).
– p. 388, Pornier prétend « que Tartuffe a été monté pour la première fois à Vaubron, dans l’ancien château ? » Vérification faite, il s’agit de l’ancien Château du Raincy, qui était situé sur la commune de l’actuel [Le Raincy] ; mais le « Vaubron » du roman est élastique ! P. 395 est évoquée Carla Bruni, un des seuls personnages désignée par son vrai nom ; pourquoi ? Le narrateur en était fan.
– Le sort de la ville de Goussainville est évoqué p. 409. Le vieux centre a été plus ou moins abandonné. Il est aussi question du Triangle de Gonesse, et du Crash du Tupolev Tu-144 à Goussainville le 3 juin 1973. L’Histoire est rattachée à l’histoire par la localisation du cadavre du grand-père du narrateur emmuré dans une maison de l’ancien Goussainville après son suicide suspect. Il travaillait justement à ce futur aéroport et aux villes nouvelles, et cette page complète le portrait du mystérieux grand-père entamé p. 20. Le narrateur assiste sans qu’on le lui ait annoncé, à l’exhumation du cadavre de son grand-père, qui avait été coulé dans une chape (pp. 411-413). L’extrait est saisissant ; je vous laisse le trouver.
– Je relève p. 419 un hapax, l’utilisation incompréhensible d’un mot dont j’ignorais l’existence, au sens pourtant très pointu (clinamen) : « la rue La Fayette – une rue conçue, juste avant les travaux d’Haussmann, comme une première contestation du primat de l’ouest, comme un long clinamen échappant pour la première fois au parcellaire parisien et fonctionnant à rebours du soleil. » P. 424 est évoqué « un restaurant étoilé, le seul du 93, installé dans une ancienne écurie du château de Vaubron ». Vérification faite, le seul restaurant étoilé (au guide Michelin) est l’Auberge des Saints Pères à Aulnay-sous-Bois, et il existe un restaurant installé dans une écurie en Île-de-France, mais c’est le Doyenné, au château de Saint-Vrain (Essonne)… Bref, l’auteur s’amuse à brouiller les pistes !
Le narrateur se rapproche de jeunes musulmans qu’il rencontre grâce à Pornier, qui s’est converti. Un certain Majd arbore la marque de ferveur religieuse appelée Zabiba ou tabaâ, mais ce mot n’est pas utilisé, au profit de périphrases (p. 425). Je me souviens d’un élève au lycée de Saint-Ouen qui avait arboré cette marque lors d’un épisode de ferveur religieuse. Pour ne pas effrayer les croyants au « choc des civilisations » (évoqué à ce propos, p. 424), c’était un garçon très sympathique et avenant, pas du tout le profil casse-couilles, ni même intégriste, un profil que j’ai très rarement rencontré, contrairement au premier mentionné. Le narrateur se livre à des analyses critiques intéressantes sur l’islam en France, avec ces nouveaux personnages qui sont tout sauf caricaturaux (pp. 438, 439). Extrait significatif :
« Mais cette rhétorique un peu grossière cachait une vérité beaucoup plus simple : l’islam n’avait pas un problème avec la modernité, c’était la modernité qui avait un problème avec l’islam.
Il devenait même de plus en plus certain – et il était un peu regrettable que les Français laïcs soient sans doute ceux qui mettraient le plus de temps à s’en apercevoir, malgré des signes de plus en plus évidents, comme le prouvait n’importe quelle photo de Dubaï ou de La Mecque, qui rivalisaient maintenant entre elles pour construire les plus hautes tours du monde – que l’islam était, à sa manière, devenu plus moderne que le christianisme » (p. 439). Je me permets de signaler en passant, au cas où un éditeur de Gallimard lisait ce modeste article, que dans mon exemplaire, Dubaï est imprimé « Dubai », et que « rivalisaient entre elles » est un joli pléonasme qu’un correcteur consciencieux aurait dû raboter !
– Je reprends un excellent passage à la Houellebecq, un peu long mais bien tourné, sur la « laïcité », qui tente d’analyser l’esprit parisien, et serait donc bon pour notre thème. C’est Pornier (converti à l’islam) qui parle :
« Il était lassé des discours hystériques sur la laïcité et sur le voile. Il les tenait pour exclusivement xénophobes – non pas qu’il condamne cette xénophobie, qu’il jugeait toute naturelle et trop humaine, ce qu’il condamnait, c’était cette manière grandiloquente de l’exprimer et d’hypostasier pour elle toute la mythologie républicaine. La république n’existait pas, ou plutôt son unique raison d’être, comme celle de l’existence d’une doctrine politique appelée républicanisme, était qu’il existait des conflits, des désaccords. La République n’était jamais neutre, elle témoignait toujours d’une tension, d’une tension qu’on avait choisi pour un temps de rendre publique, au lieu de la dissimuler. Et l’interdiction du voile obéissait à cela. C’était de l’ingénierie républicaine, une façon assez grossière de fabriquer de l’espace public – de fabriquer de l’espace public comme des urbanistes posaient des bancs et des lampadaires au pied des tours et appelaient ça une place. Mais il y avait au fond plus d’espace public dans le choix de modifier le tracé d’une ligne de bus pour atténuer une rivalité entre deux quartiers ennemis que dans tous les débats qu’il y avait eu (sic) sur la laïcité à l’Assemblée nationale, et qu’il y aurait encore, jusqu’à épuisement du sujet – soit par lassitude, soit en raison d’une épidémie de conversions massive.
Car il fallait voir, a continué Pornier, le laïcisme contemporain comme un jeu éphémère plus dû au caractère versatile des Français – des Parisiens plutôt – qu’à un ensemble de convictions bien formées. Pornier voyait même dans celui-ci un stade préreligieux, et il prophétisait, en l’espace de moins d’une génération, une vague de conversions massive.
L’élite intellectuelle, nous a-t-il expliqué, était en tout cas assez légère et sérieuse à la fois pour se mettre au Coran comme elle s’était mise hier à la psychanalyse : fanatiquement, et un peu seule au monde. Elle y viendrait sans doute par l’islamophobie, en bonne élève, pour vérifier à quel point le texte était vraiment obscurantiste et radicalement peu laïc. Elle s’y mettrait en fait comme elle s’était mise à la laïcité elle-même, une fois qu’elle se serait fatiguée d’elle et des croyances un peu pauvres qu’elle impliquait envers un idéal républicain trop tiède pour son fanatisme – un fanatisme d’opinion, un fanatisme de tête plutôt que de cœur, qui faisait des Parisiens des débatteurs passionnés et stériles, et comme une armée de réservistes pour n’importe quelle idéologie émergente. Ils s’enflammeraient alors, comme ils avaient été jadis jansénistes, libertins, communistes – aujourd’hui laïcistes : demain tous pieux, rigoristes et dévots » (p. 444).
Alexandre se convertit et confesse naïvement la pauvreté spirituelle à l’origine de cette conversion : « J’étais en pensée avec elle, j’étais devenu musulman et j’étais enfin guéri, grâce à elle, grâce à Dieu, de cette dialectique épuisante qui voulait opposer, sans fin et sans raison, progrès et réaction, passé et futur. J’étais redescendu dans la grotte du temps, au lieu où tout était encore simple, où nous vivions simplement, dans l’ordre, la succession des événements qui formaient le monde, et que Dieu avait bien voulu nous montrer pour nous divertir du néant – du néant et des répétitions sans fin des mauvais messianismes et des chantiers sans but de la modernité » (p. 467).
Hélas, Pornier, qui a précédé le narrateur dans cette conversion à la mode, doit démissionner suite à un scandale qui brouille encore plus les pistes, puisqu’il fait allusion à la biographie de Georges Tron : « Plus grave, il aurait aussi eu de nombreux gestes déplacés, comme des massages des pieds qui auraient fini en masturbation. Pornier n’avait jamais caché son attrait pour la réflexologie plantaire, qui lui permettait d’exercer, plus ou moins librement, ses pulsions fétichistes. Il semblait en tout cas avoir pratiqué la chose avec de nombreuses collaboratrices » (p. 470).
– Lire un article de fond sur ce livre : « Redonner un génie aux lieux dans Le Grand Paris d’Aurélien Bellanger » par Pauline Hachette.
– Ce livre ne dit pas un mot de la création au 1er janvier 2016 de la Métropole du Grand Paris, certes postérieure au règne du « Prince ». Pour tout dire, j’ignorais son existence jusqu’à ce que mes recherches pour ce thème m’y mènent par hasard. C’est encore un bon fromage avec voiture de fonction et frais de bouche…
© altersexualite.com 2023
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique. Abonnez-vous à ma chaîne Odysee et au fil Telegram Lionel Labosse.
 altersexualite.com
altersexualite.com

