Accueil > Culture générale et expression en BTS > À toute vitesse ! > Du bon usage de la lenteur, de Pierre Sansot
Éloge d’un monde disparu, pour étudiants et adultes
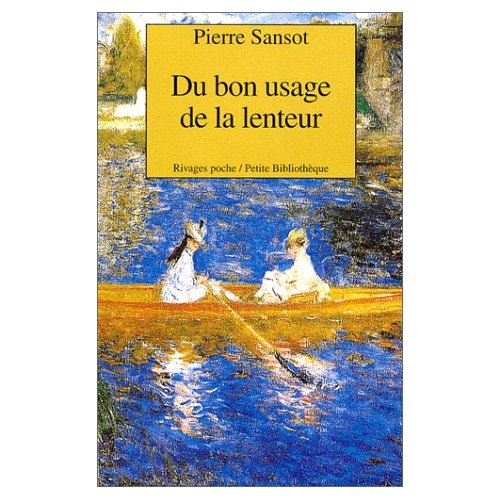 Du bon usage de la lenteur, de Pierre Sansot
Du bon usage de la lenteur, de Pierre Sansot
Rivages poches, Petite bibliothèque Payot, 1988, 204 p., 7,5 €.
samedi 12 octobre 2019, par
Du bon usage de la lenteur de Pierre Sansot (1928-2005) est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « À toute vitesse ! ». Je l’ai choisi au hasard sur cette liste. Ce livre répond à la présentation de l’auteur dans l’article de Wikipédia : « D’un abord facile et en décalage par rapport à la tradition universitaire, son œuvre a la particularité de s’attacher au repérage des petites choses du quotidien qui donnent du sens à la vie des gens ordinaires. » Cet article se limitera à un choix d’extraits utilisables en classe, qui se passent de commentaires. Le livre est divisé en trois grandes parties, dont deux sont subdivisées en chapitres. La datation de 1988 est celle d’une première édition, mais l’exemplaire que j’ai utilisé propose aussi la date de 1998 et 2000, ce qui correspond sans doute à une refonte, d’ailleurs il est question d’Internet à la p. 46, ce qui exclut 1988 comme date de l’ensemble du texte.
Dès l’avant-propos, l’auteur fait référence à Figaro dans Le Mariage de Figaro : « Car comment ne pas rendre hommage au brio, à la vista, à la vivacité ? Il faut alors que l’acteur exécute prestement sa partition, manifestant ainsi un surcroit de maîtrise, de savoir-faire, d’inspiration. Comment ne pas manifester notre gratitude à l’égard de Figaro ? » (p. 13)
Pour parer aux empressements du temps
« Les seniors veulent rattraper le temps perdu durant leur vie professionnelle. Le programme est immense et suppose une réserve inépuisable d’énergies. De fait, ils peuvent se passionner pour toutes sortes de domaines et y manifester des aptitudes réelles : des polyvalents, des polyglottes, des polytechniciens. La pêche au gros (au thon) et la pêche en rivière (à la truite), les langues orientales et les langues amérindiennes […]. Oserais-je me plaindre de cet hyperactivisme, préférerais-je les voir reclus, perdus dans des pensions de retraite ? Certainement pas. Je souhaiterais seulement qu’entre deux voyages en Extrême-Orient et à New York, entre deux séances de gymnastique et de danse, ils trouvent aussi le moyen de penser enfin à eux-mêmes, car ils n’en auront pas eu l’occasion dans leur vie d’adulte » (p. 21).
« Je reviens sur la destinée des personnes âgées au nombre desquelles je figure. Elles avaient enfin acquis le droit de se reposer. S’asseoir sur un banc exposé au soleil, entreprendre une partie de cartes interminable, considérer gravement au café un verre de blanc que l’on buvait par petites gorgées, trottiner du banc à la maison, entrouvrir une blague à tabac pour confectionner délicatement une cigarette, promener les yeux sur la page d’un journal et en particulier les notices nécrologiques. Et pour certaines femmes, tricoter, mettre un tricot, un châle, l’ôter, l’endosser à nouveau (car la température varie d’une heure à l’autre), écosser les haricots blancs, entasser leurs cosses dans un papier journal, puis les vider dans une poubelle : voilà qui tapissait humblement, glorieusement, leurs journées vespérales. Les seniors leur ont succédé et ils ont bon pied, bon œil. On leur suggère d’accomplir toutes sortes d’exploits » (p. 31).
« Je songe cependant que cette aisance n’est pas toujours le fait d’un état d’âme mais qu’elle découle de conditions sociales privilégiées. Une sorte de luxe. Tandis que les travailleurs s’affairent, se bousculent, certains êtres échappent à une telle malédiction. À la campagne, nous éprouvions ce même sentiment à la vue de ceux qui se promenaient tandis que, pendant l’été, nous courbions l’échine sur nos tomates. Certains de ces promeneurs bénéficiaient de vacances qu’ils avaient méritées. Il n’empêche que nous trouvions inconvenant qu’ils aient le loisir de parader et de nous adresser du chemin un petit signe amical. Les hommes pressés – et tels sont les hommes chargés de responsabilités – ne flânent pas. Ils n’ont pas, disent-ils, de temps à perdre, et surtout leur saisie de la ville les en détourne. Qu’ils organisent des spectacles ou qu’ils cherchent à produire un autre espace, ils vivent dans la fébrilité, font face à l’urgence. Un animateur organise d’incessantes manifestations pour divertir les habitants, pour ne pas laisser tarir sa créativité, parce que la production du nouveau incombe à sa mission » (p. 35).
« La promenade ne bénéficie pas de l’aura de la flânerie. Elle éprouve parfois le besoin de se justifier à l’aide de considérations hygiéniques : assurer une bonne digestion, emplir ses poumons d’un air que l’on décrète pur. Il me faut, pour la hausser au-dessus de ces médiocres justifications, la compagnie d’un ami avec lequel je ne suis pas en accord sur toutes choses et qui me force dans mes retranchements, qui excite mon admiration, ma colère. Puis j’associerai les détours et rebonds de nos discussions aux péripéties de notre parcours – à tel carrefour, à tel café et, si nous battons la campagne (ce qui est plus rare), à tel ruisseau, à tel fourré, à tel individu hagard au sortir d’un fourré. J’ai quelques amis aussi batailleurs que moi et les sujets qui nous opposent ne manquent pas. Tout est bon pour nous : la politique, la vie sociale, la métaphysique et même le sport » (p. 37).
« Est-il juste d’écrire qu’avec mes camarades je flânais ? La flânerie est souvent conçue comme une activité qui ne prête pas à conséquence et qui a pour seul effet de mettre un peu de rose aux joues de ceux qui s’y abandonnent. Il est vrai que nous ne dérivions pas dans l’insouciance, qu’à la différence d’un voyageur pressé ou d’un travailleur, nous ne nous fixions pas de but, que le chemin parcouru, reconnu, importait plus que le terme dont nous n’avions pas une idée précise [1]. Seulement, à la différence d’un flâneur frivole, nous avions le sentiment que nous vivions une aventure mémorable et que nous mettions en jeu une partie non négligeable de notre être. Notre légèreté n’excluait pas une certaine gravité » (p. 41).
« J’aime qu’un visiteur, même s’il m’est proche, demeure sur le seuil, qu’il frappe à ma porte, que j’aie à deviner le sens de sa visite, que lui-même prenne le temps de savoir pour quelle raison il s’est rendu chez moi – parfois en vertu de la seule amitié. De mon côté, je ne me permettrais pas de m’introduire chez autrui sans préalable. Ce n’est pas par méfiance à l’égard de l’inconnu, désir exacerbé de préserver ma vie privée. Je crois plutôt que nous ne sommes pas immédiatement en état d’amitié ; même des êtres qu’une longue entente unit doivent, à chaque rencontre, réinstaurer leur amitié. Une certaine durée est nécessaire pour nous approcher d’un autre être. C’est la grande leçon de l’hospitalité. Nous avons à rendre au visiteur les honneurs qu’il mérite et cela exige du temps. Quant à celui qui arrive auprès de nous, il doit se présenter : ce n’est pas là un contrôle d’identité, mais il lui faut peu à peu se pénétrer de ma demeure, de mon intérieur, de mon âme, pour devenir en quelque sorte mon semblable. Sous certaines précautions, comme l’on disait chez les gens de peu qui, d’instinct, avaient adopté cette forme royale de la politesse » (p. 47).
« Je vous propose un ennui dans lequel on s’étire voluptueusement, par lequel on bâille de plaisir, tout au bonheur de n’avoir rien à faire, de remettre à plus tard ce qui n’est pas urgent. Vous vivez alors le sentiment de la non-urgence.
Ce n’est pas là une chance accordée à beaucoup. Il faut s’y préparer de très bonne heure. Elle échappera à l’enfant ronchonnant parce qu’il ne possède pas les jouets désirés ou qu’un petit camarade lui a fait faux bond ou qu’on lui sert à table des épinards. Par bonheur, je devine que vous avez traîné votre ennui dans un village banal. De votre grenier, vous inspectiez la route à la recherche d’un événement, le vrombissement d’une moto, une roulotte de romanos – et nul véhicule ne soulevait la poussière du chemin. À la fin de l’après midi, vous étiez satisfait des heures passées à la fenêtre de votre grenier. Je relève un signe de bonne santé : vous demeuriez dans l’attente de la poussière sur cette route recouverte de bitume.
Malgré un début prometteur, vous n’êtes pas en état de grâce pour la vie, la grâce consistant à s’émerveiller de ses disgrâces. Une fois abandonné le grenier où vous vous penchiez, l’univers s’est emparé de vous, il vous a promis monts et merveilles : des magnétoscopes, un voyage à Rome, la Ville Éternelle, ou à Vienne au bord du beau Danube bleu, des nuits plus belles que vos jours, des jeunes femmes parfaites comme des « top models ».
Que la sagesse vous guide dans le choix de votre ville, de votre travail, de votre future femme, de vos amis. Si une ville trépide, fulmine, présente chaque matin un nouveau visage, programme sans cesse des activités culturelles, si tour à tour elle se barricade puis se rend, puis reprend l’étendard de la révolte, vous n’échapperez pas à la surcharge d’événements et vous y prendrez goût. Vous oublierez le temps délicieux où rien ne se passait, sinon une durée pure – pure parce que rien ne la troublait. Vous méconnaîtrez peu à peu ce que veut dire pureté, poésie pure (à la limite du silence), politique pure (à la limite de la frigidité), religion pure (à la limite d’un Dieu si peu figurable que vous ne le rencontrerez jamais).
Perdant la retenue qui faisait votre charme, quand des jeunes gens en colère défileront, quand des foules façonneront une queue devant une salle de cinéma ou un musée, quand des foules se porteront vers un stade, vous leur crierez : « Attendez-moi, je suis des vôtres. Je veux brailler avec vous. Je veux piétiner avec vous les parquets d’un musée. » Ils vous entendront.
Sur le coup de trois heures du matin, épuisé et ravi, vous aurez la faiblesse de prononcer : « C’est dingue », car vous aurez rejoint la foule innombrable des mal-disants et vous vous sentirez ainsi bien au chaud au milieu de phrases convenues en ajoutant des « quelque part », des « revisiter ».
Fuyez les agglomérations de cette espèce. Je n’ai aucune confiance dans les villes aussi turbulentes, tourmentées, oublieuses d’elles-mêmes et de leur âme » (pp. 55-57).
« Qu’en est-il d’une personne fort âgée ? Que peut-elle attendre, sinon la mort, quand elle a la force de la considérer s’approchant d’elle et pour qu’ainsi regardée, examinée, elle devienne en quelque sorte son bien et non point une intruse ? Nul de peut exiger de nous un pareil héroïsme, et peut-être la mort imminente sera-t-elle si différente de la mort présumée que nous ne pourrons pas estimer l’avoir véritablement attendue. Seule une espérance qui nous habite sans raison et à laquelle nous nous abandonnons comme à une grâce indubitable sera en mesure de nous délivrer de l’accablement. Et alors, pourquoi cette grâce visite-t-elle les uns et non point les autres ? » (p. 74).

« Avoir la patience d’attendre celui ou celle qui nous élira et que nous élirons. Une telle attitude exige une âme forte, soucieuse de vérité. Nous sommes pour la plupart impatients de jouer le rôle excitant, gratifiant d’amoureux(se). Parce que tout est signe, il nous est facile de décider et de jurer que c’est là un grand amour. Ou encore, nous croyons plausible d’essayer le scénario à plusieurs reprises, de le peaufiner avant qu’il nous infuse l’harmonie souhaitée. Nous multiplions les castings pour dénicher un figurant à peu près convenable. Nous n’admettons pas que l’amour est un événement improbable et que, sans doute, il ne nous échoira pas. Davantage, nous revendiquons un droit à l’amour tout comme un droit au bonheur, au logement, au travail.
Je ne mets pas en cause le vagabondage sexuel, mais l’illusion au terme de laquelle nous sommes l’élu(e) et béni(e) entre tous les hommes ou toutes les femmes » (p. 76).
« Dans un autre pays que la province nous aurions étouffé. Ce qui ailleurs aurait semblé un horrible bric-à-brac apparaissait comme une harmonie céleste et je devine les raisons de ce regard bienveillant. Nos hôtes avaient accumulé les achats. Ils n’auraient jamais accepté de se délester de l’un d’entre eux. Parce qu’il ne faut rien jeter ? ou plutôt en vertu des lois de l’hospitalité ? Quand nous avons acheté ou reçu un objet, il n’est plus question de rompre le pacte d’amitié que nous avons conclu avec lui et de l’expulser piteusement. C’est ainsi que nous promenions nos regards au milieu d’innombrables icônes et cette pendule était celle d’une grand-mère, et ce service en porcelaine avait été un cadeau de mariage, et ce napperon avait été gagné lors d’une tombola organisée par une œuvre de bienfaisance. Heureux ces personnages et ces événements qui, par la piété des hommes, avaient échappé au naufrage du temps – et j’imaginais que nos amis retarderaient l’échéance de leur propre mort pour soustraire leurs reliques à des héritiers moins fidèles qu’eux. Hors de cette considération majeure, ces gens-là n’avaient pas été atteints par le virus de la nouveauté. L’habiter n’avait pas de rapport à l’esthétique (du dénuement), au confort. Il était de l’ordre de la fondation et de la commémoration. J’ai été reçu à Paris en des maisons empreintes de cette même vertu et j’ai acquis la conviction que la province consistait en un état d’âme et qu’elle ne logeait pas nécessairement en des lieux déterminés par la géographie » (p. 87).
« Étudiant, j’ai raté certains cours parce que la ville me retenait par telle façade, par l’affairement des ménagères. J’ai manqué, pour cette même raison, des rendez-vous qui n’étaient pas seulement d’ordre amoureux. Enseignant, je regagnais mon collège en flânant le long d’une campagne heureuse de s’ébrouer au soleil. Mes élèves en étaient réduits à m’attendre avant d’être conduits à la permanence. J’ai eu honte de mon inconduite et j’ai pris la résolution de marcher la tête haute, espérant que de merveilleux nuages ne suspendraient pas mon parcours. Il nous faut nous soumettre aux devoirs de notre tâche sans succomber à une totale indifférence : le monde se réduirait alors à un ensemble de signaux à décoder le plus vite possible » (p. 97).
« La lenteur n’est pas la marque d’un esprit dépourvu d’agilité ou d’un tempérament flegmatique. Elle peut signifier que chacune de nos actions importe, que nous ne devons pas l’entreprendre à la hâte avec le souci de nous en débarrasser. Mais quoi, une vie n’est-elle pas, dans son immense part, composée de tâches insignifiantes ? Christian Bobin nous avertit du contraire – et si nous lui donnons raison, nous aurons à vivre autrement : « Il faudrait accomplir toutes choses et même et surtout les plus ordinaires, ouvrir une porte, écrire une lettre, tendre une main, avec le plus grand soin et l’attention la plus vive, comme si le sort du monde et le cours des étoiles en dépendaient et d’ailleurs il est vrai que le sort du monde et le cours des étoiles en dépendent. » À la vérité, nous nous engageons plus que nous ne le pensons dans le cours ordinaire de nos actions : ouvrir une porte nous permet de passer du dehors au dedans, d’une pièce à une autre pièce, et de nous laisser saisir par une autre atmosphère et de voguer sous d’autres cieux. Quand j’ouvre les volets, si ma maison en est pourvue, j’accepte que le monde vienne à moi, je lui adresse un signe d’amitié, je l’assure que nous ferons un bout de chemin ensemble, que nous chercherons à ne pas nous montrer déplaisant l’un à l’égard de l’autre » (p. 98).
« Ordonner une cave, c’est se livrer à un acte de foi dans l’avenir. Il faudra du temps pour que les bouteilles vieillissent et espérer que ce temps-là ne nous manquera pas à la suite d’un accident ou d’une échéance fatale. On les destine à une communion, au mariage d’un enfant, mais l’enfant se mariera-t-il et s’il se marie, acceptera-t-il qu’on célèbre l’événement en famille ? Des bouteilles destinées à un repas d’amis ne comportent pas un aspect aussi solennel, une durée familiale faite de deuils, de bonheurs, de séparations, de réconciliations. Au moment de quérir la bouteille, le chef de famille, de surcroit caviste, se souvient de l’époque lointaine où il logea chez lui avant d’en prendre soin. Une vieille bouteille achetée chez un négociant aura vieilli sans nous et il y a quelque inconvenance à nous en saisir à la fleur de l’âge, sans rien connaître de sa vie antérieure » (p. 110).
« Avec l’âge, beaucoup d’entre nous pressent le pas. Ils s’aperçoivent qu’il y a tant de choses à voir, tant de mets à goûter, tant de pays à visiter, tant d’existences à côtoyer. Comment expliquer une pareille fringale ? Certains furent privés, durant leur vie active, et du dessert, et du plat du jour. Des congés étriqués leur permirent seulement de récupérer avant de travailler à nouveau. Ils espèrent enfin découvrir leurs passions. La pensée de la mort les incite à ne plus tarder. C’est ainsi que des étudiants, quelques mois avant leurs examens, se jettent dans le travail parce que le temps leur est compté. Par nonchalance, et aussi parce qu’il me paraît improbable de tout épuiser et qu’il me fut possible de trouver le bonheur là où je le situais, je manifeste moins de gourmandise et de hâte. J’ignore quelle en est la substance. En revanche, je sais ce qui m’en détourna : le bavardage, la mesquinerie, au fond « les vanités ».
Je pense que l’essentiel ne se capture pas. Qui suis-je ? Qui fus-je ? Dans quelles circonstances ai-je causé du tort à mes semblables ? Mais l’essentiel est encore autre chose que je ne parviens pas à préciser. Mon être me paraît si immense et si obscur. La demeure est vaste : comment guider mes pas dans cette enfilade de pièces et de corridors ? Je risque de trébucher. J’ouvre avec circonspection mes portes. Je les referme avec les mêmes précautions. Je regarde sous les lits, dans les placards. Je soupçonne des soupirails (sic) dans lesquels il me faut prendre garde de ne pas plonger. Ma torche donne des signes de faiblesse. Demain, je reviendrai et je m’orienterai mieux. Mais demain, la demeure aura-t-elle encore ses portes entrouvertes ? J’époussette mes vêtements pour ne pas inquiéter mes proches au retour de mon expédition » (p. 119).
L’alternance des rythmes
« Le choix de la lenteur ne suppose-t-il pas que l’Être consent à répondre à notre attente et qu’il suffit d’un peu de patience pour en connaître les innombrables manifestations ? Ce serait sous-estimer la vertu de la surprise. Celle-ci n’aurait pas seulement un rôle ponctuel : attirer sur nous l’attention, déstabiliser l’autre. Elle nous permettrait de contraindre l’univers à se découvrir. Nous faisons alors le pari que le monde ronronne, qu’il présente le gros dos, qu’il bâille à la pensée que tout se répète. Il feint de s’absenter dès lors que nous prétendons le tirer de sa langueur. Il ne consentira à s’éveiller que si l’étrange semble lui rendre visite. Ainsi d’une personne lassée par tant de phrases convenues, de gestes prévisibles. Il faut alors frapper un grand coup. Julien Sorel met en jeu sa réputation pour émouvoir Mathilde. Le héros de Belle du Seigneur se présente à l’Aimée sous un accoutrement qui eût pu sembler grotesque. Pour inaugurer des relations amoureuses, ils ont secoué, déchiré la trame de la durée. Ils vont vite afin que l’effet de surprise ne s’estompe pas à la réflexion ou par l’effet de l’accoutumance » (p. 131).
« J’aurais désiré alterner le fugace et le durable. J’évoque, sur le mode de la métaphore, un homme chez lequel les actions rapides et les rythmes lents se succèdent. Il a tranché du bois d’un geste bref et sûr. Puis il le range minutieusement en tas. Sa tâche accomplie, il se décrotte. Il se déchausse. Il cherche des pantoufles déposées sur un escalier intérieur. Lentement. Il mâche ses aliments consciencieusement et (pourquoi pas ?) il sauce son pain dans une assiette odorante. Il a un sommeil lourd. Au moment du réveil, une brume légère continue d’envahir sa conscience.
J’aimerais que ce même individu sache bondir. Riposter vivement à une injustice. Accompagner le cri perçant de certains oiseaux. S’il joue au football, trouer la défense adverse par une passe lumineuse. Déchirer l’aube d’une journée d’été. Manifester de la hardiesse face à une situation précaire. Attraper au vol une chance qui ne lui sera pas offerte une seconde fois » (p. 137).
Procès, utopies et conseils
« Le slogan « plus haut », « plus vite », « plus loin » a débordé le cadre des jeux. Il inspire nos politiques culturelles, alors que la culture, cet art des détours, de la vacance, des mots et des pas perdus, aurait dû être, si nous tenons à une devise : « moins haut », « moins vite », « moins loin » (p. 145).
« Ce terme de « retardataire » dont nous usons moins aujourd’hui, possédait une nuance péjorative. Le retardataire ne l’était pas par accident. Il était dans sa nature de n’être point exact à ses rendez-vous à l’école, pour un pique-nique, à l’église et, du coup, il fallait l’attendre. Il mettait à mal l’ordre collectif. On le réprimandait sans méchanceté. Je me demande s’il n’agissait pas avec malice. Ainsi, à l’occasion de la rentrée scolaire, il était arrivé après les autres et il ne se déferait jamais de ce premier contretemps.
Prôner un urbanisme du retardement, quelle chimère puisque, précisément, ce dernier consiste à lever les obstacles qui entravent les flux des travailleurs ou des marchandises ! Dès son origine, il manifeste la volonté de prendre en main des villes encore livrées à elles-mêmes ou à des conceptions archaïques, désordonnées, relevant de la tradition ou du sacré. Un tel volontarisme, pour être légitime, devait se traduire par une relance ininterrompue des processus urbains. Ne rien faire ou laisser faire aurait été considéré comme contraire à sa vocation et aurait relevé de la négligence. Un urbanisme, s’il n’agit pas sans cesse et sans trêve, apparaît inutile.
Il y a donc quelque provocation dans cette expression. A-t-elle même un sens ? Toutes les mesures de retardement que nous pouvons proposer sembleront dérisoires. Ce ne sont pas les hommes, ce sont les lieux mêmes qui, en vertu de leur génie, se montrent capables de capter notre être, de le rendre captif, de lui laisser entendre que là, en ce point, réside le bonheur et qu’il serait déraisonnable de nous en éloigner au plus vite. Une connivence d’ordre poétique et non un jeu de contre-déterminations, de boyaux d’étranglement, de gendarmes couchés, de signes dissuasifs. J’admets cette observation. Mon projet serait donc plus modeste. Je n’ai pas la prétention d’enfermer les passants dans des rets dont ils sortiraient difficilement, mais de mettre fin, de-ci, de-là, aux accélérations auxquelles ils ont de la peine à résister. Je désirerais que l’on conserve ou que l’on restaure des espaces d’indétermination où les individus auraient la liberté de demeurer dans un état de vacance ou de poursuivre leur marche » (p. 158). [2]
« On pensera aussi au Bricolage, à l’infinie patience du bricoleur, à sa capacité de mettre bout à bout des éléments disparates, de chercher des bouts de ficelle et des cartons, de garder l’œil fixe sur une pièce à laquelle il voudrait à toute force trouver un usage, à son désir irrépressible d’inventer des obstacles pour arriver à un résultat qu’un peu de rationalité obtiendrait au plus vite.
J’aimerais mettre en évidence des formes moins repérables ou auxquelles on ne donne pas au premier chef cette signification : la grasse matinée, comme si le dimanche devait contraster avec les vaches maigres de la semaine. Ce matin-là, l’homme s’éveille peu à peu à lui-même, il reconnaît son visage, celui de ses enfants et de sa femme. Il tâtonne comme pour explorer son corridor, sa main ne s’empare pas tout de suite des objets familiers ; elle se dirige vers eux. Il garde longtemps sa physionomie et son expression de la nuit et c’est pourquoi il ne se rase pas tout de suite ; c’est pourquoi il n’a pas honte du sommeil qui boursoufle ses paupières, de son haleine, de ce qu’il y a de flétri dans son corps et ses vêtements. Plus tard il ira reconnaître du même pas hésitant sa rue, ses magasins, il lui faudra du temps pour se dégourdir les jambes, lui qui d’habitude court pour attraper un bus ou un métro » (p. 188).
– Retrouvez un extrait de ce livre dans un corpus original pour une synthèse : vitesse / lenteur.
Voir en ligne : Article de Wikipédia sur l’auteur
© altersexualite.com 2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Phrase qui rappelle la fameuse formule d’Antonio Machado.
[2] Un certain Grégoire Saint-Remy a plagié cette page dans un article intitulé « Ségrégations urbaines et résistance civile », sur cairn.info.
 altersexualite.com
altersexualite.com