Accueil > Culture générale et expression en BTS > Invitation au voyage… > Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau
Lecture analytique, classe de première
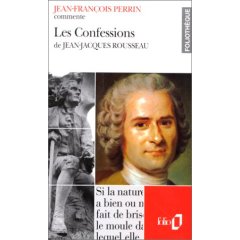 Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau
Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau
Les « infâmes » au siècle des Lumières
lundi 1er octobre 2007
Livre II, la mésaventure avec le faux Maure. Un extrait célèbre d’une des œuvres phares de la littérature française, qu’on ose rarement étudier, mais qui permet d’évoquer l’histoire de la perception de l’homosexualité, l’histoire de l’homophobie, et d’éclairer la personnalité contrariée de Rousseau, à replacer parmi ses contemporains des Lumières, pas toujours si lumineux que ça sur la question. Classe de Première L (l’autobiographie), ou toutes sections (l’argumentation, les Lumières). Cette lecture analytique sera suivie du compte rendu de lecture de l’ensemble des Confessions, où l’on découvrira que notre Jean-Jacques avait quelque chose d’altersexuel !
Les Confessions figure sur la liste du BO pour le thème de Culture générale & expression 2022-2023 : « Invitation au voyage… ». Je n’ai pas relu Les Confessions à cette occasion, je me contente de cet article qui date de 2007, et qui ne place pas du tout au centre la question du voyage, désolé.
Le texte de Rousseau
« Il n’y a point d’âme si vile et de cœur si barbare qui ne soit susceptible de quelque sorte d’attachement. L’un de ces deux bandits qui se disaient Maures me prit en affection. Il m’accostait volontiers, causait avec moi dans son baragouin franc, me rendait de petits services, me faisait part quelquefois de sa portion à table, et me donnait surtout de fréquents baisers avec une ardeur qui m’était fort incommode. Quelque effroi que j’eusse naturellement de ce visage de pain d’épice, orné d’une longue balafre, et de ce regard allumé qui semblait plutôt furieux que tendre, j’endurais ces baisers en me disant en moi-même : le pauvre homme a conçu pour moi une amitié bien vive ; j’aurais tort de le rebuter. Il passait par degrés à des manières plus libres, et tenait de si singuliers propos, que je croyais quelquefois que la tête lui avait tourné. Un soir, il voulut venir coucher avec moi : je m’y opposai, disant que mon lit était trop petit. Il me pressa d’aller dans le sien : je le refusai encore ; car ce misérable était si malpropre et puait si fort le tabac mâché, qu’il me faisait mal au cœur.
Le lendemain, d’assez bon matin, nous étions tous deux seuls dans la salle d’assemblée : il recommença ses caresses, mais avec des mouvements si violents qu’il en était effrayant. Enfin, il voulut passer par degrés aux privautés les plus malpropres et me forcer, en disposant de ma main, d’en faire autant. Je me dégageai impétueusement en poussant un cri et faisant un saut en arrière, et, sans marquer ni indignation ni colère, car je n’avais pas la moindre idée de ce dont il s’agissait, j’exprimai ma surprise et mon dégoût avec tant d’énergie, qu’il me laissa là : mais tandis qu’il achevait de se démener, je vis partir vers la cheminée et tomber à terre je ne sais quoi de gluant et de blanchâtre qui me fit soulever le cœur. Je m’élançai sur le balcon, plus ému, plus troublé, plus effrayé même que je ne l’avais été de ma vie, et prêt à me trouver mal.
Je ne pouvais comprendre ce qu’avait ce malheureux : je le crus saisi du haut mal, ou de quelque frénésie encore plus terrible, et véritablement je ne sache rien de plus hideux à voir pour quelqu’un de sang-froid que cet obscène et sale maintien, et ce visage affreux enflammé de la plus brutale concupiscence. Je n’ai jamais vu d’autre homme en pareil état ; mais si nous sommes ainsi dans nos transports près des femmes, il faut qu’elles aient les yeux bien fascinés pour ne pas nous prendre en horreur.
Je n’eus rien de plus pressé que d’aller conter à tout le monde ce qui venait de m’arriver. Notre vieille intendante me dit de me taire, mais je vis que cette histoire l’avait fort affectée, et je l’entendais grommeler entre ses dents : Can maledet ! bruta bestia ! Comme je ne comprenais pas pourquoi je devais me taire, j’allai toujours mon train, malgré la défense, et je bavardai si bien que le lendemain un des administrateurs vint de bon matin m’adresser une assez vive mercuriale, m’accusant de faire beaucoup de bruit pour peu de mal et de commettre l’honneur d’une maison sainte.
Il prolongea sa censure en m’expliquant beaucoup de choses que j’ignorais, mais qu’il ne croyait pas m’apprendre, persuadé que je m’étais défendu sachant ce qu’on me voulait, et n’y voulant pas consentir. Il me dit gravement que c’était une œuvre défendue, ainsi que la paillardise, mais dont au reste l’intention n’était pas plus offensante pour la personne qui en était l’objet, et qu’il n’y avait pas de quoi s’irriter si fort pour avoir été trouvé aimable. Il me dit sans détour que lui-même, dans sa jeunesse, avait eu le même honneur, et qu’ayant été surpris hors d’état de faire résistance, il n’avait rien trouvé là de si cruel. Il poussa l’impudence jusqu’à se servir des propres termes, et s’imaginant que la cause de ma résistance était la crainte de la douleur, il m’assura que cette crainte était vaine, et qu’il ne fallait pas s’alarmer de rien.
J’écoutais cet infâme avec un étonnement d’autant plus grand qu’il ne parlait point pour lui-même ; il semblait ne m’instruire que pour mon bien. Son discours lui paraissait si simple qu’il n’avait pas même cherché le secret du tête-à-tête : et nous avions en tiers un ecclésiastique que tout cela n’effarouchait pas plus que lui. Cet air naturel m’en imposa tellement, que j’en vins à croire que c’était sans doute un usage admis dans le monde, et dont je n’avais pas eu plus tôt occasion d’être instruit. Cela fit que je l’écoutai sans colère, mais non sans dégoût. L’image de ce qui m’était arrivé, mais surtout de ce que j’avais vu, restait si fortement empreinte dans ma mémoire, qu’en y pensant, le cœur me soulevait encore. Sans que j’en susse davantage, l’aversion de la chose s’étendit à l’apologiste, et je ne pus me contraindre assez pour qu’il ne vît pas le mauvais effet de ses leçons. Il me lança un regard peu caressant, et dès lors il n’épargna rien pour me rendre le séjour de l’hospice désagréable. Il y parvint si bien que, n’apercevant pour en sortir qu’une seule voie, je m’empressai de la prendre, autant que jusque-là je m’étais efforcé de l’éloigner.
Cette aventure me mit pour l’avenir à couvert des entreprises des Chevaliers de la manchette, et la vue des gens qui passaient pour en être, me rappelant l’air et les gestes de mon effroyable Maure, m’a toujours inspiré tant d’horreur, que j’avais peine à la cacher. Au contraire, les femmes gagnèrent beaucoup dans mon esprit à cette comparaison : il me semblait que je leur devais en tendresse de sentiments, en hommage de ma personne, la réparation des offenses de mon sexe, et la plus laide guenon devenait à mes yeux un objet adorable, par le souvenir de ce faux Africain.
Pour lui, je ne sais ce qu’on put lui dire ; il ne me parut pas que, excepté la dame Lorenza, personne le vît de plus mauvais œil qu’auparavant. Cependant il ne m’accosta ni ne me parla plus. Huit jours après, il fut baptisé en grande cérémonie, et habillé de blanc de la tête aux pieds, pour représenter la candeur de son âme régénérée. Le lendemain il sortit de l’hospice et je ne l’ai jamais revu. »
Questionnaire
– L’extrait proposé aux élèves se limite aux trois premiers paragraphes, jusqu’à « pour ne pas nous prendre en horreur ». Seule la dernière question fait référence à la suite de l’extrait. On signale aux élèves quelques pages plus haut dans le Livre II, la première apparition de ces personnages : « Deux de ces coquins étaient des Esclavons, qui se disaient Juifs et Maures, et qui, comme ils me l’avouèrent, passaient leur vie à courir l’Espagne et l’Italie, embrassant le christianisme et se faisant baptiser partout où le produit en valait la peine ». Une note de l’édition GF Flammarion procurée par Alain Grosrichard, précise que le faux maure s’appelait Abraham Ruben, juif levantin d’Alep, et qu’il avait vingt ans.
La lecture proposée suit un plan linéaire.
– Recherche documentaire : Qu’a désigné au fil du temps le mot « Maure » en français ? Expliquer « susceptible », « rebuter », « privautés », « concupiscence ».
– 1. Le blâme (jusqu’à « il me faisait mal au cœur »)
– 1.1. Relevez et commentez les termes péjoratifs dans le portrait du Maure.
– 1.2. Qu’est-ce qui peut rapprocher cette anecdote de la rencontre avec le curé de Pontverre, au début du livre II ?
– 1.3. Comment Rousseau fait-il ressortir, en l’opposant au Maure, sa propre innocence ? Qui s’exprime ici, le personnage ou l’écrivain ?
– 2. Une anecdote (jusqu’à « prêt à me trouver mal »)
– 2.1. Résumez la scène en quelques mots, sans utiliser de termes grossiers. Relevez les expressions par lesquelles Rousseau désigne ce qui s’est passé en évitant les mots précis. Comment s’appelle ce procédé consistant à ne pas nommer clairement les choses ? Commentez.
– 2.2. Commentez la forme du texte dans ce paragraphe (rythme, syntaxe, figures…).
– 3. Du personnage à l’auteur (jusqu’à « prendre en horreur »).
– 3.1. Commentez le changement des temps verbaux utilisés dans ce paragraphe, et montrez qu’il correspond à un changement de point de vue entre auteur, personnage et narrateur.
– 3.2. Sur quelle idée se clôt l’extrait ? Cette conclusion est-elle cohérente avec l’anecdote ?
– 3.3. Lisez les deux pages suivantes (jusqu’à « ce faux Africain »), relevez les mots qui désignent les homosexuels et l’homosexualité. Montrez que Rousseau utilise cette anecdote pour exposer certains préjugés personnels contre trois types de personnes.
Commentaires
Dans mon Journal de bord à la date du mardi 24 mai 2005, j’avais relaté une lecture des Confessions en 3e. Un an plus tard j’ai eu l’occasion de reprendre cet extrait par une lecture analytique en classe de première. En effet, l’objet d’étude « Le biographique » permettait d’approfondir le travail sur l’autobiographie accompli en troisième. Depuis 2007/08, cet objet d’étude fut réservé aux 1re L, limité à l’autobiographie, et il a disparu des programmes par la suite. Mais l’extrait peut s’étudier sous l’angle de l’argumentation ou du mouvement littéraire (Lumières). Cet extrait est proposé en relation avec un autre extrait du livre II sur la rencontre du curé de Pontverre, qui présente la même structure d’essai basé sur une anecdote et un portrait à charge (blâme). Il convient de rappeler à nos élèves la situation de Jean-Jacques Rousseau en 1728, année de ces événements : orphelin de mère dès la naissance, son frère ayant disparu, son père l’a laissé aux soins de son oncle, lequel l’a confié à un pasteur, puis à un maître d’apprentissage qui le maltraite, de sorte qu’il quitte Genève et se retrouve seul, comme un vagabond, sur la route, réduit à accepter l’hospitalité de quiconque croise sa route ; il n’a que 16 ans. De quoi relativiser nos petites peines d’enfants gâtés, non ? On est loin des relations avunculaires.
Les questions 1.1. et 3.3. pointent les stéréotypes et préjugés qui imprègnent le texte, et l’utilisation conventionnelle dans le processus de l’homophobie de l’amalgame entre homosexualité et une autre catégorie que l’on veut rejeter. L’homosexuel ici, permet de stigmatiser le catholicisme, présenté dans l’ensemble du chapitre comme une « religion dogmatique ». Le glissement se fait comme naturellement, mis au passif de l’innocence de l’adolescent : « Sans que j’en susse davantage, l’aversion de la chose s’étendit à l’apologiste ». De plus, comme si cela ne suffisait pas, l’homosexuel est en même temps un « Esclavon », un « Juif » et un « Maure ». N’en jetez plus ! De quoi réexaminer la question de la sincérité de l’auteur proclamée dans le préambule et l’incipit.
La question 2.1. permet de mesurer la pudeur des élèves. Certains rougiront, d’autres se feront un malin plaisir à hurler les mots attendus. On fera remarquer l’ambiguïté de la périphrase, qui ne relève pas toujours de l’euphémisme, malgré l’affirmation de l’auteur : « Il poussa l’impudence jusqu’à se servir des propres termes ». L’impudence n’est-elle pas plutôt dans cette formule faussement naïve : « je vis partir vers la cheminée et tomber à terre je ne sais quoi de gluant et de blanchâtre » ? Une élève a fort justement remarqué qu’il s’agissait d’une « prétérition qui consiste à faire semblant de ne pas vouloir dire ce que l’on exprime cependant avec force ». Enfin une courte discussion aura sans doute lieu : s’agit-il d’un viol, d’un abus sexuel ? La question de la sincérité de Rousseau se pose encore, car certains épisodes précédents le montraient plus au fait de la sexualité ! Plusieurs élèves m’ont ressorti la même remarque que j’avais entendue déjà en 3e, à savoir que « Rousseau était homosexuel » parce qu’il embrassait son cousin. Il leur paraît donc cohérent que cette homophobie coïncide avec l’homosexualité.Ont-ils prêté attention à cette phrase, dans l’épisode de Bossey, à l’évocation du désir qu’il éprouve, âgé de 8 ans, à être fessé par Mlle Lambercier : « le même châtiment reçu de son frère ne m’eût point du tout paru plaisant » ?
La question 3.2. est censée mettre en évidence l’incohérence de l’amalgame entre une relation non consentie et une relation amoureuse consentie, ainsi que la propension révélatrice de Rousseau à adopter le point de vue féminin.
La dernière question permet de relever les mots « infâme », « Chevaliers de la manchette », « en être », « chose », euphémismes et mots péjoratifs, en l’absence du mot « homosexuel », pas encore forgé. L’édition « Petits Classiques Larousse », pourtant récente (1998), ne s’embarrasse pas de scrupules pour indiquer en note à « Chevaliers de la manchette » : « pédérastes », tout en rappelant dans une formule alambiquée « l’histoire d’un empereur de Chine qui, jadis, aurait découpé sa manche afin de ne pas réveiller son favori » (p. 142). En outre, cette lecture analytique m’aura fourni parmi les plus beaux lapsus calami de la part d’élèves : « cet homme lui prêtre un intérêt particulier » (d’une élève qui a cru d’autre part que le Maure était un prêtre) ; « hardeur sexuelle » (pour le Maure) ; « mythonimie » (pour la périphrase)…
À savoir : Dans Genèse, censure, autocensure (CNRS éd., 2005), Philippe Lejeune explique que la première édition des Confessions, publiée en 1782 à Genève, était amputée de passages scabreux, dont celui-ci. Il fallut attendre 1798 pour retrouver le texte complet.
– Voici l’un des passages concernant le cousin de Jean-Jacques : « Tous deux dans le même lit nous nous embrassions avec des transports convulsifs, nous étouffions et quand nos jeunes cœurs un peu soulagés pouvaient exhaler leur colère, nous nous levions sur notre séant, et nous nous mettions tous deux à crier cent fois de toute notre force : Carnifex, Carnifex, Carnifex ! ».
– Dès qu’il est question de sexualité, Rousseau pousse loin l’art de la périphrase suggestive. Par exemple celle-ci dans l’épisode fameux autant que fumeux de la fessée : « N’imaginant que ce que j’avais senti, malgré des effervescences de sang très incommodes, je ne savais porter mes désirs que vers l’espèce de volupté qui m’était connue, sans aller jamais jusqu’à celle qu’on m’avait rendue haïssable et qui tenait de si près à l’autre sans que j’en eusse le moindre soupçon. Dans mes sottes fantaisies, dans mes érotiques fureurs, dans les actes extravagants auxquels elles me portaient quelquefois, j’empruntais imaginairement le secours de l’autre sexe, sans penser jamais qu’il fût propre à nul autre usage qu’à celui que je brûlais d’en tirer. » Tout ça pour avouer que ce petit coquin précurseur de Leopold von Sacher-Masoch aimait à être fessé par les femmes !
Notre extrait avait fait l’objet d’un vrai-faux premier récit plus ou moins autobiographique, bousculant pour le moins le pacte autobiographique. C’est au début du Livre IV de L’Émile :
Au lieu de vous dire ici de mon chef ce que je pense, je vous dirai ce que pensait un homme qui valait mieux que moi. Je garantis la vérité des faits qui vont être rapportés. Ils sont réellement arrivés à l’auteur du papier que je vais transcrire. C’est à vous de voir si l’on peut en tirer des réflexions utiles sur le sujet dont il s’agit. Je ne vous propose point le sentiment d’un autre ou le mien pour règle ; je vous l’offre à examiner.
« Il y a trente ans que, dans une ville d’Italie, un jeune homme expatrié se voyait réduit à la dernière misère. Il était né Calviniste, mais, par les suites d’une étourderie se trouvant fugitif, en pays étranger, sans ressource, il changea de religion pour avoir du pain. Il y avait dans cette ville un hospice pour les prosélytes ; il y fut admis. En l’instruisant sur la controverse, on lui donna des doutes qu’il n’avait pas, et on lui apprit le mal qu’il ignorait : il entendit des dogmes nouveaux, il vit des mœurs encore plus nouvelles ; il les vit, et faillit en être la victime. Il voulut fuir, on l’enferma ; il se plaignit, on le punit de ses plaintes ; à la merci de ses tyrans il se vit traiter en criminel pour n’avoir pas voulu céder au crime. Que ceux qui savent combien la première épreuve de la violence et de l’injustice irrite un jeune cœur sans expérience se figurent l’état du sien. Des larmes de rage coulaient de ses yeux, l’indignation l’étouffait. Il implorait le ciel et les hommes, il se confiait à tout le monde, et n’était écouté de personne. Il ne voyait que de vils domestiques soumis à l’infâme qui l’outrageait, ou des complices du même crime, qui se raillaient de sa résistance et l’excitaient à les imiter. Il était perdu sans un honnête Ecclésiastique qui vint à l’hospice pour quelque affaire, et qu’il trouva le moyen de consulter en secret. L’ecclésiastique était pauvre et avait besoin de tout le monde ; mais l’opprimé avait encore plus besoin de lui, et il n’hésita pas à favoriser son évasion, au risque de se faire un dangereux ennemi. »
Quelques pages plus loin, l’auteur finit par reconnaître : « Je me lasse de parler en tierce personne, et c’est un soin fort superflu ; car vous sentez bien, cher concitoyen, que ce malheureux fugitif, c’est moi-même ; je me crois assez loin des désordres de ma jeunesse pour oser les avouer, et la main qui m’en tira mérite bien qu’aux dépens d’un peu de honte je rende au moins quelque honneur à ses bienfaits. »
Dans le livre III des Confessions, Rousseau reconnaît la supercherie de cette supercherie proposée pour vérité : « Je ne sais s’il aura pu dans la suite rétablir ses affaires ; mais le sentiment de son infortune, profondément gravé dans mon cœur, me revint quand j’écrivis l’Emile, et réunissant M. Gâtier avec M. Gaime, je fis de ces deux dignes prêtres l’original du Vicaire savoyard. Un forfait en entraînant un autre, que croire de cette anecdote à géométrie si variable ?
– Ce texte pourrait être mis en relation avec les extraits célèbres des auteurs dits des Lumières (appel à contributions, chers collègues !)
– Voltaire, article « AMOUR SOCRATIQUE » du Dictionnaire Philosophique : « Je ne peux souffrir qu’on prétende que les Grecs ont autorisé cette licence. […] Sextus Empiricus et d’autres ont beau dire que la pédérastie était recommandée par les lois de la Perse. Qu’ils citent le texte de la loi ; qu’ils montrent le code des Persans, et, s’ils le montrent, je ne le croirai pas encore, je dirai que la chose n’est pas vraie, par la raison qu’elle est impossible. Non, il n’est pas dans la nature humaine de faire une loi qui contredit et qui outrage la nature, une loi qui anéantirait le genre humain si elle était observée à la lettre. »
– Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, chapitre XII, 6 de De l’esprit des lois : « À Dieu ne plaise que je veuille diminuer l’horreur que l’on a pour un crime que la religion, la morale et la politique condamnent tour à tour. Il faudrait le proscrire, quand il ne ferait que donner à un sexe les faiblesses de l’autre ; et préparer à une vieillesse infâme, par une jeunesse honteuse. Ce que j’en dirai lui laissera toutes ses flétrissures, et ne portera que contre la tyrannie qui peut abuser de l’horreur même que l’on en doit avoir. »
– Jeremy Bentham, le juriste anglais (1748-1832) : Défense de la liberté sexuelle, écrits sur l’homosexualité, Mille et une Nuits, 2004 : « Sans insister sur la personne d’Agésilas ou de Xénophon, il apparaît ici ou là que Thémistocle, Aristide, Épaminondas, Alcibiade, Alexandre le Grand et peut-être la majorité des héros de la Grèce étaient infectés par ce goût. Non pas que les historiens se soient donné du mal pour nous en informer expressément, car ce n’était pas extraordinaire au point que cela vaille la peine de le faire, mais ils le donnent à voir incidemment tout au long des récits qu’ils ont l’occasion de faire. »
– Denis Diderot, La Religieuse, texte également posthume, un des premiers romans à évoquer l’homosexualité féminine. La scène de l’orgasme de la mère supérieure à l’insu de l’innocente Suzanne est le pendant exact de la scène du faux-Maure.
– Histoire de ma vie, de Jacques Casanova contient quelques scènes homosexuelles, longtemps censurées, mais qui constituent le pendant de la vision de Rousseau, notamment par rapport à l’extrait qui commence cet article.
– Lire une réflexion sur ces textes dans Altersexualité, Éducation et Censure, Publibook, 2005.
Pour la bonne bouche, je cite ici un extrait croquignolesque du livre troisième de Émile, ou De l’éducation, de notre ami Rousseau, qui n’en rata pas une !
« Donnez à l’homme un métier qui convienne à son sexe, et au jeune homme un métier qui convienne à son âge : toute profession sédentaire et casanière, qui effémine et ramollit le corps, ne lui plaît ni ne lui convient. Jamais jeune garçon n’aspira de lui-même à être tailleur ; il faut de l’art pour porter à ce métier de femmes le sexe pour lequel il n’est pas fait. L’aiguille et l’épée ne sauraient être maniées par les mêmes mains. Si j’étais souverain, je ne permettrais la couture et les métiers à l’aiguille qu’aux femmes et aux boiteux réduits à s’occuper comme elles. En supposant les eunuques nécessaires, je trouve les Orientaux bien fous d’en faire exprès. Que ne se contentent-ils de ceux qu’a faits la nature, de ces foules d’hommes lâches dont elle a mutilé le cœur ? ils en auraient de reste pour le besoin. Tout homme faible, délicat, craintif, est condamné par elle à la vie sédentaire ; il est fait pour vivre avec les femmes ou à leur manière. Qu’il exerce quelqu’un des métiers qui leur sont propres, à la bonne heure ; et, s’il faut absolument de vrais eunuques, qu’on réduise à cet état les hommes qui déshonorent leur sexe en prenant des emplois qui ne lui conviennent pas. Leur choix annonce l’erreur de la nature : corrigez cette erreur de manière ou d’autre, vous n’aurez fait que du bien. » À comparer à ce que disait Jonathan Swift sur le même sujet.
– Voir un sujet de bac sur l’autobiographie contenant une partie de cet extrait des Confessions.
La suite des Confessions
L’air du temps, fin 2010, m’a donné envie de relire une œuvre qui m’avait ravi, puis dégoûté, entre 16 et 20 ans. Je gardais un souvenir ébloui des premiers livres, agacé des suivants. En relisant, l’âge aidant, l’éblouissement a duré jusqu’au bout, ou tout au moins l’intérêt, quand le désir de se justifier prend le pas sur le goût de réfléchir à partir de son expérience. Voilà un auteur dont je me sens proche. Les notes qui suivent, conformément à l’esprit de ce site, sont prioritairement axées sur la conception rousseauiste de l’amour et de la sexualité. Les déboires d’amitié de Rousseau me le rendent proche, même s’ils confinent à la paranoïa. Je ne sais plus pourquoi, alors que je fus un adolescent rousseauiste, l’ayant découvert en Première grâce à mon excellent prof de français au lycée de Villemomble, Alain Roze, puis étudié en fac, je me suis mis insensiblement à m’agacer de Rousseau, à lui préférer Voltaire. Et pourtant, se brouiller avec tous ses amis, avoir une personnalité cassante qui rompt et ne plie point, ces rares qualités que nous partageons auraient dû me rapprocher de lui. Au lieu de ça, je ne me souviens même pas pourquoi, comme pour la rupture de tant d’amitiés ; sans doute ai-je pris prétexte d’un fétu de paille pour rompre le chêne d’une inclination. Le principal est que j’ai renoué avec ce vieil ami. Je ne sais même plus si j’avais ou non lu Émile. Il ne me reste plus qu’à le relire, et tout le reste… Quant à l’extrait cité ci-dessus, ce serait bien sûr une grande idiotie de prendre prétexte d’un poil d’homophobie pour vouer aux gémonies une telle œuvre. Mais n’a-t-il pas été à la mode de prendre prétexte d’un prétendu antisémitisme de Voltaire pour rayer son œuvre d’un trait de plume ?
Livre III
Le Livre III des Confessions complète la pensée de Rousseau sur la sexualité, à partir de ses expériences qu’il nous livre avec impudeur. Exhibitionnisme : « J’allais chercher des allées sombres, des réduits cachés, où je pusse m’exposer de loin aux personnes du sexe dans l’état où j’aurais voulu pouvoir être auprès d’elles. Ce qu’elles voyaient n’était pas l’objet obscène, je n’y songeais même pas ; c’était l’objet ridicule. Le sot plaisir que j’avais de l’étaler à leurs yeux ne peut se décrire. » Il semble qu’il s’agisse de l’exhibition des fesses (objet ridicule). Cet épisode relativise l’extrait précédent, car Rousseau, finalement, agit presque comme son initiateur le faux Maure. Mais il en sera quitte à bon compte. On note son engouement pour le jeune M. Bâcle, qui le pousse à abandonner une place prometteuse pour battre la campagne, et rejoindre Madame de Warens. Plus tard, ce sera pour un certain Venture, musicien itinérant, qu’il s’engouera : « On conviendra, je m’assure, qu’après m’être engoué de M. Bâcle, qui tout compté n’était qu’un manant, je pouvais m’engouer de M. Venture, qui avait de l’éducation, des talents, de l’esprit, de l’usage du monde, et qui pouvait passer pour un aimable débauché. C’est aussi ce qui m’arriva, et ce qui serait arrivé, je pense, à tout autre jeune homme à ma place mais mon engouement n’allait point jusqu’à ne pouvoir me séparer de lui. […] J’avais à mon voisinage un bon préservatif contre cet excès. » Madame de Warens lui inspire un sentiment spécial, distinct de l’amour et de l’amitié : « Je connais un autre sentiment, moins impétueux peut-être, mais plus délicieux mille fois, qui quelquefois est joint à l’amour et qui souvent en est séparé. Ce sentiment n’est pas non plus l’amitié seule : il est plus voluptueux, plus tendre : je n’imagine pas qu’il puisse agir pour quelqu’un du même sexe : du moins je fus ami si jamais homme le fut, et je ne l’éprouvai jamais près d’aucun de mes amis. » On s’amuse des périphrases pour désigner la branlette, car Rousseau croit aux billevesées de l’époque sur les dangers de la masturbation ! « J’étais revenu d’Italie, non tout à fait comme j’y étais allé, mais comme peut-être jamais à mon âge on n’en est revenu. J’en avais rapporté non ma virginité, mais mon pucelage. J’avais senti le progrès des ans ; mon tempérament inquiet s’était enfin déclaré, et sa première éruption, très involontaire, m’avait donné sur ma santé des alarmes qui peignent mieux que toute autre chose l’innocence dans laquelle j’avais vécu jusqu’alors. Bientôt rassuré, j’appris ce dangereux supplément qui trompe la nature, et sauve aux jeunes gens de mon humeur beaucoup de désordres aux dépens de leur santé, de leur vigueur, et quelquefois de leur vie. Ce vice que la honte et la timidité trouvent si commode, a de plus un grand attrait pour les imaginations vives : c’est de disposer, pour ainsi dire, à leur gré, de tout le sexe, et de faire servir à leurs plaisirs la beauté qui les tente, sans avoir besoin d’obtenir son aveu. » Quand Madame de Warens l’envoie dans un séminaire compléter son éducation religieuse, il y rencontre un homme dont le portrait nous rappelle le Maure : « Il y avait au séminaire un maudit lazariste qui m’entreprit, et qui me fit prendre en horreur le latin qu’il voulait m’enseigner. Il avait des cheveux plats, gras et noirs, un visage de pain d’épice, une voix de buffle, un regard de chat-huant, des crins de sanglier au lieu de barbe ; son sourire était sardonique : ses membres jouaient comme les poulies d’un mannequin : j’ai oublié son odieux nom : mais sa figure effrayante et doucereuse m’est bien restée, et j’ai peine à me la rappeler sans frémir. Je crois le rencontrer encore dans les corridors, avançant gracieusement son crasseux bonnet carré pour me faire signe d’entrer dans sa chambre, plus affreuse pour moi qu’un cachot. » L’intendant de Mme de Warens écope lui aussi d’un portrait féroce, étant « ultramontain », un des mots utilisés alors pour désigner les homosexuels [1] : « quoique Mme Corvesi fût aimable, il vivait fort mal avec elle ; des goûts ultramontains la lui rendaient inutile, et il la traitait si brutalement qu’il fut question de séparation. M. Corvesi était un vilain homme, noir comme une taupe, fripon comme une chouette, et qui à force de vexations finit par se faire chasser lui-même. » Quand il accompagne à Lyon M. Le Maître, maître de musique, ils se font héberger par un ecclésiastique, qui semble lui aussi appartenir à la confrérie des chevaliers de la Manchette, bien que cela soit dit d’une façon discrète : « M. Reydelet, me trouvant joli garçon, me prit en amitié et me fit mille caresses. Nous fûmes bien régalés, bien couchés. M. Reydelet ne savait quelle chère nous faire ».
Livre IV
Le Livre IV propose un portrait de femme qui rappelle celui du faux Maure (ou du juif ?) : « Pour Mlle Giraud, qui me faisait toutes sortes d’agaceries, on ne peut rien ajouter à l’aversion que j’avais pour elle. Quand elle approchait de mon visage son museau sec et noir, barbouillé de tabac d’Espagne, j’avais peine à m’abstenir d’y cracher. » Mais surtout, il contient le récit de deux mésaventures fort amusantes, contées l’une à la suite de l’autre :
« Une petite anecdote assez difficile à dire ne me permettra jamais de l’oublier. J’étais un soir assis en Bellecour, après un très mince souper, rêvant aux moyens de me tirer d’affaire, quand un homme en bonnet vint s’asseoir à côté de moi ; cet homme avait l’air d’un de ces ouvriers en soie qu’on appelle à Lyon des taffetatiers. Il m’adresse la parole ; je lui réponds : voilà la conversation liée. À peine avions-nous causé un quart d’heure, que, toujours avec le même sang-froid et sans changer de ton, il me propose de nous amuser de compagnie. J’attendais qu’il m’expliquât quel était cet amusement ; mais, sans rien ajouter, il se mit en devoir de m’en donner l’exemple. Nous nous touchions presque, et la nuit n’était pas assez obscure pour m’empêcher de voir à quel exercice il se préparait. Il n’en voulait point à ma personne ; du moins rien n’annonçait cette intention, et le lieu ne l’eût pas favorisée. Il ne voulait exactement, comme il me l’avait dit, que s’amuser et que je m’amusasse, chacun pour son compte ; et cela lui paraissait si simple, qu’il n’avait même pas supposé qu’il ne me le parût pas comme à lui. Je fus si effrayé de cette impudence que, sans lui répondre, je me levai précipitamment et me mis à fuir à toutes jambes, croyant avoir ce misérable à mes trousses. J’étais si troublé, qu’au lieu de gagner mon logis par la rue Saint-Dominique, je courus du côté du quai, et ne m’arrêtai qu’au-delà du pont de bois, aussi tremblant que si je venais de commettre un crime. J’étais sujet au même vice ; ce souvenir m’en guérit pour longtemps.
À ce voyage-ci j’eus une autre aventure à peu près du même genre, mais qui me mit en plus grand danger. Sentant mes espèces tirer à leur fin, j’en ménageais le chétif reste. Je prenais moins souvent des repas à mon auberge, et bientôt je n’en pris plus du tout, pouvant pour cinq ou six sols, à la taverne, me rassasier tout aussi bien que je faisais là pour mes vingt-cinq. N’y mangeant plus, je ne savais comment y aller coucher, non que j’y dusse grand’chose, mais j’avais honte d’occuper une chambre sans rien faire gagner à mon hôtesse. La saison était belle. Un soir qu’il faisait fort chaud, je me déterminai à passer la nuit dans la place, et déjà je m’étais établi sur un banc, quand un abbé qui passait, me voyant ainsi couché s’approcha et me demanda si je n’avais point de gîte. Je lui avouai mon cas, il en parut touché : il s’assit à côté de moi, et nous causâmes. Il parlait agréablement : tout ce qu’il me dit me donna de lui la meilleure opinion du monde. Quand il me vit bien disposé, il me dit qu’il n’était pas logé fort au large, qu’il n’avait qu’une seule chambre, mais qu’assurément il ne me laisserait pas coucher ainsi dans la place ; qu’il était tard pour me trouver un gîte, et qu’il m’offrait pour cette nuit la moitié de son lit. J’accepte l’offre, espérant déjà me faire un ami qui pourrait m’être utile. Nous allons : il bat le fusil. Sa chambre me parut propre dans sa petitesse : il m’en fit les honneurs fort poliment. Il tira d’une armoire un pot de verre où étaient des cerises à l’eau-de-vie : nous en mangeâmes chacun deux, et nous fûmes nous coucher.
Cet homme avait les mêmes goûts que mon Juif de l’hospice, mais il ne les manifestait pas si brutalement. Soit que, sachant que je pouvais être entendu, il craignît de me forcer à me défendre, soit qu’en effet il fût moins confirmé dans ses projets, il n’osa m’en proposer ouvertement l’exécution, et cherchait à m’émouvoir sans m’inquiéter. Plus instruit que la première fois, je compris bientôt son dessein, et j’en frémis ; ne sachant ni dans quelle maison, ni entre les mains de qui j’étais, je craignis, en faisant du bruit, de le payer de ma vie. Je feignis d’ignorer ce qu’il me voulait : mais paraissant très importuné de ses caresses et très décidé à n’en pas endurer le progrès, je fis si bien qu’il fut obligé de se contenir. Alors je lui parlai avec toute la douceur et toute la fermeté dont j’étais capable ; et, sans paraître rien soupçonner, je m’excusai de l’inquiétude que je lui avais montrée, sur mon ancienne aventure, que j’affectai de lui conter en termes si pleins de dégoût et d’horreur, que je lui fis, je crois, mal au cœur à lui-même, et qu’il renonça tout à fait à son sale dessein. Nous passâmes tranquillement le reste de la nuit. Il me dit même beaucoup de choses très bonnes, très sensées, et ce n’était assurément pas un homme sans mérite, quoique ce fût un grand vilain. »
Livre V
C’est le livre des années de bonheur avec Mme de Warens – et du dépucelage tardif – dont il nous livre un éloge paradoxal, typique de sa façon de penser : « Une des preuves de l’excellence du caractère de cette aimable femme est que tous ceux qui l’aimaient s’aimaient entre eux. La jalousie, la rivalité même cédait au sentiment dominant qu’elle inspirait, et je n’ai vu jamais aucun de ceux qui l’entouraient se vouloir du mal l’un à l’autre. Que ceux qui me lisent suspendent un moment leur lecture à cet éloge ; et s’ils trouvent en y pensant quelque autre femme dont ils puissent en dire autant, qu’ils s’attachent à elle pour le repos de leur vie (fût-elle au reste la dernière des catins). ». Avant d’en venir au dépucelage, Rousseau nous glisse une indication sur sa conception de la sexualité, à propos de tout autre chose : « en toute chose la gêne et l’assujettissement me sont insupportables ; ils me feraient prendre en haine le plaisir même. On dit que chez les mahométans un homme passe au point du jour dans les rues pour ordonner aux maris de rendre le devoir à leurs femmes. Je serais un mauvais Turc à ces heures-là. ». On en vient insensiblement à ce déniaisement si raisonnable dicté à Mme de Warens (surnommée « maman ») par les avances que reçoit son protégé des mères de ses élèves : « Dans le même temps on m’en tendit un d’une espèce plus dangereuse, auquel j’échappai, mais qui lui fit sentir que les dangers qui me menaçaient sans cesse rendaient nécessaires tous les préservatifs qu’elle y pouvait apporter. » On apprécie l’usage si particulier ici du mot « préservatif » ! Voilà une prévention plus attrayante que le latex ! « Maman » propose donc à notre héros de la déniaiser, et le prévient une semaine à l’avance… Jean-Jacques montre peu d’empressement, tout en nous apprenant qu’il est éjaculateur précoce (en termes choisis, cela va sans dire) : « On verra que, dans un âge avancé, la seule idée de quelques légères faveurs qui m’attendaient près de la personne aimée allumait mon sang à tel point qu’il m’était impossible de faire impunément le court trajet qui me séparait d’elle. Comment, par quel prodige, dans la fleur de ma jeunesse, eus-je si peu d’empressement pour la première jouissance ? » L’analyse de ses sentiments pour Mme de Warens est exemplaire : « Je l’aimais toujours aussi passionnément qu’il fût possible ; mais je l’aimais plus pour elle et moins pour moi, ou du moins je cherchais plus mon bonheur que mon plaisir auprès d’elle : elle était pour moi plus qu’une sœur, plus qu’une mère, plus qu’une amie, plus même qu’une maîtresse ; et c’était pour cela qu’elle n’était pas une maîtresse. Enfin, je l’aimais trop pour la convoiter : voilà ce qu’il y a de plus clair dans mes idées. ». La relation de l’acte en lui-même est discrète, déceptive, et abonde en périphrases : « Ce jour, plutôt redouté qu’attendu, vint enfin. Je promis tout, et je ne mentis pas. Mon cœur confirmait mes engagements sans en désirer le prix. Je l’obtins pourtant. Je me vis pour la première fois dans les bras d’une femme, et d’une femme que j’adorais. Fus-je heureux ? non, je goûtai le plaisir. Je ne sais quelle invincible tristesse en empoisonnait le charme : j’étais comme si j’avais commis un inceste ». Cette idylle amoureuse n’est pas un couple, mais un trouple : « maman » se partage entre Claude Anet et Jean-Jacques, sans qu’aucun des deux ne s’en plaigne : « Ainsi s’établit entre nous trois une société sans autre exemple peut-être sur la terre. Tous nos vœux, nos soins, nos cœurs étaient en commun ; rien n’en passait au-delà de ce petit cercle. L’habitude de vivre ensemble et d’y vivre exclusivement devint si grande, que si, dans nos repas, un des trois manquait ou qu’il vînt un quatrième, tout était dérangé, et, malgré nos liaisons particulières, les tête-à-tête nous étaient moins doux que la réunion ». On a envie de lire entre les lignes… en tout cas souhaitons qu’un réalisateur qui n’aurait pas froid aux yeux nous offre une biographie de Jean-Jacques Rousseau ; ce sera très altersexuel, ou du moins pas conventionnel ! On songe aux relations moins pudiques de Jacques Casanova dans Histoire de ma vie, avec Nanette et Marton dans le tome I par exemple. Jean-Jacques est avec cette « maman » – dont il faut rappeler qu’au début elle était censée offerte par la Providence pour le ramener dans le giron de notre Sainte-Mère l’Église ! – comme un moderne gigolo : « Je me mis en tête d’aller à Besançon prendre leçon de l’abbé Blanchard ; et cette idée me parut si raisonnable, que je parvins à la faire trouver telle à maman. La voilà travaillant à mon petit équipage, et cela avec la profusion qu’elle mettait à toute chose. ».
Livre VI
Le temps ralentit, voici l’idylle aux « Charmettes », Claude Anet étant mort, mais elle sera de courte durée, bien qu’embellie par le souvenir. Lors d’un voyage à Montpellier pour se soigner, Rousseau connaît une aventure galante avec une Mme de Larnage rencontrée en chemin, à laquelle il laisse faire les premiers pas, solécisme amoureux au regard de l’époque. On note en passant une expression perdue : ses compagnons le croient sincère, et n’imaginent pas qu’il aille à Montpellier pour « y faire un tour de casserole », ce qui signifie selon la note de l’édition GF : « soigner une vérole, « d’après Casserole, sobriquet donné à un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies honteuses » (sic). Revenons à Mme de Larnage : Rousseau est incapable de faire le premier pas, malgré le rentre-dedans éhonté de la donzelle. Tant et si bien qu’à la fin, « Elle interrompit brusquement ce silence en passant un bras autour de mon cou, et dans l’instant sa bouche parla trop clairement sur la mienne pour me laisser mon erreur. » (Rétrospectivement, on imagine que le faux maure avait dû, mutatis mutandis, en faire autant, confondant la froideur de Rousseau avec sa timidité). Voici donc une idylle de voyage : « Cette vie délicieuse dura quatre ou cinq jours, pendant lesquels je m’enivrai des plus douces voluptés. Je les goûtai pures, vives, sans aucun mélange de peines : ce sont les premières et les seules que j’aie ainsi goûtées ; et je puis dire que je dois à madame de Larnage de ne pas mourir sans avoir connu le plaisir. » […] « Je ne l’aimais pas non plus comme j’avais aimé et comme j’aimais madame de Warens ; mais c’était pour cela même que je la possédais cent fois mieux. Près de maman mon plaisir était toujours troublé par un sentiment de tristesse, par un secret serrement de cœur que je ne surmontais pas sans peine ; au lieu de me féliciter de la posséder, je me reprochais de l’avilir. » N’est-on pas en plein dans le siècle du libertinage ? Vivant une relation à trois avec une dame patronnesse, faisant l’amour avec une dame de rencontre, alors qu’ils sont en compagnie de plusieurs autres personnes, le tout sans que jamais Rousseau le recherche, car il semble tout lui-même sauf un libertin : cela nous donne à penser que, en dépit du poids de l’Église, ces mœurs légères, cette façon décomplexée de concevoir les rapports charnels, était dans l’air. Peut-être la situation de concurrence entre les factions protestante et catholique faisait-elle oublier aux prêtres et pasteurs la répression du sexe pour ne se consacrer qu’au prosélytisme de conversion ? Quoi qu’il en soit, Rousseau se comporte encore en gigolo, avec cette femme plus âgée que lui : « quoiqu’elle ne fût pas riche elle-même, elle voulut à notre séparation me forcer de partager sa bourse, qu’elle apportait de Grenoble assez bien garnie, et j’eus beaucoup de peine à m’en défendre. » Ils prévoient de se revoir chez elle, et Jean-Jacques réitère son érotisme incestueux : « Elle avait une fille dont elle m’avait parlé très souvent en mère idolâtre. Cette fille avait quinze ans passés ; elle était vive, charmante et d’un caractère aimable. On m’avait promis que j’en serais caressé : je n’avais pas oublié cette promesse, et j’étais fort curieux d’imaginer comment mademoiselle de Larnage traiterait le bon ami de sa maman. ». La froideur épistolaire de « maman » ainsi que la peur d’être démasqué, s’étant fait passer pour anglais auprès de Mme de Larnage, la peur encore de s’amouracher de la fille et de la mère, le font avancer son retour, et là, patatras : « Un jeune homme était avec elle. Je le connaissais pour l’avoir vu déjà dans la maison avant mon départ ; mais cette fois il y paraissait établi, il l’était. Bref, je trouvai ma place prise. ». Le portrait de ce garçon de 20 ans est celui d’un vrai gigolo, et fait songer à la formule du livre V : « la dernière des catins » : « Le fils de M. le capitaine était garçon perruquier, et courait le monde en cette qualité quand il vint se présenter à madame de Warens, qui le reçut bien, comme elle faisait tous les passants, et surtout ceux de son pays. C’était un grand fade blondin, assez bien fait, le visage plat, l’esprit de même, parlant comme le beau Léandre ; mêlant tous les tons, tous les goûts de son état avec la longue histoire de ses bonnes fortunes ; ne nommant que la moitié des marquises avec lesquelles il avait couché, et prétendant n’avoir point coiffé de jolies femmes dont il n’eût aussi coiffé les maris ; vain, sot, ignorant, insolent ; au demeurant le meilleur fils du monde. Tel fut le substitut qui me fut donné pendant mon absence, et l’associé qui me fut offert après mon retour. » Mais Rousseau, qui sut partager avec Claude Anet qu’il avait relégué au rang de second, n’entend pas s’accepter tel : « Non, maman, lui dis-je avec transport ; je vous aime trop pour vous avilir ; votre possession m’est trop chère pour la partager ». Ce passage est l’occasion de traiter l’un des dilemmes de l’autobiographie : le dévoilement de la vie des proches de l’auteur : « pardonnez, ombre chère et respectable, si je ne fais pas plus de grâce à vos fautes qu’aux miennes, si je dévoile également les unes et les autres aux yeux des lecteurs ».
Le nouveau ménage à trois ne manque pas de sel. Rousseau présente le garçon comme une sorte de brute érotisée, occupée toute la journée à fendre du bois, et qui plus est : « chaque fois qu’il fendait du bois, emploi qu’il remplissait avec une fierté sans égale, il fallait que je fusse là spectateur oisif, et tranquille admirateur de sa prouesse. » Le garçon, en plus de « maman », se repaît « d’une femme de chambre vieille, rousse, édentée », tandis que notre benêt de Jean-Jacques s’étonne du refroidissement de « maman » à partir du moment où il refuse son commerce charnel ! Le pauvre n’a toujours pas compris que sa Mme de Warens est une bonne charrette à foin, qui a besoin de deux roues pour rouler dans ses ornières ! Quittant « maman », Jean-Jacques se retrouve précepteur. J’aime beaucoup ce passage dans lequel sa volupté s’exerce au vin : « Environné de petites choses volables que je ne regardais même pas, je m’avisai de convoiter un certain petit vin blanc d’Arbois très joli, dont quelques verres que par-ci, par-là je buvais à table m’avaient fort affriandé. […] l’occasion fit que je m’en accommodai de temps en temps de quelques bouteilles pour boire à mon aise en mon petit particulier. Malheureusement je n’ai jamais pu boire sans manger. Comment faire pour avoir du pain ? Il m’était impossible d’en mettre en réserve. En faire acheter par les laquais, c’était me déceler, et presque insulter le maître de la maison. En acheter moi-même, je n’osai jamais. Un beau monsieur l’épée au côté aller chez un boulanger acheter un morceau de pain, cela se pouvait-il ? Enfin je me rappelai le pis-aller d’une grande princesse à qui l’on disait que les paysans n’avaient pas de pain, et qui répondit : Qu’ils mangent de la brioche. J’achetai de la brioche. Encore que de façons pour en venir là ! Sorti seul à ce dessein, je parcourais quelquefois toute la ville, et passais devant trente pâtissiers avant d’entrer chez aucun. Il fallait qu’il n’y eût qu’une seule personne dans la boutique, et que sa physionomie m’attirât beaucoup, pour que j’osasse franchir le pas. Mais aussi quand j’avais une fois ma chère petite brioche, et que, bien enfermé dans ma chambre, j’allais trouver ma bouteille au fond d’une armoire, quelles bonnes petites buvettes je faisais là tout seul en lisant quelques pages de roman ! Car lire en mangeant fut toujours ma fantaisie, au défaut d’un tête-à-tête : c’est le supplément de la société qui me manque. Je dévore alternativement une page et un morceau : c’est comme si mon livre dînait avec moi. »
Livre VII
Nous voici au second tome. Le livre VII est encore joyeux, même si Rousseau entre plus profond dans le monde. Années décisives, où il noue amitiés ou connaissances avec le gratin du siècle. Deux années passées comme secrétaire d’un ambassadeur à moitié fou, à Venise, puis des années parisiennes avant sa carrière d’homme de lettres connu, à l’époque où il tâche de se faire connaître comme musicien, rivalisant sans succès avec le célèbre Rameau. À Venise, pour nous prouver à quel point « la dépense des filles » n’a pas été sa tasse de thé, il raconte avec humour comment il se ridiculisa auprès de deux courtisanes dans le lit desquelles l’avaient poussé des amis. Crainte panique de la vérole, à cette époque où l’existence des condoms était confidentielle (Casanova, pourtant né en 1725 et vénitien, n’était pas encore connu, n’ayant achevé qu’en 1797 son Histoire de ma vie, publiée à partir de 1820). Une périphrase évoque la « funeste habitude de donner le change à mes besoins », sans doute la masturbation, faute de fréquenter les filles publiques. Il n’existait pas d’alternative, le pauvre n’ayant pas les moyens, dans cette société de castes, de fréquenter dans les milieux où il officiait. Rousseau trouve toutes les excuses pour s’abstenir de la chair, et ce témoignage semblerait aussi bien le fait de quelque jeune Parisien actuel, victime du principe de précaution : « Je ne pouvais concevoir qu’on pût sortir impunément des bras de la Padoana. Le chirurgien lui-même eut toute la peine imaginable à me rassurer. Il n’en put venir à bout qu’en me persuadant que j’étais conformé d’une façon particulière à ne pouvoir pas aisément être infecté ; et quoique je me sois moins exposé peut-être qu’aucun autre homme à cette expérience, ma santé, de ce côté, n’ayant jamais reçu d’atteinte, m’est une preuve que le chirurgien avait raison. Cette opinion cependant ne m’a jamais rendu téméraire ; et si je tiens en effet cet avantage de la nature, je puis dire que je n’en ai pas abusé. » Plus loin, il raconte comment avec un camarade, ils achetèrent « une petite fille de onze à douze ans, que son indigne mère cherchait à vendre ». Il s’agissait de l’entretenir jusqu’à ce « qu’elle fût mûre », mais la fibre paternelle prit le dessus, et il n’en fut plus question. Le témoignage est quand même intéressant à notre époque de diabolisation de la sexualité en-dessous de quinze ans : notre immense philosophe, aujourd’hui, pour cette phrase, ne le réduirait-on pas en bouillie !
On relève aussi dans ce livre deux fortes amitiés, l’une avec un Espagnol, Ignacio Emmanuel de Altuna : « Hors moi, je n’ai vu que lui seul de tolérant depuis que j’existe. Il ne s’est jamais informé d’aucun homme comment il pensait en matière de religion. Que son ami fût juif, protestant, Turc, bigot, athée, peu lui importait, pourvu qu’il fût honnête homme. » De cet ami, Rousseau dit : « Nous nous liâmes si bien que nous fîmes le projet de passer nos jours ensemble. Cela ne se fit pas parce qu’ils se marièrent, mais ce genre de sortie chez un homme au demeurant incapable de comprendre la sexualité entre hommes, nous fait penser à l’énigme d’un contemporain de Rousseau, Joseph de Jussieu, exposée dans le roman Le corps du monde de Patrick Drevet. La deuxième amitié est celle de Denis Diderot. Quand il apprend son emprisonnement à Vincennes, il devient fou de douleur : « Rien ne peindra jamais les angoisses que me fit sentir le malheur de mon ami. […] Je le crus là pour le reste de sa vie. La tête faillit m’en tourner. J’écrivis à madame de Pompadour pour la conjurer de le faire relâcher, ou d’obtenir qu’on m’enfermât avec lui. […] Mais si elle eût duré quelque temps encore avec la même rigueur, je crois que je serais mort de désespoir au pied de ce malheureux donjon. »
C’est aussi dans ce livre qu’est racontée la rencontre avec Thérèse Levasseur, qui sera longtemps sa compagne sans qu’ils se marient jamais (parce qu’il ne le lui a pas promis !). De cette femme du peuple on a un beau portrait paradoxal, qui la montre inculte, mais appréciée par les proches de Rousseau pour la finesse de son jugement moral. Avec elle il semble qu’il trouve surtout l’apaisement de sa crainte de la vérole. Il raconte l’abandon de leurs deux premiers enfants, avec moins d’apitoiement que ne lui en avait causé cette fillette vénitienne de onze ans qu’il avait « adoptée » !
Livre VIII
C’est le début du succès, avec l’écriture et la publication du premier Discours sur les sciences et les arts. Rousseau décide de sa « réforme » au moment du succès : il s’habillera plus simplement, et vivra de l’humble métier de copiste de musique. Le succès lui amène des théories de fâcheux qui ne lui laissent pas un moment de libre et l’empêchent de gagner sa vie. Le succès de son opéra Le devin du village redouble celui du Discours, et la querelle des bouffons met Rousseau au premier plan, d’autant plus qu’il fait scandale en refusant une probable pension royale, ou plutôt en fuyant l’occasion de la recevoir, ce qui commence à le mettre mal avec ses amis philosophes, dont Diderot [2]. Charles Pinot Duclos lui reste fidèle, à qui sera dédicacé le Devin, seule dédicace de Rousseau (qui ne fera, dit-il, qu’une exception, mais laquelle ?) Avec Thérèse, la vie sexuelle de Rousseau s’est assagie, mais il se reproche encore une soirée de beuverie avec ses amis Klupffel et Melchior Grimm [3], auquel il s’attache d’une de ces amitiés intenses qu’il regrettera quand il comprendra l’arrivisme du personnage, qui s’est servi de Rousseau comme d’un tabouret pour son ascension sociale. Lors de cette soirée, les trois amis jouissent tour à tour d’une « petite fille » entretenue par Klupffel. Rousseau s’en confesse à Thérèse aussitôt. Quel âge pouvait avoir cette « petite fille » ? c’est ce que le texte ne dit pas. Rousseau relate sans s’étendre l’abandon de trois enfants supplémentaires ; « J’ai promis ma confession, non ma justification ». À l’occasion d’un séjour à Genève à l’été 1754, et de sa conversion, Rousseau revoit Mme de Warens : « Dans quel état, mon Dieu ! quel avilissement ! »
Livre IX
C’est la chronique de la vie à l’Ermitage, une maison rurale construite et aménagée pour Rousseau par son amie Louise d’Épinay. Rousseau s’y installe et y reste même l’hiver, ce qui lui vaut les sarcasmes de la « coterie holbachique » (du baron d’Holbach, qui ne pensait pas qu’il supporterait l’isolement. Rousseau se met à part du monde littéraire, avec des phrases qui sonnent comme des sentences : « Non, non : j’ai toujours senti que l’état d’auteur n’était, ne pouvait être illustre et respectable, qu’autant qu’il n’était pas un métier. Il est trop difficile de penser noblement, quand on ne pense que pour vivre. Pour pouvoir, pour oser dire de grandes vérités, il ne faut pas dépendre de son succès. » Mme d’Épinay ne lui laisse pas une seconde de vraie liberté, et exige qu’il rapplique dès qu’elle est seule. Il ne la désire pas, ce qu’il exprime en termes galants : « Elle était fort maigre, fort blanche, de la gorge comme sur ma main. Ce défaut seul eût suffi pour me glacer : jamais mon cœur ni mes sens n’ont su voir une femme dans quelqu’un qui n’eût pas des tétons. » Il vit en bonne intelligence avec Thérèse, même s’il supporte difficilement la présence de la vieille, dont il sait qu’elle complote avec la coterie. Cependant il ne l’aime pas : « Je n’ai jamais senti la moindre étincelle d’amour pour elle ; je n’ai pas plus désiré de la posséder que madame de Warens, et les besoins des sens, que j’ai satisfaits auprès d’elle, ont uniquement été pour moi ceux du sexe, sans avoir rien de propre à l’individu » Son besoin d’amour s’exprime en des termes étonnants, où l’amitié le dispute à l’amour : « Comment se pouvait-il qu’avec une âme naturellement expansive, pour qui vivre c’était aimer, je n’eusse pas trouvé jusqu’alors un ami tout à moi, un véritable ami, moi qui me sentais si bien fait pour l’être ? Comment se pouvait-il qu’avec des sens si combustibles, avec un cœur tout pétri d’amour, je n’eusse pas du moins une fois brûlé de sa flamme pour un objet déterminé ? »
Une page est consacrée à Voltaire. Lui ayant écrit pour donner ses sentiments sur le « poème sur la ruine de Lisbonne », il pense que Candide est la réponse de Voltaire à sa lettre ! (un bon extrait à utiliser comme document complémentaire si on étudie le conte philosophique). Le récit de la genèse de La nouvelle Héloïse est étonnant : Rousseau se dédit, lui qui avait condamné les romans. C’est parce qu’il vit dans un désert amoureux qu’il imagine ces personnages et se livre à des « érotiques transports » par l’écriture ! C’est à ce moment-là qu’il s’éprend de Sophie Lalive de Bellegarde, alias Sophie d’Houdetot : « Et qu’on n’aille pas s’imaginer qu’ici mes sens me laissaient tranquille, comme auprès de Thérèse et de maman. Je l’ai déjà dit, c’était de l’amour cette fois, et l’amour dans toute son énergie et dans toutes ses fureurs. » Amour non payé de retour, car la belle comtesse était déjà pourvue en mari et amant ; c’était ce dernier, Monsieur de Saint-Lambert, qui l’avait engagée, pendant son absence, à fréquenter son ami Rousseau… C’est dans ce livre que Rousseau commence, à titre de preuve, à intégrer des copies de lettres envoyées ou reçues. Premier échange, pourtant peu transcendant, avec Mme d’Épinay. Deuxième, avec Diderot, avec lequel il se rabiboche pourtant. À la lecture de ces pages, on tombe d’accord avec Rousseau quand il reconnaît : « Je ne comprends pas aujourd’hui comment j’eus la bêtise de lui répondre et de me fâcher, au lieu de lui rire au nez pour toute réponse. » L’attitude de Grimm nous vaut un portrait cinglant, bon extrait à utiliser en classe. En passant, on en apprend de belles sur Mme d’Épinay, qui à l’arrivée de Grimm, vire Rousseau de la chambre qu’il occupait auprès de la sienne (quand il n’était pas à l’Ermitage) : « il y avait entre sa chambre et celle que je quittais une porte masquée de communication, qu’elle avait jugé inutile de me montrer. Son commerce avec Grimm n’était ignoré de personne, ni chez elle, ni dans le public, pas même de son mari » Une page étonnante dans ce portrait de Grimm est révélatrice de l’idiosyncrasie de Rousseau : « Cela l’avait mis à la mode, et lui avait donné du goût pour la propreté de femme : il se mit à faire le beau ; sa toilette devint une grande affaire ; tout le monde sut qu’il mettait du blanc, et moi, qui n’en croyais rien, je commençai de le croire, non seulement par l’embellissement de son teint, et pour avoir trouvé des tasses de blanc sur sa toilette, mais sur ce qu’entrant un matin dans sa chambre, je le trouvai brossant ses ongles avec une petite vergette faite exprès ; ouvrage qu’il continua fièrement devant moi. Je jugeai qu’un homme qui passe deux heures tous les matins à brosser ses ongles peut bien passer quelques instants à remplir de blanc les creux de sa peau. […] Tout cela n’était que des ridicules, mais bien antipathiques à mon caractère. […] Comment les vifs et continuels élans que fait hors de lui-même un cœur sensible peuvent-ils le laisser s’occuper sans cesse de tant de petits soins pour sa petite personne ? Eh ! mon Dieu, celui qui sent embraser son cœur de ce feu céleste cherche à l’exhaler, et veut montrer le dedans. Il voudrait mettre son cœur sur son visage ; il n’imaginera jamais d’autre fard. » Grimm est peint en Tartuffe parfait : « Tout Paris fut instruit de son désespoir après la mort du comte de Friese. […] Il fallut l’entraîner à l’hôtel de Castries, où il joua dignement son rôle, livré à la plus mortelle affliction. Là, tous les matins il allait dans le jardin pleurer à son aise, tenant sur ses yeux son mouchoir baigné de larmes, tant qu’il était en vue de l’hôtel ; mais au détour d’une certaine allée, des gens auxquels il ne songeait pas le virent mettre à l’instant son mouchoir dans sa poche et tirer un livre. » Jean-Jacques finit par dire ce qu’il pense, Mme d’Épinay lui donne son congé, et il quitte l’Ermitage sous la neige, pour s’installer à Montmorency : « la haine des méchants ne fait que s’animer davantage par l’impossibilité de trouver sur quoi la fonder ; et le sentiment de leur propre injustice n’est qu’un grief de plus contre celui qui en est l’objet. »
Livre X
Voilà Jean-Jacques installé à Montmorency. Il y rompt publiquement avec Diderot, en prenant soin de ne pas toucher au souvenir de leur amitié : « En rompant avec Diderot, que je croyais moins méchant qu’indiscret et faible, j’ai toujours conservé dans l’âme de l’attachement pour lui, même de l’estime, et du respect pour notre ancienne amitié, que je sais avoir été longtemps aussi sincère de sa part que de la mienne. C’est tout autre chose avec Grimm, homme faux par caractère, qui ne m’aima jamais, qui n’est pas même capable d’aimer ». Il sera sévère avec d’Alembert également ; je note la phrase suivante pour l’utilisation du pronom « en », qu’en principe on n’applique pas à des personnes, c’est dire : « Quant à M. d’Alembert, je n’en dis rien ici, j’en reparlerai dans la suite. » Et pour Voltaire, il lui tourne une superbe lettre : « Je vous hais, enfin, puisque vous l’avez voulu ; mais je vous hais en homme encore plus digne de vous aimer, si vous l’aviez voulu. De tous les sentiments dont mon cœur était pénétré pour vous, il n’y reste que l’admiration qu’on ne peut refuser à votre beau génie, et l’amour de vos écrits ». Rousseau fuit donc la « clique philosophique », et fréquente quantité de membres de la bonne compagnie locale, dans toute l’échelle sociale, à un point qui ferait passer les « amitiés Facebook » de notre XXe siècle pour des cercles fermés. Cela va jusqu’à se laisser entraîner par un « M. de Jonville » « chez des filles de sa connaissance, avec deux ou trois commis des affaires étrangères, gens très aimables, et qui n’avaient point du tout l’air ni le ton libertin ». Il ne consomme ni ne paie, ce qui courrouce son hôte. Je note le trait simplement pour prendre la température morale de l’époque. Parmi les personnes avec lesquelles il entretient correspondance, il fait l’éloge de l’illustre Lamoignon de Malesherbes, le même qui sauva les planches de l’Encyclopédie en prévenant Diderot. L’amitié qui le lie avec le et la Maréchal de Luxembourg, des grands du royaume qui le traitent sur un pied d’égalité, prend beaucoup de place, car leur protection non seulement lui assure un logis d’appoint quand le sien est en réparation, mais aussi un appui de poids pour la publication de Julie, puis pour celle du Contrat socialet enfin de l’Émile. La difficulté de fréquenter des riches quand on n’a pas le sou nous vaut une des dernières belles pages humoristiques de l’ouvrage : « Une femme m’écrivait-elle de Paris à l’Ermitage, ou à Montmorency : ayant regret aux quatre sous de port que sa lettre m’aurait coûté, elle me l’envoyait par un de ses gens, qui arrivait à pied tout en nage, et à qui je donnais à dîner, et un écu qu’il avait assurément bien gagné. » C’est dans ce livre qu’est évoquée l’origine des Confessions une demande de son éditeur hollandais Rey d’écrire les Mémoires de sa vie. Une Madame de Boufflers, de la famille des Luxembourg, lui cause encore quelque émoi, heureusement sans espoir : « et je fis mes adieux à l’amour pour le reste de ma vie. » On relève dans ce livre un usage particulier à Rousseau d’un mot fort rare, « prédicament », dont les dictionnaires actuels ne signalent au mieux qu’un sens philosophique qui n’est pas celui de Rousseau : « Ce procédé peu galant n’avait pas dû me mettre en bon prédicament auprès d’elle. Ce mot se retrouve au livre XII : « Mon hôte était un petit homme de basse mine et passablement fripon, que j’appris le lendemain être débauché, joueur, et en fort mauvais prédicament dans le quartier ». Ce mot fut aussi utilisé par Saint-Simon.
Livre XI
Ce livre est consacré aux événements pénibles qui entourèrent la publication de Julie, et surtout de l’Émile. L’impression de ce dernier subit des retardements, et Rousseau reçut de nombreux avertissements de prudence, qu’il ne voulut pas écouter parce qu’il avait été assuré du soutien de Malesherbes comme de la Maréchale de Luxembourg, lesquels s’étaient trop entremis, croyait-il, pour qu’on pût l’atteindre sans les toucher. Il se moque « de mes pusillanimes amis, qui paraissaient s’inquiéter pour moi », et méprise les avis de ceux qu’il considère désormais comme ses ennemis, sans en donner de preuves éclatantes d’ailleurs, autres que des raisonnements tant soit peu paranoïaques : « J’avais toujours senti, malgré le patelinage du P. Berthier, que les jésuites ne m’aimaient pas, non seulement comme encyclopédiste, mais parce que tous mes principes étaient encore plus opposés à leurs maximes et à leur crédit que l’incrédulité de mes confrères, puisque le fanatisme athée et le fanatisme dévot, se touchant par leur commune intolérance » Ces craintes le poussent successivement dans ses textes publiés, à des ajouts ou des retraits, des scrupules tout au moins, qui nous semblent risibles avec le recul, mais qui sont à méditer pour avoir une idée claire des compromissions des auteurs de l’époque, surtout avec la haute aristocratie qui pouvait les faire mettre en prison pour un oui ou un non. L’exemple le plus dérisoire en est sans doute la crainte finalement sans fondement qu’une phrase de son Émile sur les abus des princes contre les paysans lors des chasses, ne soit prise de travers par tel prince de Conti, auquel il n’avait point songé en écrivant, plutôt que par tel autre, auquel il avait songé ! Averti en pleine nuit d’un décret de prise de corps qui devait être effectif au matin, il finit par se laisser convaincre de partir, pour protéger ses protecteurs, et prend la poste pour la Suisse après s’être réfugié entre-temps chez les Luxembourg. Il présente cette scène comme une enquête, relevant au passage quelques incohérences susceptibles d’accréditer la thèse du complot, et le livre se termine sur ces mots : « Exemple grossier, mais sensible, de l’importance des moindres détails dans l’exposé des faits dont on cherche les causes secrètes, pour les découvrir par induction. »
Livre XII
Ce livre est qualifié d’« œuvre de ténèbres », puisqu’il concerne la partie la plus agitée de l’existence de l’auteur, et que la rédaction s’en est faite pour partie de mémoire, sans les documents qui avaient aidé au débute l’ouvrage. L’Émile est brûlé à Genève, tandis que Rousseau s’est réfugié sur le territoire de Berne, chez son ami Roguin. Il doit quitter Berne, qui s’apprête à imiter Genève, et se résout à accepter un logement qu’on lui propose à Môtiers, sur les terres de Neufchâtel, partie du royaume de Frédéric II de Prusse, qu’il lui est arrivé de brocarder. Il parie nonobstant sur la magnanimité du souverain, qui lui ferait gagner à protéger un philosophe qui a médit de lui. Thérèse le rejoint, et Rousseau signale un refroidissement dans leur entente, dû sans doute à l’abstinence qu’il aurait décidée pour éviter de la rendre enceinte, ce qu’il dit dans des phrases admirables : « j’aimai mieux me condamner à l’abstinence que d’exposer Thérèse à se voir derechef dans le même cas. J’avais d’ailleurs remarqué que l’habitation des femmes empirait sensiblement mon état : cette double raison m’avait fait former des résolutions que j’avais quelquefois assez mal tenues, mais dans lesquelles je persistais avec plus de constance depuis trois ou quatre ans ; c’était aussi depuis cette époque que j’avais remarqué du refroidissement dans Thérèse : elle avait pour moi le même attachement par devoir, mais elle n’en avait plus par amour. » Il éprouve alors pour George Keith, seigneur des terres sur lesquelles est situé Môtiers, une de ces amitiés fortes dont il est coutumier : « L’émotion que j’éprouvais jadis dans mes courses de l’Ermitage à Eaubonne était bien différente assurément ; mais elle n’était pas plus douce que celle avec laquelle j’approchais de Colombier. Que de larmes d’attendrissement j’ai souvent versées dans ma route, en pensant aux bontés paternelles, aux vertus aimables, à la douce philosophie de ce respectable vieillard ! » Il se fait constituer par commodité « une petite garde-robe arménienne » par un tailleur arménien des environs, ce qui lui causera l’inconvénient d’être reconnu facilement quand les contrecoups de la publication de ses écrits viendront aux oreilles des habitants du lieu. Il évoque une autre amitié, dans des termes qu’on a déjà souvent trouvés, avec un certain Du Peyrou, qui deviendra son ayant-droit pour l’édition de ses œuvres : « Je ne m’engouai pas, mais je m’attachai par l’estime ; et peu à peu cette estime amena l’amitié. » Une autre amitié retient notre attention, celle d’un jeune Hongrois qui recherche soi-disant sa sagesse. Ils échangent en latin et français, car le Hongrois s’exprime mal en français. Rousseau se plaint cependant d’avoir été trompé. Il s’avère que le garçon lui aurait menti sinon sur sa naissance, du moins sur son attitude, ayant apparemment fui les lieux après avoir engrossé « une si vilaine salope », servante d’auberge, et pour rejoindre une femme mariée, au su du mari, si on lit entre les lignes ! Les persécutions continuent, avec la publication d’un feuillet anonyme sans lequel on le traite de coureur de bordel, vérolé, etc., lui « dont le plus grand défaut fut toujours d’être timide et honteux comme une vierge ». Cela culmine avec la fameuse lapidation de Môtiers (sa maison est la cible d’une lapidation nocturne). Des amies le poussent à fuir en Angleterre, où plusieurs personnes, dont George Keith, lui proposent une retraite. Il hésite à partir pour la Corse, des insulaires lui ayant demandé de travailler à un projet de constitution. Il choisit cependant de s’installer sur l’île de Saint-Pierre, où il consacre son temps à l’« oisiveté », c’est-à-dire en fait à la botanique, étudiant à fond l’œuvre de Linné. Cette courte idylle est interrompue par l’ordre du gouvernement de Berne de quitter l’État sous 24h. Il décide de partir pour Berlin, laissant Thérèse sur l’île. Il prévoit une suite, en des termes inquiétants : « on verra dans ma troisième partie, si jamais j’ai la force de l’écrire, comment, croyant partir pour Berlin, je partis en effet pour l’Angleterre, et comment les deux dames qui voulaient disposer de moi, après m’avoir, à force d’intrigues, chassé de la Suisse, où je n’étais pas assez en leur pouvoir, parvinrent enfin à me livrer à leur ami [4]. » Nous sommes en 1765, il lui reste 13 ans à vivre.
– Ce livre fait partie des nombreux ouvrages que j’ai lus ou relus pour écrire mon essai Le Contrat universel : au-delà du « mariage gay ». Il y est question du trio constitué par Rousseau avec Mme de Warens et Claude Anet. Et si vous l’achetiez ?
– Lire l’article sur Du Contrat social (1762).
Voir en ligne : Texte intégral et illustrations
© altersexualite.com 2007.
L’illustration des Confessions est tirée de cet excellent site où l’on trouve tout le texte et les illustrations d’époque. Malheureusement, aucune illustration de la scène du Maure…
[1] Consulter à ce propos l’ouvrage de Claude Courouve : Vocabulaire de l’homosexualité masculine.
[2] Lire cette page exhaustive sur Rousseau musicien, ou plutôt sur son petit Opéra. Il semble que toutes ses autres partitions aient disparu, en tout cas on n’en trouve nulle trace discographique. Il semble qu’il ait été et soit encore l’objet de condescendance pour son œuvre musicale. Cela me fait penser à Léo Ferré, au tempérament assez rousseauiste, dont la musique instrumentale é été l’objet de la même condescendance, pour avoir lui aussi préféré la mélodie à l’harmonie, et trempé dans la « variété ».
[3] Les prénoms de ces personnages ne sont jamais donnés, Rousseau écrit simplement « Duclos » ou « Grimm ».
[4] Le philosophe David Hume, avec lequel il se brouillera.
 altersexualite.com
altersexualite.com