Accueil > Livres pour les jeunes et les « Isidor » HomoEdu > Théâtre, Poésie & Chanson > L’Île des esclaves, de Marivaux
Au programme des classes de 1re techno en 2020-2023
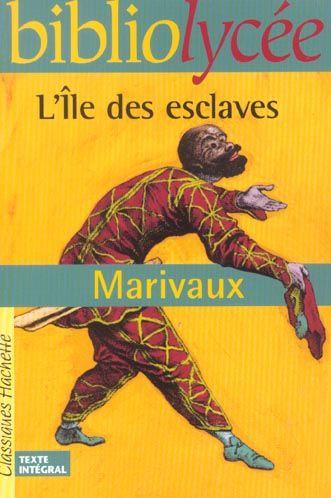 L’Île des esclaves, de Marivaux
L’Île des esclaves, de Marivaux
Petits Classiques Larousse, 2006 (1725).
samedi 22 août 2020, par
L’Île des esclaves de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, dit Marivaux (1688-1763) est avec Juste la fin du monde, Jean-Luc Lagarce une des trois pièces inscrites au programme de 1re technologique en 2020-2023, en remplacement des 3 pièces précédentes, dont Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. En 1re générale, c’est Les Fausses confidences, alors que les deux autres œuvres sont identiques : ces programmes sont quand même très étonnants ! Je relis cette pièce pour être capable d’interroger dessus au bac, et parce que je me tâte au cas où j’aurais une 1re techno. Le « parcours » associé est : « maîtres et valets », alors que pour Le Mariage de Figaro c’était « la comédie du valet ». Arlequin figure en bonne place dans l’arbre généalogique de Figaro. En fait depuis que j’ai ouvert le livre nous avons appris dans mon petit lycée que les 2 classes de 1re que l’on nous avait promises sont remises en causes. En fait la réforme Blanquer a tué la filière techno, qui était la seule à conserver des groupes classes et pas le bazar qu’est devenu le lycée général. Il semble que cela plaise malgré l’hécatombe qu’a été l’enseignement des maths lors de cette première année test cataclysmique. Bref, revenons à nos moutons : il s’agit d’une pièce en un acte, publiée alors que Marivaux est âgé de 37 ans, et a déjà connu plusieurs grands succès avec Arlequin poli par l’amour (1720) ; La Surprise de l’amour (1722) ; La Double Inconstance (1723), etc. C’est sa 12e pièce, mais ce nombre inclut des pièces de jeunesse très peu jouées. La pièce connaît également le succès. J’ai utilisé l’édition des Petits Classiques Larousse (2006) par Élio Suhamy ; il existe quantité d’éditions parascolaires.
À part deux pièces de jeunesse, Marivaux commence sa carrière lors de la période de renouveau théâtral qui suit la mort de Louis XIV en 1715. Les informations suivantes sont notamment tirées de l’Histoire du théâtre dessinée d’André Degaine (Nizet, 1996). Lors de sa vieillesse puritaine, le roi avait expulsé les comédiens italiens en 1797, qui auraient manqué de respect envers Mme de Maintenon. Cette gravure représente le Départ des Comédiens italiens, par Louis Jacob d’après Watteau, 1697.

À Paris les Foires Saint-Germain (du 3 février aux Rameaux) et Saint-Laurent (de juillet à septembre) présentent des spectacles dans de petites salles démontables vers l’actuel marché Saint-Germain et vers l’actuelle gare de l’Est, et c’est là que Marivaux présente sa première vraie pièce, Annibal, une tragédie, qui ne connaît pas le succès. La Comédie-Française obtient le privilège d’être la seule à pouvoir représenter la tragédie. À la foire, seuls les danseurs de corde ont le droit de parler quand ils sont sur la corde ! En 1797, après l’expulsion des italiens, il n’y a plus qu’un seul théâtre à Paris, et les comédiens de foire ont une tolérance relative toujours contestée pour jouer la comédie. Il y a quatre troupes, qui se produisent lors des deux foires. En 1704, interdiction de dialoguer : un seul acteur sur scène, la réplique vient de la coulisse. En 1707, interdiction de parler, on joue « à la muette », on essaie de chanter, mais en 1709, c’est interdit, ce qui oblige à mimer. Les comédiens détournent la loi en exhibant des pancartes avec le texte, que le public (enfin le pourcentage alphabétisé, mais les places étant chères, le public est choisi) lit ou chante à voix haute ! Les pièces sont courtes et font la part belle à l’imagination et aux trucs de forains, utilisent le personnage d’Arlequin qui s’exprime en français. Les auteurs de l’époque sont censurés de toutes les manières, que ce soit par la censure officielle à la Comédie Française, ou par les interdictions, d’où l’oubli des auteurs de l’époque dont le talent a été étouffé. À la mort de Louis XIV, Louis XV étant enfant, c’est Philippe d’Orléans qui devient le Régent, et la Régence permet la réouverture du Théâtre italien de Paris en 1716, avec comme directeur Louis Riccoboni. La foire est interdite en 1719, puis rouverte en 1722. Les deux foires disparaissent entre 1789 et 1806. Les Italiens sous l’influence de la foire, jouent en français, et polissent le personnage d’Arlequin, le font moins grossier. Marivaux est beaucoup joué, ses pièces s’inspirent du théâtre de foire et de la comédie italienne, mais il demeure un illustre inconnu, sa gloire est éclipsée après sa mort et il est redécouvert au XXe siècle. L’Île des esclaves n’est créée à la Comédie-Française qu’en 1939. Après le succès de L’Île des esclaves, Marivaux écrira deux autres « îles », L’Île de la raison (1727) et La Nouvelle colonie (1729).
La pièce est une comédie à idée, une sorte d’expérience philosophique permettant d’améliorer le comportement des personnages, avec une morale de bon ton, ce qui favorise l’identification du public bourgeois. C’est aussi une brève utopie, avec un totalitarisme en germe, aussitôt aboli par le bon fond des personnages qui les retient d’abuser de la situation. Marivaux n’est pas le précurseur des bolchéviques, mais un auteur des Lumières qui cherche à mettre en avant le bon côté de chacun de ses personnages, à moins de considérer que la tirade de Trivelin (extrait 2) suggère le non-dit de la pièce, une violence pré-révolutionnaire sous-jacente. Sur les 5 personnages, deux (Arlequin et Trivelin) ont des noms typiques de la commedia dell’arte, les trois autres des noms créés sur des racines grecques : Iphicrate (« celui qui commande par la force »), Euphrosine (« qui rend heureux »), Cléanthis (« gloire des fleurs »). À noter : personne ne nomme Trivelin dans la pièce ; il apparaît donc comme le démiurge des lieux. Il me fait penser au Prospero de Shakespeare. La liste des personnages ajoute « Des habitants de l’île », ce qui laisse toute latitude au metteur en scène.
Extraits proposés en lecture expliquée.
1er extrait : scène 1 (extrait)
La scène d’exposition, et particulièrement ce passage, pose le problème que la pièce se propose de résoudre.
« IPHICRATE, retenant sa colère. – Mais je ne te comprends point, mon cher Arlequin.
ARLEQUIN. – Mon cher patron, vos compliments me charment ; vous avez coutume de m’en faire à coups de gourdin qui ne valent pas ceux-là ; et le gourdin est dans la chaloupe.
IPHICRATE. – Eh ! ne sais-tu pas que je t’aime ?
ARLEQUIN. – Oui ; mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules, et cela est mal placé. Ainsi, tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse ! s’ils sont morts, en voilà pour longtemps ; s’ils sont en vie, cela se passera, et je m’en goberge.
IPHICRATE, un peu ému. – Mais j’ai besoin d’eux, moi.
ARLEQUIN, indifféremment. – Oh ! cela se peut bien, chacun a ses affaires : que je ne vous dérange pas !
IPHICRATE. – Esclave insolent !
ARLEQUIN, riant. – Ah ! ah ! vous parlez la langue d’Athènes ; mauvais jargon que je n’entends plus.
IPHICRATE. – Méconnais-tu ton maître, et n’es-tu plus mon esclave ?
ARLEQUIN, se reculant d’un air sérieux. – Je l’ai été, je le confesse à ta honte ; mais va, je te le pardonne ; les hommes ne valent rien. Dans le pays d’Athènes j’étais ton esclave, tu me traitais comme un pauvre animal, et tu disais que cela était juste, parce que tu étais le plus fort. Eh bien ! Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi ; on va te faire esclave à ton tour ; on te dira aussi que cela est juste, et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là ; tu m’en diras ton sentiment, je t’attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable ; tu sauras mieux ce qu’il est permis de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux dans le monde, si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Adieu, mon ami ; je vais trouver mes camarades et tes maîtres. Il s’éloigne. »
2e extrait : scène 2 (extrait)
Trivelin fait le metteur en scène et l’auteur ; il paraphrase la devise de la comédie : « castigat ridendo mores », et manipule ses comédiens pour leur faire découvrir sa vérité.
« TRIVELIN, avec cinq ou six insulaires, arrive conduisant une Dame et la suivante, et ils accourent à Iphicrate qu’ils voient l’épée à la main.
TRIVELIN, faisant saisir et désarmer Iphicrate par ses gens. – Arrêtez, que voulez-vous faire ?
IPHICRATE. – Punir l’insolence de mon esclave.
TRIVELIN. – Votre esclave ? vous vous trompez, et l’on vous apprendra à corriger vos termes. (Il prend l’épée d’Iphicrate et la donne à Arlequin.) Prenez cette épée, mon camarade, elle est à vous.
ARLEQUIN. – Que le ciel vous tienne gaillard, brave camarade que vous êtes !
TRIVELIN. – Comment vous appelez-vous ?
ARLEQUIN. – Est-ce mon nom que vous demandez ?
TRIVELIN. – Oui vraiment.
ARLEQUIN. – Je n’en ai point, mon camarade.
TRIVELIN. – Quoi donc, vous n’en avez pas ?
ARLEQUIN. – Non, mon camarade ; je n’ai que des sobriquets qu’il m’a donnés ; il m’appelle quelquefois Arlequin, quelquefois Hé.
TRIVELIN. – Hé ! le terme est sans façon ; je reconnais ces Messieurs à de pareilles licences. Et lui, comment s’appelle-t-il ?
ARLEQUIN. – Oh, diantre ! il s’appelle par un nom, lui ; c’est le seigneur Iphicrate.
TRIVELIN. – Eh bien ! changez de nom à présent ; soyez le seigneur Iphicrate à votre tour ; et vous, Iphicrate, appelez-vous Arlequin, ou bien Hé.
ARLEQUIN, sautant de joie, à son maître. – Oh ! Oh ! que nous allons rire, seigneur Hé !
TRIVELIN, à Arlequin. – Souvenez-vous en prenant son nom, mon cher ami, qu’on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité, que pour le corriger de son orgueil.
ARLEQUIN. – Oui, oui, corrigeons, corrigeons !
IPHICRATE, regardant Arlequin. – Maraud !
ARLEQUIN. – Parlez donc, mon bon ami, voilà encore une licence qui lui prend ; cela est-il du jeu ? »
3e extrait : scène 2 (extrait)
Cette tirade de Trivelin est étonnante, car malgré le ton apaisant de l’ensemble de la pièce et du dénouement, elle suggère une violence vengeresse pré-révolutionnaire dont on se demande comment elle a pu passer la censure.
« TRIVELIN. – Ne m’interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leurs maîtres, quittèrent la Grèce et vinrent s’établir ici, dans le ressentiment des outrages qu’ils avaient reçus de leurs patrons, la première loi qu’ils y firent fut d’ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves : la vengeance avait dicté cette loi ; vingt ans après, la raison l’abolit, et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons ; ce n’est plus votre vie que nous poursuivons, c’est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire ; nous vous jetons dans l’esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu’on y éprouve ; nous vous humilions, afin que, nous trouvant superbes, vous vous reprochiez de l’avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d’humanité, dure trois ans, au bout desquels on vous renvoie, si vos maîtres sont contents de vos progrès ; et si vous ne devenez pas meilleurs, nous vous retenons par charité pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire encore ailleurs, et par bonté pour vous, nous vous marions avec une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois à cet égard ; mettez à profit leur rigueur salutaire, remerciez le sort qui vous conduit ici, il vous remet en nos mains, durs, injustes et superbes ; vous voilà en mauvais état, nous entreprenons de vous guérir ; vous êtes moins nos esclaves que nos malades, et nous ne prenons que trois ans pour vous rendre sains, c’est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie. »
4e extrait : scène 3 (extrait)
Cette scène présente une jolie liste à ajouter à notre article sur les injures.
« TRIVELIN, CLÉANTHIS, esclave, EUPHROSINE, sa maîtresse.
TRIVELIN. – Ah ça ! ma compatriote – car je regarde désormais notre île comme votre patrie –, dites-moi aussi votre nom.
CLÉANTHIS, saluant. – Je m’appelle Cléanthis, et elle, Euphrosine.
TRIVELIN. – Cléanthis ? passe pour cela.
CLÉANTHIS. – J’ai aussi des surnoms ; vous plaît-il de les savoir ?
TRIVELIN. – Oui-da. Et quels sont-ils ?
CLÉANTHIS. – J’en ai une liste : Sotte, Ridicule, Bête, Butorde, Imbécile, et caetera.
EUPHROSINE, en soupirant. – Impertinente que vous êtes !
CLÉANTHIS. – Tenez, tenez, en voilà encore un que j’oubliais.
TRIVELIN. – Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l’on en peut dire impunément.
EUPHROSINE. – Hélas ! que voulez-vous que je lui réponde, dans l’étrange aventure où je me trouve ?
CLÉANTHIS. – Oh ! dame, il n’est plus si aisé de me répondre. Autrefois il n’y avait rien de si commode ; on n’avait affaire qu’à de pauvres gens : fallait-il tant de cérémonies ? Faites cela, je le veux ; taisez-vous, sotte ! Voilà qui était fini. Mais à présent il faut parler raison ; c’est un langage étranger pour Madame ; elle l’apprendra avec le temps ; il faut se donner patience : je ferai de mon mieux pour l’avancer.
TRIVELIN, à Cléanthis. – Modérez-vous, Euphrosine. (À Euphrosine.) Et vous, Cléanthis, ne vous abandonnez point à votre douleur. Je ne puis changer nos lois, ni vous en affranchir : je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. »
5e extrait : scène 3 (extrait)
Cette tirade de Cléanthis est typique de la mise en abyme : elle joue sa maîtresse devant elle-même pour la confondre.
« CLÉANTHIS. – Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé ? Ah qu’on m’apporte un miroir ; comme me voilà faite ! que je suis mal bâtie ! Cependant on se mire, on éprouve son visage de toutes les façons, rien ne réussit ; des yeux battus, un teint fatigué ; voilà qui est fini, il faut envelopper ce visage-là, nous n’aurons que du négligé, Madame ne verra personne aujourd’hui, pas même le jour, si elle peut ; du moins fera-t-il sombre dans la chambre. Cependant il vient compagnie, on entre : que va-t-on penser du visage de Madame ? on croira qu’elle enlaidit : donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies ? Non, il y a remède à tout : vous allez voir. Comment vous portez-vous, Madame ? Très mal, Madame ; j’ai perdu le sommeil ; il y a huit jours que je n’ai fermé l’œil ; je n’ose pas me montrer, je fais peur. Et cela veut dire : Messieurs, figurez-vous que ce n’est point moi, au moins ; ne me regardez pas, remettez à me voir ; ne me jugez pas aujourd’hui ; attendez que j’aie dormi. J’entendais tout cela, moi, car nous autres esclaves, nous sommes doués contre nos maîtres d’une pénétration !… Oh ! ce sont de pauvres gens pour nous. »
6e extrait : scène 6 (extrait)
Encore une scène de mise en abyme : les personnages semblent régler une mise en scène.
« CLÉANTHIS, IPHICRATE, ARLEQUIN, EUPHROSINE.
CLEANTHIS. − Seigneur Iphicrate, puis-je vous demander de quoi vous riez ?
ARLEQUIN. − Je ris de mon Arlequin qui a confessé qu’il était un ridicule.
CLEANTHIS. − Cela me surprend, car il a la mine d’un homme raisonnable. Si vous voulez voir une coquette de son propre aveu, regardez ma suivante.
ARLEQUIN, la regardant. − Malepeste ! quand ce visage-là fait le fripon, c’est bien son métier. Mais parlons d’autres choses, ma belle demoiselle ; qu’est-ce que nous ferons à cette heure que nous sommes gaillards ?
CLEANTHIS. − Eh ! mais la belle conversation.
ARLEQUIN. − Je crains que cela ne nous fasse bâiller, j’en bâille déjà. Si je devenais amoureux de vous, cela amuserait davantage.
CLEANTHIS. − Eh bien, faites. Soupirez pour moi ; poursuivez mon cœur, prenez-le si vous le pouvez, je ne vous en empêche pas ; c’est à vous de faire vos diligences ; me voilà, je vous attends ; mais traitons l’amour à la grande manière, puisque nous sommes devenus maîtres ; allons-y poliment, et comme le grand monde.
ARLEQUIN. − Oui-da ; nous n’en irons que meilleur train.
CLEANTHIS. − Je suis d’avis d’une chose, que nous disions qu’on nous apporte des sièges pour prendre l’air assis, et pour écouter les discours galants que vous m’allez tenir ; il faut bien jouir de notre état, en goûter le plaisir.
ARLEQUIN. − Votre volonté vaut une ordonnance. (À Iphicrate.) Arlequin, vite des sièges pour moi, et des fauteuils pour Madame.
IPHICRATE. − Peux-tu m’employer à cela ?
ARLEQUIN. − La république le veut.
CLEANTHIS. − Tenez, tenez, promenons-nous plutôt de cette manière-là, et tout en conversant vous ferez adroitement tomber l’entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Car encore une fois nous sommes d’honnêtes gens à cette heure, il faut songer à cela ; il n’est plus question de familiarité domestique. Allons, procédons noblement, n’épargnez ni compliment ni révérences.
ARLEQUIN. − Et vous, n’épargnez point les mines. Courage ! quand ce ne serait que pour nous moquer de nos patrons. Garderons-nous nos gens ?
CLEANTHIS. − Sans difficulté ; pouvons-nous être sans eux ? c’est notre suite, qu’ils s’éloignent seulement. »
7e extrait : scène 10 (extrait)
Cette tirade de Cléanthis illustre la double énonciation.
« CLEANTHIS. − Ah ! vraiment, nous y voilà avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent, et qui nous regardent comme des vers de terre ; et puis, qui sont trop heureux dans l’occasion de nous trouver cent fois plus honnêtes gens qu’eux. Fi ! que cela est vilain, de n’avoir eu pour mérite que de l’or, de l’argent et des dignités ! C’était bien la peine de faire tant les glorieux ! Où en seriez-vous aujourd’hui, si nous n’avions point d’autre mérite que cela pour vous ? Voyons, ne seriez-vous pas bien attrapés ? Il s’agit de vous pardonner, et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être, s’il vous plaît ? Riche ? non ; noble ? non ; grand seigneur ? point du tout. Vous étiez tout cela ; en valiez-vous mieux ? Et que faut-il donc ? Ah ! nous y voici. Il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison ; voilà ce qu’il nous faut, voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu’un homme est plus qu’un autre. Entendez-vous, Messieurs les honnêtes gens du monde ? Voilà avec quoi l’on donne les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent. Et à qui les demandez-vous ? À de pauvres gens que vous avez toujours offensés, maltraités, accablés, tout riches que vous êtes, et qui ont aujourd’hui pitié de vous, tout pauvres qu’ils sont. Estimez-vous à cette heure, faites les superbes, vous aurez bonne grâce ! Allez ! vous devriez rougir de honte. »
8e extrait : scène 11 (entière)
Voici un dénouement heureux qui ne peut guère chagriner le public bourgeois de la foire.
« TRIVELIN et les acteurs précédents.
TRIVELIN. − Que vois-je ? vous pleurez, mes enfants ; vous vous embrassez !
ARLEQUIN. − Ah ! vous ne voyez rien ; nous sommes admirables ; nous sommes des rois et des reines. En fin finale, la paix est conclue, la vertu a arrangé tout cela ; il ne nous faut plus qu’un bateau et un batelier pour nous en aller : et si vous nous les donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous.
TRIVELIN. − Et vous, Cléanthis, êtes-vous du même sentiment ?
CLEANTHIS, baisant la main de sa maîtresse. − Je n’ai que faire de vous en dire davantage ; vous voyez ce qu’il en est.
ARLEQUIN, prenant aussi la main de son maître pour la baiser. − Voilà aussi mon dernier mot, qui vaut bien des paroles.
TRIVELIN. − Vous me charmez. Embrassez-moi aussi, mes chers enfants ; c’est là ce que j’attendais. Si cela n’était pas arrivé, nous aurions puni vos vengeances, comme nous avons puni leurs duretés. Et vous, Iphicrate, vous, Euphrosine, je vous vois attendris ; je n’ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leurs maîtres, et vous en avez mal agi ; ils sont devenus les vôtres, et ils vous pardonnent ; faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n’est qu’une épreuve que les dieux font sur nous : je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans deux jours et vous reverrez Athènes. Que la joie à présent, et que les plaisirs succèdent aux chagrins que vous avez sentis, et célèbrent le jour de votre vie le plus profitable. »
– Si je choisis cette pièce il me semble qu’en histoire des arts, je mettrais à mon programme « forêts paisibles », le tube extrait des Indes galantes (1735) de Jean-Philippe Rameau, dont voici les paroles, sous la video magnifique des Arts Florissants pour leur 40e anniversaire à la Philharmonie de Paris, dirigée par William Christie. Cela pourrait d’ailleurs aussi servir pour le parcours « Notre monde vient d’en trouver un autre » en argumentation.
<https://www.youtube.com/watch?v=wNm...>
« Forêts paisibles,
Jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs.
S’ils sont sensibles,
Fortune, ce n’est pas au prix de tes faveurs.
(Chœur des sauvages)
Forêts paisibles,
Jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs.
S’ils sont sensibles,
Fortune, ce n’est pas au prix de tes faveurs.
Dans nos retraites,
Grandeur, ne viens jamais
offrir de tes faux attraits !
Ciel, tu les as faites
pour l’innocence et pour la paix.
Jouissons dans nos asiles,
Jouissons des biens tranquilles !
Ah ! Peut-on être heureux,
Quand on forme d’autres vœux ? »
– Le dossier de l’édition Larousse suggère un rapprochement avec le film Metropolis de Fritz Lang, dont la fin utopique semble une paraphrase de la pièce. Un carton profère que « Le médiateur entre le cerveau et les mains doit être le cœur », après que Freder a obligé son père Fredersen et le contremaître Grot à se serrer la main.
– D’autres textes complémentaires sont à puiser parmi les contemporains de Marivaux qui ont pu l’inspirer, et réciproquement, que ce soit Robinson Crusoé (1719) de Daniel Defoe, Les Voyages de Gulliver (1726), de Jonathan Swift, Micromégas (1752) de Voltaire, sans oublier L’Île de la raison (1727) de Marivaux.
Voir en ligne : L’Île des esclaves sur Wikisource
© altersexualite.com 2020
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com