Accueil > Culture générale et expression en BTS > « Dans ma maison » > Éloge du quotidien. Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle, de (...)
De Rembrandt à Vermeer, en passant par Steen, Hals, Ter Borch, Dou, promenade à travers la peinture hollandaise du XVIIe siècle
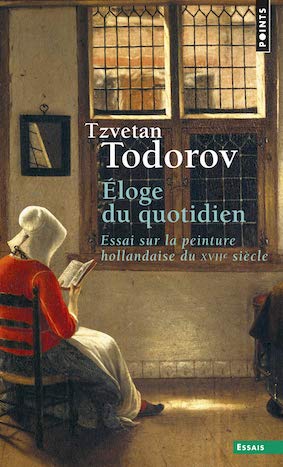 Éloge du quotidien. Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle, de Tzvetan Todorov
Éloge du quotidien. Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle, de Tzvetan Todorov
Points Seuil, 2009, 170 p., 8,1 €.
samedi 4 décembre 2021, par
Éloge du quotidien. Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle est un livre inscrit sur la liste du Bulletin officiel pour le thème de BTS « Dans ma maison » (2021-2023). Je suis familier des essais de l’auteur Tzvetan Todorov, linguiste émérite qui fournissait depuis des lustres du foin à la curiosité des étudiants en lettres. Le sujet en soi suffisait à me faire choisir ce livre dans la liste, car il va permettre un article illustré en plein dans le thème.
Todorov évoque la rupture qui se produit lorsqu’on visite un grand musée de peinture dans le sens chronologique : « Ce parcours connaît plusieurs ruptures de thèmes et de styles. Arrêtons-nous sur l’une d’elles : soudain, à la place des grands tableaux représentant des personnages historiques, mythologiques ou religieux, apparaissent des images de mères épouillant un enfant, de tailleurs penchés sur leur ouvrage, de jeunes filles lisant des lettres ou jouant du clavecin. Le doute n’est plus permis : nous sommes dans les salles de peinture hollandaise du XVIIe siècle, une peinture de la vie quotidienne, appelée aussi « peinture de genre ». Les siècles suivants, les pays voisins préserveront cet acquis ; mais il y manquera une espèce d’acuité dans le regard du peintre, que l’on ressent lorsque l’on est en face des tableaux hollandais de cette époque. De là naîtra ce qu’on appelle, un peu sommairement, la peinture réaliste. Le choc suivant, comparable en intensité, se produira deux cents ans plus tard (et plusieurs centaines de mètres plus loin, dans le musée) : la représentation réaliste s’évanouira dans les tableaux impressionnistes et symbolistes » (p. 9). La vie quotidienne n’était pas absente des œuvres des siècles antérieurs, « Mais on sent tout de suite que cette ancienne représentation de la vie quotidienne est soumise à un objectif supérieur : dresser le répertoire exhaustif et systématique des situations de la vie, illustrer un ordre préexistant. Ou encore, dans un tableau à sujet religieux ou édifiant, on trouve tel saint occupé à un travail manuel tout à fait commun. À une certaine époque, on privilégie les sujets sacrés qui permettent un rapprochement maximal avec le monde profane : les tribulations du fils prodigue, le Christ chez Marthe et Marie, la maternité. Mais, là aussi, on voit que si cette activité a été élevée à la dignité que présuppose son apparition dans une image, c’est parce qu’elle est l’attribut d’un personnage célèbre, non parce qu’on la considère comme suffisamment noble en elle-même. Ce n’est pas n’importe quelle mère allaitant son enfant qu’on nous montre, c’est seulement la Vierge avec le petit Jésus » (p. 10). Une hiérarchie des genres est instaurée. La représentation humaine est au sommet, au-dessus des paysages, des natures mortes et des animaux, et la peinture « réaliste » partage le devant de la scène avec « la peinture à sujets historiques et religieux ». Après l’époque de l’académisme (fin XIXe), « l’idée de hiérarchie des genres, voire de genres de peinture tout court, devient obsolète » (p. 13). En ce qui concerne l’interprétation des tableaux, Todorov montre à partir de l’exemple de Bethsabée de Jan Steen, qu’un titre ou un mot (ici « Bethsabée » écrit sur le papier que tient la jeune protagoniste du tableau) peuvent changer l’interprétation. « Trois modes d’interprétation marquent les extrémités d’un territoire – dont le centre serait occupé par le littéralisme pur. À un bout, on trouve l’interprétation allégorique : l’image est alors la figuration codée d’une abstraction. Cette femme que nous voyons n’est pas du tout une femme, c’est Mélancolie, cette autre est Justice, cette troisième Vérité.
Le tableau de Dou, Le Hachis d’oignons, par exemple, est rempli d’objets qui évoquent pour le spectateur contemporain la sexualité : les oignons eux-mêmes, l’oiseau suspendu, la cage vide, l’aiguière renversée, le pilon et le mortier [1]. À une autre extrémité, l’interprétation historique : on se réfère alors à une histoire qui préexiste au tableau, dans la religion chrétienne ou dans la mythologie grecque, dans l’histoire des peuples ou dans les œuvres des poètes. C’est une histoire unique, qu’il est indispensable de connaître sous peine de se méprendre sur le sens du tableau, tel que le voulait son auteur ; ce sens naît de l’interprétation que fait le peintre d’un sujet d’avance connu du spectateur » (p. 18). L’auteur souligne l’éloge de la maison qui nourrit la peinture hollandaise : « La maison est l’incarnation à la fois de la communauté idéale, hiérarchisée et solidaire, et du recueillement individuel. Ainsi tout ce qui a trait à la maison privée se trouve marqué d’un indice favorable (alors que les lieux publics sont, potentiellement au moins, des lieux de perdition) : avant tout le mariage, lui-même fondement du ménage, et les enfants qui en sont issus. Ceux-ci apparaissent du reste, aux yeux des visiteurs étrangers en Hollande, comme à la fois pourvus de trop d’importance et trop libres » (p. 30). La femme incarne les vertus domestiques, qui se trouvent surévaluées. « Or, la structuration de la vie autour de l’axe intérieur/extérieur correspond aussi à une distribution des rôles selon les sexes : aux hommes le monde extérieur, aux femmes la maison. Le plus célèbre poète-moraliste de l’époque, Jacob Cats, formule ainsi la répartition des tâches (et illustre par la même occasion le mauvais ménage formé par poésie et morale) :
« Le mari doit être à la rue pour exercer son métier,
L’épouse, à ses fourneaux, ne quittera son foyer.
Chez l’homme diligent la sagesse de rue se louera volontiers,
Mais à l’épouse délicate il faut des mœurs paisibles et régulières.
Ô toi, industrieux mari, ton pain va-t-en gagner,
Et toi , ô jeune épousée, veille sur ton foyer. »
Cette répartition n’a certes rien de surprenant ni d’original. La Hollande du XVIIe siècle n’est ni la première ni la dernière société du monde où l’on s’attend que la femme se consacre essentiellement à trois tâches : nettoyer la maison, préparer les repas, porter et élever ses enfants. Que dans chacun des deux grands domaines le représentant de l’un des sexes règne en maître incontesté, là l’homme, ici la femme, n’est pas nouveau. Ce qui rend la situation un peu plus singulière, c’est que le domaine de la maison, de l’intérieur, du privé – donc celui de la femme – soit plus apprécié que l’autre. Cela entraîne des conséquences surprenantes pour le statut des femmes dans cette société pourtant bien patriarcale. Infiniment plus que les hommes, elles incarnent les vertus domestiques (toujours autour des mêmes thèmes : propreté, nourriture, enfants), même si l’on peut trouver des gravures nous montrant les hommes occupés à des tâches traditionnellement féminines : bercer les enfants, ranger la maison ; du reste, la légende de la gravure tourne parfois l’homme en dérision. De l’avis de tous les voyageurs étrangers, les femmes jouissent en Hollande d’une liberté inconnue ailleurs ; les Français, un peu vexés, se l’expliquent par leur tempérament froid qui les protège des excès (dans les mêmes conditions de liberté les Françaises passionnées feraient des folies). La violence domestique est punie par la loi » (p. 34). La plupart de ces peintres ne vivent pas dans l’aisance car ils se font concurrence : « Un voyageur français, de Monconys, se rend à l’atelier de Vermeer (c’est une des une des rares mentions anciennes du peintre), malheureusement, celui-ci n’a aucun de ses tableaux chez lui ; où notre voyageur pourrait-il en voir un ? Eh bien, chez le boulanger ! Un autre tableau de Vermeer est mentionné dans la succession d’un aubergiste. Mais ce boulanger de Delft, on a pu l’établir, était un homme riche, et la présence d’un Vermeer chez lui indique avant tout que le peintre ne disposait pas d’autres moyens pour régler ses achats ; après la mort du peintre, sa veuve se verra obligée d’acquitter ses dettes auprès du même boulanger par deux autres tableaux du maître. Il y a une demande pour la peinture qui permet de décorer les maisons, ces lieux chers au cœur des Néerlandais ; mais l’offre est si forte que les prix ne sont en général pas élevés » (p. 39). Il ne faut rien chercher derrière le réalisme hollandais : « Le réalisme de cette peinture serait tel qu’on y chercherait en vain la moindre leçon morale ; le seul but du tableau, c’est de représenter ce qui est. « L’école qui s’est le plus exclusivement occupée du monde réel semble celle de toutes qui en a le plus méconnu l’intérêt moral […]. Quelle raison un peintre hollandais a-t-il de faire un tableau ? Aucune ; et remarquez qu’on ne la lui demande jamais. Un paysan au nez aviné vous regarde avec son gros œil et vous rit à pleines dents en levant un broc ; si la chose est bien peinte, elle a son prix. » Du reste, le terme « réalisme » lui-même est employé pour la première fois en France dans son sens actuel en 1835, pour désigner non les œuvres romanesques du XIXe siècle, mais, justement, la peinture hollandaise du XVIIe siècle, dont la « vérité humaine » était censée s’opposer à « l’idéalité poétique » de la peinture italienne » (p. 44).
Todorov établit un distinguo entre littérature et peinture, à propos des métiers entachés de blâme ou d’éloge : « admettre la présence de ces significations morales ne diminue nullement le plaisir qu’on éprouve à regarder les images ; qu’il faille condamner les charlatans et approuver les mères vertueuses ne rend pas ces images fastidieuses. L’étonnement trouve sa source dans une comparaison avec la littérature : pour la sensibilité moderne, un message didactique explicite est incompatible avec la qualité littéraire. Mais c’est que les deux modes de représentation diffèrent en profondeur : l’existence d’une leçon morale ne transforme pas nécessairement l’image mais s’y superpose, alors que son homogénéité avec la matière verbale de l’œuvre littéraire modifie celle-ci de l’intérieur. Un message chrétien imprégnera le texte tout entier, alors que, aussi pieux que soit le peintre, ce même message ne fera que se greffer sur l’image. Non seulement le spectateur moderne peut sans mal faire abstraction des significations allégoriques et morales du tableau, alors que l’opération est impossible lorsqu’il se fait lecteur, mais le mode de production du sens n’est pas le même en littérature et en peinture. Il est vrai que nous ne savons jamais avec certitude si l’auteur d’une fiction prend à son compte les énoncés qui s’y trouvent ; mais, quant au peintre, il ne produit même pas de pseudo-assertions : il montre sans affirmer, sa syntaxe comporte des sujets mais non des prédicats » (p. 57).
Un exemple extrême est le tableau de Jan Steen, Couple au lit « Dans grand nombre de ses tableaux on voit des scènes figurant les différentes faiblesses humaines, et l’indication d’une leçon morale y est claire : en témoignent les mots dans le tableau, les figures et accessoires à signification allégorique codée, la composition d’ensemble même – accumulation invraisemblable de personnages et de situations illustrant une même idée. Il a, de plus, peint de nombreux personnages peu recommandables, ivrognes et prostituées, faisant preuve parfois d’un certain voyeurisme. Mais est-ce tout ? L’important n’est-il pas plutôt en ce que l’intempérance s’y mue en exubérance ? Peut-on ignorer, là aussi, l’amour de la vie que respirent tant les personnes représentées (l’humour de Steen ne verse pas dans la satire) que le peintre lui-même, à travers l’exécution rigoureuse de son tableau et le plaisir visuel qu’il cherche à procurer ? Les scènes de bordel, qui ne sont certainement pas représentées pour nous indiquer un exemple à suivre, ne frappent-elles pas d’abord par la bonne humeur qu’elles respirent ? Ou regardons cette Mangeuse d’huîtres. Il est clair qu’elle est loin d’être une incarnation de la vertu : aussi bien la nourriture réputée aphrodisiaque que le regard quelque peu insolent, voire racoleur de la jeune fille, la classent plutôt parmi les habituées des auberges, sinon des maisons closes. Mais le regard de Steen, lui, ne porte nulle condamnation simple : une fois de plus, le plaisir que prend le personnage à manger, et le peintre et le spectateur, à regarder, ne peuvent être ignorés » (p. 60). Tel n’est pas le cas de Gabriel Metsu, qu’on dirait un émule de George Soros avant la lettre : « Gabriel Metsu a peint des scènes de vertus domestiques : femmes préparant la nourriture ou distribuant l’aumône, et aussi des actions peu recommandables (scènes de bordel) ou des échanges grivois, comme dans Le Cadeau du chasseur. Mais l’essentiel de son œuvre n’entre pas facilement dans ces catégories ; plutôt que la vertu ou le vice, le sujet principal de Metsu est, simplement, la femme – dont il apparaît comme un véritable « champion ». Certaines toiles prennent ouvertement le parti des femmes, présentées volontiers comme les victimes des hommes : les pauvrettes sont toujours amenées au bord des larmes ! Ainsi pleure une femme devant le méchant usurier, une autre auprès d’un forgeron non moins antipathique ; heureusement que, comme le dit le titre d’un tableau allégorique de Metsu, La Justice protège la veuve et l’orphelin (contre qui ? Contre les vilains hommes, bien sûr). Dans un autre tableau célèbre, la source du malheur est la seule maladie, et il n’est donc pas question d’éloge ou de blâme ; mais la compassion de Metsu n’a pas diminué » (p. 65).

Même chez Ter Borch, on est loin de l’idéologie « #metoo » : « Quel qu’en soit le point de départ, les tableaux que nous avons sous les yeux contiennent aussi un éloge de l’amour purement humain, et c’est sa représentation même qui en fait un acte digne d’admiration. Même lorsque ce qui est peint correspond clairement à l’amour vénal, comme dans Le Galant Militaire de Ter Borch, il n’y a pas de condamnation sans appel. Ce soldat un peu ventru qui respire la bonhomie n’est décidément pas Satan, même s’il veut de toute évidence acheter les services de la jeune femme à ses côtés ; elle-même boit du vin et mange des huîtres, mais sa pose est si retenue (intimidée ?), son regard si mélancolique ! C’est bien une situation « immorale » qui est représentée ici ; et pourtant Ter Borch ne s’en sert pas en vue d’une simple leçon » (p. 75).
« Dans d’autres tableaux encore, l’enfant attire l’attention et suscite des éloges, non parce qu’il illustre une quelconque vertu, ni parce qu’il sert une allégorie, mais parce qu’il est lui-même devenu le centre de la famille, objet d’amour et d’admiration. Les tableaux de Netscher où la petite fille apprend à lire, où le petit garçon se fait peigner par sa mère, illustrent, bien entendu, les vertus domestiques, mais pas seulement elles. Dans chacun d’eux, un second enfant présent imite, et en même temps tourne en dérision, le geste maternel : le petit frère, là, semble exercer ses talents pédagogiques sur le chien, et la petite sœur, ici, fait des grimaces au lieu de chercher à s’embellir comme le garçon. Ce contraste entre sérieux et facétie a bien un sens moral, mais il est enveloppé dans une image si jolie, à la limite du mièvre, que l’attendrissement l’emporte sur la leçon » (p. 79).
« Mais, à s’en tenir à la seule période de Delft et des toutes premières années d’Amsterdam (correspondant à trente ou quarante tableaux), le rapport à la vertu et au vice n’est pas non plus facile à décrire. Incontestablement, de Hooch fait l’éloge des valeurs et du bonheur domestiques. Mais ce bonheur, à son tour, est atteint grâce aux actes les plus simples de la vie. Ayant commencé par découvrir une manière de peindre conforme à la pureté et à l’élévation de ces sujets vertueux, de Hooch l’étend ensuite (ou en même temps) à l’ensemble de la vie quotidienne. À l’époque où il vit à Delft, son œuvre est une calme glorification de la vie de tous les jours. Par conséquent, la causalité s’inverse : ce n’est plus parce que le sujet est noble que la peinture le magnifie, c’est parce que la peinture de De Hooch révèle la beauté du monde et de la vie que nous sommes prêts à leur attribuer une grande élévation » (p. 93). « La sublimation esthétique de la morale n’est pas un refus de reconnaître celle-ci, plutôt l’espoir que le beau ne puisse être du mal pur. La peinture hollandaise ne nie pas les vertus et les vices, mais les transcende en une réjouissance devant l’existence du monde » (p. 109). « Il ne faut pas sous-estimer la force révolutionnaire de ce geste, du point de vue de l’histoire des images : gratter les navets et peler les pommes devient, pour la première fois, un acte aussi digne de figurer au centre d’un tableau que le couronnement d’un monarque ou les amours d’une déesse ; les femmes en train de faire le ménage sont mises sur le piédestal des saints et des héros antiques. Il n’y a plus rien de choquant dans le fait de peindre une mère qui épouille son enfant, un homme au rouet, puisque la morale dominante a décidé que ces gestes étaient dignes d’être admirés ? Jusque-là, il s’agit d’une conquête qui trouve son origine dans la morale, non dans l’art même. C’est néanmoins par cette brèche que le nombre infiniment varié du quotidien va s’introduire dans le royaume de la peinture – auparavant, on ne l’avait pas trouvé beau – et que la vie ordinaire des gens communs pourra devenir objet d’éloges » (p. 110).

Je signale ce tableau original de Judith Leyster : « une situation inverse à celle qu’on voit d’habitude : c’est maintenant une femme plus âgée qui propose de l’or au jeune homme, lequel semble encore hésiter sur la voie à suivre. Hélas, la brièveté même de sa carrière a empêché Judith Leyster de pousser plus loin son exploration du quotidien et de produire une œuvre plus importante : on ne lui doit, en tout, qu’une trentaine de tableaux de genre » (p. 122). Todorov présente le peintre Gérard Dou : « Dou peint une scène comme si c’était une nature morte, mais il lui attribue en même temps une certaine monumentalité, en encadrant les gestes de la vie quotidienne par des éléments architecturaux imposants : niches, voûtes ou fenêtres. Cette attention extrême au détail et à la surface du tableau – Dou a inventé la peinture « léchée » – implique un travail patient et minutieux, qui a frappé ses contemporains » (p. 122). Et de citer des témoignages de visiteurs sur des séances de travail démesurées pour des détails, ce qui entraîne des réserves : « Il ne semble pas éprouver pour les protagonistes de ces scènes une sympathie plus grande que pour les accessoires, objets, meubles ou aliments ; ce sont pour lui des surfaces comme les autres, et il n’aspire pas à chercher au-delà d’elles. On a l’impression avec Dou d’un remarquable technicien mais qui ne nous apporte pas une sagesse nouvelle » (p. 123).

À l’opposé se trouve Johannes Vermeer : « Regardons, encore et encore, Le Collier de perles : cette femme est bien engagée dans une action quotidienne, elle essaie un nouveau collier ; mais la précision avec laquelle sont peints tous les objets, la répartition rigoureuse de la lumière et des ombres, le dépouillement de l’espace et, surtout, l’immobilité sereine de la femme, qui l’extrait du monde réel pour la maintenir dans une sorte de royaume enchanté, tout cela fait que nous quittons à notre tour le monde représenté et nous nous installons avec volupté dans le tableau lui-même. Grâce à la perfection qu’il atteint dans la représentation […], Vermeer donne l’impression de peindre des tableaux plutôt que des êtres ; ce n’est pas le monde humain qui l’intéresse au premier chef, c’est celui de la peinture » (p. 125). Et plus loin : « On comprend maintenant pourquoi Vermeer a pu nous sembler déborder un peu son temps, et pourquoi aussi les artistes et les écrivains, deux cents ans plus tard, ont vu en lui un des leurs. Par son génie personnel, il conduit la peinture qu’il avait appris à pratiquer, la peinture de genre, à un tel degré de perfection que nous ne pouvons plus pénétrer dans le monde représenté, au-delà de l’image ; nous restons comme frappés de stupeur devant la beauté des tissus, des meubles, des gestes. Vermeer neutralise la représentation par la puissance de la présentation, et c’est en cela qu’il est « moderne » (p. 142).
Le peintre Gerard ter Borch a la particularité de ne pas représenter l’extérieur dans ses tableaux. « Les activités des femmes se déroulent de préférence dans la maison, loin de tout pittoresque, et elles mettent en valeur la vie affective et intérieure plutôt que le grand fracas des actions publiques, réservées en priorité aux hommes. Or, Ter Borch a une répugnance instinctive pour les paysages comme pour les extérieurs : seul le monde humain l’intéresse et, en celui-ci, l’être intérieur que figure et annonce, précisément, l’intérieur des maisons, dont tout contact avec le monde du dehors est gommé (c’est à peine si l’on entrevoit ici les portes et les fenêtres : Ter Borch peint des huis clos). Mais il faut dire qu’il peint aussi ses hommes comme si c’étaient des femmes : des êtres pour qui l’amour et l’attention d’autrui comptent plus que tout le reste » (p. 131).
Petite digression : en visite au musée de Sens en décembre 2022, j’admire une peinture de petites dimensions créditée « Moses Ter Boch » (sic) (1645-1667), intitulée L’Éplucheuse de pommes et datée de 1661 (le peintre aurait eu 15 ans). Une brève recherche m’apprend qu’il s’agit du frère tardif de Gérard, dont vous saurez tout sur Wikipédia en espagnol, et que le tableau La Peleuse de pommes de Gérard Ter Borch orne le Kunsthistorisches Museum de Vienne. Eh bien, même si ma photo est nulle à cause du fait que ce tableau est installé dans un coin et protégé par une épaisse vitre qui empêche de l’admirer, quand je compare les deux photos, la copie de Sens me semble supérieure à l’original ! Sens possèderait-elle un trésor caché ? Une carte du monde est affichée au mur, qui dicte une interprétation : ce qui se passe sous les yeux de l’enfant, cette pomme ronde qui est peut-être bleue comme une orange, est aussi importante que le vaste monde !

Sur ce tableau de Pieter de Hooch : « Voici un intérieur caractéristique des maisons de Delft avec ses objets et tableaux familiers, et, à droite, une jeune femme occupée à ranger. Au centre, une porte ouverte donne sur la cour ; une enfant s’y tient, souriante. Or il existe un autre tableau, clairement relié à celui-ci ; il ne retient que la petite fille debout dans l’embrasure de la porte, mais elle tient maintenant un bâton de kolf à la main (une espèce de hockey sur gazon) ; un autre personnage semblable au premier l’attend à l’extérieur. S’agit-il d’un détail du premier tableau, que de Hooch aurait choisi de rendre autonome et d’agrandir, ayant reconnu sa valeur propre ? Ou au contraire d’un tableau initial, voire d’une étude, qu’il a décidé après coup d’inclure dans une composition plus vaste ? On ne le saura probablement jamais. Quoi qu’il en soit, l’image de l’enfant y est particulièrement forte. Dans le tableau « d’ensemble », celle-ci figure déjà la même complexité d’idées que les autres enfants sur le seuil ; dans le « détail », on dispose d’un tableau, exceptionnel chez de Hooch et assez rare en général, qui représente l’enfant isolée : trop expressif pour être un portrait, trop individuel pour s’épuiser dans une signification allégorique ou typique » (p. 139).
Bilan : « La peinture hollandaise du quotidien, telle qu’on l’a entr’aperçue ici, appartient à un moment précis de l’histoire : le milieu du XVIIe siècle, entre Hals et Ochtervelt. Dès la fin du siècle, le secret qui animait de l’intérieur tant de tableaux est perdu, et les peintres se contentent de transmettre une technique et quelques motifs ; le déclic ne se produit plus. L’art réaliste se poursuit, bien sûr, jusqu’au XIXe et même au XXe siècle ; mais on n’y trouve plus cet amour du monde, cette joie de vivre, cette glorification du réel, caractéristiques des maîtres d’autrefois. La peinture réaliste, comme toute peinture représentative, continue d’affirmer la beauté de ce qu’elle montre ; mais c’est souvent une beauté de l’accablement, du désespoir, de la détresse : ce sont des fleurs du mal. Il n’y aura plus, pour parler comme Fromentin, de « tendresse pour le vrai », de « cordialité pour le réel » (p. 141).
La conclusion prend de la hauteur : « Notre société a su agir sur l’une des causes de la détresse qu’on peut éprouver dans le quotidien, la fatigue physique, en remplaçant la force humaine par l’action des machines : l’homme exténué d’efforts est mal placé pour jouir de la qualité de chaque instant. Mais elle n’a pas su, ou voulu, infléchir notre système de valeurs pour que nous puissions apprécier la beauté de chaque geste, qu’il soit dirigé vers les objets ou vers les êtres qui nous entourent ; nous chérissons par-dessus tout l’efficacité, allant jusqu’à transformer en moyen, sinon en instrument, nos proches et nous-mêmes. Tout se passe comme si nous nous pressions pour régler au plus vite les affaires et que, pendant ce temps, nous avions suspendu notre vie ; mais ce provisoire-là dure, et finit par se substituer à l’objectif toujours repoussé. Peut-être pourrions-nous un jour apprendre à ralentir non pas nos gestes – nous aurions à renoncer là à une part trop importante de nous-mêmes mais l’impression qu’ils laissent dans notre conscience, pour nous donner le temps de les habiter et de les savourer. C’est alors que la vie quotidienne cesserait de s’opposer aux œuvres d’art, aux œuvres de l’esprit, pour devenir, tout entière, aussi belle et riche de sens qu’une œuvre.
On peut surprendre chez un enfant de bonne humeur des moments de jubilation que rien pourtant ne motive : c’est la joie à l’état pur, la plénitude vécue dans un regard, dans un geste anodin. L’adulte ne s’en sent pas capable, sauf dans des moments exceptionnels dont il garde longtemps après la nostalgie : moments bénis, moments de grâce où il habitait tout entier sa propre présence. La peinture hollandaise, qui n’a rien d’enfantin ni d’idyllique, nous est peut-être précieuse pour cette raison exacte : elle nous rassure sur l’existence de ces moments, elle nous indique un sentier que, même sortis des limbes de l’enfance, nous pourrions suivre » (p. 147).

Puisqu’il est bientôt Noël, je termine cet article par La Fête de Saint-Nicolas de Jan Steen, signalée par l’amie Isabelle avec ce commentaire : « Toute une histoire familiale se raconte qui circule dans les jeux de regards et les mimiques des personnages. Cette peinture de genre célèbre sans aucun doute la maison et sa maîtresse, par extension la famille, mais surtout une opulence et une gourmandise qui s’attache autant à la nourriture qu’aux objets du décor intérieur ». Mais c’est bien sûr !
– Du même auteur, lire La Vie commune (1995).
© altersexualite.com 2021
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Voir une analyse de ce petit tableau (21 × 17 cm).
 altersexualite.com
altersexualite.com


