Accueil > Culture générale et expression en BTS > Seuls avec tous > La Vie commune, de Tzvetan Todorov
Exister aux yeux d’autrui, pour étudiants et adultes
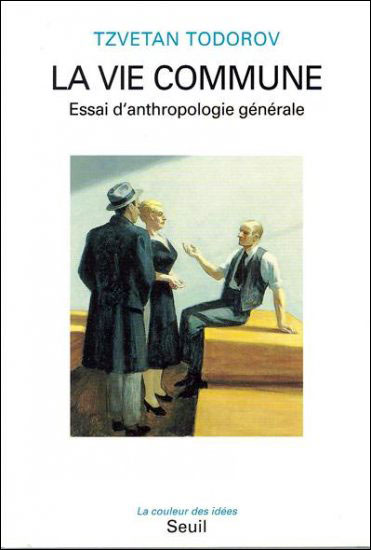 La Vie commune, de Tzvetan Todorov
La Vie commune, de Tzvetan Todorov
Seuil, La couleur des idées, 1995, 192 p., 7,6 €.
samedi 20 avril 2019
La Vie commune de Tzvetan Todorov (1939-2017) est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « Seuls avec tous ». Je l’ai choisi parce que l’auteur fut familier à l’étudiant en lettres des années 1980 que je fus pour son Introduction à la littérature fantastique (1970), et à côté de classiques, cela permettait de proposer une réflexion plus actuelle aux étudiants. L’auteur a fait inscrire sur le livre le sous-titre : « essai d’anthropologie générale », mais je classerais plutôt le livre en sociologie, et d’ailleurs il semble écrit en marge de La Société des individus, de Norbert Elias. Après une revue critique des différentes théories sur le rapport entre individu et société, Todorov concentre son attention sur ce qui lui semble concrètement régir les rapports de soi avec autrui, dans une perspective plus intime que les ouvrages que nous avons étudiés pour ce thème. La date de l’essai (1995) exclut les réseaux sociaux et l’Internet du champ des recherches de Todorov, ce en quoi l’essai de Sherry Turkle Seuls ensemble constituera un complément utile.
I. Coup d’œil sur l’histoire de la pensée
La problématique est posée dans l’avant-propos : « […] traiter non, comme on le fait d’habitude, de la place de l’homme dans la société, mais, à l’inverse, de celle de la société dans l’homme. Que signifie au juste ce fait généralement admis que l’homme est un être social ? Quelles sont les conséquences de ce constat, qu’il n’existe pas de je sans tu ? En quoi consiste, pour l’individu, la contrainte de ne jamais connaître qu’une vie commune ? (p. 10). Dans un long chapitre intitulé « Coup d’œil sur l’histoire de la pensée », Todorov s’étonne de la prégnance de visions asociales de l’humanité : « quel que soit le parti que l’on prend dans ces conflits, on y embrasse toujours une définition solitaire, non sociale, de l’homme » (p. 15).
« On peut observer chez La Rochefoucauld (ou avant lui chez Hobbes) la mise en place d’un dispositif d’argumentation qui se maintiendra à peu près intact pendant des siècles. Dans un premier temps, on fait comme si tous les rapports sociaux se ramenaient aux qualités louables, à la générosité, à l’amour d’autrui ; autrement dit, on interprète l’opposition entre solitude et socialité comme équivalente à celle entre égoïsme et altruisme, ce qui est évidemment abusif. C’est alors que, dans un deuxième temps, on procède à un travail de désillusionnement, on arrache le masque de vertu. Ce geste est d’autant plus convaincant à nos yeux qu’il ne semble avoir rien de flatteur (or, nous disons-nous inconsciemment, on n’affirmerait pas une chose désagréable à moins qu’elle ne soit vraie). Du coup, ayant rejeté une vision trop bienveillante de l’homme, on reste avec l’idée d’un être originel solitaire et égoïste. La socialité est vertueuse, or la vertu est trompeuse ; donc la vérité est asociale. La Rochefoucauld peut conclure : « Les hommes ne vivraient pas longtemps en société s’ils n’étaient les dupes les uns des autres » ; et Pascal : « L’union qui est entre les hommes n’est fondée que sur cette mutuelle tromperie. » On croit à tort que les autres nous veulent du bien ; si l’on devenait lucide, la société disparaîtrait ! » (p. 18).
À la p. 19, Todorov formule la thèse de Norbert Elias, qu’il cite pour un autre livre quelques pages plus loin, mais jamais pour La Société des individus : « Or la relation à autrui n’est pas un produit des intérêts du moi, elle est antérieure aussi bien à l’intérêt qu’au moi. Il n’y a pas lieu de se demander, à la manière de Hobbes pourquoi les hommes choisissent-ils de vivre en société ? ou de Schopenhauer : d’où vient le besoin de société ? parce que les hommes n’accomplissent jamais un tel passage à la vie commune : la relation précède l’élément isolé. Ils ne vivent pas en société par intérêt, ou par vertu, ou par la force d’une raison autre, quelle qu’elle soit ; ils le font parce qu’il n’y a pas pour eux d’autre forme d’existence possible » (p. 19). Todorov évoque ensuite la « véritable révolution » que propose Rousseau lorsqu’il « formule, le premier, une nouvelle conception de l’homme comme d’un être qui a besoin des autres » (p. 25) ; « L’innovation de Rousseau ne consiste pas à remarquer que les hommes peuvent être mus par le désir de gloire ou de prestige – cela, tous les moralistes le savent –, mais à faire de ce désir le seuil au-delà duquel seulement on peut parler d’humanité. Le besoin d’être regardé, le besoin de considération, ces propriétés de l’homme découvertes par Rousseau ont une extension sensiblement plus grande que l’aspiration à l’honneur » (p. 28). Adam Smith aurait développé la pensée de Rousseau en imaginant un « « spectateur impartial et bien informé » qui habite à l’intérieur de nous » (p. 33). Selon Smith, puis Hegel, l’homme « est prêt à perdre sa vie pour gagner la renommée. Achille, qui préfère la gloire à la vie, est le premier représentant authentique de l’humanité, et non seulement un grand héros. Le besoin de reconnaissance est le fait humain constitutif. C’est en ce sens que l’homme n’existe pas avant la société et que l’humain est fondé dans l’interhumain. « La réalité humaine ne peut être que sociale. » « Il faut, pour le moins, être deux pour être humain. » » (p. 36). Et les idées continuent à se hausser les unes sur les autres, avec la découverte du fait que l’individu ne commence pas adulte, mais bébé. Pour expliquer le fait que pendant des siècles, les philosophes aient pensé un individu né adulte : « Pourquoi ne prendre en considération que les seules relations de rivalité, donc de ressemblance, entre les hommes et ignorer celles de contiguïté et de complémentarité ? », Todorov propose une hypothèse : « Si le récit d’origine de l’espèce a été systématiquement préféré à celui d’origine de l’individu, la phylogenèse à l’ontogenèse, c’est sans doute, au moins en partie, parce que les auteurs de ces récits sont des hommes, non des femmes, alors que l’origine de l’individu, c’est-à-dire la naissance et la petite enfance, a appartenu exclusivement, pendant des siècles, à l’univers des femmes. Le récit concernant l’espèce est une pure spéculation, celui sur l’individu relève de l’observation – mais les narrateurs attitrés n’y avaient pas accès ou ne s’y intéressaient pas, et les observatrices étaient interdites de récit » (p. 60). Une autre hypothèse est qu’il serait flatteur pour les penseurs « de se penser comme ne devant rien à personne et cherchant solitairement la vérité plutôt que l’approbation de son public » (p. 62).
II. Être, vivre, exister
Après avoir examiné les penseurs du passé, Todorov établit ses propres pensées. Demande de reconnaissance : « Le besoin d’exister ne peut jamais être comblé définitivement, nulle coexistence déjà vécue ne nous délivre de la demande de nouvelles coexistences. La raison de l’incomplétude constitutive n’est donc pas l’inévitable socialisation d’un être désirant qui serait fondamentalement seul, mais la disparité entre une demande infinie et sa satisfaction forcément partielle et provisoire. Ce besoin naît peu après notre naissance physique et ne s’éteint que dans l’inconscience qui précède la mort. La reconnaissance de notre existence, qui est la condition préliminaire de toute coexistence, est l’oxygène de l’âme : pas plus que le fait de respirer aujourd’hui ne me dispense de l’air de demain, les reconnaissances passées ne me suffisent dans le présent. C’est seulement par naïveté, ou par malveillance, que nous pouvons tenter de consoler celui qui déplore l’absence de reconnaissance en lui rappelant ses succès d’hier ; ce rappel, au contraire, fait mesurer d’autant plus cruellement leur manque aujourd’hui. Les lauriers de l’an passé accusent plutôt qu’ils ne compensent l’absence de lauriers fraîchement coupés » (p. 74).
La vieillesse : « La vieillesse, à son tour, est une diminution non seulement des forces vitales mais aussi de l’existence. La cause première en est l’accroissement de la solitude. « J’ai commencé la mort par de la solitude », écrit Victor Hugo : l’existence peut mourir avant même que la vie ne s’éteigne. L’être social du vieillard est progressivement « débranché » des différents réseaux dont il participait ; l’ennui devient l’expérience principale de sa vie. Les distributeurs habituels de reconnaissance disparaissent l’un après l’autre (c’est la sélection naturelle), et ceux qui les remplacent – les « nouvelles générations » – n’éprouvent plus aucun intérêt pour lui et du reste ne l’intéressent pas (c’est la sélection volontaire). Ils n’ont pas besoin du vieillard ni lui d’eux, alors même que la pulsion d’exister se maintient. » (p. 76). Je veux bien être d’accord sur le constat, mais peut-être un jour, lorsque les pouvoirs publics se seront assez penchés sur l’éducation contre l’homophobie, contre le sexisme, contre la « violence routière », ils s’engageront au rapprochement entre les générations, à l’empathie pour les vieillards, à la lutte contre le suicide…
L’enfance : « Quant au besoin des autres, il s’étend aussi, bien entendu, à ce que j’appelle ici la vie : le bébé ne pourrait survivre sans être nourri par un autre que lui. Mais cette dépendance biologique, évidente, a trop longtemps servi à masquer une autre dépendance qui, elle, est sociale : le besoin d’exister, et non seulement de vivre. Or tout semble indiquer que les deux dépendances sont d’emblée distinctes : le besoin d’être réconforté n’est pas un substitut du besoin d’être nourri. On s’en est mieux aperçu depuis une célèbre expérience de Harlow portant sur des petits singes : ceux-ci préfèrent un mannequin-singe qui offre le même contact que leur mère, à un mannequin qui les nourrit mais auquel ils ne peuvent se frotter. De même, et plus encore, l’enfant a besoin d’être porté, bercé, entouré de sons et de contacts bienveillants, et non seulement nourri » (p. 78). « Ce moment décisif marque la naissance simultanée de sa conscience d’autrui (celui qui doit le regarder) et de soi (celui qu’autrui regarde), et par là la naissance de la conscience elle-même. Bien que ne pouvant pas, évidemment, se le dire, à partir de ce moment l’enfant sait : on me regarde, donc je existe ; le regard du parent a introduit l’enfant à l’existence. Comme s’ils connaissaient l’importance de ce moment (alors qu’il n’en est rien), parent et enfant peuvent se regarder mutuellement pendant de longs moments dans les yeux ; cette action sera tout à fait exceptionnelle à l’âge adulte, où un regard mutuel de plus de dix secondes ne peut signifier que deux choses : que les deux partenaires vont se battre ou faire l’amour » (p. 84). Voici un photogramme représentant Jean Gabin et Charles Vanel dans La Belle équipe (1936) de Julien Duvivier. Se battre ou faire l’amour ? Chiche !
Amitié / communion mère-enfant : « Il existe en revanche une autre action simple que parents et enfants découvrent un peu plus tard (et qui peut, elle aussi, être un ingrédient ou une forme de l’amour) ; on pourrait peut-être l’appeler communier. La mère peut éprouver très tôt un sentiment de communion avec son enfant, une sorte d’équivalent psychique à la symbiose intra-utérine ; mais il faut attendre plus longtemps si l’on veut que les deux individus éprouvent le même sentiment et que celui-ci ne se confonde pas pour autant avec l’illusion d’un retour à la symbiose. Dans la communion, on n’ignore pas que l’autre est un autre, on reste à l’intérieur de la coexistence, mais il y a en même temps continuité entre les deux partenaires : c’est la certitude absolue, n’admettant aucun doute, d’être accepté par l’autre. Les deux personnes participant de cet état connaissent alors ce qu’Aristote attribue à l’amitié à ses sommets, la joie de l’un est celle de l’autre, ou plutôt : la simple présence de l’un, à qui l’on ne demande rien, est source pour l’autre d’une joie tranquille. Je l’aime pour lui-même et non pour moi, me réjouissant de son existence sans aucune attente de récompense. Je n’en ai pas besoin : aimer ainsi me fait éprouver un sentiment intense et irradiant de ma propre existence. L’incomplétude originelle est oubliée » (p. 87).
III. La reconnaissance et ses destinées
Les habits : « les habits jouent un rôle particulier, car ils sont littéralement un terrain de rencontre entre le regard des autres et ma volonté, et ils me permettent de me situer par rapport à ces autres : je veux leur ressembler, ou à certains d’entre eux mais pas à tous, ou à personne. Bref, je choisis mes habits en fonction des autres, serait-ce pour leur dire qu’ils me sont indifférents. Celui en revanche qui ne peut plus exercer de contrôle sur ses habits (pour cause de pauvreté, par exemple) se sent paralysé face aux autres, privé de sa dignité. Ce n’est donc pas entièrement à tort qu’une vieille plaisanterie dit : la personne humaine se compose de trois parties, âme, corps et habits… » (p. 96).
Le conformisme : « Si par mon travail j’assume une fonction que la société considère comme utile pour elle, je peux ne pas avoir besoin d’une reconnaissance de distinction (je ne m’attends pas à ce qu’on me fasse sans arrêt des compliments) : je me contente parfaitement de ma reconnaissance de conformité (j’accomplis mon devoir, je sers mon pays ou mon entreprise). Pour l’obtenir, je n’ai donc pas besoin de solliciter, chaque fois, le regard des autres ; j’ai intériorisé ce regard sous forme de normes et d’usages, éventuellement de snobisme, et ma seule conformité aux règles me renvoie une image – positive de surcroît – de moi-même ; donc j’existe. Je n’aspire plus à être exceptionnel mais normal ; le résultat est pourtant le même. Le conformiste est en apparence plus modeste que le vaniteux ; mais l’un n’a pas moins besoin de reconnaissance que l’autre » (p. 99).
Le néant, pire que la haine : « Moritz [ Karl Philipp Moritz ] a bien relevé cette différence en observant les effets contraires de la dérision et de la haine. « Se sentir ridicule revient en quelque sorte à se sentir anéanti et rendre quelqu’un ridicule équivaut presque à porter à son Moi une atteinte mortelle qu’aucune autre offense ne saurait égaler. En revanche, être haï de tous excepté de soi-même est un état souhaitable, voire désirable. Une telle détestation générale n’entraînerait pas la mort du Moi, au contraire : elle l’emplirait d’un sentiment de bravade qui lui permettrait de survivre des siècles durant et de clamer sa colère face à un monde de haine. Mais n’avoir pas d’ami ni même d’ennemi, voilà l’enfer véritable dans lequel un être pensant éprouve les tourments de l’anéantissement progressif sous toutes leurs formes. » La haine de quelqu’un, c’est son rejet : elle peut donc renforcer son sentiment d’existence. Mais ridiculiser quelqu’un, ne pas le prendre au sérieux, le condamner au silence et à la solitude, c’est aller bien plus loin : il se voit menacé du néant » (p. 101).
La socialité : « Ce qui est universel, et constitutif de l’humanité, est que nous entrons dès la naissance dans un réseau de relations interhumaines, donc dans un monde social ; ce qui est universel est que nous aspirons tous à un sentiment de notre existence. Les voies qui nous permettent d’y accéder, en revanche, varient selon les cultures, les groupes et les individus. Tout comme la capacité de parler est universelle et constitutive de l’humanité alors que les langues sont diverses, la socialité est universelle, mais non ses formes. Le sentiment d’exister peut être l’effet de ce que j’appelle l’accomplissement, le contact non médiatisé avec l’univers, comme de la coexistence avec les autres ; celle-ci peut prendre la forme de reconnaissance ou de coopération, de combat ou de communion ; enfin la reconnaissance n’a pas la même signification selon qu’elle est directe ou indirecte, de distinction ou de conformité, intérieure ou extérieure » (p. 104).
Fanatisme : « Mais ce sentiment commun peut aussi se transformer et devenir un combat : je donne alors toutes mes forces pour assurer la victoire de mon groupe, je suis même prêt à assumer le rôle de martyr, et je lutte contre tous les autres groupes rivaux ; cette identification aux intérêts du groupe m’assure d’une reconnaissance stable. On pourrait donner à cette forme exacerbée du conformisme social le nom de fanatisme et rappeler les exemples, si fréquents autour de nous, du fanatisme nationaliste ou religieux. Très souvent, il s’agit là de solutions de substitution : la puissance de l’intégrisme musulman aujourd’hui a pour condition l’impossibilité des individus, dans les pays concernés, d’accéder à tout autre type de reconnaissance […] » (p. 117).
Drogues, musique, autisme ? : « On peut rapprocher de l’autisme certaines attitudes moins pathologiques. On peut se demander, par exemple, si l’usage répandu des drogues, « dures » ou « douces », chez les adolescents (ou de l’alcool plus tard) ne correspond pas à un refus d’avoir à chercher la reconnaissance des autres. Quand on « plane », on a le sentiment de plénitude, d’autosuffisance, qui permet de ne plus se soucier des réactions de ceux qui nous entourent. Dans le même groupe d’âge, un rôle comparable est joué par la musique – que j’écoute de préférence très fort, ou avec un casque sur les oreilles : elle aussi sert de couche isolante entre le monde extérieur et moi, m’enveloppe comme un cocon et me dispense d’aller quémander une reconnaissance » (p. 119).
On n’est jamais mieux servi que par soi-même : « Si quelqu’un – qu’il soit menuisier ou écrivain – fait bien son travail, il peut trouver une satisfaction ou bien dans le jugement positif qu’il porte sur lui (c’est l’intériorisation orgueilleuse du jugement des autres), ou bien dans l’acte même de le faire, sans passer par aucune médiation (c’est ce que j’appelle l’« accomplissement ») » (p. 122). Cette citation me fait fortement penser au Cyrano de Rostand : « Je me les sers moi-même avec assez de verve / Mais je ne permets pas qu’un autre me les serve »).
Le plaisir de rendre service : « Un être dépendant de moi peut me causer des soucis et des désagréments ; il me donne néanmoins plus qu’il ne me prend : il me rend nécessaire. « On a toujours besoin de quelqu’un qui a besoin de vous », dit un personnage de Romain Gary. Cette mère se plaint du temps que lui prend son enfant, cette femme souffre d’avoir à rendre visite à un prisonnier, cet homme est exaspéré car il doit s’occuper de son père malade ; la disparition de ces êtres dépendants ne porterait pas moins un coup à leur sentiment d’existence. La demande de reconnaissance que m’adresse autrui, on l’a vu, est en elle-même une reconnaissance pour moi. Or, justement, l’orgueilleux ne m’adresse aucune demande, il ne cherche pas mon approbation, il n’admet pas sa faiblesse. Il essaie même de tout faire mieux que ses proches, au point qu’ils se sentent humiliés par la comparaison. À cet égard, l’être vaniteux, en surface insupportable, est bien plus agréable : il me signifie constamment son besoin de moi » (p. 123).
Du plaisir de la victimisation : « Je terminerai mon énumération des palliatifs en évoquant brièvement une autre forme de renoncement à la reconnaissance, qui permet en même temps d’obtenir une reconnaissance de substitution : c’est celle qui consiste à jouer délibérément à la victime. Comme dans l’orgueil, la reconnaissance est maintenant essentiellement le produit d’une instance qui m’est intérieure (ma conscience) ; à la différence des cas précédents, toutefois, elle provient non du sentiment de ma valeur, mais de celui d’être la victime de l’inattention des autres. Comme dans l’idolâtrie, il y a ici quelque chose de magique : les frustrations, les blessures narcissiques dont je peux souffrir deviennent des sources de satisfaction par la seule force de ma volonté, puisqu’elles me permettent d’occuper la position, en réalité désirable, de la victime. « L’envie d’être plaint ou d’être admiré fait souvent la plus grande partie de notre confiance », écrivait La Rochefoucauld, en mettant ainsi un signe d’équivalence entre la victime et le héros, deux postures dans la sollicitation de la reconnaissance » […] « Le statut de victime peut s’étendre aussi aux groupes à l’intérieur d’une société, ou à des peuples entiers, leur assurant ainsi le privilège de la revendication, voire de l’impunité. Puisque, selon l’idéologie démocratique, tous doivent avoir les mêmes droits (la même dignité), celui qui peut prouver qu’il en a eu moins que les autres dans le passé peut escompter des bénéfices supplémentaires dans le présent » (p. 128).
Todorov propose de pratiquer ce qu’il appelle le « tour de rôle » dans la reconnaissance, que ce soit une « version simpliste », où par exemple on écoute patiemment une maman raconter les réussites scolaires de son bambin, à charge de revanche : elle doit vous écouter patiemment raconter celles du vôtre, ou dans une version à long terme, dont le meilleur exemple est un couple, où l’un doit accorder à l’autre alternativement toute son attention.
IV. Structure de la personne
Normes intégrées dès l’enfance : « […] au cours de l’enfance, nous absorbons non seulement les injonctions et les exemples parentaux, mais aussi les normes sociales, propres à la communauté. Elles ont été intériorisées au cours d’échanges anciens, dont les protagonistes ne sont pas forcément des individus identifiables. Il s’agit en effet d’un consensus sur le devoir-être sans auteur particulier, fait de coutumes, d’évidences, de découvertes scientifiques, de lois, de proverbes, de clichés, que l’on enregistre quelque part au fond de sa mémoire sans savoir encore quel usage on en fera. Ces normes me concernent non en tant qu’individu mais comme membre du groupe. Elles ne sont du reste pas exclusivement morales, elles peuvent également être esthétiques : par exemple, les jeunes filles pensent qu’elles doivent rester minces, et donc manger le moins possible (tous les stéréotypes sociaux sont mis à contribution) » (p. 154).
Un paragraphe polémique sur la victimisation : « Les effets négatifs de ces personnages intériorisés se ressentent aussi sur le plan collectif. Certaines minorités raciales ont le plus grand mal à s’extraire de cet engrenage : on les croit violentes, elles le deviennent. La pauvreté qui les caractérise engendre le mépris chez les autres, qui détruit la confiance en soi, ce qui à son tour condamne les membres de cette minorité à s’enfoncer encore plus dans la pauvreté – ou à recourir au palliatif de la violence. Comme l’a montré Shelby Steele dans ses analyses du problème racial aux États-Unis, l’agressivité du saboteur intérieur, de l’anti-soi de la minorité noire est grandement responsable de la situation inextricable dans laquelle elle se trouve aujourd’hui » (p. 157).
V. Coexistence et accomplissement
Sur la solitude : « La vie en société ne relève pas d’un choix : nous sommes toujours déjà sociaux. Comme l’ont remarqué à peu près à la même époque le Russe Bakhtine et l’Américain G.H. Mead, nous ne pouvons jamais nous voir physiquement en entier ; c’est là une incarnation parlante de notre incomplétude constitutive, du besoin que nous avons d’autrui pour établir notre conscience de soi, et donc aussi pour exister. C’est à un tout autre niveau que se situe le choix entre vie isolée et vie en groupe, choix qui ne révèle rien de fondamental dans notre attitude envers le monde, mais plutôt un penchant pour le calme et le silence ou, au contraire, une agoraphilie. La solitude comme mode de vie n’implique pas qu’on puisse se passer des autres, ni qu’on s’en désintéresse : toute solitude est précédée d’une période formatrice au cours de laquelle c’est bien le rapport à autrui qui a orienté notre soi ; or celui-ci à son tour influence la vie présente. Dans la solitude on ne cesse pas de communiquer avec ses semblables, on choisit seulement certaines formes de communication au détriment d’autres ; les rencontres espacées ou indirectes peuvent compenser en intensité ce qu’elles perdent en fréquence ou en facilité » (p. 166).
Le bonheur ? « Un sentier bien étroit conduit au bonheur, qui sépare des abîmes vertigineux ; et on ne peut jamais avoir la certitude de s’y être engagé pour de bon. Que faire alors ? S’enfermer dans une solitude fière, comme le préconisent les stoïciens, pour s’épargner des déceptions futures ? Se détacher des biens terrestres, comme le recommande saint Augustin, pour n’aimer infiniment que le seul être infini, Dieu ? Ou bien accepter sa condition, comme nous y incite Rousseau, sans espoir de vie éternelle ni d’âme immortelle, sans la consolation d’une survie par la communauté, par la descendance ou par les œuvres, ces substituts de l’immortalité ? La vie commune ne garantit jamais, et dans le meilleur des cas, qu’un frêle bonheur » (p. 172). C’est sur ces mots que Todorov achève sa réflexion.
– Du même auteur, lire Éloge du quotidien. Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle (2009).
Voir en ligne : Article de Wikipédia sur l’auteur
© altersexualite.com 2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com