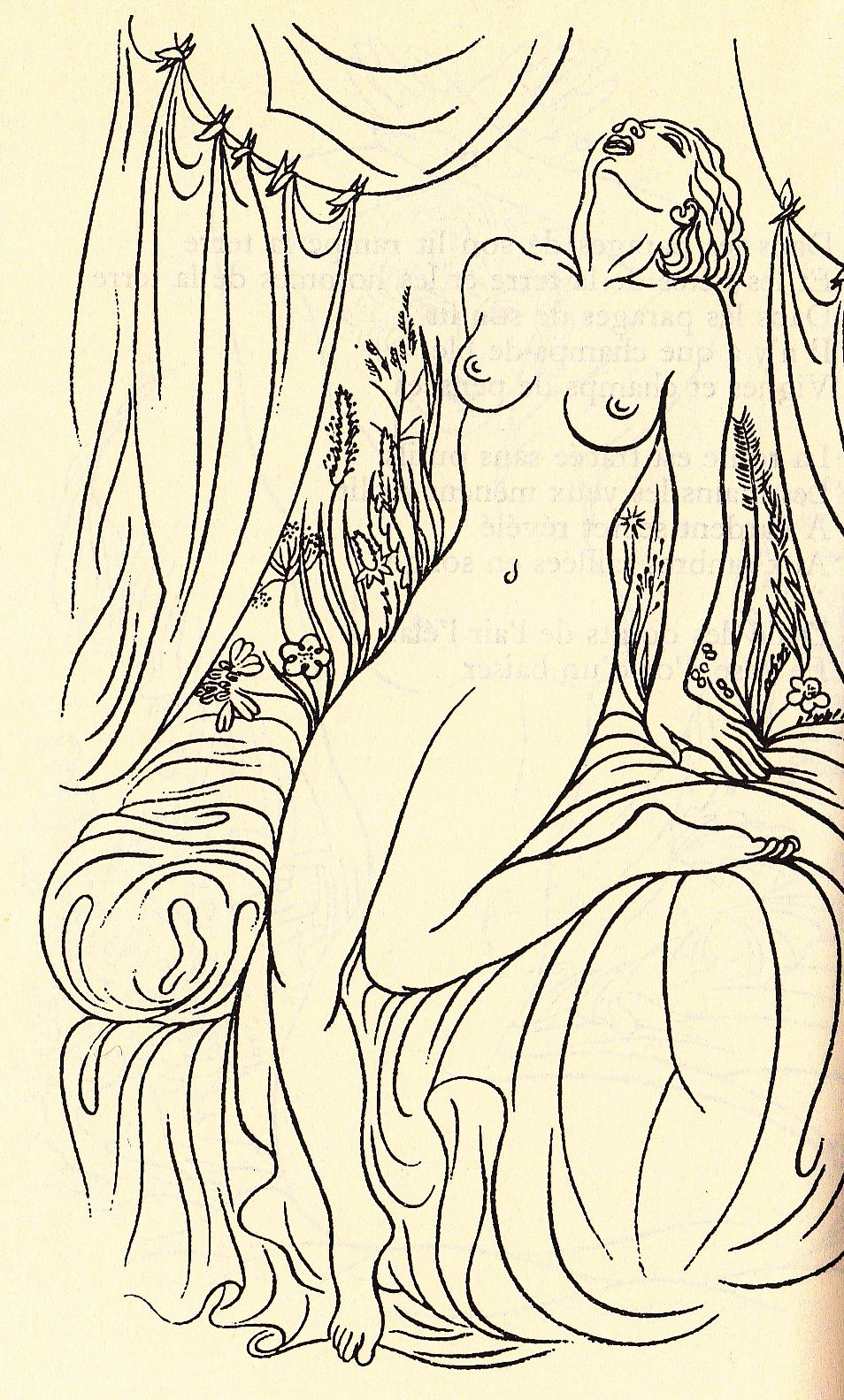Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Tout Éluard, de Les Mains libres à la Libération
Œuvres complètes de Paul Éluard, de 1938 à 1945.
 Tout Éluard, de Les Mains libres à la Libération
Tout Éluard, de Les Mains libres à la Libération
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, tome 1, 1968, 1670 p.
samedi 23 août 2014
Voici la suite de notre article sur Paul Éluard avant Les Mains libres. Nous suivrons le poète dans ce tome 1 de la Pléiade, qui couvre l’œuvre d’Éluard jusqu’à la Libération. Le troisième et dernier article traite du tome 2, de la Libération à la fin.
Plan de l’article
Avant Les Mains libres
Dictionnaire abrégé du surréalisme (1938)
Cours naturel (1938)
Chanson complète (1939)
Médieuses (1939)
Donner à voir (1939)
Le Livre ouvert (1940)
Blasons des fleurs et des fruits (1940)
Poésie et vérité 1942 (1942)
Poésie involontaire et poésie intentionnelle (1942)
Les Sept poèmes d’amour en guerre (1943)
Le Lit la table (1944)
Les Armes de la douleur (1944)
Dignes de vivre (1944)
Au rendez-vous allemand (1944)
de la Libération à la fin
Le Dictionnaire abrégé du surréalisme (opus 35, 1938) est écrit en collaboration avec André Breton. Comme pour Notes sur la poésie par exemple. Là encore, je me contenterai de reproduire quelques articles qui m’ont paru plus significatifs (pp. 719 à 796).
CHAPLIN (Charlie), né en 1888. — « Merci à celui qui sur l’immense écran occidental fait aujourd’hui passer vos ombres, grandes réalités de l’homme. »
ENFANT. — « Le calcul des probabilités se confond avec l’enfant, noir comme la mèche d’une bombe posée sur le passage d’un souverain qui est l’homme par un anarchiste individualiste de la pire espèce qui est la femme. » (A.B. et P.E. [provient de « La naissance », dans L’immaculée conception, p. 310.]). « Le miroir de chair où perle un enfant. » (P.E.).
L’article « FENÊTRE » est précédé d’une reproduction de la partie centrale de l’Autoportrait aux lunettes de Man Ray.
IMAGE. — « L’image surréaliste la plus forte est celle qui présente le degré d’arbitraire le plus élevé, celle qu’on met le plus longtemps à traduire en langage pratique, soit qu’elle recèle une dose énorme de contradiction apparente, soit que l’un de ses termes en soit curieusement dérobé, soit que, s’annonçant sensationnelle, elle ait l’air de se dénouer faiblement (qu’elle ferme brusquement l’angle de son compas), soit qu’elle tire d’elle-même une justification formelle dérisoire, soit qu’elle soit d’ordre hallucinatoire, soit qu’elle prête très naturellement à l’abstrait le masque du concret, ou inversement, soit qu’elle implique la négation de quelque propriété physique élémentaire, soit qu’elle déchaîne le rire. » (A.B.)
MARX (Karl), 1818-1883. — « Transformer le monde, a dit Marx ; changer la vie, a dit Rimbaud : ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un. » (A.B.)
PARANOÏA. — « Délire d’interprétation comportant une structure systématique. — Activité paranoïaque-critique : méthode spontanée de connaissance irrationnelle basée sur l’objectivation critique et systématique des associations et interprétations délirantes. » (S.D.)
PERCEPTION. — « On peut affirmer la présence ou la perception d’un objet quand il est présent et perçu, quand il est absent et perçu, quand il n’est ni présent ni perçu. » (Pierre Quercy.) « La perception et la représentation — qui semblent au civilisé, à l’adulte s’opposer d’une manière radicale — doivent être tenues pour les produits de dissociation d’une faculté unique, originelle, dont l’image éidétique rend compte et dont on retrouve les traces chez le primitif et l’enfant. » (A.B.)
SOUPAULT (Philippe), né en 1897. — « Cresson de pissotière. » Poète surréaliste. S’est séparé du groupe en 1927. Les Champs magnétiques (1919), Poésies complètes (1937). Je cite cet article au hasard pour souligner que les nombreux compagnons de route qui quittèrent le surréalisme, Soupault n’étant qu’un d’entre eux, ont été inclus dans ce dictionnaire, malgré les dissensions.
Cours naturel (opus 36, 1938) est dédié à Nusch. « Novembre 1936 », poème politique évoquant la guerre d’Espagne, est paru dans L’Humanité, ce qui irrita Breton. On remarque l’utilisation rare chez Éluard de l’alexandrin, sans rime : « Regardez travailler les bâtisseurs de ruines / Ils sont riches patients ordonnés noirs et bêtes/ Mais ils font de leur mieux pour être seuls sur terre / Ils sont au bord de l’homme et le comblent d’ordures / Ils plient au ras du sol des palais sans cervelle. » Le thème cher à Éluard de la femme unique et ressemblante est brodé, en alexandrins aussi, par « Une pour toutes » (suivi de « Toutes pour une ») : « La mieux connue l’aimée on la voit à peine / Mais sa suite surgit dans des robes ingrates / Pour prendre tout au corps et laisser tout au cœur / La première la seule elle est enfermée […] / Mais ses suivantes mais ses images en foule / Se coiffent gentiment et brûlent les pavés / Leurs seins libres mêlant la rue à l’éternel // Leurs charmes justifiant le seul amour possible » (p. 807).
Chanson complète (opus 40, 1939) contient un texte relativement érotique, sans doute consacré à Nusch, « Poème perpétuel » : « La femme qui se fait complice / D’amours sans force et d’amours forcenées / La femme attentive à la vie / À la tempête d’un sanglot / À l’île verte du silence » […] « Notre jeunesse tendrement / Fait naître l’aurore sur terre » (p. 870). C’est à l’occasion de la publication d’un de ces poèmes dans la revue Commune qu’interviendrait selon les notes de la Pléiade, la rupture Éluard / Breton. « Breton avait eu à se plaindre de l’influence dont la revue avait usé pour le discréditer auprès de certains milieux révolutionnaires mexicains au moment où il se rendait dans leur pays. ». Voici une lettre de Paul Éluard (créditée « À H… De Paris, 1938 », extraite de Éluard, livre d’identité, citée p. 1537) : « J’ai rompu définitivement avec Breton, à la suite d’une discussion relativement calme, au café. Ma décision a été entraînée par son affreuse manière de discuter, quand il est devant des gens. C’est fini, je ne participerai plus à aucune activité avec lui. J’en ai assez. Tout cela manquait trop souvent, à cause de Breton, de sérieux. J’étais depuis longtemps décidé à ne plus supporter les puérilités, ni l’inconséquence, ni la mauvaise foi. Je voulais pouvoir critiquer sans que Breton s’appuie pour me répondre sur des gens qui se foutent de tout, sur un troupeau de moutons. Le surréalisme ne devait pas devenir une école, une chapelle littéraire où l’enthousiasme et je ne sais quelle misérable action devaient répondre à la commande. […] Ma vie en changera sûrement. Je ne sais dans quel sens. Entre nous, j’ai un peu l’impression d’aller à l’aventure. Ce n’est pas désagréable. Au bout de 18 ans, tout cela devenait une habitude, un ordre. » [1]
Médieuses (opus 41, 1939) est un recueil de joliesses assez traditionnellement illustrées par Valentine Hugo. Elle évoque « une espèce de mythologie féminine » (p. 1538), ce qui pourrait expliquer le titre. Exemple de poème avec l’illustration correspondante : « La gorge lourde et lente / Par mille gerbes balancée / Arrive aux fêtes de ses fleurs // Elle donne soif et faim // Son corps est un amoureux nu / Il s’échappe de ses yeux / Et la lumière noue la nuit la chair la terre / La lumière sans fond d’un corps abandonné / Et de deux yeux qui se répètent » (p. 893). On pourra comparer avec le type de collaboration Éluard / Man Ray.
Donner à voir (opus 43, 1939) contient notamment un poème en prose banal intitulé « Toilette » (p. 926) qui nous vaut une excellente page de Georges Mounin extraite de « La notion de situation en linguistique et la poésie », dont nous avions déjà apprécié un extrait à propos de « Où se fabriquent les crayons » (Les Temps modernes n° 247, déc. 1966, cité p. 1551) : « Jusqu’ici, pour démontrer le rôle fondamental de la situation dans la saisie des messages linguistiques (même et surtout quand ces messages sont des poèmes), on a choisi des textes modernes dans lesquels il demeure au moins un indice situationnel capable de garantir la lecture juste. Avec des centaines de textes entièrement obscurs, la démonstration serait trop facile, on se retrouverait en face de messages linguistiques semblables à ceux des journaux intimes abrégés les plus cryptographiques. L’analogie est significative, car l’auteur du poème, exactement comme l’auteur du journal intime à partir des notes qu’il relit toujours sans difficulté, retrouve toujours la totalité de la situation qu’il évoque par son texte hermétique : en effet, pour lui le texte dénote (au sens linguistique du terme) et tout à fait clairement, la situation qu’il a connue. On pourrait faire une dernière expérience (je l’ai faite) [2] en proposant à plusieurs dizaines de lecteurs un court poème d’Éluard, avec lequel la démonstration est d’autant plus étonnante qu’apparemment le texte entier est descriptif, et semble livrer le plus banalement du monde une situation (mais on s’aperçoit bientôt qu’il n’a sans doute omis qu’un ou deux indices, les plus sémantiquement pertinents peut-être ici, parce qu’ils auraient livré son rapport à lui, Éluard, avec cette situation). Il s’agit du poème intitulé Toilette… :
« Elle entra dans sa petite chambre pour se changer, tandis que la bouilloire chantait. Le courant d’air venant de la fenêtre claqua la porte derrière elle. Un court instant, elle polit sa nudité étrange, blanche et droite, elle aviva sa chevelure paresseuse. Puis elle se glissa dans une robe de veuve »
« On obtient de lecteurs ouverts, et loin de tous exercices universitaires, une dizaine de lectures discordantes. Tantôt tout est conditionné par le mot veuve, qui détermine à contre-courant toute la coloration du texte ; tantôt par le mot elle (le poème est alors celui de la femme, et même de la femme éluardienne). Tantôt tout tourne autour du thème d’un cadre nu, pauvre, étroit, terne, et d’un événement qui s’harmonise avec ce cadre ; et tantôt sur un contraste entre ce cadre, perçu comme familier, intime, et un événement qui le contredit. Tantôt tout tourne autour du mot toilette, il s’agit d’un moment quotidien, ou bien d’un tableau de peintre, donnés à voir ; quelquefois même d’un moment imperceptiblement érotique. Mais d’autres fois, c’est l’amour éluardien, le couple mutilé, détruit par le monde extérieur, ou même par l’Histoire. L’attitude traditionnelle (pour le critique, ou pour le professeur, ou pour le lecteur) consiste à proposer sa propre interprétation et à poser que toutes les autres sont erronées, par inaptitude à lire, ou par inculture, ou par insensibilité, — sans tenir compte du fait que chaque lecteur a sélectionné dans un texte unique les indices situationnels qui le justifient (et sans doute aussi a projeté sa propre subjectivité habituelle, ou momentanée, sur ces indices, électivement, d’une manière plus révélatrice quant au lecteur que quant au poème). Mais il faudrait tenir compte ici, pour reconstruire la situation capable de fournir une lecture univoque du texte, de sa date de publication, de sa date de composition si on arrive à la fixer, de tout ce qu’on sait sur Éluard et sur le moment où il a écrit. C’est peut-être une variante qui confirme la lecture de ceux qui voient dans le poème une brève scène quotidienne donnée à voir, avec la légère teinte érotique qui s’attache à ce passage rapide entre se dévêtir et se rhabiller : en effet, entre un court instant et elle polit sa nudité, Éluard avait d’abord écrit : elle ordonna sa chevelure paresseuse, ce qui avec le titre (souvent important pour déterminer la situation), avec pour se changer, avec polit, centre vraiment le poème ; tandis que la suggestion érotique, qui est peut-être le ressenti de la situation, affleure à peine dans sa nudité, peut-être dans polit, dans le contraste subtil entre blanche et veuve, et surtout dans se glissa, renforcé par toute la phonétique des sibilantes et des liquides de la dernière phrase. La robe de veuve n’est peut-être qu’une robe noire, un peu habillée, pour sortir, et le noir est érotique. Mais sans doute vaut-il mieux admettre qu’on est devant un poème scellé malgré les apparences, par manque peut-être d’un seul indice explicite, qui formerait clé. Pourquoi le courant d’air, et claqua la porte derrière elle (qui suggèrent à certains lecteurs enfermement, solitude, et même agressivité du monde extérieur) ? Et surtout, comment voir la réalité qui se dissimule plus qu’elle ne s’exprime derrière le mot polit. Les gestes d’une femme à sa coiffeuse ? Ou au contraire une femme toute droite devant sa grande glace, et qui promène spontanément ses mains sur les parties nues de son corps avant de se changer ? Toutes ces lectures immédiates ont été proposées. On peut penser que, chez le poète, la volonté d’aller au plus court, au ressenti des deux dernières phrases (et le fait d’être à l’intérieur d’une situation transparente pour lui) l’a conduit à négliger cette compensation nécessaire dans le texte écrit à l’absence même de la situation, peut-être en supprimant toute référence au témoin de la scène, — avec ce résultat que ces dernières phrases ne sont plus lisibles exactement comme elles furent écrites… »
Ce même recueil reprend dans la section « Physique de la poésie » des éléments de réflexion déjà publiés. On retrouve par exemple la phrase fameuse de L’évidence poétique, mais la suite n’est pas piquée des hannetons, car on glisse insensiblement de la définition de la poésie vers l’affirmation du candaulisme, paraphilie dont on verra dans l’article sur Nusch, qu’elle était appréciée d’Éluard (comme de Casanova). Le titre du recueil, Donner à voir, est donc à prendre au sens trivial. Un véritable coming out candauliste : « Les poèmes ont toujours de grandes marges blanches, de grandes marges de silence où la mémoire ardente se consume pour recréer un délire sans passé. Leur principale qualité est non pas [cela change à partir de ce mot] d’évoquer, mais d’inspirer. Tant de poèmes d’amour sans objet réuniront des amants. D’autres destineront la femme du poète à un autre homme. En tirer une certaine satisfaction, l’objet s’amplifiant. Pour son amant, la femme aimée se substitue à toutes les femmes désirées, elle peut par conséquent être aimée de tous. De là à le vouloir… Que le langage se concrétise ! » (p. 937). Le terme politiquement correct et assez inattendu dans le B.O. : « cet hymne à la voyance qu’est le recueil » peut se comprendre comme un euphémisme pour « hymne au voyeurisme » !
Dans un article consacré à Baudelaire, voici un paragraphe sur la ressemblance qui peut éclairer la vision de la femme chez Éluard : « Mais les moyens que l’homme a de constater objectivement, rationnellement la ressemblance sont parfaitement différents de ceux qu’il a d’identifier. Il serait possible, en déformant patiemment et progressivement la photographie d’eux-mêmes qu’on leur montre, d’obtenir de certains primitifs qu’ils sachent ce qu’elle représente. Des lunettes spéciales guériront peut-être un jour, aussi bien de l’illusion de fausse reconnaissance que de cette cécité très particulière, amnésie ou misanthropie, qui ne laisse jamais rencontrer un homme ou une femme que pour la première fois » (p. 955).
Un 2e article aussi intitulé « Physique de la poésie » contient une liste de collaborations artistiques, et ces deux paragraphes : « En 1910, un peintre, Picasso, découvrit dans l’œuvre d’un poète un nouveau mode d’inspiration. Depuis, les peintres n’ont cessé de s’éloigner de la description, de l’imitation des sujets qui leur étaient proposés : des images n’accompagnent un poème que pour en élargir le sens, en dénouer la forme. » ; « Pour collaborer, peintres et poètes se veulent libres. La dépendance abaisse, empêche de comprendre, d’aimer. Il n’y a pas de modèle pour qui cherche ce qu’il n’a jamais vu. À la fin, rien n’est aussi beau qu’une ressemblance involontaire. » (p. 982-983). Notons enfin que Donner à voir reprend intégralement, sous le titre « Les mains libres », la préface du recueil éponyme, ceci dans la section « Peintres ».
Le livre ouvert I (opus 45, 1940) Contient des poèmes d’une veine désespérée — qu’on retrouve sur des blogs adolescents —, dont voici quelques vers : « Mourir » : « Entre les murs l’ombre est entière / Et je descends dans mon miroir / Comme un mort dans sa tombe ouverte. » (p. 1021). « Finir » : « La charrue des mots est rouillée / Aucun sillon d’amour n’aborde plus la chair / Un lugubre travail est jeté en pâture / À la misère dévorante » (p. 1022). Mais la veine érotique est encore présente : « Vue donne vie » : IV « Dans les ténèbres du jardin / Viennent des filles invisibles / Plus fines qu’à midi l’ondée / Mon sommeil les a pour amies / Elles m’enivrent en secret / De leurs complaisances aveugles. » (p. 1027).
Le livre ouvert II (opus 51, 1942) contient quelques jolis vers, par exemple « Surgis » : « Surgis fille d’une seule eau / Dans tes bras une île inconnue / Prendra la forme de ton corps […] // Une île et la mer diminue » (p. 1077).
Blasons des fleurs et des fruits (opus 46, 1940). Une glose d’André Gide extraite de son Anthologie de la poésie française en Pléiade est citée p. 1577 :
« L’incantation (dans les poèmes d’Éluard par exemple — et je le cite à bon escient) est obtenue en dehors, et comme en dépit de la signification des mots
Rose pareille au parricide / Descend de la toile de fond / Et tout en flammes s’évapore
Ces vers que je lisais hier dans son dernier Blason des fleurs et des fruits, ces vers m’enchantent, et je ne sais pourquoi.
Seringa masque de l’aveugle / Écorce de la nuit d’été.
Une telle « combinaison de sons » échappe à la compréhension de l’intelligence, à la critique, au bon sens commun. Éluard ne retient des mots que leur pouvoir incantateur ; pouvoir qui, du reste, n’est dû, en plus de leur sonorité, qu’au souvenir de leur emploi précédent, alors qu’ils gardaient signification plus ou moins précise. Ainsi se forme-t-il autour des mots une sorte d’auréole diffuse ; leurs contours s’irisent, et le poète obtient son sortilège en juxtaposant ces diaprures. Le lecteur n’a plus à précisément comprendre mais à se prêter. Les sons rythmés évoqueront en lui je ne sais quel faisceau de sensations où la raison n’a rien à voir, la raison raisonneuse ; malgré quoi, ou plutôt : à cause de quoi, une telle poésie devient extraordinairement spirituelle, émancipée de toute relation avec le monde des transactions… » Il fumait pas un peu la moquette, le Dédé ?
Poésie et vérité 1942 (opus 53, 1942) commence par le fameux « Liberté » dont je propose une parodie en 2023. Figure humaine de Francis Poulenc est une cantate pour double chœur mixte composée en 1943 sur des textes de Paul Éluard, créée à Londres dans une traduction anglaise en 1945. Elle comporte huit chants, dont le dernier est « Liberté ». On peut écouter le premier chant « De tous les printemps du monde » et en lire une analyse sur ce site. Le texte sera repris dans un recueil-programme en 1946 : Figure humaine. Et pour « Liberté », c’est sur youtube. On connaît la légende de ce « poème de circonstance » selon Éluard lui-même, primitivement intitulé « Une seule pensée », qui fut parachuté par la RAF dans toute la France. Jean Lurçat en tira une tapisserie tissée clandestinement en 1943 à Aubusson. Elle est exposée à Angers au Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine et l’on peut télécharger une fiche pédagogique sur cette page. Les poèmes de guerre comprennent un certain nombre de textes plus explicites que la poétique éluardienne nous en avait donné l’habitude, parmi lesquels certains sont devenus célèbres, et nous touchent encore, comme « Couvre-feu » : « Que voulez-vous la porte était gardée / Que voulez-vous nous étions enfermés / Que voulez-vous la rue était barrée / Que voulez-vous la ville était matée / Que voulez-vous elle était affamée / Que voulez-vous nous étions désarmés / Que voulez-vous la nuit était tombée / Que voulez-vous nous nous sommes aimés. » (p. 1108).
Poésie involontaire et poésie intentionnelle (opus 54, 1942) a été publié dans l’urgence par Pierre Seghers en 1942, avec des motivations étonnantes. Les notes citent une lettre de Seghers : « Je veux une typo simple, mais heureuse. Je prends pour vous mes dernières rames de papier. On tirera à 1500 ou 2000 avec des luxe pour vous. Dès que j’aurai défini le tirage, je vous fixerai à ce sujet. Laissez-moi vous redire mon vif plaisir, je suis heureux d’éditer cela… » (p. 1616). Il ne s’agit pourtant que d’un recueil de citations, et avec le recul, on a du mal à saisir l’urgence, sauf peut-être qu’Éluard était une gloire, et que cette gloire appuyait la cause de Seghers ? Bref, parmi les citations on en trouve une plus longue de Lautréamont, qu’on peut reprendre ici car elle sert à Éluard de « miroir légitimant » : « La somme des jours ne compte plus, quand il s’agit d’apprécier la capacité intellectuelle d’une figure sérieuse. Je me connais à lire l’âge dans les lignes physiognomoniques du front : il a seize ans et quatre mois ! Il est beau comme la rétractilité des serres des oiseaux rapaces ; ou encore, comme l’incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure ; ou plutôt, comme ce piège à rats perpétuel, toujours retendu par l’animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment, et fonctionner même caché sous la paille ; et surtout, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie. » (p. 1147). Quelle urgence, en 1942, de publier ce fatras ? Le facteur Ferdinand Cheval est cité, que Breton présentait comme « le maître incontesté de l’architecture et de la sculpture médianimiques » (p. 1618). Paul Claudel est aussi cité, et l’on se demande si la querelle de 1925 est enterrée, ou s’il s’agit d’une moquerie.
Les sept poèmes d’amour en guerre (opus 55, 1943) se termine par un poème explicite qui aurait sans doute été traité de naïf sans la prestigieuse signature : « Au nom des hommes en prison / Au nom des femmes déportées / Au nom de tous nos camarades / Martyrisés et massacrés / Pour n’avoir pas accepté l’ombre // Il nous faut drainer la colère / Et faire se lever le fer / Pour préserver l’image haute / Des innocents partout traqués / Et qui partout vont triompher. » Voir la couverture de ce recueil clandestin. Le pseudonyme est à l’époque présenté ainsi : « Jean du Haut est le pseudonyme de l’un de nos plus purs poètes, actuellement en France envahie. Nous révélerons l’identité de Jean du Haut après la guerre. Mais déjà ces poèmes qui nous parviennent de la capitale de la douleur contiennent assez de poésie et vérité pour qu’on en reconnaisse l’auteur. » (p. 1620).
Le lit la table (opus 57, 1944) commence par « Notre année », poème d’amour : « Nous garderons pour cette année / La résistance de l’enfance / La nudité de la verdure / La nudité de tes yeux clairs / Et sous tes lèvres entr’ouvertes tes seins clairs / Montre tes seins ma révélée / Impose aux autres ton bonheur / Ces deux minutes d’eau claire / Retenues sur la pente et creusant leur éclat » (p. 1196). « Le monde est nul » est un poème terrifiant, écrit pendant qu’Éluard se cachait à l’asile psychiatrique de Saint-Alban (Lozère) : IV « Impérieusement elle ordonnait aux hommes / De se mettre à l’abri sous de bonnes ordures / Elle hurlait je suis la putain du Seigneur / Une fille de rien je sors de la nuit noire / Par une étoile dérobée / Et je commande avec une langue de boue / Que l’on m’aime à jamais » (p. 1213). Succès garanti dans une séance de slam !
Les armes de la douleur (opus 58, 1944) se termine par deux poèmes de combat. « Courage » commence par ces vers : « Paris a froid Paris a faim / Paris ne mange plus de marrons dans la rue / Paris a mis de vieux vêtements de vieille / Paris dort tout debout sans air dans le métro » (p. 1231). « Bêtes et méchants » n’est guère mémorable, comme son titre l’indique, sauf qu’on remarque l’utilisation d’un mètre régulier en cinq syllabes, comme si ce rythme était à l’image du titre : « Qu’ils partent qu’ils meurent / Leur mort nous suffit » (p. 1233). Le recueil commençait par « Les armes de la douleur », poème de circonstance dédié « à la mémoire de Lucien Legros fusillé pour ses dix-huit ans » (p. 1225).
Dignes de vivre (opus 59, 1944) nous vaut un article élogieux de Louis Parrot dans Les Lettres françaises (cité p. 1635) :
« C’est en vain que l’on chercherait la moindre trace de préciosité dans toutes ces images dont ces poèmes s’illuminent, dans ces images qui égalent en rayonnement et surpassent peut-être en densité celles des premiers recueils de l’auteur. Elles sont traversées par un courant poétique d’une extrême violence, par une émotion que l’on ne retrouverait guère dans des poèmes patiemment élaborés et arrachés de vive force à une inspiration rebelle.
Une lecture attentive des poèmes d’Éluard nous montre clairement visibles d’un recueil à l’autre ces efforts vers la simplification qui tout d’abord lui fait craindre puis finalement répéter toutes les savantes notations poétiques où il excellait. Bien sûr, il n’y a pas ici appauvrissement. Mais ces richesses longtemps visibles et qui brillaient de molles lueurs à la surface du poème, c’est très profondément qu’il faut les découvrir. Éluard les a recouvertes d’un langage emprunté à la réalité vulgaire. A-t-on remarqué que Paul Éluard est le poète d’aujourd’hui dont le vocabulaire est le plus réduit ? Comparons avec Henri Michaux qui invente une langue nouvelle, qui se trouve un langage personnel ; Éluard ne connaît d’autres mots que ceux dont on se sert autour de lui. […] Éluard est un homme qui vit ici, au milieu de nous comme il le dira dans son nouveau poème à Picasso [il s’agit de Picasso bon maître de la liberté]. De là ce caractère de plus en plus familier, de là l’exceptionnelle plénitude de ses mots chargés de sens, de bon sens ou de sens commun et tout le poids de ces sentences poétiques que dicte au long de son œuvre l’expérience que seul un homme qui ne sépare pas sa vie de celle des autres hommes pouvait atteindre. Aussi ne laisse-t-il pas entrevoir, comme certains, un monde merveilleux situé toujours plus loin que nous ne pouvons atteindre. Il désigne, au contraire, ce qu’il y a de merveilleux dans notre réalité. »
Au rendez-vous allemand (opus 62, 1944) est le grand recueil qui reprend sous plusieurs éditions successives, les poèmes de guerre. On y trouve des poèmes de circonstance excusables par l’urgence du combat : « Un petit nombre d’intellectuels français s’est mis au service de l’ennemi » [c’est le titre] : « Épouvantés épouvantable/ L’heure est venue de les compter / Car la fin de leur règne arrive // Ils nous ont vanté nos bourreaux / Ils nous ont détaillé le mal / Ils n’ont rien dit innocemment // Belles paroles d’alliance / Ils vous ont voilées de vermine / Leur bouche donne sur la mort // Mais voici que l’heure est venue / De s’aimer et de s’unir / Pour les vaincre et les punir. » (à lire et écouter sur ce blog) « Comprenne qui voudra » (p. 1261), outre sa célébrité pour avoir pris la défense des femmes tondues, a connu une gloire posthume pour avoir été cité lors d’une conférence de presse par le président Georges Pompidou, à propos de l’affaire Gabrielle Russier. Voir notre article sur Les Écrous de la haine, de Michel Del Castillo. Cette remotivation du poème dans une situation totalement différente nous renvoie aux propos de Georges Mounin cités supra.
Je cite parce que c’est mon quartier, « Dans un miroir noir » : « Dans la rue de la Chapelle / Une façade d’école / Grêlée éthérée de balles […] Dans la rue de la Chapelle / Sur les murs enfin marqués / Par une empreinte vivante / Par le désir d’être libre » (p. 1269). « Éternité de ceux que je n’ai pas revus » est un « ubi sunt » rendant hommage aux poètes morts : « Visages clairs souvenirs sombres / Puis comme un grand coup sur les yeux / Visages de papier brulés / Dans la mémoire rien que cendres / La rose froide de l’oubli / Pourtant Desnos, pourtant Péri / Crémieux Fondane Pierre Unik / Sylvain Itkine Jean Jausion / Grou-Radenez Lucien Legros / Le temps le temps insupportable / Politzer Decour Robert Blache / Serge Meyer Mathias Lübeck / Maurice Bourdet et Jean Fraysse / Dominique Corticchiato / Et Max Jacob et Saint-Pol-Roux / Rien que le temps de n’être plus / Et rien que le temps d’être tout / Dans ma mémoire qui revient / Dans la mémoire que j’enseigne » (p. 1286). Poème émouvant — métré — qui me rappelle Aragon et son « Conscrit des cent villages ». Cela me ramène à mon poème fétiche : « Strophes pour se souvenir », dont il est question dans l’article sur la lettre de Manouchian. Que voulez-vous que je vous dise ? À thème équivalent, cette poésie fait plus battre mon cœur. Comprenne qui voudra…
Voici ce 2e article terminé. Le 3e article sur le tome second de la Pléiade, nous permet de connaître l’évolution d’Éluard dans les six années qui précèdent sa mort… Lisez aussi nos articles sur Nusch, Portrait d’une muse du surréalisme, de Chantal Vieuille ; un article sur Kiki de Montparnasse, bande dessinée de Catel & Bocquet, qui porte un regard sur une autre muse du surréalisme au destin proche de celui de Nusch, et sur Man Ray avant son travail avec Éluard ; un article sur l’Autoportrait de Man Ray ; un article sur le film culte des surréalistes, Peter Ibbetson, un autre sur les Recherches sur la sexualité, enfin un article sur le contexte artistique des années 30.
Voir en ligne : Les Mains libres, sur Lettres volées
© altersexualite.com, 2014.
La vignette représente un timbre émis en 1991 dans la série Poètes du XXe siècle. La gravure est faite d’après un dessin de Pablo Picasso réalisé en 1941.
[1] Agnès Vinas me signale que la Pléiade commet là une erreur de datation et une confusion. La lettre d’Éluard, que l’on retrouve intégralement à la p. 263 des Lettres à Gala, éditées par Pierre Dreyfus (Gallimard, 1984), date en réalité de « Montlignon, avril 1936 », ce qui est corroboré par une allusion d’Éluard à la future exposition de Londres dans cette même lettre. En fait, il y a eu une deuxième rupture, définitive celle-là, en 1938 après le voyage de Breton au Mexique, et les deux ont été confondues par Robert Valette (l’auteur de Livre d’identité), erreur reprise par la Pléiade. Cette lettre est citée dans l’article de Lettres volées sur « L’aventure ».
[2] Et que voilà une séance de cours toute prête pour nos terminales ! Voir dans cet esprit le cours de Sylvie Cadinot-Romerio sur l’herméneutique surréaliste, que vous pouvez télécharger sur cette page de Lettres volées.
 altersexualite.com
altersexualite.com