Accueil > Livres pour les jeunes et les « Isidor » HomoEdu > Documentaires (élèves) > Les Disparus, de Daniel Mendelsohn
Un livre marquant sur la shoah, pour le lycée
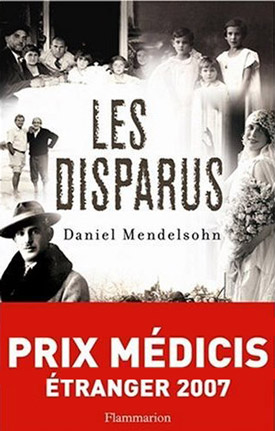 Les Disparus, de Daniel Mendelsohn
Les Disparus, de Daniel Mendelsohn
Flammarion, 2006, 654 p., 26,4 €
samedi 11 juillet 2015
Cet article est basé d’une part sur un texte écrit pour le journal du lycée dans lequel j’enseigne, d’autre part sur des notes prises en vue du roman M&mnoux sur lequel je travaille actuellement, sur l’histoire d’une partie de ma famille. Ce qui m’intéressait pour ce projet n’était donc pas le génocide, mais comment raconter sa généalogie.
Les génocides du XXe siècle ne nous offrent-ils pas une piste de réflexion sur la question du racisme ? En effet, il est parfois rassurant de se dire que le racisme, ce sont des blancs qui haïssent des noirs, ou que ce sont des haines religieuses. Oui, mais alors le génocide khmer rouge ? Des Cambodgiens qui massacrent des Cambodgiens de même confession. Oui, mais le génocide des Tutsis ? Des noirs catholiques massacrés par des noirs catholiques ; et parmi eux des prêtres assassinant d’autres prêtres [1]. La haine est malheureusement, comme le rire, le propre de l’homme. Parmi les lieux de mémoire les plus émouvants que j’aie pu visiter figure Tuol Sleng ou S-21, le centre de torture de la dictature khmère rouge, installé dans un ancien lycée français de Phnom Penh au Cambodge [2]. J’étais bouleversé à l’idée que dans l’espace de quelques salles de classe, on ait pu exterminer 14 000 personnes. Si l’on pouvait y songer, avant de s’insulter à tire-larigot dans les salles de classe de France & de Navarre ?
Génocide juif & génocide arménien
Mais je voulais évoquer deux autres génocides. On a parfois l’impression d’avoir trop d’informations sur le génocides des juifs, mais parfois, un livre, un film (La Vie est belle, de Roberto Benigni), une bande dessinée (Maus, d’Art Spiegelman) vous font retrouver l’émotion intacte, le « mais ce n’est pas possible qu’on ait fait ça, nous autres Européens soi-disant civilisés, au XXe siècle, deux siècles après les prétendues Lumières ! »). J’ai lu récemment un livre paru en 2006, Les Disparus, de Daniel Mendelsohn, un pavé qui ne laisse pas indifférent. C’est une enquête sur les ancêtres juifs de l’auteur dispersés sur quatre continents, à partir de leur village d’origine en Ukraine, Bolekhiv. Lui est né aux États-Unis, et traite la question avec détachement, sans chercher à accuser, mais à comprendre. Au cours de cette enquête parmi ses ascendants, il est amené à relater certains cas critiques, comme ceux de juifs qui ont fait partie de la « police juive », chargée par les nazis de désigner les victimes, et qui étaient les derniers à être assassinés. Au lieu d’accuser, il conclut sur ce point que pour sauver sa femme ou ses enfants, lui-même aurait pu céder aux pressions des Allemands, et accepter cette abjection. Au lieu de juger les Ukrainiens ou les Polonais chrétiens, dont certains ont assisté les nazis pour tuer les juifs, il insiste d’une part sur le fait que les très rares rescapés juifs de Bolekhiv (moins de 1 %) ont été sauvés aussi grâce à des Ukrainiens ou à des Polonais, au péril de leur vie ; d’autre part sur le fait que l’attitude des Ukrainiens peut être expliquée sinon excusée par le quasi-génocide subi par les Ukrainiens de la part des soviétiques dans les années 1930, désigné par le mot « Holodomor ». Mais Mendelsohn se surpasse dans le détachement, quand il établit un parallèle vertigineux entre une pyramide de martyrs juifs nus entassés par les nazis lors du premier massacre de masse (« aktion ») de Bolekhiv, au cours de laquelle 900 personnes furent assassinées après une série d’atrocités innommables, et la pyramide d’hommes nus que les soldats étasuniens édifièrent dans la prison d’Abou Ghraib en 2003. Selon lui, la pyramide symbolise « les sommets de la civilisation et ses profondeurs, la capacité de faire quelque chose à partir de rien et celle de faire le rien à partir de quelque chose ».
Le Mas des alouettes, de Paolo et Vittorio Taviani
J’ai retrouvé une image similaire à propos du dernier génocide dont je souhaite parler dans cet article, le génocide des Arméniens, dont le centenaire a été commémoré le 24 avril 2015. Dans un film des frères Paolo et Vittorio Taviani, Le Mas des alouettes (2007), on voit, lors de la déportation des femmes et des filles à travers l’Anatolie vers le désert syrien de Deir ez-Zor, après que les hommes et les garçons eurent été massacrés, deux femmes, deux mères, obligées par les soldats turcs, de tuer elles-même le nouveau-né d’une d’entre elles, de sexe masculin. Les cinéastes ont choisi de montrer la scène de façon à la fois sobre et terrifiante : les femmes se mettent dos à dos et étouffent l’enfant. J’établis un parallèle avec la pyramide de Mendelsohn : que des mères, dont le ventre donne la vie, donnent la mort par leur dos, ce chiasme visuel et philosophique constitue une allégorie inoubliable de la barbarie humaine. Il se trouve que, lors d’un voyage en Syrie en 2003, j’avais eu l’occasion de passer par Deir ez-Zor. Je n’avais pas eu le courage à l’époque de visiter le mémorial du génocide qui se trouvait dans cette ville, et il y a peu de chances que j’aie à nouveau l’occasion de rattraper cet oubli, à cause de ce que vous savez.
Alors, le racisme : une simple question de couleur de peau ?
L’enquête de Daniel Mendelsohn
Daniel Mendelsohn aura mis six ans pour boucler son livre, dédié à neuf de ses témoins morts avant publication. Il théorise ce besoin que nous avons de préciser, dans le grand catalogue des procédés narratifs, les modèles auxquels nous nous référons. Lui part de la narration en boucle des Grecs anciens, qui vous bourraient de laine hétéroclite le matelas de l’histoire, et tiraient de part et d’autre des capitons pour que l’ensemble ne branlât pas trop, mais mentionne aussi les contemporains. Ce type de narration qui offre son ventre ouvert au lecteur est devenue un modèle en soi depuis Proust, mais de plus en plus insoucieuse de cacher les câbles qui descendent de ses cintres.
De la première à la dernière page, ce livre n’est jamais qualifié de roman ou autre genre littéraire, mais d’« ouvrage », puis dans les extraits de presse de la quatrième de couverture, de « roman policier », « œuvre », « enquête », « épopée », « tragédie », « tableau » ; l’article de Wikipédia en français le qualifie d’« essai », tandis que la version anglaise utilise le terme « mémoire ». Bien qu’il ait commencé à se faire le mémorialiste de sa famille depuis son adolescence, Daniel Mendelssohn regrette d’avoir attendu que les derniers témoins survivants aient largement dépassé les soixante-dix ans, certains aphasiques, pour entrer dans l’enquête directe, après avoir exploité pendant trente ans toutes les archives écrites. Je qualifierais ce livre de « récit d’une enquête », car il nous raconte surtout comment il a réussi à savoir ce qu’il nous raconte dans l’ordre qu’il l’a su, quitte à saucissonner les informations sur tel ou tel membre de la famille, et à rectifier des informations erronées données d’abord.
Les points marquants de cette enquête sont nombreux. Par exemple, le fait que les enfants et petits-enfants des rescapés profitent de l’entretien avec l’auteur pour entendre ce que leurs aïeux ne leur ont jamais vraiment raconté. Je relève aussi la « consternation » de l’auteur à propos d’un album de photos anciennes qu’un de ses témoins lui présente, sans la moindre légende sous les photos : « tous ceux-là sont absolument perdus, impossibles à connaître ». L’errance de l’auteur dans les rues de Bolekhiv en compagnie de son interprète et ami, en quête de toute personne âgée susceptible de le renseigner est fort émouvante. L’histoire elle-même est riche en rebondissements. Dans les années 1920, si son grand-père put émigrer aux États-Unis, c’est grâce au sacrifice de deux de ses sœurs, qui durent promettre d’épouser le fils bossu d’un cousin, en contrepartie des billets de bateau. L’aînée des filles étant morte avant le mariage, la cadette dut se sacrifier à son tour. Moyennant quoi, toute cette partie de la famille échappa au nazisme. L’une des rares rescapées, cachée dans la cave d’une ferme, donnait des leçons de mathématiques à la petite fille de ses sauveteurs. Elle dut arrêter, car les progrès de la fillette étonnèrent l’institutrice, et l’on inventa un oncle de passage à la ferme pour étouffer de possibles soupçons. De trois frères cachés dans une meule de foin, l’un sera trouvé à la pointe d’une fourche, les deux autres feront partie des quarante-huit rescapés pour avoir su laisser prendre leur frère sans se trahir. Deux sœurs institutrices tentèrent de sauver le grand-oncle et l’arrière-cousine de l’auteur, les cachant dans une cave humide et sombre. Elles furent dénoncées à cause d’un jeune polonais amoureux de la jeune juive, qui les ravitaillait trop visiblement, et qui fut tué par les nazis, ainsi que l’une des sœurs institutrice, en représailles.
Je n’appris un détail significatif pour les lecteurs fidèles d’altersexualite.com qu’après avoir tourné la dernière page du livre, lorsque je fis une recherche sur l’auteur : dans d’autres livres, il affirme son goût pour les garçons, motif totalement absent des Disparus, que j’avais lu par hasard, sans rien connaître sur l’auteur. Rétrospectivement, je me dis que s’il s’intéresse de si près à la vie amoureuse de ses personnages, c’est peut-être la seule trace de son altersexualité. Que sa lointaine cousine Frydka ait été ou non une fille facile, qu’elle ait ou non été enceinte quand elle fut assassinée, que l’institutrice qui la sauva et le paya de sa vie, ait été animée de sentiments chrétiens ou simplement une femme bonne, et fille-mère de surcroît, si tout cela passionne notre auteur et qu’il titille ses témoins sur ces aspects secrets que certains ont du mal à aborder, ce n’est sans doute pas par hasard. Daniel Mendelsohn utilise d’autres épisodes de sa biographie. Par exemple, il s’accuse d’avoir cassé le bras de son frère cadet lorsqu’il avait dix ans, ce qui lui permet d’éployer les rémiges de son érudition biblique sur le thème d’Abel et de Caïn, au cœur de la tragédie de la famille de son grand-oncle, à qui ses frères ont refusé de tendre la main. Son enquête est rythmée par l’exégèse de grands mythes de l’Ancien testament. Mais revenons en arrière, pour évoquer le drame plus personnel de la famille de Daniel Mendelsohn, dont l’oncle, malgré tous ses appels à l’aide aux frères et aux sœurs, ne put se faire payer la traversée de l’Atlantique, et périt avec sa famille sous les balles nazies. Ce problème, après avoir été posé, est d’ailleurs pudiquement évacué de l’enquête de Mendelsohn, ce qui laisse supposer qu’il a obtenu des éléments de réponse au cours de son enquête, mais n’a pas souhaité les publier, de même que dans ses longues pages d’exégèse biblique, il se garde bien de poser clairement la question de l’abandon par le dieu des juifs du « peuple élu », expression qu’il utilise pourtant à longueur de pages. Il laisse seulement un de ses personnages exprimer son ressentiment à propos de sa propre mère, prise alors qu’elle sortait de leur cachette pour respecter une fête religieuse, alors que l’un des oncles du narrateur, boucher, ayant vendu de la viande non cashère, fut exclu de la communauté, émigra, et fut sauvé.
Les « pyramides » de Mendelsohn
Revenons sur cette page qui est pour moi la plus marquante de l’œuvre. Les propos de l’auteur sur Abou Ghraib sont réactivés à l’aune des réactions disproportionnées, en 2014, à l’égard des crimes commis par les fascistes islamistes de Syrie et d’Irak. Quand le président des États-Unis, le pays qui a mis en place les crimes de guerre de la prison d’Abou Ghraib, invoque la « barbarie » à chaque fois qu’un citoyen européen ou étasunien est assassiné par ces fascistes islamiques, il commet à mon sens une erreur politique.
Ces fascistes ne sont pas barbares quand ils assassinent un seul citoyen à la fois devant une caméra, mais quand ils commettent, à l’instar des nazis ou des Turcs contre les juifs ou les Arméniens, un crime de masse, à l’écart des caméras, contre par exemple des chrétiens d’Orient. On dit souvent que le nombre n’a rien à voir dans l’horreur d’un crime, mais bien sûr que si. Un crime de masse est plus grave qu’un assassinat isolé, ou que dix assassinats isolés, et la façon d’assassiner est un détail. Le livre de Mendelsohn est utile pour rappeler que le génocide avait commencé avant l’institution des chambres à gaz, par des assassinats de masse (appelés Shoah par balles), accompagnés des pires humiliations qu’un cerveau humain puisse concevoir. Les juifs survivants de Bolekhiv après cette première « aktion » par balles durent, par exemple, payer aux assassins les balles utilisées pour tuer les premières victimes. Motif utile pour qui trouverait mesquin le fait que, soixante-dix ans après les faits, des héritiers des victimes continuent à réclamer la restitution de biens spoliés.
Que la pratique de l’égorgement affectionnée par les fascistes islamistes autorise une telle indignation médiatique me semble immoral. Cent chrétiens tués par balle dans un village, ou cent sunnites tués par des chiites ou vice-versa, en dehors de la présence d’une caméra, cela est encore plus grave, j’en suis désolé, qu’un journaliste occidental tué, par égorgement ou non, devant une caméra (à moins que l’on fasse partie des proches du journaliste en question ; mais les victimes de massacre de masse ont aussi, chacun pris individuellement, des proches ; qui sont souvent, il est vrai, tués dans le même crime). L’égorgement n’est que la version artisanale d’une guillotinade ou d’une décollation à la hache, pratiquées en France ou en Angleterre jusqu’à des époques où nous nous targuions d’être droit-de-l’hommistes ; au Japon jusqu’au milieu du siècle, et aujourd’hui même au Mexique, à la frontière étasunienne, par des narco-fascistes, qui portent souvent une croix chrétienne sur leur poitrail poilu. Cette indignation médiatique touche à l’infamie quand elle prétend ériger l’islam en général en parangon de la barbarie. Certes nous devons lutter sans merci contre ces islamo-fascistes, et les détruire si possible jusqu’au dernier, mais sans perdre la mémoire des génocides du siècle, perpétrés rarement au nom de la religion, plutôt au nom de l’athéisme, par des musulmans turcs, par des chrétiens allemands, par des bouddhistes khmers, par des catholiques hutus, par des chrétiens serbes. Quelle que soit sa religion d’origine, n’importe quel être humain peut être amené à se comporter de façon barbare, mais s’il est une qualité qui distingue la civilisation, c’est de rester maître de soi. Il n’est donc pas utile qu’un président de république soi-disant civilisée perde son sang froid et galvaude un terme tel que « barbarie ». De même, lors des attentats de 2001, ceux qui ont traité les kamikazes de « lâches » se sont ridiculisés, car ces terroristes qui se sont tués pour commettre leurs attentats ignobles méritaient tous les noms d’oiseaux imaginables, sauf précisément celui de « lâche ». C’est malheureusement nous les « lâches », car, comme nous avons pris goût à la vie, nous craignons la mort.
Voir en ligne : Site de l’auteur (en français !)
© altersexualite.com 2015.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Lire « L’Église catholique et le génocide des Tutsi : de l’idéologie à la négation », Jean Damascène Bizimana.
[2] Voir le film de Rithy Panh, S21, la machine de mort Khmère rouge (2002).
 altersexualite.com
altersexualite.com