Accueil > Essais & Documentaires (adultes) > « Le Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir, tome 2
De « La femme mariée » à « La femme indépendante »
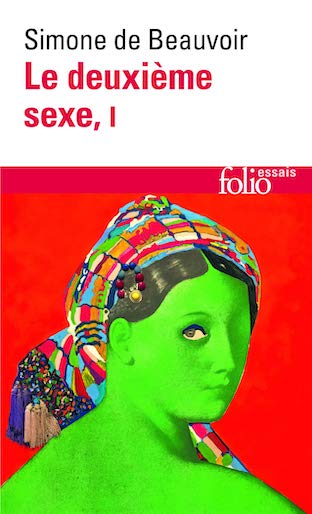 « Le Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir, tome 2
« Le Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir, tome 2
Gallimard, Folio essais, 1949, 504 p., 11,5 €
samedi 2 octobre 2021, par
Cela fait dix ans que j’avais lu et consacré un article au tome 1 du Deuxième Sexe, et c’est à l’occasion de la mise au programme du thème « Dans ma maison » pour le BTS (2021-2023) que je passe au tome 2… ayant lu entre temps L’Invitée et « Les Mémoires d’une jeune fille dérangée » (qui n’est pas d’elle). Seul le chapitre I « La femme mariée » de la Première partie « Situation » est au programme de BTS, ce qui fait un essai bref de 125 pages tout à fait accessible pour nos étudiants, permettant d’explorer l’aspect « femme au foyer » du thème. Je lui ai réservé un article séparé. Le présent article est consacré à la suite du tome 2, un livre évidemment daté mais qui reste une référence – parfois repoussoir – pour le féminisme contemporain. Cet article se limitera à une compilation d’extraits. Il se peut que certains de nos étudiants s’estiment « choqués » par la parole crue sur la sexualité sous la plume d’une femme libre au milieu du XXe siècle, mais ce choc est-il inutile ?
Première partie « Situation ». Chapitre II « La mère ».
Cette entrée sur l’hypocrisie de la médecine sur l’avortement résonne étrangement sous la tyrannie covidiste de 2020-2021, car c’est la même hypocrisie au sujet des traitements précoces du covid et du vaxin. La doxa, c’est les vaxins, et vouloir soigner les gens c’est aussi criminel que ce le fut de pratiquer des avortements clandestins. Les morts du vaxin provoquent la même indifférence que jadis la mort des avortées clandestines. Ceux qui sont actuellement traités de charlatans par les médecins de plateaux-télé seront les héros de demain.
« Il est peu de sujets sur lesquels la société bourgeoise déploie plus d’hypocrisie : l’avortement est un crime répugnant auquel il est indécent de faire allusion. Qu’un écrivain décrive les joies et les souffrances d’une accouchée, c’est parfait ; qu’il parle d’une avortée, on l’accuse de se vautrer dans l’ordure et de décrire l’humanité sous un jour abject : or, il y a en France chaque année autant d’avortements que de naissances. C’est un phénomène si répandu qu’il faut le considérer comme un des risques normalement impliqués par la condition féminine. Le code s’obstine cependant à en faire un délit : il exige que cette opération délicate soit exécutée clandestinement. Rien de plus absurde que les arguments invoqués contre la législation de l’avortement. On prétend que c’est une intervention dangereuse. Mais les médecins honnêtes reconnaissent avec le docteur Magnus Hirschfeld que : « L’avortement fait par la main d’un véritable médecin spécialiste, dans une clinique et avec les mesures préventives nécessaires, ne comporte pas ces graves dangers dont la loi pénale affirme l’existence. » C’est au contraire sous sa forme actuelle qu’il fait courir à la femme de grands risques. Le manque de compétence des « faiseuses d’anges », les conditions dans lesquelles elles opèrent, engendrent quantité d’accidents, parfois mortels. La maternité forcée aboutit à jeter dans le monde des enfants chétifs, que leurs parents seront incapables de nourrir, qui deviendront les victimes de l’Assistance publique ou des « enfants martyrs ». Il faut remarquer d’ailleurs que la société si acharnée à défendre les droits de l’embryon se désintéresse des enfants dès qu’ils sont nés ; on poursuit les avorteuses au lieu de s’appliquer à réformer cette scandaleuse institution nommée Assistance publique ; on laisse en liberté les responsables qui en livrent les pupilles à des tortionnaires ; on ferme les yeux sur l’horrible tyrannie qu’exercent dans des « maisons d’éducation » ou dans des demeures privées les bourreaux d’enfants ; et si on refuse d’admettre que le fœtus appartient à la femme qui le porte, en revanche, on consent que l’enfant soit la chose de ses parents ; dans la même semaine, on vient de voir un chirurgien se suicider parce qu’il était convaincu de manœuvres abortives et un père qui avait battu son fils presque à mort a été condamné à trois mois de prison avec sursis » (p. 135).
« L’avortement dit criminel est aussi familier à toutes les classes sociales que les politiques anticonceptionnelles acceptées par notre société hypocrite. Les deux tiers des avortées sont des femmes mariées… On peut estimer approximativement qu’il y a en France autant d’avortements que de naissances.
Du fait que l’opération se pratique dans des conditions souvent désastreuses, beaucoup d’avortements se terminent par la mort de l’avortée.
Deux cadavres de femmes avortées arrivent par semaine à l’Institut médico-légal de Paris ; beaucoup provoquent des maladies définitives » (p. 139).
Passons à la grossesse, que la philosophe s’emploie à démythifier :
« Mais la grossesse est surtout un drame qui se joue chez la femme entre soi et soi ; elle la ressent à la fois comme un enrichissement et comme une mutilation ; le fœtus est une partie de son corps, et c’est un parasite qui l’exploite ; elle le possède et elle est possédée par lui ; il résume tout l’avenir et, en le portant, elle se sent vaste comme le monde ; mais cette richesse même l’annihile, elle a l’impression de ne plus être rien. Une existence neuve va se manifester et justifier sa propre existence, elle en est fière ; mais elle se sent aussi jouet de forces obscures, elle est ballottée, violentée. Ce qu’il y a de singulier chez la femme enceinte, c’est qu’au moment même où son corps se transcende il est saisi comme immanent : il se replie sur lui-même dans les nausées et les malaises ; il cesse d’exister pour lui seul et c’est alors qu’il devient plus volumineux qu’il n’a jamais été. La transcendance de l’artisan, de l’homme d’action est habitée par une subjectivité : mais chez la future mère l’opposition sujet et objet s’abolit ; elle forme avec cet enfant dont elle est gonflée un couple équivoque que la vie submerge ; prise aux rets de la nature, elle est plante et bête, une réserve de colloïdes, une couveuse, un œuf ; elle effraie les enfants au corps égoïste et fait ricaner les jeunes gens parce qu’elle est un être humain, conscience et liberté, qui est devenu un instrument passif de la vie. La vie n’est habituellement qu’une condition de l’existence ; dans la gestation elle apparaît comme créatrice ; mais c’est une étrange création qui se réalise dans la contingence et la facticité. Il y a des femmes pour qui les joies de la grossesse et de l’allaitement sont si fortes qu’elles veulent indéfiniment les répéter ; dès que le bébé est sevré, elles se sentent frustrées. Ces femmes, qui sont des « pondeuses » plutôt que des mères, cherchent avidement la possibilité d’aliéner leur liberté au profit de leur chair : leur existence leur apparaît tranquillement justifiée par la passive fertilité de leur corps. Si la chair est pure inertie, elle ne peut incarner, même sous une forme dégradée, la transcendance ; elle est paresse et ennui, mais dès qu’elle bourgeonne elle devient souche, source, fleur, elle se dépasse, elle est mouvement vers l’avenir en même temps qu’une présence épaisse. La séparation dont la femme a jadis souffert au moment de son sevrage est compensée ; elle est noyée à nouveau dans le courant de la vie, réintégrée au tout, chaînon dans la chaîne sans fin des générations, chair qui existe pour et par une autre chair. La fusion cherchée dans les bras du mâle et qui est refusée aussitôt qu’accordée, la mère la réalise quand elle sent l’enfant dans son ventre lourd ou qu’elle le presse contre ses seins gonflés. Elle n’est plus un objet soumis à un sujet ; elle n’est pas non plus un sujet angoissé par sa liberté, elle est cette réalité équivoque : la vie. Son corps est enfin à elle puisqu’il est à l’enfant qui lui appartient. La société lui en reconnaît la possession et le revêt, en outre, d’un caractère sacré. Le sein qui était naguère un objet érotique, elle peut l’exhiber, c’est une source de vie : au point que des tableaux pieux nous montrent la Vierge Mère découvrant sa poitrine en suppliant son Fils d’épargner l’humanité. Aliénée dans son corps et dans sa dignité sociale, la mère a l’illusion pacifiante de se sentir un être en soi, une valeur toute faite » (p. 156).
« Certains prêtres de la Vie et de la Fécondité prétendent mystiquement que la femme reconnaît à la qualité du plaisir éprouvé que l’homme vient de la rendre mère : c’est un de ces mythes qu’il faut mettre au rebut. Elle n’a jamais une intuition décisive de l’événement : elle l’induit à partir de signes incertains. Ses règles s’arrêtent, elle épaissit, ses seins deviennent lourds et lui font mal, elle éprouve des vertiges, des nausées ; parfois elle se croit tout simplement malade et c’est un médecin qui la renseigne. Alors elle sait que son corps a reçu une destination qui le transcende ; jour après jour, un polype né de sa chair et étranger à sa chair va s’engraisser en elle ; elle est la proie de l’espèce qui lui impose ses mystérieuses lois et généralement cette aliénation l’effraie : son effroi se traduit par des vomissements. Ceux-ci sont en partie provoqués par les modifications des sécrétions gastriques qui se produisent alors ; mais si cette réaction, inconnue des autres femelles mammifères, prend de l’importance, c’est pour des motifs psychiques ; elle manifeste le caractère aigu que revêt alors chez la femelle humaine le conflit entre espèce et individu » (p. 159).
Beauvoir ne craint pas d’aborder des sujets tabous :
« Certaines femmes considèrent au contraire que c’est une épreuve relativement facile à supporter. Un petit nombre y trouve un plaisir sensuel. »
« Je suis un être tellement sexuel que l’accouchement même est pour moi un acte sexuel, écrit l’une [Stekel]. J’avais une très belle « Madame ». Elle me baignait et me donnait des injections. C’était assez pour me mettre dans un état de haute excitation avec des frissons nerveux » (p. 171).
« Parfois ces rapports revêtent un caractère nettement sexuel. Ainsi, dans la confession recueillie par Stekel et que j’ai citée, on lit :
« J’allaitais mon fils, mais sans joie car il ne poussait pas et nous perdions tous deux du poids. Cela représentait quelque chose de sexuel pour moi et j’éprouvais un sentiment de honte en lui donnant le sein. J’avais la sensation adorable de sentir le petit corps chaud qui se serrait contre le mien ; je frissonnais quand je sentais ses petites mains me toucher… Tout mon amour se détachait de mon moi pour aller vers mon fils… L’enfant était trop souvent avec moi. Dès qu’il me voyait au lit, il avait alors deux ans, il se traînait vers le lit, essayant de se mettre sur moi. Il caressait mes seins avec ses petites mains et voulait descendre avec son doigt ; ce qui me faisait plaisir au point que j’avais de la peine à le renvoyer. Souvent j’ai dû lutter contre la tentation de jouer avec son pénis… » (p. 180).
Voici expliquée la rivalité mère-fille : « La mère se plaît à régner sans conteste sur son univers féminin ; elle se veut unique, irremplaçable ; et voilà que sa jeune assistante la réduit à la pure généralité de sa fonction. Elle gronde durement sa fille si, après deux jours d’absence, elle trouve la maison en désordre ; mais elle entre dans des transes furieuses s’il s’avère que la vie familiale s’est parfaitement poursuivie sans elle. Elle n’accepte pas que sa fille devienne vraiment un double, un substitut d’elle-même. Cependant, il lui est encore plus intolérable qu’elle s’affirme franchement comme une autre. Elle déteste systématiquement les amies en qui sa fille cherche du secours contre l’oppression familiale et qui « lui montent la tête » ; elle les critique, défend à sa fille de les voir trop souvent ou même prend prétexte de leur « mauvaise influence » pour lui interdire radicalement de les fréquenter. Toute l’influence qui n’est pas la sienne est mauvaise ; elle a une animosité particulière à l’égard des femmes de son âge – professeurs, mères de camarades – vers qui la fillette tourne son affection : elle déclare ces sentiments absurdes ou malsains. Parfois, il suffit pour l’exaspérer de la gaieté, de l’inconscience, des jeux et des rires de l’enfant ; elle les pardonne plus volontiers aux garçons ; ils usent de leur privilège mâle, c’est naturel, elle a renoncé depuis longtemps à une impossible compétition. Mais pourquoi cette autre femme jouirait-elle d’avantages qui lui sont refusés ? Emprisonnée dans les pièges du sérieux, elle envie toutes les occupations et les amusements qui arrachent la fillette à l’ennui du foyer ; cette évasion est un démenti de toutes les valeurs auxquelles elle s’est sacrifiée. Plus l’enfant grandit, plus la rancune ronge le cœur maternel ; chaque année achemine la mère vers son déclin ; d’année en année le corps juvénile s’affirme, s’épanouit ; cet avenir qui s’ouvre devant sa fille, il semble à la mère qu’on le lui dérobe ; c’est de là que vient l’irritation de certaines femmes, quand leurs filles ont leurs premières règles : elles leur en veulent d’être dorénavant sacrées femmes. À cette nouvelle venue s’offrent, contre la répétition et la routine qui sont le lot de l’aînée, des possibilités encore indéfinies : ce sont ces chances que la mère envie et déteste ; ne pouvant les faire siennes, elle essaie souvent de les diminuer, de les supprimer : elle garde sa fille à la maison, la surveille, la tyrannise, elle la fagote exprès, elle lui refuse tous loisirs, elle entre dans des colères sauvages si l’adolescente se maquille, si elle « sort » ; toute sa rancune à l’égard de la vie, elle la tourne contre cette jeune vie qui s’élance vers un avenir neuf ; elle essaie d’humilier la jeune fille, elle tourne en ridicule ses initiatives, elle la brime. Une lutte ouverte se déclare souvent entre elles, c’est normalement la plus jeune qui gagne car le temps travaille pour elle ; mais sa victoire a goût de faute : l’attitude de sa mère engendre en elle à la fois révolte et remords ; la seule présence de la mère fait d’elle une coupable : on a vu que ce sentiment peut lourdement grever tout son avenir. Bon gré, mal gré, la mère finit par accepter sa défaite ; quand sa fille devient adulte, il se rétablit entre elles une amitié plus ou moins tourmentée. Mais l’une demeure à jamais déçue, frustrée ; l’autre se croira souvent poursuivie par une malédiction » (p. 193).
Première partie « Situation ». Chapitre III « La vie de société ».
Observation acérée de la vie sociale dans les milieux bourgeois : « Mais il faut souligner que la décence ne consiste pas à se vêtir avec une rigoureuse pudeur. Une femme qui sollicite trop clairement le désir mâle a mauvais genre ; mais celle qui semble le répudier n’est pas plus recommandable : on pense qu’elle veut se masculiniser, c’est une lesbienne ; ou se singulariser : c’est une excentrique ; en refusant son rôle d’objet, elle défie la société : c’est une anarchiste. Si elle veut seulement ne pas se faire remarquer, il faut qu’elle conserve sa féminité. C’est la coutume qui réglemente le compromis entre l’exhibitionnisme et la pudeur ; tantôt c’est la gorge et tantôt la cheville que « l’honnête femme » doit cacher ; tantôt la jeune fille a droit à souligner ses appâts afin d’attirer des prétendants tandis que la femme mariée renonce à toute parure : tel est l’usage dans beaucoup de civilisations paysannes ; tantôt on impose aux jeunes filles des toilettes vaporeuses, aux couleurs de dragées, à la coupe discrète, tandis que leurs aînées ont droit à des robes collantes, des tissus lourds, des teintes riches, des coupes provocantes ; sur un corps de seize ans le noir semble voyant parce que la règle à cet âge est de n’en pas porter. Il faut, bien entendu, se plier à ces lois ; mais en tout cas, et même dans les milieux les plus austères, le caractère sexuel de la femme sera souligné : une femme de pasteur ondule ses cheveux, se maquille légèrement, suit la mode avec discrétion, marquant par le souci de son charme physique qu’elle accepte son rôle de femelle. Cette intégration de l’érotisme à la vie sociale est particulièrement évidente dans la « robe du soir ». Pour signifier qu’il y a fête, c’est-à-dire luxe et gaspillage, ces robes doivent être coûteuses et fragiles ; on les veut aussi incommodes qu’il est possible ; les jupes sont longues et si larges ou si entravées qu’elles interdisent la marche ; sous les bijoux, les volants, les paillettes, les fleurs, les plumes, les faux cheveux, la femme est changée en poupée de chair ; cette chair même s’exhibe ; comme gratuitement s’épanouissent les fleurs, la femme étale ses épaules, son dos, sa poitrine ; sauf dans les orgies, l’homme ne doit pas indiquer qu’il la convoite : il n’a droit qu’aux regards et aux étreintes de la danse ; mais il peut s’enchanter d’être le roi d’un monde aux si tendres trésors. D’homme à homme, la fête prend ici la figure d’un potlatch ; chacun offre en cadeau à tous les autres la vision de ce corps qui est son bien. En robe du soir, la femme est déguisée en femme pour le plaisir de tous les mâles et l’orgueil de son propriétaire » (p. 209-210).
C’est toujours avec froideur si Beauvoir évoque le lesbianisme ; sans doute ne veut-elle pas paraître suspecte : « En presque toute jeune fille, avons-nous dit, il y a des tendances homosexuelles : les étreintes souvent maladroites du mari ne les effacent pas ; de là vient cette douceur sensuelle que la femme connaît auprès de ses semblables et qui n’a pas d’équivalent chez les hommes normaux. Entre les deux amies, l’attachement sensuel peut se sublimer en sentimentalité exaltée, ou se traduire par des caresses diffuses ou précises. Leurs étreintes peuvent aussi n’être qu’un jeu qui distrait leurs loisirs – c’est le cas pour les femmes de harem dont le principal souci est de tuer le temps – ou elles peuvent prendre une importance primordiale.
Cependant, il est rare que la complicité féminine s’élève jusqu’à une véritable amitié ; les femmes se sentent plus spontanément solidaires que les hommes, mais du sein de cette solidarité ce n’est pas chacune vers l’autre qu’elles se dépassent : ensemble, elles sont tournées vers le monde masculin dont elles souhaitent accaparer chacune pour soi les valeurs. Leurs rapports ne sont pas construits sur leur singularité, mais immédiatement vécus dans la généralité : et par là s’introduit aussitôt un élément d’hostilité » (p. 229).
Première partie « Situation ». Chapitre IV « Prostituées et hétaïres ».
Les idées de Beauvoir sur la prostitution sont sans surprise de gauche et guidées par l’empathie pour les victimes, avec force citations. « Un des arguments des esclavagistes américains en faveur de l’esclavage, c’est que les Blancs du Sud étant tous déchargés des besognes serviles pouvaient entretenir entre eux les relations les plus démocratiques, les plus raffinées ; de même, l’existence d’une caste de « filles perdues » permet de traiter « l’honnête femme », avec le respect le plus chevaleresque. La prostituée est un bouc émissaire ; l’homme se délivre sur elle de sa turpitude et il la renie. Qu’un statut légal la mette sous une surveillance policière ou qu’elle travaille dans la clandestinité, elle est en tout cas traitée en paria » (p. 247).
« Les moralistes bien pensants répondent en ricanant que les récits apitoyants des prostituées sont des romans à l’usage du client naïf. En effet, dans beaucoup de cas, la prostituée aurait pu gagner sa vie par un autre moyen : mais si celui qu’elle a choisi ne lui semble pas le pire, cela ne prouve pas qu’elle a le vice dans le sang ; plutôt cela condamne une société où ce métier est encore un de ceux qui paraît à beaucoup de femmes le moins rebutant » (p. 248).
« Par certains côtés, cette histoire est conforme à l’histoire classique de la fille vouée au trottoir par un souteneur. Il arrive que ce dernier rôle soit joué par le mari. Et quelquefois aussi par une femme. L. Faivre a fait, en 1931, une enquête sur 510 jeunes prostituées ; il a trouvé que 284 d’entre elles vivaient seules, 132 avec un ami, 94 avec une amie à qui les unissaient ordinairement des liens homosexuels. Il cite (avec leur orthographe) les extraits de lettres suivants :
« Suzanne, dix-sept ans. Je me suis livré à la prostitution avec surtout des prostituées. Une qui m’a garder longtemps, était très jalouse, aussi j’ai quitté la rue de…
« Andrée, quinze ans et demi. J’ai quitter mes parents pour habité avec une amie rencontrée dans un bal, je m’apercevais vite qu’elle voulait m’aimer comme un homme, je suis restée avec elle quatre mois, puis…
« Jeanne, quatorze ans. Mon pauvre petit papa s’appelait X…, il est mort des suites de la guerre à l’hôpital en 1922. Ma mère s’est remariée. J’allais à l’école pour obtenir mon certificat d’études, puis l’ayant obtenu je dus apprendre la couture… puis gagnant très peu, les disputes commencèrent avec mon beau-père… J’ai dû être placée bonne chez Mme X…, rue… J’étais seule depuis dix jours avec sa fille qui pouvait avoir vingt-cinq ans environ ; j’aperçu un changement très grand envers elle. Puis un jour, tout comme un jeune homme, elle m’avoua son grand amour. J’hésitais puis ayant peur d’être renvoyé, je finis par céder ; je compris alors certaines choses… J’ai travaillé, puis me trouvant sans travail je dus aller au Bois où je me prostituai avec des femmes. Je fis connaissance d’une dame très généreuse, etc. » (p. 255).
« Ce n’est pas leur situation morale et psychologique qui rend pénible l’existence des prostituées. C’est leur condition matérielle qui est dans la plupart des cas déplorable. Exploitées par le souteneur, la taulière, elles vivent dans l’insécurité et les trois quarts d’entre elles sont sans argent » (p. 263).
« Les courtisanes de la Renaissance, les geishas japonaises jouissent d’une liberté infiniment plus grande que leurs contemporaines. En France, la femme qui nous apparaît comme la plus virilement indépendante, c’est peut-être Ninon de Lenclos. Paradoxalement, ces femmes qui exploitent à l’extrême leur féminité se créent une situation presque équivalente à celle d’un homme ; à partir de ce sexe qui les livre aux mâles comme objets, elles se retrouvent sujets » (p. 267).
Un excursus préfigure le film Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig sur les actrices : « On sait dans quel esclavage tombent les vedettes de Hollywood. Leur corps n’est plus à elles ; le producteur décide de la couleur de leurs cheveux, de leur poids, leur ligne, leur type ; pour modifier la courbe d’une joue on leur arrachera des dents. Régimes, gymnastique, essayages, maquillage sont une corvée quotidienne. Sous la rubrique « Personal appearance » sont prévus les sorties, les flirts ; la vie privée n’est plus qu’un moment de la vie publique » (p. 270). D’aucuns font semblant de découvrir cela en 2017 avec « #MeToo »…
Première partie « Situation ». Chapitre V « De la maturité à la vieillesse ».
Points de vue édifiants dans ce chapitre. « L’histoire de la femme – du fait que celle-ci est encore enfermée dans ses fonctions de femelle – dépend beaucoup plus que celle de l’homme de son destin physiologique ; et la courbe de ce destin est plus heurtée, plus discontinue que la courbe masculine. Chaque période de la vie féminine est étale et monotone : mais les passages d’un stade à un autre sont d’une dangereuse brutalité ; ils se trahissent par des crises beaucoup plus décisives que chez le mâle : puberté, initiation sexuelle, ménopause. Tandis que celui-ci vieillit continûment, la femme est brusquement dépouillée de sa féminité ; c’est encore jeune qu’elle perd l’attrait érotique et la fécondité d’où elle tirait, aux yeux de la société et à ses propres yeux, la justification de son existence et ses chances de bonheur : il lui reste à vivre, privée de tout avenir, environ la moitié de sa vie d’adulte.
« L’âge dangereux » est caractérisé par certains troubles organiques, mais ce qui leur donne leur importance, c’est la valeur symbolique qu’ils revêtent. La crise est ressentie de manière beaucoup moins aiguë par les femmes qui n’ont pas essentiellement misé sur leur féminité ; celles qui travaillent durement – dans leur foyer ou au-dehors – accueillent avec soulagement la disparition de la servitude menstruelle ; la paysanne, la femme d’ouvrier, que menacent sans cesse de nouvelles grossesses, sont heureuses quand, enfin, ce risque est éludé. En cette conjoncture, comme en quantité d’autres, c’est moins du corps lui-même que proviennent les malaises de la femme que de la conscience angoissée qu’elle en prend. Le drame moral s’ouvre d’ordinaire avant que les phénomènes physiologiques ne se soient déclarés et il ne s’achève que lorsqu’ils sont depuis longtemps liquidés » (p. 277).
« Elle avoue sa répugnance pour un époux que naguère elle tolérait et elle devient frigide entre ses bras ; ou, au contraire, elle s’abandonne aux ardeurs qu’elle refrénait ; elle accable l’époux de ses exigences ; elle revient à la pratique de la masturbation abandonnée depuis l’enfance. Les tendances homosexuelles – qui existent de manière larvée chez presque toutes les femmes – se déclarent. Souvent, le sujet les reporte sur sa fille ; mais, parfois aussi, c’est à propos d’une amie que naissent des sentiments insolites » (p. 281).
« La femme sur qui pèse une tradition de décence et d’honnêteté ne va pas toujours jusqu’aux actes. Mais ses rêves se peuplent de fantômes érotiques qu’elle suscite aussi pendant la veille ; elle manifeste à ses enfants une tendresse exaltée et sensuelle, elle nourrit à propos de son fils des obsessions incestueuses ; elle tombe secrètement amoureuse d’un jeune homme après l’autre ; comme l’adolescente, elle est hantée par des idées de viol ; elle connaît aussi le vertige de la prostitution ; chez elle aussi l’ambivalence de ses désirs et de ses craintes engendre une anxiété qui parfois provoque des névroses : elle scandalise alors ses proches par des conduites bizarres qui ne font en vérité que traduire sa vie imaginaire.
La frontière de l’imaginaire et du réel est encore plus indécise dans cette période troublée que pendant la puberté. Un des traits les plus accusés chez la femme vieillissante, c’est un sentiment de dépersonnalisation qui lui fait perdre tous repères objectifs. Les gens qui en pleine santé ont vu la mort de très près disent aussi avoir éprouvé une curieuse impression de dédoublement ; quand on se sent conscience, activité, liberté, l’objet passif dont se joue la fatalité apparaît nécessairement comme un autre : ce n’est pas moi qu’une automobile renverse ; ce n’est pas moi cette vieille femme dont le miroir renvoie le reflet. La femme qui « ne s’est jamais sentie aussi jeune » et qui jamais ne s’est vue aussi âgée ne parvient pas à concilier ces deux aspects d’elle-même ; c’est en rêve que le temps coule, que la durée la ronge. Ainsi, la réalité s’éloigne et s’amenuise : du même coup, elle ne se distingue plus bien de l’illusion. La femme se fie à ses évidences intérieures plutôt qu’à cet étrange monde où le temps avance à reculons, où son double ne lui ressemble plus, où les événements l’ont trahie. Ainsi est-elle disposée aux extases, aux illuminations, aux délires. Et puisque l’amour est alors plus que jamais son essentielle préoccupation, il est normal qu’elle s’abandonne à l’illusion qu’elle est aimée. Neuf sur dix des érotomanes sont des femmes ; et celles-ci ont presque toutes de quarante à cinquante ans » (p. 283).
« C’est dans son automne, dans son hiver que la femme s’affranchit de ses chaînes ; elle prend prétexte de son âge pour éluder les corvées qui lui pèsent ; elle connaît trop son mari pour se laisser encore intimider par lui, elle élude ses étreintes, elle s’arrange à ses côtés – dans l’amitié, l’indifférence ou l’hostilité – une vie à elle ; s’il décline plus vite qu’elle, elle prend en main la direction du couple » […] « La femme qui a eu la chance d’engendrer dans un âge avancé se trouve privilégiée : elle est encore une jeune mère au moment où les autres deviennent des aïeules. Mais en général, entre quarante et cinquante ans, la mère voit ses petits se changer en adultes. C’est dans l’instant où ils lui échappent qu’elle s’efforce avec passion de se survivre à travers eux » (p. 288, 289).
L’attachement pour un fils donne lieu à un développement osé : « Entre-temps, elle lui a administré des gifles et des purges mais elle les a oubliées ; celui qu’elle a porté dans son ventre, c’était déjà un de ces demi-dieux qui gouvernent le monde et le destin des femmes : maintenant, il va la reconnaître dans la gloire de sa maternité. Il va la défendre contre la suprématie de l’époux, la venger des amants qu’elle a eus et de ceux qu’elle n’a pas eus, il sera son libérateur, son sauveur. Elle retrouve devant lui les conduites de séduction et de parade de la jeune fille guettant le prince charmant ; elle pense, quand elle se promène à ses côtés, élégante, charmante encore, qu’elle semble sa « sœur aînée » ; elle s’enchante si – prenant modèle sur les héros des films américains – il la taquine et la bouscule, rieur et respectueux : c’est avec une orgueilleuse humilité qu’elle reconnaît la supériorité virile de celui qu’elle a porté dans ses flancs. Dans quelle mesure peut-on qualifier ces sentiments d’incestueux ? Il est certain que quand elle se représente avec complaisance appuyée au bras de son fils, le mot de « sœur aînée » traduit pudiquement des fantasmes équivoques ; quand elle dort, quand elle ne se surveille pas, ses rêveries l’emportent parfois très loin ; mais j’ai dit déjà que rêves et fantasmes sont bien loin de toujours exprimer le désir caché d’un acte réel : souvent ils se suffisent, ils sont l’accomplissement achevé d’un désir qui ne réclame qu’un assouvissement imaginaire. Quand la mère joue d’une manière plus ou moins voilée à voir en son fils un amant, il ne s’agit que d’un jeu. L’érotisme proprement dit a d’ordinaire peu de place dans ce couple. Mais c’est un couple ; c’est du fond de sa féminité que la mère salue en son fils l’homme souverain ; elle se remet entre ses mains avec autant de ferveur que l’amoureuse et, en échange de ce don, elle escompte être élevée à la droite du dieu » (p. 290).
Première partie « Situation ». Chapitre VI « Situation et caractère de la femme ».
Les idées développées dans ce chapitre sont évidemment de l’ordre du constat, ce ne sont pas des mots d’ordre féministes ! « Les idoles proposées par son père, ses frères, son mari, si on les abat, elle ne pressent aucun moyen de repeupler le ciel ; elle s’acharne à les défendre. Pendant la guerre de Sécession nul parmi les sudistes n’était aussi passionnément esclavagiste que les femmes ; en Angleterre au moment de la guerre des Boers, en France contre la Commune, ce sont elles qui se montrèrent les plus enragées ; elles cherchent à compenser par l’intensité des sentiments qu’elles affichent leur inaction ; en cas de victoire, elles se déchaînent comme des hyènes sur l’ennemi abattu ; en cas de défaite, elles se refusent âprement à toute conciliation ; leurs idées n’étant que des attitudes, il leur est indifférent de défendre les causes les plus périmées : elles peuvent être légitimistes en 1914, tsaristes en 1949. L’homme parfois les encourage en souriant : il lui plaît de voir reflétées sous une forme fanatique les opinions qu’il exprime avec plus de mesure ; mais parfois aussi il s’agace de l’aspect stupide et têtu que revêtent alors ses propres idées » (p. 312).
« C’est essentiellement parce qu’elle n’a jamais éprouvé les pouvoirs de la liberté qu’elle ne croit pas à une libération : le monde lui semble régi par un obscur destin contre lequel il est présomptueux de se dresser. Ces chemins dangereux qu’on veut l’obliger à suivre, elle ne les a pas elle-même frayés : il est normal qu’elle ne s’y précipite pas avec enthousiasme. Qu’on lui ouvre l’avenir, elle ne se cramponne plus au passé. Quand on appelle concrètement les femmes à l’action, quand elles se reconnaissent dans les buts qu’on leur désigne, elles sont aussi hardies et courageuses que les hommes » (p. 314).
« Ainsi l’utilité règne au ciel de la ménagère plus haut que la vérité, la beauté, la liberté ; et c’est dans cette perspective qui est la sienne qu’elle envisage l’univers entier ; et c’est pourquoi elle adopte la morale aristotélicienne du juste-milieu, de la médiocrité. Comment trouverait-on en elle audace, ardeur, détachement, grandeur ? Ces qualités n’apparaissent qu’au cas où une liberté se jette à travers un avenir ouvert, émergeant par-delà tout donné. On enferme la femme dans une cuisine ou dans un boudoir, et on s’étonne que son horizon soit borné ; on lui coupe les ailes, et on déplore qu’elle ne sache pas voler. Qu’on lui ouvre l’avenir, elle ne sera plus obligée de s’installer dans le présent » (p. 317). Notons l’anaphore « Qu’on lui ouvre l’avenir ».
« Elle sera une chaste et fidèle épouse : et elle cédera en cachette à ses désirs ; elle sera une mère admirable : mais elle pratiquera avec soin le « birth-control » et elle se fera avorter au besoin. L’homme officiellement la désavoue, c’est la règle du jeu ; mais il est clandestinement reconnaissant à celle-ci de sa « petite vertu », à celle-là de sa stérilité. La femme a le rôle de ces agents secrets qu’on laisse fusiller s’ils se font prendre, et qu’on comble de récompenses s’ils réussissent ; à elle d’endosser toute l’immoralité des mâles : ce n’est pas seulement la prostituée, ce sont toutes les femmes qui servent d’égout au palais lumineux et sain dans lequel habitent les honnêtes gens » (p. 331).
« Récusant les principes logiques, les impératifs moraux, sceptique devant les lois de la nature, la femme n’a pas le sens de l’universel ; le monde lui apparaît comme un ensemble confus de cas singuliers ; c’est pourquoi elle croit plus facilement aux ragots d’une voisine qu’à un exposé scientifique ; sans doute elle respecte le livre imprimé, mais ce respect glisse au long des pages écrites sans en accrocher le contenu : au contraire l’anecdote racontée par un inconnu dans une queue ou dans un salon revêt aussitôt une écrasante autorité ; dans son domaine, tout est magie ; dehors, tout est mystère ; elle ne connaît pas le critérium de la vraisemblance ; seule l’expérience immédiate emporte sa conviction : sa propre expérience ou celle d’autrui, dès qu’il l’affirme avec assez de force » (p. 333). Si l’on croit Beauvoir, alors en 2020, 90 % de la population est devenu femme !
« Il y a une justification, une compensation suprême que la société s’est toujours attachée à dispenser à la femme : la religion. Il faut une religion pour les femmes comme il en faut une pour le peuple, exactement pour les mêmes raisons : quand on condamne un sexe, une classe à l’immanence, il est nécessaire de lui offrir le mirage d’une transcendance. L’homme a tout avantage à faire endosser par un Dieu les codes qu’il fabrique : et singulièrement puisqu’il exerce sur la femme une autorité souveraine, il est bon que celle-ci lui ait été conférée par l’être souverain. Entre autres chez les juifs, les mahométans, les chrétiens, l’homme est le maître par droit divin : la crainte de Dieu étouffera chez l’opprimée toute velléité de révolte. On peut miser sur sa crédulité. La femme adopte devant l’univers masculin une attitude de respect et de foi : Dieu dans son ciel lui apparaît à peine moins lointain qu’un ministre et le mystère de la genèse rejoint celui des centrales électriques. Mais surtout, si elle se jette si volontiers dans la religion, c’est que celle-ci vient combler un besoin profond. Dans la civilisation moderne qui fait – même chez la femme – sa part à la liberté, elle apparaît beaucoup moins comme un instrument de contrainte que comme un instrument de mystification. On demande moins à la femme d’accepter au nom de Dieu son infériorité que de se croire, grâce à lui, l’égale du mâle suzerain ; on supprime la tentation même d’une révolte en prétendant surmonter l’injustice. La femme n’est plus frustrée de sa transcendance puisqu’elle va destiner à Dieu son immanence ; c’est seulement au ciel que se mesurent les mérites des âmes et non d’après leurs accomplissements terrestres ; ici-bas, il n’y a jamais, selon le mot de Dostoïevski, que des occupations : cirer des souliers ou bâtir un pont, c’est la même vanité ; par-delà les discriminations sociales, l’égalité des sexes est rétablie. C’est pourquoi la petite fille et l’adolescente se jettent dans la dévotion avec une ferveur infiniment plus grande que leurs frères ; le regard de Dieu qui transcende sa transcendance humilie le garçon : il demeurera à jamais un enfant sous cette puissante tutelle, c’est une castration plus radicale que celle dont il se sent menacé par l’existence de son père. Tandis que « l’éternelle enfant » trouve son salut dans ce regard qui la métamorphose en une sœur des anges ; il annule le privilège du pénis. Une foi sincère aide beaucoup la fillette à éviter tout complexe d’infériorité ; elle n’est ni mâle ni femelle, mais une créature de Dieu » (p. 341).
Conclusion du chapitre et de la Première partie : « Elles essaient de justifier leur existence au sein de leur immanence, c’est-à-dire de réaliser la transcendance dans l’immanence. C’est cet ultime effort – parfois ridicule, souvent pathétique – de la femme emprisonnée pour convertir sa prison en un ciel de gloire, sa servitude en souveraine liberté que nous trouvons chez la narcissiste, chez l’amoureuse, chez la mystique » (p. 350).
Deuxième partie « Justifications »
Chapitre I « La narcissiste ».
Le nom « narcissiste » est assez rare, auquel on préfère « narcissique », voire « narcissien ».
« On sait, entre autres, combien les femmes sont attachées à leurs souvenirs d’enfance ; la littérature féminine en fait foi ; l’enfance n’occupe en général qu’une place secondaire dans les autobiographies masculines ; les femmes, au contraire, se bornent souvent au récit de leurs premières années ; celles-ci sont la matière privilégiée de leurs romans, de leurs contes. Une femme qui se raconte à une amie, à un amant, commence presque toutes ses histoires par ces mots : « Quand j’étais petite fille… » Elles gardent une nostalgie de cette période. C’est qu’en ce temps elles sentaient sur leur tête la main bienveillante et imposante du père tout en goûtant les joies de l’indépendance ; protégées et justifiées par les adultes, elles étaient des individus autonomes devant qui s’ouvrait un libre avenir : tandis que, maintenant, elles sont imparfaitement défendues par le mariage et l’amour et elles sont devenues des servantes ou des objets, emprisonnées dans le présent » (p. 359).
Chapitre II « L’amoureuse ».
« Des hommes ont pu être à certains moments de leur existence des amants passionnés, mais il n’en est pas un qu’on puisse définir comme « un grand amoureux » ; dans leurs emportements les plus violents, ils n’abdiquent jamais totalement ; même s’ils tombent à genoux devant leur maîtresse, ce qu’ils souhaitent encore c’est la posséder, l’annexer ; ils demeurent au cœur de leur vie comme des sujets souverains ; la femme aimée n’est qu’une valeur parmi d’autres ; ils veulent l’intégrer à leur existence, non engloutir en elle leur existence entière. Pour la femme au contraire, l’amour est une totale démission au profit d’un maître » (p. 377).
« Quand elle reçoit l’homme aimé, la femme est habitée, visitée comme la Vierge par le Saint-Esprit, comme le croyant par l’hostie ; c’est ce qui explique l’analogie obscène des cantiques pieux et des chansons grivoises : ce n’est pas que l’amour mystique ait toujours un caractère sexuel ; mais la sexualité de l’amoureuse revêt une couleur mystique. « Mon Dieu, mon adoré, mon maître… », les mêmes mots s’échappent des lèvres de la sainte agenouillée et de l’amoureuse couchée sur le lit ; l’une offre sa chair aux traits du Christ, elle tend les mains pour recevoir les stigmates, elle appelle la brûlure de l’Amour divin ; l’autre est aussi offrande et attente : traits, dard, flèches s’incarnent dans le sexe mâle. En toutes deux, c’est le même rêve, le rêve infantile, le rêve mystique, le rêve amoureux : en s’abolissant au sein de l’autre, exister souverainement » (p. 387). Cela me fait songer au personnage d’Elvire dans Dom Juan de Molière, et à ce qu’en disait Jacques Lassalle dans un documentaire réalisé par Jeanne Labrune sur sa mise en scène mémorable de 1993.
Du mysticisme, on glisse au masochisme : « C’est un lieu commun – et semble-t-il une vérité – que la prostituée est fière d’être battue par son homme : mais ce n’est pas l’idée de sa personne battue et asservie qui l’exalte, c’est la force, l’autorité, la souveraineté du mâle dont elle dépend ; elle aime aussi le voir maltraiter un autre mâle, elle l’excite souvent à des compétitions dangereuses : elle veut que son maître détienne les valeurs reconnues dans le milieu auquel elle appartient. La femme qui se soumet avec plaisir à des caprices masculins admire aussi dans la tyrannie qui s’exerce sur elle l’évidence d’une liberté souveraine. Il faut prendre garde que si pour quelque raison le prestige de l’amant s’est trouvé ruiné, les coups et les exigences deviendront odieux : ils n’ont de prix que s’ils manifestent la divinité du bien-aimé. En ce cas, c’est une joie enivrante que de se sentir la proie d’une liberté étrangère : c’est pour un existant la plus surprenante aventure que de se trouver fondé par la volonté diverse et impérieuse d’un autre ; on se fatigue d’habiter toujours la même peau ; l’obéissance aveugle est la seule chance de changement radical que puisse connaître un être humain. Voilà la femme esclave, reine, fleur, biche, vitrail, paillasson, servante, courtisane, muse, compagne, mère, sœur, enfant selon les rêves fugaces, les ordres impérieux de l’amant : elle se plie avec ravissement à ces métamorphoses tant qu’elle n’a pas reconnu qu’elle gardait toujours sur ses lèvres le goût identique de la soumission. Sur le plan de l’amour comme sur celui de l’érotisme, il nous apparaît que le masochisme est un des chemins dans lesquels s’engage la femme insatisfaite, déçue par l’autre et par soi-même ; mais ce n’est pas la pente naturelle d’une démission heureuse. Le masochisme perpétue la présence du moi sous une figure meurtrie, déchue ; l’amour vise à l’oubli de soi en faveur du sujet essentiel » (p. 391).
« L’homme amoureux est autoritaire : mais quand il a obtenu ce qu’il voulait, il est satisfait ; tandis qu’il n’y a pas de limites au dévouement exigeant de la femme. Un amant qui a confiance en sa maîtresse accepte sans déplaisir qu’elle s’absente, qu’elle s’occupe loin de lui : sûr qu’elle lui appartient, il aime mieux posséder une liberté qu’une chose. Au contraire, l’absence de l’amant est toujours pour la femme une torture : il est un regard, un juge, dès qu’il fixe ses yeux sur autre chose qu’elle, il la frustre ; tout ce qu’il voit, il le lui vole ; loin de lui, elle est dépossédée à la fois d’elle-même et du monde ; même assis à ses côtés, lisant, écrivant, il l’abandonne, il la trahit. Elle hait son sommeil » (p. 397).
Chapitre III « La mystique ».
« L’amour a été assigné à la femme comme sa suprême vocation et, quand elle l’adresse à un homme, en lui elle recherche Dieu : si les circonstances lui interdisent l’amour humain, si elle est déçue ou exigeante, c’est en Dieu même qu’elle choisira d’adorer la divinité. Certes, il y a eu des hommes qui ont aussi brûlé de cette flamme ; mais ils sont rares et leur ferveur revêtait une figure intellectuelle fort épurée. Au lieu que les femmes qui s’abandonnent aux délices des épousailles célestes sont légion : et elles les vivent d’une manière étrangement affective. La femme est accoutumée à vivre à genoux ; normalement, elle attend que son salut descende du ciel où trônent les mâles ; eux aussi sont enveloppés de nuées : c’est par-delà les voiles de leur présence charnelle que leur majesté se révèle. L’Aimé est toujours plus ou moins absent ; il communique avec son adoratrice par des signes ambigus ; elle ne connaît son cœur que par un acte de foi ; et plus il lui apparaît comme supérieur, plus ses conduites lui semblent impénétrables. On a vu que dans l’érotomanie cette foi résistait à tous les démentis. La femme n’a pas besoin de voir ni de toucher pour sentir à ses côtés la Présence. Qu’il s’agisse d’un médecin, d’un prêtre ou de Dieu, elle connaîtra les mêmes incontestables évidences, elle accueillera en esclave dans son cœur les flots d’un amour qui tombe d’en haut. Amour humain, amour divin se confondent, non parce que celui-ci serait une sublimation de celui-là, mais parce que le premier est aussi un mouvement vers un transcendant, vers l’absolu. Il s’agit en tout cas pour l’amoureuse de sauver son existence contingente en l’unissant au Tout incarné en une Personne souveraine.
Cette équivoque est flagrante dans de nombreux cas – pathologiques ou normaux – où l’amant est divinisé, où Dieu revêt des traits humains » (p. 416).
Troisième partie « Vers la libération »
Chapitre I « La femme indépendante ».
« Le code français ne range plus l’obéissance au nombre des devoirs de l’épouse et chaque citoyenne est devenue une électrice ; ces libertés civiques demeurent abstraites quand elles ne s’accompagnent pas d’une autonomie économique ; la femme entretenue – épouse ou courtisane – n’est pas affranchie du mâle parce qu’elle a dans les mains un bulletin de vote ; si les mœurs lui imposent moins de contraintes qu’autrefois, ces licences négatives n’ont pas modifié profondément sa situation ; elle reste enfermée dans sa condition de vassale. C’est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle ; c’est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Dès qu’elle cesse d’être un parasite, le système fondé sur sa dépendance s’écroule ; entre elle et l’univers il n’est plus besoin d’un médiateur masculin. La malédiction qui pèse sur la femme vassale, c’est qu’il ne lui est permis de rien faire : alors, elle s’entête dans l’impossible poursuite de l’être à travers le narcissisme, l’amour, la religion ; productrice, active, elle reconquiert sa transcendance ; dans ses projets elle s’affirme concrètement comme sujet ; par son rapport avec le but qu’elle poursuit, avec l’argent et les droits qu’elle s’approprie, elle éprouve sa responsabilité. Beaucoup de femmes ont conscience de ces avantages, même parmi celles qui exercent les métiers les plus modestes. J’ai entendu une femme de journée, en train de laver le carreau d’un hall d’hôtel, qui déclarait : « Je n’ai jamais rien demandé à personne. Je suis arrivée toute seule » (p. 431).
Et voici un morceau d’anthologie, que j’ai eu l’occasion de traiter avec des élèves de lycée, mais je ne me souviens pas à quelle occasion ! « Le privilège que l’homme détient et qui se fait sentir dès son enfance, c’est que sa vocation d’être humain ne contrarie pas sa destinée de mâle. Par l’assimilation du phallus et de la transcendance, il se trouve que ses réussites sociales ou spirituelles le douent d’un prestige viril. Il n’est pas divisé. Tandis qu’il est demandé à la femme pour accomplir sa féminité de se faire objet et proie, c’est-à-dire de renoncer à ses revendications de sujet souverain. C’est ce conflit qui caractérise singulièrement la situation de la femme affranchie. Elle refuse de se cantonner dans son rôle de femelle parce qu’elle ne veut pas se mutiler ; mais ce serait aussi une mutilation de répudier son sexe. L’homme est un être humain sexué ; la femme n’est un individu complet, et l’égale du mâle, que si elle est aussi un être humain sexué. Renoncer à sa féminité, c’est renoncer à une part de son humanité. Les misogynes ont souvent reproché aux femmes de tête de « se négliger » ; mais ils leur ont aussi prêché : Si vous voulez être nos égales, cessez de vous peindre la figure et de vernir vos ongles. Ce dernier conseil est absurde. Précisément parce que l’idée de féminité est définie artificiellement par les coutumes et les modes, elle s’impose du dehors à chaque femme ; elle peut évoluer de manière que ses canons se rapprochent de ceux adoptés par les mâles : sur les plages, le pantalon est devenu féminin. Cela ne change rien au fond de la question : l’individu n’est pas libre de la modeler à sa guise. Celle qui ne s’y conforme pas se dévalue sexuellement et par conséquent socialement, puisque la société a intégré les valeurs sexuelles. En refusant des attributs féminins, on n’acquiert pas des attributs virils ; même la travestie ne réussit pas à faire d’elle-même un homme : c’est une travestie. On a vu que l’homosexualité constitue elle aussi une spécification : la neutralité est impossible. Il n’est aucune attitude négative qui n’implique une contrepartie positive. L’adolescente croit souvent qu’elle peut simplement mépriser les conventions ; mais par là même elle manifeste ; elle crée une situation nouvelle entraînant des conséquences qu’il lui faudra assumer. Dès qu’on se soustrait à un code établi on devient un insurgé. Une femme qui s’habille de manière extravagante ment quand elle affirme avec un air de simplicité qu’elle suit son bon plaisir, rien de plus : elle sait parfaitement que suivre son bon plaisir est une extravagance. Inversement, celle qui ne souhaite pas faire figure d’excentrique se conforme aux règles communes. À moins qu’il ne représente une action positivement efficace, c’est un mauvais calcul que de choisir le défi : on y consume plus de temps et de forces qu’on n’en économise. Une femme qui ne désire pas choquer, qui n’entend pas socialement se dévaluer doit vivre en femme sa condition de femme : très souvent sa réussite professionnelle même l’exige. Mais tandis que le conformisme est pour l’homme tout naturel – la coutume s’étant réglée sur ses besoins d’individu autonome et actif -, il faudra que la femme qui est elle aussi sujet, activité, se coule dans un monde qui l’a vouée à la passivité. C’est une servitude d’autant plus lourde que les femmes confinées dans la sphère féminine en ont hypertrophié l’importance : de la toilette, du ménage, elles ont fait des arts difficiles. L’homme n’a guère à se soucier de ses vêtements ; ils sont commodes, adaptés à sa vie active, il n’est pas besoin qu’ils soient recherchés ; à peine font-ils partie de sa personnalité ; en outre, nul ne s’attend qu’il les entretienne lui-même : quelque femme bénévole ou rémunérée le décharge de ce soin. La femme au contraire sait que quand on la regarde on ne la distingue pas de son apparence : elle est jugée, respectée, désirée à travers sa toilette. Ses vêtements ont été primitivement destinés à la vouer à l’impotence et ils sont demeurés fragiles : les bas se déchirent ; les talons s’éculent, les blouses et les robes claires se salissent, les plissés se déplissent ; cependant, elle devra réparer elle-même la plupart de ces accidents ; ses semblables ne viendront pas bénévolement à son secours et elle aura scrupule à grever encore son budget pour des travaux qu’elle peut exécuter elle-même : les permanentes, mises en plis, fards, robes neuves coûtent déjà assez cher. Quand elles rentrent le soir, la secrétaire, l’étudiante ont toujours un bas à remailler, une blouse à laver, une jupe à repasser. La femme qui gagne largement sa vie s’épargnera ces corvées mais elle sera astreinte à une élégance plus compliquée, elle perdra du temps en courses, essayages, etc. La tradition impose aussi à la femme, même célibataire, un certain souci de son intérieur ; un fonctionnaire nommé dans une ville nouvelle habite facilement l’hôtel ; sa collègue cherchera à s’installer un « chez-soi » ; elle devra l’entretenir avec scrupule car on n’excuserait pas chez elle une négligence qu’on trouverait naturelle chez un homme. Ce n’est pas d’ailleurs le seul souci de l’opinion qui l’incite à consacrer du temps et des soins à sa beauté, à son ménage. Elle désire pour sa propre satisfaction demeurer une vraie femme. Elle ne réussit à s’approuver à travers le présent et le passé qu’en cumulant la vie qu’elle s’est faite avec la destinée que sa mère, que ses jeux d’enfants et ses fantasmes d’adolescente lui avaient préparée. Elle a nourri des rêves narcissistes ; à l’orgueil phallique du mâle, elle continue à opposer le culte de son image ; elle veut s’exhiber, charmer. Sa mère, ses aînées lui ont insufflé le goût du nid : un intérieur à elle, ç’a été la forme primitive de ses rêves d’indépendance ; elle n’entend pas les renier même quand elle a trouvé la liberté sur d’autres chemins. Et dans la mesure où elle se sent encore mal assurée dans l’univers masculin, elle garde le besoin d’une retraite, symbole de ce refuge intérieur qu’elle a été habituée à chercher en soi-même. Docile à la tradition féminine, elle cirera ses parquets, elle fera elle-même sa cuisine, au lieu d’aller, comme son collègue, manger au restaurant. Elle veut vivre à la fois comme un homme et comme une femme : par là elle multiplie ses tâches et ses fatigues » (pp. 435-438).
« Une femme qui se dépense, qui a des responsabilités, qui connaît l’âpreté de la lutte contre les résistances du monde, a besoin – comme le mâle – non seulement d’assouvir ses désirs physiques mais de connaître la détente, la diversion, qu’apportent d’heureuses aventures sexuelles. Or, il y a encore des milieux où cette liberté ne lui est pas concrètement reconnue ; elle risque, si elle en use, de compromettre sa réputation, sa carrière ; du moins réclame-t-on d’elle une hypocrisie qui lui pèse. Plus elle a réussi à s’imposer socialement, plus on fermera volontiers les yeux ; mais, en province surtout, elle est dans la plupart des cas sévèrement épiée. Même dans les circonstances les plus favorables – quand la crainte de l’opinion ne joue plus – sa situation n’est pas équivalente ici à celle de l’homme. Les différences proviennent à la fois de la tradition et des problèmes que pose la nature singulière de l’érotisme féminin.
L’homme peut facilement connaître des étreintes sans lendemain qui suffisent à la rigueur à calmer sa chair et à le détendre moralement. Il y eu des femmes – en petit nombre – pour réclamer que l’on ouvrît des bordels pour femmes ; dans un roman intitulé le Numéro 17, une femme proposait qu’on créât des maisons où les femmes pourraient aller se faire « soulager sexuellement » par des sortes de « taxi-boys ». Il paraît qu’un établissement de ce genre exista naguère à San Francisco ; seules le fréquentaient les filles de bordel, tout amusées de payer au lieu de se faire payer : leurs souteneurs le firent fermer. Outre que cette solution est utopique et peu souhaitable, elle aurait sans doute peu de succès : on a vu que la femme n’obtenait pas un « soulagement » aussi mécaniquement que l’homme ; la plupart estimeraient la situation peu propice à un abandon voluptueux. En tout cas, le fait est que cette ressource leur est aujourd’hui refusée. La solution qui consiste à ramasser dans la rue un partenaire d’une nuit ou d’une heure – à supposer que la femme douée d’un fort tempérament, ayant surmonté toutes ses inhibitions, l’envisage sans dégoût – est beaucoup plus dangereuse pour elle que pour le mâle » (p. 441).
« La femme qui conquiert une indépendance virile a le grand privilège d’avoir affaire sexuellement à des individus eux-mêmes autonomes et actifs qui – généralement – ne joueront pas dans sa vie un rôle de parasite, qui ne l’enchaîneront pas par leur faiblesse et l’exigence de leurs besoins. Seulement rares sont en vérité les femmes qui savent créer avec leur partenaire un libre rapport ; elles se forgent elles-mêmes les chaînes dont il ne souhaite pas les charger : elles adoptent à son égard l’attitude de l’amoureuse. Pendant vingt ans d’attente, de rêve, d’espoir, la jeune fille a caressé le mythe du héros libérateur et sauveur : l’indépendance conquise dans le travail ne suffit pas à abolir son désir d’une abdication glorieuse. Il faudrait qu’elle eût été élevée exactement comme un garçon pour pouvoir surmonter aisément le narcissisme de l’adolescence : mais elle perpétue dans sa vie d’adulte ce culte du moi auquel toute sa jeunesse l’a inclinée ; de ses réussites professionnelles, elle fait des mérites dont elle enrichit son image ; elle a besoin qu’un regard venu d’en haut révèle et consacre sa valeur. Même si elle est sévère pour les hommes dont elle prend quotidiennement la mesure, elle n’en révère pas moins l’Homme et, si elle le rencontre, elle est prête à tomber à ses genoux » (p. 453).
« C’est à cause de la tension morale dont j’ai parlé, à cause de toutes les tâches qu’elles assument, des contradictions au milieu desquelles elles se débattent que les femmes sont sans cesse harassées, à la limite de leurs forces ; ceci ne signifie pas que leurs maux soient imaginaires : ils sont réels et dévorants comme la situation qu’ils expriment. Mais la situation ne dépend pas du corps, c’est lui qui dépend d’elle. Ainsi, la santé de la femme ne nuira pas à son travail quand la travailleuse aura dans la société la place qu’il lui faut ; au contraire, le travail aidera puissamment à son équilibre physique en lui interdisant de s’en préoccuper sans cesse » (p. 456).
Voici la femme artiste sur le tard : « C’est souvent au moment de la ménopause que la femme, pour compenser les failles de son existence, se jette sur le pinceau ou sur la plume : il est bien tard ; faute d’une formation sérieuse, elle ne sera jamais qu’un amateur. Même si elle commence assez jeune, il est rare qu’elle envisage l’art comme un sérieux travail ; habituée à l’oisiveté, n’ayant jamais éprouvé dans sa vie l’austère nécessité d’une discipline, elle ne sera pas capable d’un effort soutenu et persévérant, elle ne s’astreindra pas à acquérir une solide technique ; elle répugne aux tâtonnements ingrats solitaires du travail qu’on ne montre pas, qu’il faut cent fois détruire et reprendre ; et comme dès son enfance en lui enseignant à plaire on lui a appris à tricher, elle espère se tirer d’affaire par quelques ruses » (p. 468).
« Elles se sont toujours considérées comme données ; elles croient que leurs mérites viennent d’une grâce qui les habite et n’imaginent pas que la valeur puisse se conquérir ; pour séduire, elles ne savent que se manifester : leur charme agit ou n’agit pas, elles n’ont aucune prise sur sa réussite ou son échec ; elles supposent que d’une manière analogue il suffit pour s’exprimer de montrer ce qu’on est ; au lieu d’élaborer leur œuvre par un travail réfléchi, elles font confiance à leur spontanéité ; écrire ou sourire, pour elles c’est tout un : elles tentent leur chance, le succès viendra ou ne viendra pas. Sûres d’elles-mêmes, elles escomptent que le livre ou le tableau se trouvera réussi sans effort ; timides, la moindre critique les décourage ; elles ignorent que l’erreur peut ouvrir le chemin du progrès, elles la tiennent pour une catastrophe irréparable, au même titre qu’une malformation » (p. 468).
Conclusion
« La dispute durera tant que les hommes et les femmes ne se reconnaîtront pas comme des semblables, c’est-à-dire tant que se perpétuera la féminité en tant que telle ; des uns et des autres qui est le plus acharné à la maintenir ? La femme qui s’en affranchit veut néanmoins en conserver les prérogatives ; et l’homme réclame qu’alors elle en assume les limitations. […] Mais il est lui-même esclave de son double : quel travail pour édifier une image dans laquelle il est toujours en danger ! Elle est malgré tout fondée sur la capricieuse liberté des femmes : il faut sans cesse se rendre celle-ci propice ; l’homme est rongé par le souci de se montrer mâle, important, supérieur ; il joue des comédies afin qu’on lui en joue ; il est lui aussi agressif, inquiet ; il a de l’hostilité pour les femmes parce qu’il a peur d’elles, et il a peur d’elles parce qu’il a peur du personnage avec lequel il se confond. Que de temps et de forces il gaspille à liquider, sublimer, transposer des complexes, à parler des femmes, à les séduire, à les craindre ! On le libérerait en les libérant. Mais c’est précisément ce qu’il redoute. Et il s’entête dans les mystifications destinées à maintenir la femme dans ses chaînes » (p. 486-7).
On relève une brève envolée gauchiste : « En France, aussi, on a souvent proclamé – quoique de manière moins scientifique – que les ouvriers avaient bien de la chance de n’être pas obligés de « représenter », et davantage encore les clochards qui peuvent se vêtir de haillons et se coucher sur les trottoirs, plaisirs interdits au comte de Beaumont et à ces pauvres messieurs de Wendel. Tels les pouilleux insouciants qui grattent allègrement leur vermine, tels les joyeux nègres riant sous les coups de chicote et ces gais Arabes du Sous qui enterrent leurs enfants morts de faim avec le sourire aux lèvres, la femme jouit de cet incomparable privilège : l’irresponsabilité. Sans peine, sans charge, sans souci, elle a manifestement « la meilleure part ». Ce qui est troublant c’est que par une perversité entêtée – liée sans doute au péché originel – à travers siècles et pays les gens qui ont la meilleure part crient toujours à leurs bienfaiteurs : C’est trop ! Je me contenterai de la vôtre ! Mais les capitalistes magnifiques, les généreux colons, les mâles superbes s’entêtent : Gardez la meilleure part, gardez-la ! » (p. 489).
« Il faut que la femme comprenne que les échanges – c’est une loi fondamentale de l’économie politique – se règlent selon la valeur que la marchandise offerte revêt pour l’acheteur, et non pour le vendeur : on l’a trompée en la persuadant qu’elle possédait un prix infini ; en vérité elle est pour l’homme seulement une distraction, un plaisir, une compagnie, un bien inessentiel ; il est le sens, la justification de son existence à elle ; l’échange ne se fait donc pas entre deux objets de même qualité ; cette inégalité va se marquer singulièrement dans le fait que le temps qu’ils passent ensemble – et qui paraît fallacieusement le même temps – n’a pas pour les deux partenaires la même valeur ; pendant la soirée que l’amant passe avec sa maîtresse il pourrait faire un travail utile à sa carrière, voir des amis, cultiver des relations, se distraire ; pour un homme normalement intégré à la société, le temps est une richesse positive : argent, réputation, plaisir. Au contraire, pour la femme oisive, qui s’ennuie, c’est une charge dont elle n’aspire qu’à se débarrasser ; dès qu’elle réussit à tuer des heures, elle fait un bénéfice : la présence de l’homme est un pur profit ; en de nombreux cas, ce qui intéresse le plus clairement l’homme dans une liaison, c’est le gain sexuel qu’il en tire : à la limite, il peut se contenter de passer tout juste avec sa maîtresse le temps nécessaire à perpétrer l’acte amoureux ; mais – sauf exception – ce qu’elle souhaite quant à elle c’est d’« écouler » tout cet excès de temps dont elle ne sait que faire : et – comme le marchand qui ne vend des pommes de terre que si on lui « prend » des navets – elle ne cède son corps que si l’amant « prend » par-dessus le marché des heures de conversation et de sortie. L’équilibre réussit à s’établir si le coût de l’ensemble ne paraît pas à l’homme trop élevé : cela dépend bien entendu de l’intensité de son désir et de l’importance qu’ont à ses yeux les occupations qu’il sacrifie ; mais si la femme réclame – offre – trop de temps, elle devient tout entière importune, comme la rivière qui sort de son lit, et l’homme choisira de n’en rien avoir plutôt que d’en avoir trop » (p. 491).
« Si dès l’âge le plus tendre la fillette était élevée avec les mêmes exigences et les mêmes honneurs, les mêmes sévérités et les mêmes licences que ses frères, participant aux mêmes études, aux mêmes jeux, promise à un même avenir, entourée de femmes et d’hommes qui lui apparaîtraient sans équivoque comme des égaux, le sens du « complexe de castration » et celui du « complexe d’Œdipe » seraient profondément modifiés. Assumant au même titre que le père la responsabilité matérielle et morale du couple, la mère jouirait du même durable prestige ; l’enfant sentirait autour d’elle un monde androgyne et non un monde masculin ; fût-elle affectivement plus attirée par son père – ce qui n’est pas même sûr –, son amour pour lui serait nuancé par une volonté d’émulation et non par un sentiment d’impuissance : elle ne s’orienterait pas vers la passivité ; autorisée à prouver sa valeur dans le travail et le sport, rivalisant activement avec les garçons, l’absence de pénis – compensée par la promesse de l’enfant – ne suffirait pas à engendrer un « complexe d’infériorité » ; corrélativement, le garçon n’aurait pas spontanément un « complexe de supériorité » si on ne le lui insufflait pas et s’il estimait les femmes autant que les hommes. La fillette ne chercherait donc pas de stériles compensations dans le narcissisme et le rêve, elle ne se prendrait pas pour donnée, elle s’intéresserait à ce qu’elle fait, elle s’engagerait sans réticence dans ses entreprises. J’ai dit combien sa puberté serait plus facile si elle la dépassait, comme le garçon, vers un libre avenir d’adulte ; la menstruation ne lui inspire tant d’horreur que parce qu’elle constitue une chute brutale dans la féminité ; elle assumerait aussi bien plus tranquillement son jeune érotisme si elle n’éprouvait pas un dégoût effaré pour l’ensemble de son destin ; un enseignement sexuel cohérent l’aiderait beaucoup à surmonter cette crise. Et grâce à l’éducation mixte, le mystère auguste de l’Homme n’aurait pas l’occasion de naître : il serait tué par la familiarité quotidienne et les franches compétitions. Les objections qu’on oppose à ce système impliquent toujours le respect des tabous sexuels ; mais il est vain de prétendre inhiber chez l’enfant la curiosité et le plaisir ; on n’aboutit qu’à créer des refoulements, des obsessions, des névroses ; la sentimentalité exaltée, les ferveurs homosexuelles, les passions platoniques des adolescentes avec tout leur cortège de niaiserie et de dissipation sont bien plus néfastes que quelques jeux enfantins et quelques précises expériences. Ce qui serait surtout profitable à la jeune fille, c’est que ne cherchant pas dans le mâle un demi-dieu – mais seulement un camarade, un ami, un partenaire – elle ne serait pas détournée d’assumer elle-même son existence ; l’érotisme ; l’amour prendraient le caractère d’un libre dépassement et non celui d’une démission ; elle pourrait les vivre comme un rapport d’égal à égal » (p. 497).
Quant à cette sortie altersexuelle en avance sur son temps, il faudrait la graver en lettres d’or bien au-dessus de tous les « #MeToo » et les mythos du féminisme misandre (j’ai mis en gras une phrase que j’adore) : « Revendiquant leur dignité d’être humain, beaucoup de femmes modernes saisissent encore leur vie érotique à partir d’une tradition d’esclavage : aussi leur paraît-il humiliant d’être couchées sous l’homme, pénétrées par lui et elles se crispent dans la frigidité ; mais si la réalité était différente, le sens qu’expriment symboliquement gestes et postures amoureux le seraient aussi : une femme qui paie, qui domine son amant peut par exemple se sentir fière de sa superbe oisiveté et considérer qu’elle asservit le mâle qui activement se dépense ; et il existe d’ores et déjà quantité de couples sexuellement équilibrés où les notions de victoire et de défaite font place à une idée d’échange. En vérité, l’homme est comme la femme une chair, donc une passivité, jouet de ses hormones et de l’espèce, proie inquiète de son désir ; et elle est comme lui au sein de la fièvre charnelle consentement, don volontaire, activité ; ils vivent chacun à sa manière l’étrange équivoque de l’existence faite corps. Dans ces combats où ils croient s’affronter l’un l’autre, c’est contre soi que chacun lutte, projetant en son partenaire cette part de lui-même qu’il répudie ; au lieu de vivre l’ambiguïté de sa condition, chacun s’efforce d’en faire supporter par l’autre l’abjection et de s’en réserver l’honneur. Si cependant tous deux l’assumaient avec une lucide modestie, corrélative d’un authentique orgueil, ils se reconnaîtraient comme des semblables et vivraient en amitié le drame érotique. Le fait d’être un être humain est infiniment plus important que toutes les singularités qui distinguent les êtres humains ; ce n’est jamais le donné qui confère des supériorités : la « vertu » comme l’appelaient les anciens se définit au niveau de « ce qui dépend de nous ». Dans les deux sexes se joue le même drame de la chair et de l’esprit, de la finitude et de la transcendance ; les deux sont rongés par le temps, guettés par la mort, ils ont un même essentiel besoin de l’autre ; et ils peuvent tirer de leur liberté la même gloire ; s’ils savaient la goûter, ils ne seraient plus tentés de se disputer de fallacieux privilèges ; et la fraternité pourrait alors naître entre eux » (p. 499).
– Retour à l’article consacré au tome 1, et à celui consacré à « La femme mariée », chapitre I du tome 2.
Voir en ligne : « Le Deuxième Sexe » en héritage, par Sylvie Chaperon
© altersexualite.com 2021
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com