Accueil > Classiques > XIXe siècle > Au Soleil, de Guy de Maupassant
Maupassant, les Arabes, les homos, les juifs… pour le lycée
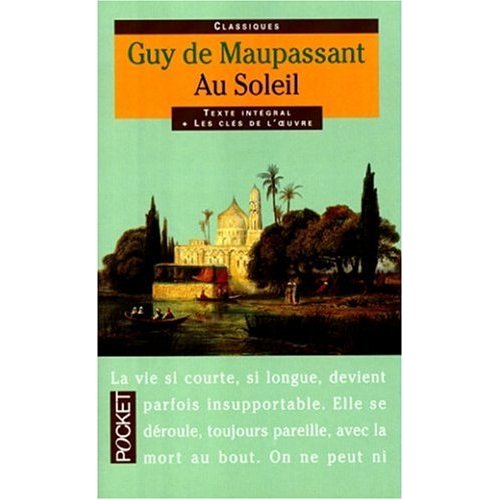 Au Soleil, de Guy de Maupassant
Au Soleil, de Guy de Maupassant
Pocket, édition de Gérard Gengembre (1998), 230 p. (épuisé)
dimanche 2 décembre 2007
Les nombreuses citations de Maupassant dans La Comédie indigène, de Lotfi Achour, qui soulignent l’aspect raciste de sa pensée, m’ont donné envie d’y voir de plus près, d’autant plus que l’aspect altersexuel de ses nouvelles, qui ressort par exemple de Miss Harriet, me semblait contradictoire avec ses sorties racistes autant qu’homophobes. Ce recueil d’articles publié en 1884 contient 9 textes sur l’Algérie, issus de reportages publiés dans la presse en 1881, suivis de 3 textes sur la province française, qui n’ont rien à voir. Maupassant était parti enquêter suite à la révolte de Bouamama. Les éditeurs actuels feraient mieux de proposer une compilation de ces textes avec les quelques nouvelles de l’auteur dont l’action se passe au Maroc, ou qui mettent en scène des personnages d’origine africaine. Un livre a été publié en 1988 par Denise Brahimi sous le titre « Écrits sur le Maghreb », mais il est épuisé. On trouvera tous ces textes numérisés sur ce site.
Gérard Gengembre, auteur de la préface et des notes de cette édition Pocket, elle aussi épuisée [1], corrobore la vision de Lotfi Achour : selon lui, Maupassant « entreprend un parcours de régénération par retour – et non pas régression – à l’état primitif, une cure de primitivité en quelque sorte » (p. 8) ; « À la rencontre d’un autre monde, l’observateur jouisseur peut libérer en lui la part primitive, les racines les plus profondes » (p. 11). Cependant il est moins sévère pour le sens à donner au texte. Que ce soit sur les Arabes ou les juifs, les pages qui sont à première vue racistes doivent être interprétées selon le préfacier en tenant compte du « contexte d’une époque engoncée dans ses certitudes, et pour qui le mot « race » va de soi » (p. 14).
« Tout logis qu’on habite longtemps devient prison ! Oh ! fuir, partir ! fuir les lieux connus, les hommes, les mouvements pareils aux mêmes heures, et les mêmes pensées, surtout ! […] Moi, je me sentais attiré vers l’Afrique par un impérieux besoin, par la nostalgie du Désert ignoré, comme par le pressentiment d’une passion qui va naître » (p. 26). Voilà comment commence « Au Soleil ». « Alger » donne une clé d’interprétation des propos à venir : « C’est nous qui avons l’air de barbares au milieu de ces barbares, brutes il est vrai, mais qui sont chez eux, et à qui les siècles ont appris des coutumes dont nous semblons n’avoir pas encore compris le sens. […] Or nous sommes restés des conquérants brutaux, maladroits, infatués de nos idées toutes faites. Nos mœurs imposées, nos maisons parisiennes, nos usages choquent sur ce sol comme des fautes grossières d’art, de sagesse et de compréhension. Tout ce que nous faisons semble un contresens, un défi à ce pays, non pas tant à ses habitants premiers qu’à la terre elle-même. » (p. 33). De même dans « Bou-Amama » : « Notre système de colonisation consistant à ruiner l’Arabe, à le dépouiller sans repos, à le poursuivre sans merci et à le faire crever de misère, nous verrons encore d’autres insurrections » (p. 44). Enfin, dans La Kabylie – Bougie, un passage typique de la position complexe de l’auteur : « Enfin, pour résumer la question de la colonisation, le gouvernement, afin de favoriser l’établissement des Européens, emploie vis-à-vis des Arabes, des moyens absolument iniques. Comment les colons ne suivraient-ils pas un exemple qui concorde si bien avec leurs intérêts ? Il faut constater cependant que, depuis quelques années, des hommes fort capables, très experts dans toutes les questions de culture, semblent avoir fait entrer la colonie dans une voie sensiblement meilleure. L’Algérie devient productive sous les efforts des derniers venus. La population qui se forme ne travaille plus seulement pour des intérêts personnels, mais aussi pour les intérêts français.
Il est certain que la terre, entre les mains de ces hommes, donnera ce qu’elle n’aurait jamais donné entre les mains des Arabes ; il est certain aussi que la population primitive disparaîtra peu à peu ; il est indubitable que cette disparition sera fort utile à l’Algérie, mais il est révoltant qu’elle ait lieu dans les conditions où elle s’accomplit » (p. 124).
Des mœurs bizarres
Province d’Alger propose une vision du ramadan un peu caustique : « Les hommes, les femmes, les garçons à partir de quinze ans, les filles dès qu’elles sont nubiles, c’est-à-dire entre onze et treize ans environ, demeurent le jour entier sans manger ni boire. Ne pas manger n’est rien ; mais s’abstenir de boire est horrible par ces effrayantes chaleurs. Dans ce carême, il n’est point de dispense. Personne, d’ailleurs, n’oserait en demander ; et les filles publiques elles-mêmes, les Oulad-Naïl, qui fourmillent dans tous les centres arabes et dans les grandes oasis, jeûnent comme les marabouts, peut-être plus que les marabouts. Et ceux-là des Arabes qu’on croyait civilisés, qui se montrent en temps ordinaire disposés à accepter nos mœurs, à partager nos idées, à seconder notre action, redeviennent tout à coup, dès que le ramadan commence, sauvagement fanatiques et stupidement fervents.
Il est facile de comprendre quelle furieuse exaltation résulte, pour ces cerveaux bornés et obstinés, de cette dure pratique religieuse. Tout le jour, ces malheureux méditent, l’estomac tiraillé, regardant passer les roumis conquérants, qui mangent, boivent et fument devant eux. Et ils se répètent que, s’ils tuent un de ces roumis pendant le ramadan, ils vont droit au ciel, que l’époque de notre domination touche à sa fin, car leurs marabouts leur promettent sans cesse qu’ils vont nous jeter tous à la mer à coups de matraque » (p. 53). Mais deux pages plus loin : « Un indéfinissable sentiment de respect, mêlé de pitié, vous prend devant ces fanatiques maigres, qui n’ont point de ventre pour gêner leurs souples prosternations, et qui font de la religion avec le mécanisme et la rectitude des soldats prussiens faisant la manœuvre. »
Dans « Le Zar’ez », Maupassant s’émerveille d’une différence de conception de l’éducation des enfants : « Alors je vis s’approcher un enfant d’une douzaine d’années, un peu grêle, mais d’une grâce fière et charmante, que j’avais déjà remarqué quelques jours auparavant au milieu des Oulad-Naïl dans le café maure de Boukhrari.
J’avais été frappé par la finesse et l’éclatante blancheur de vêtements de ce frêle petit Arabe, par son allure noble, et par le respect que chacun semblait lui témoigner ; et, comme je m’étonnais qu’on le laissât ainsi rôder, à cet âge, au milieu des courtisanes, on me répondit :
— C’est le plus jeune fils du bach’agha. Il vient ici pour apprendre la vie et connaître les femmes !!!
Comme nous voici loin de nos mœurs françaises ! » (p. 72).
Dans « Constantine », ce sont les petites filles qui attisent sa curiosité : « Mais la gaieté de Constantine, c’est le peuple mignon des petites filles, des toutes petites. Attifées comme pour une fête costumée, vêtues de robes traînantes de soie bleue ou rouge, portant sur la tête de longs voiles d’or ou d’argent, les sourcils peints, allongés comme un arc au-dessus des deux yeux, les ongles teints, les joues et le front parfois tatoués d’une étoile, le regard hardi et déjà provocant, attentives aux admirations, elles trottinent, donnant la main à quelque grand Arabe, leur serviteur.
On dirait quelque nation de conte de fée, une nation de petites femmes galantes ; car elles ont l’air femme, ces fillettes, femmes par leur toilette, par leur coquetterie éveillée déjà, par les apprêts de leur visage. Elles appellent de l’œil, comme les grandes ; elles sont charmantes, inquiétantes, et irritantes comme des monstres adorables. On dirait un pensionnat de courtisanes de dix ans de la graine d’amour qui vient d’éclore. »
Quelques notations sans nuances : « Qui dit Arabe dit voleur, sans exception » (p. 74) ; « Les Arabes passent, toujours errants, sans attaches, sans tendresse pour cette terre que nous possédons, que nous rendons féconde, que nous aimons avec les fibres de notre cœur humain ; ils passent au galop de leurs chevaux, inhabiles à tous nos travaux, indifférents à nos soucis, comme s’ils allaient toujours quelque part où ils n’arriveront jamais.
Leurs coutumes sont restées rudimentaires. Notre civilisation glisse sur eux sans les effleurer. » (p. 77). « Ils apportent des réclamations invraisemblables, car nul peuple n’est chicanier, querelleur, plaideur et vindicatif comme le peuple arabe. Quant à savoir la vérité, quant à rendre un jugement équitable, il est absolument inutile d’y songer. Chaque partie amène un nombre fantastique de faux témoins qui jurent sur les cendres de leurs pères et mères, et affirment sous serment les mensonges les plus effrontés » (p. 79).
Toujours dans « Le Zar’ez », la femme arabe : « La femme arabe, en général, est petite, blanche comme du lait, avec une physionomie de jeune mouton. Elle n’a de pudeur que pour son visage. On rencontre celles du peuple allant au travail la figure voilée avec soin, mais le corps couvert seulement de deux bandes de laine tombant l’une par devant, l’autre par derrière, et laissant voir, de profil, toute la personne.
À quinze ans, ces misérables, qui seraient jolies, sont déformées, épuisées par les dures besognes. Elles peinent du matin au soir à toutes les fatigues, vont chercher l’eau à plusieurs kilomètres avec un enfant sur le dos. Elles semblent vieilles à vingt-cinq ans.
Leur visage, qu’on aperçoit parfois, est tatoué d’étoiles bleues sur le front, les joues et le menton. Le corps est épilé, par mesure de propreté. Il est fort rare d’apercevoir les femmes des Arabes riches. » (p. 97).
Juifs et Mozabites
Dans « Le Zar’ez » encore : « Les Mozabites et les Juifs sont les seuls marchands, les seuls négociants, les seuls êtres industrieux de toute cette partie de l’Afrique.
Dès qu’on avance dans le sud, la race juive se révèle sous un aspect hideux qui fait comprendre la haine féroce de certains peuples contre ces gens, et même les massacres récents. Les Juifs d’Europe, les Juifs d’Alger, les Juifs que nous connaissons, que nous coudoyons chaque jour, nos voisins et nos amis, sont des hommes du monde, instruits, intelligents, souvent charmants. Et nous nous indignons violemment quand nous apprenons que les habitants d’une petite ville inconnue et lointaine ont égorgé et noyé quelques centaines d’enfants d’Israël. Je ne m’étonne plus aujourd’hui ; car nos Juifs ne ressemblent guère aux Juifs de là-bas.
À Bou-Saada, on les voit, accroupis en des tanières immondes, bouffis de graisse, sordides et guettant l’Arabe comme une araignée guette la mouche. Ils l’appellent, essaient de lui prêter cent sous contre un billet qu’il signera. L’homme sait le danger, hésite, ne veut pas. Mais le désir de boire et d’autres désirs encore le tiraillent. Cent sous représentent pour lui tant de jouissances !
Il cède enfin, prend la pièce d’argent, et signe le papier graisseux.
Au bout de trois mois, il devra dix francs, cent francs au bout d’un an, deux cents francs au bout de trois ans. Alors le Juif fait vendre sa terre, s’il en a une, ou sinon, son chameau, son cheval, son bourricot, tout ce qu’il possède enfin.
Les chefs, Caïds, Aghas ou Bach’agas, tombent également dans les griffes de ces rapaces qui sont le fléau, la plaie saignante de notre colonie, le grand obstacle à la civilisation et au bien-être de l’Arabe.
Quand une colonne française va razzier quelque tribu rebelle, une nuée de Juifs la suit, achetant à vil prix le butin qu’ils revendent aux Arabes dès que le corps d’armée s’est éloigné.
Si l’on saisit, par exemple, six mille moutons dans une contrée, que faire de ces bêtes ? Les conduire aux villes ? Elles mourraient en route, car comment les nourrir, les faire boire pendant les deux ou trois cents kilomètres de terre nue qu’on devra traverser ? Et puis, il faudrait, pour emmener et garder un pareil convoi, deux fois plus de troupes que n’en compte la colonne.
Alors les tuer ? Quel massacre et quelle perte ! Et puis les Juifs sont là qui demandent à acheter, à deux francs l’un, des moutons qui en valent vingt. Enfin le trésor gagnera toujours douze mille francs. On les leur cède.
Huit jours plus tard les premiers propriétaires ont repris à trois francs par tête leurs moutons. La vengeance française ne coûte pas cher.
Le Juif est maître de tout le sud de l’Algérie. Il n’est guère d’Arabes, en effet, qui n’aient une dette, car l’Arabe n’aime pas rendre. Il préfère renouveler son billet à cent ou deux cents pour cent. Il se croit toujours sauvé quand il gagne du temps. Il faudrait une loi spéciale pour modifier cette déplorable situation.
Le Juif, d’ailleurs, dans tout le Sud, ne pratique guère que l’usure par tous les moyens aussi déloyaux que possible ; et les véritables commerçants sont les Mozabites. Quand on arrive dans un village quelconque du Sahara, on remarque aussitôt toute une race particulière d’hommes qui se sont emparés des affaires du pays. Eux seuls ont les boutiques ; ils tiennent les marchandises d’Europe et celles de l’industrie locale ; ils sont intelligents, actifs, commerçants dans l’âme. Ce sont les Beni-Mzab ou Mozabites. On les a surnommés les « Juifs du désert » (p. 103 sq). Lire la suite dans « Le Zar’ez ».
Les courtisanes : Oulad-Naïl
Admiration et dégoût se mêlent dans le portrait des prostituées indigènes, dans « Province d’Alger » : « Boukhrari est le premier village où l’on rencontre des Oulad-Naïl. On est saisi de stupéfaction à l’aspect de ces courtisanes du désert.
Les rues populeuses sont pleines d’Arabes couchés en travers des portes, en travers de la route, accroupis, causant à voix basse ou dormant. Partout leurs vêtements flottants et blancs semblent augmenter la blancheur unie des maisons. Point de taches, tout est blanc ; et soudain une femme apparaît, debout sur une porte, avec une large coiffure qui semble d’origine assyrienne surmontée d’un énorme diadème d’or.
Elle porte une longue robe rouge éclatante. Ses bras et ses chevilles sont cerclés de bracelets étincelants ; et sa figure aux lignes droites est tatouée d’étoiles bleues.
Puis en voici d’autres, beaucoup d’autres, avec la même coiffure monumentale : une montagne carrée qui laisse pendre de chaque côté une grosse tresse tombant jusqu’au bas de l’oreille, puis relevée en arrière pour se perdre de nouveau dans la masse opaque des cheveux. Elles portent toujours des diadèmes dont quelques-uns sont fort riches. La poitrine est noyée sous les colliers, les médailles, les lourds bijoux ; et deux fortes chaînettes d’argent font tomber jusqu’au bas-ventre une grosse serrure de même métal, curieusement ciselée à jour et dont la clef pend au bout d’une autre chaîne. Quelques-unes de ces filles n’ont encore que de minces bracelets. Elles débutent. Les autres, les anciennes, montrent sur elles quelquefois pour dix ou quinze mille francs de bijoux. J’en ai vu une dont le collier était formé de huit rangées de pièces de vingt francs. Elles gardent ainsi leur fortune, leurs économies laborieusement gagnées. Les anneaux de leurs chevilles sont en argent massif et d’un poids surprenant. En effet, dès qu’elles possèdent en pièces d’argent la valeur de deux ou trois cents francs, elles les donnent à fondre aux bijoutiers mozabites, qui leur rendent alors ces anneaux ciselés ou ces serrures symboliques, ou ces chaînes, ou ces larges bracelets. Les diadèmes qui les couronnent sont obtenus de la même façon.
Leur coiffure monumentale, emmêlement savant et compliqué de tresses entortillées, demande presque un jour de travail et une incroyable quantité d’huile. Aussi ne se font-elles guère recoiffer que tous les mois, et prennent-elles un soin extrême à ne point compromettre, dans leurs amours, ce haut et difficile édifice de cheveux qui répand, en peu de temps, une intolérable odeur. C’est le soir qu’il faut les voir, quand elles dansent au café maure. […]
Au-dedans, des files d’êtres immobiles et blancs assis sur des planches, le long des murs blancs, sous un toit très bas. Et par terre, accroupies, avec leurs oripeaux flamboyants, leurs éclatants bijoux, leurs faces tatouées, leurs hautes coiffures à diadème qui rappellent les bas-reliefs égyptiens, les Oulad-Naïl attendent. […]
Elles vont ainsi, l’une vers l’autre. Quand elles se rencontrent, leurs mains se touchent ; elles semblent frémir ; leurs tailles se renversent, laissant traîner un grand voile de dentelle qui va de la coiffure aux pieds. Elles se frôlent, cambrées en arrière, comme pâmées dans un joli mouvement de colombes amoureuses. Le grand voile bat comme une aile. Puis, redressées soudain, redevenues impassibles, elles se séparent ; et chacune continue jusqu’à la ligne des spectateurs son glissement lent et boitillant. […]
Ces prostituées venaient jadis d’une seule tribu, les Oulad-Naïl. Elles amassaient ainsi leur dot et retournaient ensuite se marier chez elles, après fortune faite. On ne les en estimait pas moins dans leur tribu ; c’était l’usage. Aujourd’hui, bien qu’il soit toujours admis que les filles des Oulad-Naïl aillent faire fortune au loin par ce moyen, toutes les tribus fournissent des courtisanes aux centres arabes. […]
Celles des Oulad-Naïl qui sont de grande tente apportent dans leurs relations avec leurs visiteurs toute la générosité et la délicatesse que comporte leur origine. Il suffit d’admirer une seconde l’épais tapis qui sert de lit pour que le serviteur de la noble prostituée apporte à son amant d’une minute, dès qu’il a regagné sa demeure, l’objet qui l’avait frappé.
Elles ont, comme les filles de France, des protecteurs qui vivent de leurs fatigues. On trouve parfois au matin une d’elles au fond d’un ravin, la gorge ouverte d’un coup de couteau, dépouillée de tous ses bijoux. Un homme qu’elle aimait a disparu ; et on ne le revoit jamais. […]
Les gens riches, arabes ou français, qui veulent passer une nuit de luxueuse orgie, louent jusqu’à l’aurore le bain maure avec les serviteurs du lieu. Ils boivent et mangent dans l’étuve, et modifient l’usage des divans de repos » (p. 61 à 65).
Les Arabes : tous pédés !
S’il y a un peuple pour lequel Maupassant semble n’avoir aucune excuse, c’est bien celui des homosexuels [2], nonobstant les propos rapportés par Gérard Gengembre : « Denise Brahimi se demande si la condamnation de l’homosexualité, surprenante chez un érotomane averti, ne procède pas d’une hypocrisie précautionneuse qui lui permet d’épicer ses articles d’anecdotes croustillantes » (p. 14). Certes, mais qu’on en juge : « Les Espagnols n’avaient qu’un fusil ; ils se rendirent ; ils furent néanmoins massacrés, à l’exception de Blas Rojo, épargné sans doute à cause de sa jeunesse et de sa bonne mine. On sait que les Arabes ne sont point indifférents à la beauté des hommes. » (« Bou-Amama », p. 48). Remarque étonnante, car dans la suite de cet article, s’il est mentionné de « grandes et belles filles nues, violées et ensanglantées », le fameux Blas Rojo ne semble se plaindre de rien de tel !
C’est dans « Province d’Alger » que Maupassant développe le sujet, après avoir parlé des Oulad-Naïl en guise de prélude. Si le jugement est sans appel, on dénichera ici ou là quelque contradiction et quelque trace de fascination pour un vice si « répugnant » :
« Cette question de mœurs m’amène à un sujet bien difficile.
Nos idées, nos coutumes, nos instincts diffèrent si absolument de ceux qu’on rencontre en ces pays, qu’on ose à peine parler chez nous d’un vice si fréquent là-bas que les Européens ne s’en scandalisent même plus. On arrive à en rire au lieu de s’indigner. C’est là une matière fort délicate, mais qu’on ne peut passer sous silence quand on veut essayer de raconter la vie arabe, de faire comprendre le caractère particulier de ce peuple.
On rencontre ici à chaque pas ces amours anti-naturelles entre êtres du même sexe que recommandait Socrate, l’ami d’Alcibiade.
Souvent, dans l’histoire, on trouve des exemples de cette étrange et malpropre passion à laquelle s’abandonnait César, que les Romains et les Grecs pratiquèrent constamment, que Henri III mit à la mode en France et dont on suspecta bien des grands hommes. Mais ces exemples ne sont cependant que des exceptions d’autant plus remarquées qu’elles sont assez rares. En Afrique, cet amour anormal est entré si profondément dans les mœurs que les Arabes semblent le considérer comme aussi naturel que l’autre.
D’où vient cette déviation de l’instinct ? De plusieurs causes sans doute. La plus apparente est la rareté des femmes, séquestrées par les riches qui possèdent quatre épouses légitimes et autant de concubines qu’ils en peuvent nourrir. Peut-être aussi l’ardeur du climat, qui exaspère les désirs sensuels, a-t-elle émoussé chez ces hommes de tempérament violent la délicatesse, la finesse, la propreté intellectuelle qui nous préservent des habitudes et des contacts répugnants.
Peut-être encore trouve-t-on là une sorte de tradition des mœurs de Sodome, une hérédité vicieuse chez ce peuple nomade, inculte, presque incapable de civilisation, demeuré aujourd’hui tel qu’il était aux temps bibliques.
Oserai-je citer quelques exemples récents et bien caractéristiques de la puissance de cette passion chez l’Arabe ? Le hammam eut, dans ses débuts, parmi les garçons des bains, un petit nègre d’Algérie. Après un séjour de quelque temps à Paris, ce jeune homme revint en Afrique. Or, un matin, on trouva dans une caserne deux soldats assassinés ; et l’enquête démontra bien vite que le meurtrier n’était autre que l’ancien employé du hammam, qui, du même coup, avait tué ses deux amants. Des relations intimes s’étant établies entre ces hommes qui s’étaient connus par lui, il avait découvert leur liaison, et, jaloux de tous les deux, les avait égorgés.
De pareils faits sont très fréquents.
Voici maintenant un autre drame.
Un jeune Arabe de grande tente (?) [3] était connu dans toute la contrée pour ses habitudes amoureuses qui faisaient aux Oulad-Naïl une déloyale concurrence. Ses frères lui reprochèrent plusieurs fois, non pas ses mœurs, mais sa vénalité. Comme il ne changeait en rien ses habitudes, ils lui donnèrent huit jours pour renoncer à son commerce. Il ne tint pas compte de cet avertissement.
Le neuvième jour, au matin, on le trouva mort, étranglé, le corps nu et la tête voilée, au milieu du cimetière arabe. Quand on découvrit la figure, on aperçut une pièce de monnaie violemment incrustée, d’un coup de talon, dans la chair du front, et, sur cette pièce, une petite pierre noire.
À côté du drame, une comédie.
Un officier de spahis cherchait en vain une ordonnance. Tous les soldats qu’il employait étaient mal habillés, peu soigneux, impossibles à garder. Un matin, un jeune cavalier arabe se présente, fort beau, intelligent, d’allure fine. Le lieutenant le prit à l’essai. C’était une trouvaille, un garçon actif, propre, silencieux, plein d’attention et d’adresse. Tout alla bien pendant huit jours. Le neuvième jour au matin, comme le lieutenant rentrait de sa promenade quotidienne, il aperçut devant sa porte un vieux spahi en train de cirer ses bottes. Il passa dans le vestibule ; un autre spahi balayait. Dans la chambre, un troisième faisait le lit. Un quatrième, au loin, chantait dans l’écurie, tandis que le véritable ordonnance, le jeune Mohammed, fumait des cigarettes, couché sur un tapis.
Stupéfait, le lieutenant appela un de ces remplaçants inattendus, et, lui montrant ses camarades :
— Qu’est-ce que vous f… ichez ici, vous autres ?
L’Arabe immédiatement s’expliqua :
— Mon lieutenant, c’est le lieutenant indigène qui nous a envoyés. (Chaque lieutenant français, en effet, est doublé d’un officier indigène qui lui est subordonné.)
— Ah ! c’est le lieutenant indigène. Et pourquoi ça ?
Le soldat reprit :
— Mon lieutenant, il nous a dit : « Allez-vous-en chez le lieutenant et faites-moi tout l’ouvrage de Mohammed. Mohammed il doit rien faire, parce que c’est la femme du lieutenant. »
Cette attention délicate coûta d’ailleurs à l’officier deux mois d’arrêts.
Ce qui prouve combien ce vice est entré dans les mœurs des Arabes, c’est que tout prisonnier qui leur tombe dans les mains est aussitôt utilisé pour leurs plaisirs. Sils sont nombreux, l’infortuné peut mourir à la suite de ce supplice de volupté.
Quand la justice est appelée à constater un assassinat, elle constate aussi fort souvent que le cadavre a été violé, après la mort, par le meurtrier.
Il est encore d’autres faits fort communs et tellement ignobles que je ne les puis rapporter ici. » (p. 65 à 67).
On trouve encore dans « Le Zar’ez » le portrait d’un « caïd » aux mœurs bizarres : « Cela suffisait à leur maître, qui s’offrit ainsi des promenades à travers le Sahara dans un stupéfiant équipage, en compagnie de beautés indigènes qu’il envoyait quérir à Djelfa par son favori, un jeune Arabe de seize ans.
Il faut avoir vu ce pays pelé, rongé, dénudé ; il faut connaître, l’Arabe avec son introublable gravité, pour comprendre le comique infini de ce débauché à tête de vautour, de cet élégant du désert promenant des cocottes aux pieds nus, dans une carriole de bois brut, à roues inégales, conduite à fond de train par son… mignon. Cette élégance du tropique, cette débauche saharienne, ce chic enfin en pleine Afrique me parurent d’une inoubliable drôlerie » (p. 85).
En conclusion, ne jetons pas Maupassant avec l’eau du bain maure. Prenons ces textes comme un témoignage de cette époque où nous avons de la chance (?) de ne pas être nés, et demandons-nous si, à sa place, avec les connaissances disponibles et les préjugés courants, nous aurions fait mieux. Efforçons-nous d’être à la hauteur de notre siècle plutôt que, juchés tels des poux sur des tifs de géants, pouffer de leur démarche un peu gauche.
– Voir dans l’article sur La Comédie indigène, de Lotfi Achour, d’autres citations de Maupassant extraites d’autres textes sur l’Afrique qui ne sont pas inclus dans ce recueil.
– De Maupassant, lire La Maison Tellier et Miss Harriet.
– Lire mon article sur un voyage en Algérie.
Voir en ligne : Site de l’association des amis de Guy de Maupassant
© altersexualite.com 2007
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Pourtant il me semble formateur de montrer à des élèves que des auteurs réputés ne sont pas plus à admirer inconditionnellement qu’à vilipender pour quelques errements hors du politiquement correct de notre époque.
[2] Le mot existait, mais n’avait pas encore été traduit en français ; cf. L’Invention de l’hétérosexualité, de Jonathan Ned Katz.
[3] Ce ( ?) figure dans l’édition Pocket avec une note de bas de page signalant un jeu de mots scabreux sur « tante ».
 altersexualite.com
altersexualite.com