Accueil > Classiques > XIXe siècle > Salammbô, de Gustave Flaubert
Après Bovary, carton-pâte antique, pour lycéens et adultes
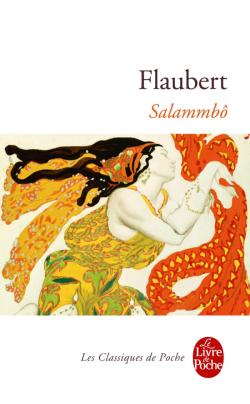 Salammbô, de Gustave Flaubert
Salammbô, de Gustave Flaubert
Édition de la Pléiade, Gallimard, 2013 (1862).
samedi 25 juillet 2015
Je ne me coltinerai plus ; pardon : je n’aurai plus l’insigne honneur d’enseigner la Litthérhatur en Terminale L à la rentrée 2015, mais on ne va pas se quitter en mauvais termes avec l’ami Flaubert. Si l’on poursuivait l’étude de Madame Bovary par celle du pensum ; pardon, du péplum ; pardon, du chef-d’œuvre subséquent, j’ai nommé Salammbô ? Références : Œuvres complètes, III, 1851-1862, édition publiée sous la direction de Claudine Gothot-Mersch, avec, pour ce volume, la collaboration de Jeanne Bem, Yvan Leclerc, Guy Sagnes et Gisèle Séginger, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2013, 1 vol. (XVIII + 1334 p.), 67 €. C’est la seconde fois que je lis ce drôle de roman, et sans doute la dernière. On se demande ce qui a poussé Flaubert à se documenter à ce point pour fournir au final ce péplum de carton-pâte qui syncrétise des traditions éparses, jusqu’au sacrifice du soleil des aztèques pour la scène finale. La piste d’un fantasme homoérotique pour cet holocauste de tant de beaux soldats n’est pas la plus dénuée de sens. Mais ne nous lançons pas sur cette fausse piste documentaire : c’est justement parce qu’on ne savait quasiment rien à l’époque de Flaubert, de la civilisation carthaginoise, qu’il a choisi ce sujet-là plutôt qu’un sujet se situant en Égypte, en Syrie, ou en d’autres pays d’Orient qu’il avait visités avant l’écriture de Madame Bovary. Cela lui permettait de composer un « poëme en prose », selon la formule de Sainte-Beuve, et de tenter avec la liberté du romancier, de recréer une civilisation disparue. En ce sens, je retire tout ce qui précède : ce péplum-pensum est un chef-d’œuvre !
Plan de l’article :
La genèse
Le roman
Le bataillon sacré
Appendices & dossier
L’Atelier de Flaubert
La genèse de Salammbô
Le procès Bovary à peine bouclé, Flaubert se lance par réaction dans la rédaction de l’anti-Bovary : « Je vais écrire un roman dont l’action se passera trois siècles avant Jésus-Christ, car j’éprouve le besoin de sortir du monde moderne, où ma plume s’est trop trempée et qui d’ailleurs me fatigue autant à reproduire qu’il me dégoûte à voir. » (Lettre à Mlle Leroyer de Chantepie, 18 mars 1857). L’un des motifs, l’histoire d’une femme amoureuse d’Anubis, provient d’une lecture de Montaigne, Apologie de Raimond Sebond, soit Essais, II, XII : « Paulina femme de Saturninus, matrone de grande réputation à Rome, pensant coucher avec le dieu Serapis, se trouve entre les bras d’un sien amoureux, par le macquerellage des Prestres de ce temple. » Le sujet principal est emprunté à l’histoire réelle, notamment racontée par Polybe, de la guerre des Mercenaires, qui se déroula de l’automne 241 à la fin 238 av. J.-C., à la suite de la Première Guerre punique (264-241 av. J.-C.). Le 29 nov. 1860, Flaubert présente son projet aux Goncourt, qui le résument ainsi dans leur Journal : « il faut que je fasse baiser un homme, qui croira enfiler la lune, avec une femme qui croira être baisée par le soleil ». Salammbô incarne un type de femme « élaboré par Flaubert dès ses années romantiques » (Pléiade, p. 1198), et qui hantera l’imaginaire des décadents notamment sous l’avatar de Salomé, avec les peintures de Gustave Moreau. Le manuscrit est daté « septembre 1857 - avril 1862 », à quoi s’ajoutent six mois de documentation en amont, et deux mois et demie de corrections en aval, avec notamment la « déliaison », c’est-à-dire la suppression des « et » trop nombreux signalés par Maxime Du Camp. Jusqu’à la quatrième édition, Flaubert allègera son texte : « Je veux faire dans Salammbô quelques allègements, enlever des phrases un peu lourdes, des « mais », des « car », des « cependant » ». La méthode Bovary est appliquée à nouveau, avec la rédaction de scénarios avant d’entamer le texte. Un chapitre explicatif est rédigé en juillet-août 1858, finalement ôté du roman, mais conservé dans les notes. Ce n’est que dans le 7e scénario que l’héroïne trouve son nom, et que l’idée du dualisme religieux vient à Flaubert. Selon les éditeurs de la Pléiade, le style épique pousse Flaubert à tremper sa plume dans un dictionnaire des idées reçues pour une fois dépourvu de distance ironique, avec par exemple ces épithètes de nature : « les Gaulois sont ivrognes et les Crétois menteurs ». Flaubert ne fait pas un roman historique qui « enseignerait l’histoire », comme dit dans son Dictionnaire des Idées Reçues, mais un roman singulier cultivant l’étrangeté et ne cherchant pas à expliquer aujourd’hui à la lueur d’hier. Le dialogue joue un rôle majeur dans cette tentative de recréer une civilisation disparue avec sa façon de penser. À Mme Roger des Genettes, Flaubert écrit : « Les Dieux n’étant plus et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc-Aurèle, un moment unique où l’homme seul a été. » (1861 ?). La publication donne lieu à des échanges d’articles et de réponses de Flaubert, qu’il décide d’annexer aux rééditions du roman, comme il l’avait fait pour Bovary : c’est la « querelle de Salammbô ». En parallèle, Flaubert se laisse tenter par la vie mondaine, et fréquente le salon de la princesse Mathilde. Flaubert s’oppose avec indignation aux velléités d’illustrer son œuvre, ce qui n’empêche pas qu’il inspire dessinateurs et sculpteurs. On relèvera par exemple une sculpture de Théodore Rivière intitulée Salammbô chez Mâtho (1895).
Salammbô
Le roman est divisé en quinze chapitres, et suivi d’un dossier bien plus long dans l’édition de la Pléiade.
Chapitre I. Le Festin. On débute in medias res, par un festin des mercenaires dans les jardins d’Hamilcar, qui permet de présenter la situation, les personnages principaux, et la rencontre de Mâtho et de Salammbô. Le lecteur croule sous l’avalanche de mots inconnus, parmi lesquels « Tamrapanni », qui désigne Ceylan. C’est en fait une variante orthographique de Taprobane, un hapax, comme il y en a tant dans ce livre. Dès cette entrée en matière, Flaubert esquisse des comportements plus ou moins altersexuels parmi les mercenaires : « Quelques-uns s’avançaient comme des femmes en faisant des gestes obscènes ; d’autres se mettaient nus pour combattre, au milieu des coupes, à la façon des gladiateurs ; et une compagnie de Grecs dansait autour d’un vase où l’on voyait des nymphes, pendant qu’un nègre tapait avec un os de bœuf sur un bouclier d’airain ». Mais face à eux, Salammbô a ses prêtres eunuques : « Derrière elle, de chaque côté, se tenaient deux longues théories d’hommes pâles, vêtus de robes blanches à franges rouges qui tombaient droit sur leurs pieds. Ils n’avaient pas de cheveux, pas de sourcils. Dans leurs mains étincelantes d’anneaux ils portaient d’énormes lyres et chantaient tous, d’une voix aiguë, un hymne à la divinité de Carthage. C’étaient les prêtres eunuques du temple de Tanit, que Salammbô appelait souvent dans sa maison. » Une phrase anodine du portrait de Salammbô est éclairée par une note : « Elle portait entre les chevilles une chaînette d’or ». Cette sorte de chaînette, signalée dans la Bible, a pour but de préserver les signes de la virginité. Blessé, Mâtho est soigné par l’esclave Spendius, qu’il a fait libérer : « Non ! reprit l’esclave. Tu m’as délivré de l’ergastule. Je suis à toi ! tu es mon maître ! Ordonne ! » Cette déclaration serait-elle à double entente ?
Chapitre II. À Sicca. Les mercenaires sont invités à quitter Carthage et installer leur camp à quelques jours de marche. C’est l’occasion de faire connaissance avec Spendius, dont le passé est assez agité. Avant d’être devenu esclave, il a beaucoup voyagé et parle plusieurs langues. Il va d’ailleurs commencer par s’acheter un esclave ! Ils arrivent après sept jours dans la ville sacrée de Sicca, où ils sont reçus par « les prêtresses de Tanit, accourues pour recevoir les hommes » Il s’agit bien sûr de prostituées sacrées, et pour les évoquer, Flaubert utilise ses souvenirs d’Orient tels qu’ils apparaissent dans sa Correspondance. Mâtho est complètement déprimé par la pensée de Salammbô. Belle scène où « nu comme un cadavre […] couché à plat ventre sur une peau de lion, [Mâtho] se serrait contre sa poitrine » (de Spendius). On comprend pourquoi Flaubert détestait l’idée qu’on illustre son œuvre ! Mâtho chante et « imitait la voix de Salammbô, tandis que ses mains étendues faisaient comme deux mains légères sur les cordes d’une lyre. À toutes les consolations de Spendius, il lui répétait les mêmes discours ; leurs nuits se passaient dans ces gémissements et ces exhortations ». Une amitié bien proche… Flaubert songe sans doute à ses amis Louis Bouilhet et Maxime Du Camp. Spendius commence à manipuler les mercenaires pour les pousser à investir Carthage. Quand le suffète Hannon envoyé de Carthage s’adresse aux troupes dans une langue qu’elles ne connaissent pas, le punique, Spendius traduit/trahit son discours en cinq langues (grec, latin, gaulois, lybique et baléare), en faisant croire qu’Hannon insulte les mercenaires et en veut à leur vie. Du coup il est décidé de retourner à Carthage, réclamer son dû.
Chapitre III. Salammbô. Bref chapitre jumeau où l’inquiétude de la jeune vierge répond à celle du soudard. Des allusions cryptées y sont faites à l’hystérie, qui peut se soigner par le fait de « choisir un époux ». Grâce à son père, Salammbô n’est pas prêtresse de Tanit : « Son père n’avait pas voulu qu’elle entrât dans le collège des prêtresses, ni même qu’on lui fît rien connaître de la Tanit populaire. Il la réservait pour quelque alliance pouvant servir sa politique, si bien que Salammbô vivait seule au milieu de ce palais ; sa mère, depuis longtemps, était morte ». Elle bovaryse en parlant avec sa nourrice : « Quelquefois, Taanach, il s’exhale du fond de mon être comme de chaudes bouffées, plus lourdes que les vapeurs d’un volcan. Des voix m’appellent, un globe de feu roule et monte dans ma poitrine, il m’étouffe, je vais mourir ; et puis, quelque chose de suave, coulant de mon front jusqu’à mes pieds, passe dans ma chair… c’est une caresse qui m’enveloppe, et je me sens écrasée comme si un dieu s’étendait sur moi. Oh ! je voudrais me perdre dans la brume des nuits, dans le flot des fontaines, dans la sève des arbres, sortir de mon corps, n’être qu’un souffle, qu’un rayon, et glisser, monter jusqu’à toi, ô Mère ! Elle veut voir Rabbetna, une déesse de Carthage, mais le grand prêtre l’en empêche : « Les Baals hermaphrodites ne se dévoilent que pour nous seuls, hommes par l’esprit, femmes par la faiblesse. »
Chapitre IV. Sous les murs de Carthage. Les barbares sont de retour à Carthage. Mâtho ne pense qu’à Salammbô, « jaloux de cette Carthage enfermant Salammbô, comme de quelqu’un qui l’aurait possédée ». Dans le camp se trouvent « des femmes de toutes les nations, brunes comme des dattes mûres, verdâtres comme des olives, jaunes comme des oranges, vendues par des matelots, choisies dans les bouges, volées à des caravanes, prises dans le sac des villes, que l’on fatiguait d’amour tant qu’elles étaient jeunes, qu’on accablait de coups lorsqu’elles étaient vieilles ». On y trouve aussi « des enfants robustes, couverts de vermine, nus, incirconcis », dont on se demande bien ce qu’ils font là en queue de liste des prostituées, sinon servir au même plaisir… Flaubert laisse toujours son lecteur deviner. Le suffète Giscon est délégué pour payer les mercenaires, avec une énorme caisse pleine de monnaies. Les soldats doivent décliner leurs états de service. Giscon démasque un tricheur qui ne porte pas les callosités produites par « la mentonnière du casque », ce qui en termes imagés s’appelle « avoir les carroubes », par analogie avec le fruit. Face aux mercenaires excités par Spendius de plus en plus exigeants, Giscon promet tout et n’importe quoi, par exemple « toute une caravane de vierges […] on les enverrait sur des vaisseaux, dans les ports des Baléares ».
Chapitre V. Tanit. Conduit par Spendius et par l’aqueduc, Mâtho découvre le temple de Cybèle, puis Tanit, déesse hermaphrodite que Flaubert a dû s’amuser à composer : « Tout autour de la muraille, dans des corbeilles de roseau, s’amoncelaient des barbes et des chevelures, prémices des adolescences ; et, au milieu de l’appartement circulaire, le corps d’une femme sortait d’une gaine couverte de mamelles. Grasse, barbue, et les paupières baissées, elle avait l’air de sourire, en croisant ses mains sur le bord de son gros ventre, poli par les baisers de la foule ». Il vole le « zaïmph », voile sacré de la déesse, dont il pense faire don à Salammbô, qu’il surprend dans sa chambre. Curieusement, la moustiquaire qui protège la pucelle « s’enflamma d’un seul coup, disparut » ; les notes y voient une allusion à la goutte d’huile du mythe de Psyché, mais ne peut-on y voir une allégorie de la rupture symbolique de l’hymen ? Hélas, elle appelle à l’aide après avoir feint de l’aimer. Il réussit à quitter Carthage grâce à la superstition des habitants au sujet du voile dont il est couvert : « Comment reprendre le voile ? Sa vue seule était un crime : il était de la nature des dieux et son contact faisait mourir. »
Chapitre VI. Hannon. Mâtho fait alliance pour fédérer les mercenaires et attaquer Carthage avec le prince des Numides, ce qui nous vaut ce beau portrait : « Narr’Havas était le plus beau de tous ; des courroies garnies de perles serraient ses bras minces ; le cercle d’or attachant autour de sa tête son large vêtement retenait une plume d’autruche qui lui pendait par-derrière l’épaule : un continuel sourire découvrait ses dents ; ses yeux semblaient aiguisés comme des flèches, et il y avait dans toute sa personne quelque chose d’attentif et de léger. » Toutes les provinces soumises à Carthage, écrasées d’impôts, se rallient à la rébellion avec joie, sauf deux villes. Le riche aristocrate Hannon se voit confier la défense de la ville. Il prend son temps et fait tout organiser avec faste avant de partir en campagne. Flaubert nous livre alors en moins de deux pages une défaite en règle des Carthaginois, suivie d’une contre-attaque par la troupe d’éléphants d’Hannon qui met en déroute les mercenaires. Mais trop pressé de fêter sa victoire, celui-ci se restaure et se fait soigner son éléphantiasis dans la ville d’Utique, dans une atmosphère très orientale : « deux jeunes garçons penchés sur les marches du bassin, lui frottaient les jambes. […] L’encens fuma plus fort dans les larges cassolettes, et les masseurs tout nus, qui suaient comme des éponges, lui écrasèrent sur les articulations une pâte composée avec du froment, du soufre, du vin noir, du lait de chienne, de la myrrhe, du galbanum et du styrax. » Derrière « jeunes garçons », lisons « bardaches », comme nous y invite la fameuse lettre à Louis Bouilhet du 15 mars 1850 (à lire dans l’article sur la Correspondance) : « Tu sauras que tous les garçons de bain sont bardaches ; les derniers masseurs, ceux qui viennent vous frotter quand tout est fini, sont ordinairement de jeunes garçons assez gentils. ». Pendant qu’Hannon « se délectait dans l’imagination de leur supplice », les mercenaires, grâce à une idée de Spendius, terrorisent les éléphants avec des cochons barbouillés de bitume et enflammés, et c’est une cuisante défaite pour les Carthaginois. Hannon s’apprête à s’empoisonner pour ne pas être crucifié, mais Carthage est trop assommée pour s’attaquer à lui.
Chapitre VII. Hamilcar Barca. Hamilcar n’est pas de la même trempe qu’Hannon ; c’est un richissime aristocrate aussi, doublé d’un « Suffète-de-la-mer » à qui on ne la fait pas. Impulsif et violent, il réagit au quart de tour et condamne tel esclave à la mort, tel autre à des supplices infernaux, comme on se gratterait une couille. On ne voit guère comment Flaubert concilie ce trait de caractère avec les capacités de stratège du personnage, mais cela constitue sans doute la matière même du carton-pâte dont est fait ce roman. Hamilcar a un enfant caché, dont lui rend compte un vieil esclave qui n’a pas peur de se travestir pour plus de discrétion : « et en se débarrassant de ses voiles, avec sa manche elle se frotta la figure ; la couleur noire, le tremblement sénile, la taille courbée, tout disparut. C’était un robuste vieillard ». Au terme d’un débat houleux, il se fait voter les pleins pouvoirs pour débarrasser la ville des mercenaires. Salammbô n’est pas la fille à son papa : « Elle lui était survenue après la mort de plusieurs enfants mâles. D’ailleurs, la naissance des filles passait pour une calamité dans les religions du Soleil. » Le chapitre contient l’interminable visite de « Mégara », nom du quartier de Carthage désignant par métonymie le domaine d’Hamilcar avec ses salles secrètes, sa fabrique, ses éléphants, et Sainte-Beuve dans sa critique (cf. infra), sera sévère avec ce capharnaüm. Dans la fabrique, atmosphère très-orientale : « Des hommes nus pétrissaient des pâtes ». Le maître choisit ses hommes avec goût, et veille au cheptel : « — Qu’ai-je à faire de ces vieux ? dit-il ; vends-les ! C’est trop de Gaulois, ils sont ivrognes ! et trop de Crétois, ils sont menteurs ! Achète-moi des Cappadociens, des Asiatiques et des Nègres. » Il s’étonna du petit nombre des enfants. « Chaque année, Giddenem, la maison doit avoir des naissances ! Tu laisseras toutes les nuits les cases ouvertes pour qu’ils se mêlent en liberté. » Les esclaves sont traités avec une humanité qui tient davantage des lectures sadiennes de Flaubert que du souci de vérité psychologique sinon historique : « — Qu’on les amène ! cria-t-il, et marquez-les au front avec des fers rouges, comme des lâches ! Alors, on apporta et l’on répandit au milieu du jardin des entraves, des carcans, des couteaux, des chaînes pour les condamnés aux mines, des cippes qui serraient les jambes, des numella qui enfermaient les épaules, et des scorpions, fouets à triples lanières terminées par des griffes en airain. Tous furent placés la face vers le soleil, du côté de Moloch dévorateur, étendus par terre sur le ventre ou sur le dos, et les condamnés à la flagellation, debout contre les arbres, avec deux hommes auprès d’eux, un qui comptait les coups et un autre qui frappait. »
Chapitre VIII. La bataille du Macar. C’est la bataille tant attendue des deux côtés. Comme Hannon, Hamilcar prend son temps, et les mercenaires sont impatients d’en découdre. Le chef numide Narr’Havas fait sa tapiole : « en caressant la plume d’autruche qui lui retombait sur l’épaule, roulait ses yeux comme une femme et souriait d’une manière irritante ». En l’absence de Mâtho, les Barbares sont vaincus à grand renfort d’éléphants. On les croirait anéantis, car Flaubert s’amuse à nous faire croire toujours que c’est la der des der, mais Mâtho retrouve Spendius parmi les blessés, et c’est reparti pour un tour.
Chapitre IX. En campagne. Les prisonniers envoyés par Hamilcar sont offerts à la foule façon foire du Trône : « Les deux mille Barbares furent attachés dans les Mappales, contre les stèles des tombeaux ; et des marchands, des goujats de cuisine, des brodeurs et même des femmes, les veuves des morts avec leurs enfants, tous ceux qui voulaient, vinrent les tuer à coups de flèche. » Retournement de situation, les troupes d’Hamilcar sont encerclées par les mercenaires, affamées et assoiffées. Les quatre chefs barbares (Mâtho, Spendius, Autharite et Narr’Havas) se réunissent régulièrement pour établir une stratégie. À Carthage on se lamente, et c’est la première idée d’un sacrifice à Moloch, dieu rival de Tanit. D’aucuns songent à l’immolation de Salammbô.
Chapitre X. Le serpent. Retour auprès de l’héroïne éponyme. Le prêtre eunuque Schahabarim rumine de noires pensées : « De la position du soleil au-dessus de la lune, il concluait à la prédominance de Baal, dont l’astre lui-même n’est que le reflet et la figure ; d’ailleurs, tout ce qu’il voyait des choses terrestres le forçait à reconnaître pour suprême le principe mâle exterminateur. Puis, il accusait secrètement la Rabbet de l’infortune de sa vie. N’était-ce pas pour elle qu’autrefois le grand pontife, s’avançant dans le tumulte des cymbales, lui avait pris sa virilité future ? Et il suivait d’un œil mélancolique les hommes qui se perdaient avec les prêtresses au fond des térébinthes. […] Mais sur l’aridité de sa vie, Salammbô faisait comme une fleur dans la fente d’un sépulcre. […] Sa condition établissait entre eux comme l’égalité d’un sexe commun, et il en voulait moins à la jeune fille de ne pouvoir la posséder que de la trouver si belle et surtout si pure. » Il a l’idée d’envoyer Salammbô rechercher le zaïmph auprès de Mâtho, au risque de la prostituer sans le lui dire clairement : « quoi qu’il entreprenne, n’appelle pas ! ne t’effraye pas ! Tu seras humble, entends-tu, et soumise à son désir qui est l’ordre du ciel ! ». Quant au serpent, Sainte-Beuve relève dans son article, dans les lignes suivantes, une « gaudriole » déplacée dans une épopée : « Elle le trouva enroulé par la queue à un des balustres d’argent, près du lit suspendu, et il s’y frottait pour se dégager de sa vieille peau jaunâtre, tandis que son corps tout luisant et clair s’allongeait comme un glaive à moitié sorti du fourreau. »
Chapitre XI. Sous la tente. On ne comprend guère la logique de découpage des chapitres, car nous avons ici deux courts chapitres pour une seule action, la récupération du Zaïmph, alors que les suivants vont être très longs et relater des successions d’actions guerrières, revers et triomphes. Quand Mâtho se retrouve face à son idole sous sa tente sans témoins, au lieu de la [censuré], le voilà comme un vulgaire Léon de Madame Bovary : « Une curiosité indomptable l’entraîna ; et, comme un enfant qui porte la main sur un fruit inconnu, tout en tremblant, du bout de son doigt, il la toucha légèrement sur le haut de sa poitrine ; la chair un peu froide céda avec une résistance élastique. Ce contact, à peine sensible pourtant, ébranla Mâtho jusqu’au fond de lui-même. Un soulèvement de tout son être le précipitait vers elle. Il aurait voulu l’envelopper, l’absorber, la boire. […] En la prenant par les deux poignets, il l’attira doucement, et il s’assit alors sur une cuirasse, près du lit de palmier que couvrait une peau de lion. […] et il répétait : — Comme tu es belle ! comme tu es belle ! » Il lui tient un discours des plus romantique : « Oh ! Si tu savais, au milieu de la guerre, comme je pense à toi ! Quelquefois, le souvenir d’un geste, d’un pli de ton vêtement, tout à coup me saisit et m’enlace comme un filet ! j’aperçois tes yeux dans les flammes des phalariques et sur la dorure des boucliers ! j’entends ta voix dans le retentissement des cymbales. Je me détourne, tu n’es pas là ! et alors je me replonge dans la bataille ! » Son portrait en focalisation interne nous laisse percevoir, derrière les yeux de l’héroïne, le regard de Flaubert sur son héros très « Dieux du Stade » : « Il levait ses bras où des veines s’entrecroisaient comme des lierres sur des branches d’arbre. De la sueur coulait sur sa poitrine, entre ses muscles carrés ; et son haleine secouait ses flancs avec sa ceinture de bronze toute garnie de lanières qui pendaient jusqu’à ses genoux, plus fermes que du marbre. Salammbô, accoutumée aux eunuques, se laissait ébahir par la force de cet homme. » Mâtho a un geste violent vite réprimé, puis nous livre son fantasme de trempling : « Écrase-moi, pourvu que je sente tes pieds ! maudis-moi, pourvu que j’entende ta voix ! Ne t’en va pas ! pitié ! je t’aime ! je t’aime ! ». Elle s’offre à lui, et « Mâtho lui saisit les talons, la chaînette d’or éclata, et les deux bouts, en s’envolant, frappèrent la toile comme deux vipères rebondissantes. », ce qui rappelle la phrase de Bovary (III, 6) : « Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset, qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. » Mais Mâtho est appelé au combat, et Salammbô s’échappe avec le voile, qu’elle remet à son père aussitôt (elle passe les infranchissables lignes ennemies façon Roxane dans Cyrano). Quant à savoir s’ils ont ou non baisé, le texte se contente de le suggérer très vaguement. Aussitôt la fortune change, et Narr’Havas se rallie à Hamilcar ; avec une mention de « son ancien amour » qui ne peut se comprendre que par la lecture des scénarios (voir infra) : « peut-être y avait-il dans sa défection une rancune contre Mâtho, soit à cause du commandement ou de son ancien amour. » Hamilcar, voyant la chaînette défaite de sa fille, meilleur lecteur que nous, croit ou comprend qu’elle est déflorée, et l’offre aussitôt au Numide en gage d’alliance.
Chapitre XII. L’aqueduc. Défaite subite des mercenaires : « Les moribonds se roulaient dans la boue sanglante en mordant de rage leurs poings mutilés ; et quarante-trois Samnites, tout un printemps sacré, s’entr’égorgèrent comme des gladiateurs. ». Mais on est pleins de ressources. On commence par sacrifier tous les prisonniers carthaginois dont Giscon, puis on recommence à marcher. Hannon est envoyé à la rescousse d’Hamilcar : « il se savait tellement hideux qu’il se mettait, comme une femme, un voile sur la tête » Après la prise d’Hippo-Zaryte, nouveau retournement de situation : Hamilcar estime qu’« Il était maintenant irrévocablement perdu ». Sans lâcher de chiffre, Flaubert énumère les forces mercenaires, et cela descend « jusqu’au bas des races, on voyait, derrière tous les autres, des hommes à profil de bête et ricanant d’un rire idiot ; misérables ravagés par de hideuses maladies, pygmées difformes, mulâtres d’un sexe ambigu, albinos dont les yeux rouges clignotaient au soleil ». Siège de Carthage, et Spendius ayant l’idée géniale (à laquelle personne n’avait pensé à Carthage) de couper l’aqueduc, la victoire semble assurée pour les « Barbares ».
Chapitre XIII. Moloch. Long chapitre de siège, avec des forces équilibrées. La ville semble inexpugnable, mais on a faim et soif. On apprend ici ou là qu’il y a dans cette ville immense « douze cents esclaves nubiles, de celles que l’on destinait aux prostitutions de la Grèce et de l’Italie », à qui l’on prend leurs cheveux pour les machines de guerre. Mâtho est au mieux de sa forme : « jetant sa cuirasse, avait pris sa peau de lion, plus commode pour la bataille. Le mufle s’adaptait sur la tête en bordant le visage d’un cercle de crocs ; les deux pattes antérieures se croisaient sur la poitrine, et celles de derrière avançaient leurs ongles jusqu’au bas de ses genoux. » Les Carthaginois décident le sacrifice suprême de dizaines d’enfants, parmi les riches si possible, bien que ceux-là tentent de sauver leurs mômes ; ainsi Hamilcar substitue-t-il un enfant d’esclave à son enfant caché qui a été repéré, quitte à gaver le papa esclave de nourritures pour calmer sa douleur ; d’ailleurs certains sont trop heureux de sacrifier leur enfant. Au passage, signalons que cet enfant caché n’est autre que le futur Hannibal Barca. Ce type de sacrifice d’enfants est évoqué dans l’Ancien testament, source d’ailleurs de nombreuses références documentaires de l’œuvre (Lévitique XX, 2 ; 2 Rois XVII, 17…). Jolie cérémonie qui vous a des faux airs de comices agricoles, couleur locale changée : « De temps en temps, il arrivait des files d’hommes complètement nus, les bras écartés et tous se tenant par les épaules. » On honore le dieu hermaphrodite : « Hommage à toi, Soleil ! roi des deux zones, créateur qui s’engendre, Père et Mère, Père et Fils, Dieu et Déesse, Déesse et Dieu ! » Toute cette fest-noz sanglante a un résultat : pousser Flaubert à l’allitération : « Ce grand bruit et cette grande lumière avaient attiré les Barbares au pied des murs ; se cramponnant pour mieux voir sur les débris de l’hélépole, ils regardaient, béants d’horreur. »
Chapitre XIV. Le défilé de la hache. Le sacrifice à peine terminé, l’athée Flaubert fait s’abattre une pluie torrentielle sur Carthage, et c’est un nouveau retournement de situation. Hamilcar sort de la ville en force et accule habilement le gros des mercenaires dans le piège du « défilé de la hache », un cirque naturel qu’il fait clore par un éboulement de roches. Les voilà condamnés à mourir de faim, mais cela ne va pas sans quelques jolies scènes de cannibalisme : « Puis, comme il fallait vivre, comme le goût de cette nourriture s’était développé, comme on se mourait, on égorgea les porteurs d’eau, les palefreniers, tous les valets des Mercenaires. Chaque jour on en tuait. Quelques-uns mangeaient beaucoup, reprenaient des forces et n’étaient plus tristes. » Pour la soif, « On buvait de l’urine, refroidie dans les casques d’airain ». Les amateurs remarqueront l’étonnante précision de « refroidie » ; l’ami Flaubert n’était sans doute pas familier du Tong zi dan ni de l’amaroli…
Pour accélérer la fin, Hamilcar ruse et laisse sortir une partie des survivants, qu’il fait massacrer sans pitié. Voilà le passage remarquable du bataillon sacré (ce mot n’est pas utilisé par Flaubert) [1]. Je vous le livre intégralement, sachant que les éditeurs de la Pléiade, qui nous infligent un luxe infini d’annotations pour le moindre détail technique (mieux que pour Bovary), ont dédaigné d’informer leurs lecteurs sur les sources de ces pages sublimes qui constitueront une excellente lecture analytique. L’article de Wikipédia vous aidera, mais a priori ce placage d’une coutume thébaine est purement gratuit et nous le devons aux fantasmes homoérotiques de l’auteur, ou plutôt à sa poétique : en l’absence de données sur cette armée, pourquoi cette coutume n’aurait pas pu exister dans un des corps de cette armée composite, puisqu’elle existait quelque part ailleurs dans le bassin méditerranéen ? Il en a agi de même sur tous les motifs de sa narration ; il n’a pas censuré l’homosexualité, voilà tout. Il avait existé dans les siècles précédents, à Carthage, une légion sacrée de 2500 soldats, composée de jeunes aristocrates, apparemment sans lien pédérastique ; mais Flaubert n’y fait pas allusion. Zola s’est sans doute inspiré de cette légende perpétuée par son ami Flaubert pour sa vision des couples de soldats « mariés », notamment Maurice et Jean, dans La Débâcle, son roman épique sur la guerre de 1870.
Il voyait, et tous voyaient à six cents pas de là, sur la gauche, au sommet d’un mamelon, des Barbares encore ! En effet, quatre cents des plus solides, des Mercenaires, Étrusques, Libyens et Spartiates, dès le commencement avaient gagné les hauteurs, et jusque-là s’y étaient tenus incertains. Après ce massacre de leurs compagnons, ils résolurent de traverser les Carthaginois ; déjà ils descendaient en colonnes serrées, d’une façon merveilleuse et formidable.
Un héraut leur fut immédiatement expédié. Le Suffète avait besoin de soldats ; il les recevait sans condition, tant il admirait leur bravoure. Ils pouvaient même, ajouta l’homme de Carthage, se rapprocher quelque peu, dans un endroit qu’il leur désigna, et où ils trouveraient des vivres.
Les Barbares y coururent et passèrent la nuit à manger. Alors, les Carthaginois éclatèrent en rumeurs contre la partialité du Suffète pour les Mercenaires.
Céda-t-il à ces expansions d’une haine insatiable, ou bien était-ce un raffinement de perfidie ? Le lendemain, il vint lui-même sans épée, tête nue, dans une escorte de Clinabares, et il leur déclara qu’ayant trop de monde à nourrir, son intention n’était pas de les conserver. Cependant, comme il lui fallait des hommes et qu’il ne savait par quel moyen choisir les bons, ils allaient se combattre à outrance ; puis il admettrait les vainqueurs dans sa garde particulière. Cette mort-là en valait bien une autre ; et alors, écartant ses soldats (car les étendards puniques cachaient aux Mercenaires l’horizon), il leur montra les cent quatre-vingt-douze éléphants de Narr’Havas formant une seule ligne droite et dont les trompes brandissaient de larges fers, pareils à des bras de géant qui auraient tenu des haches sur leurs têtes.
Les Barbares s’entre-regardèrent silencieusement. Ce n’était pas la mort qui les faisait pâlir, mais l’horrible contrainte où ils se trouvaient réduits.
La communauté de leur existence avait établi entre ces hommes des amitiés profondes. Le camp, pour la plupart, remplaçait la patrie ; vivant sans famille, ils reportaient sur un compagnon leur besoin de tendresse, et l’on s’endormait côte à côte, sous le même manteau, à la clarté des étoiles. Puis, dans ce vagabondage perpétuel à travers toutes sortes de pays, de meurtres et d’aventures, il s’était formé d’étranges amours, unions obscènes aussi sérieuses que des mariages, où le plus fort défendait le plus jeune au milieu des batailles, l’aidait à franchir les précipices, épongeait sur son front la sueur des fièvres, volait pour lui de la nourriture ; et l’autre, enfant ramassé au bord d’une route, puis devenu Mercenaire, payait ce dévouement par mille soins délicats et des complaisances d’épouse.
Ils échangèrent leurs colliers et leurs pendants d’oreilles, cadeaux qu’ils s’étaient faits autrefois, après un grand péril, dans des heures d’ivresse. Tous demandaient à mourir, et aucun ne voulait frapper. On en voyait un jeune, çà et là, qui disait à un autre dont la barbe était grise : « Non ! non, tu es le plus robuste ! Tu nous vengeras, tue-moi ! » et l’homme répondait : « J’ai moins d’années à vivre ! Frappe au cœur, et n’y pense plus ! » Les frères se contemplaient, les deux mains serrées, et l’amant faisait à son amant des adieux éternels, debout, en pleurant sur son épaule.
Ils retirèrent leurs cuirasses pour que la pointe des glaives s’enfonçât plus vite. Alors, parurent les marques des grands coups qu’ils avaient reçus pour Carthage ; on aurait dit des inscriptions sur des colonnes.
Ils se mirent sur quatre rangs égaux à la façon des gladiateurs, et ils commencèrent par des engagements timides. Quelques-uns s’étaient bandé les yeux, et leurs glaives ramaient dans l’air, doucement, comme des bâtons d’aveugle. Les Carthaginois poussèrent des huées en leur criant qu’ils étaient des lâches. Les Barbares s’animèrent, et bientôt le combat fut général, précipité, terrible.
Parfois deux hommes s’arrêtaient tout sanglants, tombaient dans les bras l’un de l’autre et mouraient en se donnant des baisers. Aucun ne reculait. Ils se ruaient contre les lames tendues. Leur délire était si furieux que les Carthaginois, de loin, avaient peur.
Enfin, ils s’arrêtèrent. Leurs poitrines faisaient un grand bruit rauque, et l’on apercevait leurs prunelles, entre leurs longs cheveux qui pendaient comme s’ils fussent sortis d’un bain de pourpre. Plusieurs tournaient sur eux-mêmes, rapidement, tels que des panthères blessées au front. D’autres se tenaient immobiles en considérant un cadavre à leurs pieds ; puis, tout à coup, ils s’arrachaient le visage avec les ongles, prenaient leur glaive à deux mains et se l’enfonçaient dans le ventre.
Il en restait soixante encore. Ils demandèrent à boire. On leur cria de jeter leurs glaives ; et, quand ils les eurent jetés, on leur apporta de l’eau.
Pendant qu’ils buvaient, la figure enfoncée dans les vases, soixante Carthaginois, sautant sur eux, les tuèrent avec des stylets, dans le dos.
Hamilcar avait fait cela pour complaire aux instincts de son armée, et, par cette trahison, l’attacher à sa personne. »
Pendant ce temps-là, Salammbô reçoit son futur : « Ce jeune homme à voix douce et à taille féminine captivait ses yeux par la grâce de sa personne et lui semblait être comme une sœur aînée que les Baals envoyaient pour la protéger. » De son côté Hannon profite de la guerre pour se livrer, avec ses soldats, aux délices du viol : « il donnait à ses soldats les femmes à violer avant leur égorgement ; les plus belles étaient jetées dans sa litière, car son atroce maladie l’enflammait de désirs impétueux ; il les assouvissait avec toute la fureur d’un homme désespéré. » Tous les Barbares ne sont pas encore anéantis, car Flaubert a mis de côté une poire pour la soif : Mâtho, lequel s’apprête à mourir dans Tunis assiégée, mais « C’était la dernière lutte ; il n’espérait rien, et cependant il se disait que la fortune était changeante. » Et de fait, il a le temps de défaire l’armée d’Hannon, et prend encore le temps de crucifier trente carthaginois, dont Hannon, dans une belle scène réaliste : « Hamilcar eut de la peine à reconnaître Hannon. Ses os spongieux ne tenant pas sous les fiches de fer, des portions de ses membres s’étaient détachées, et il ne restait à la croix que d’informes débris, pareils à ces fragments d’animaux suspendus contre la porte des chasseurs. »
Voilà enfin la dernière bataille, décidée d’un commun accord. Flaubert se livre à un décompte des forces en présence : 7200 mercenaires contre 14000 Carthaginois (on se demande comment il peut en rester autant). Les sentiments de Salammbô, Mâtho et Narr’Havas sont confus, et aboutissent à nouveau à une pensée homoérotique : « Cependant la fille d’Hamilcar n’avait point de tendresse pour Narr’Havas. Le souvenir de Mâtho la gênait d’une façon intolérable ; il lui semblait que la mort de cet homme débarrasserait sa pensée, comme, pour se guérir de la blessure des vipères, on les écrase sur la plaie. Le roi des Numides était dans sa dépendance ; il attendait impatiemment les noces, et comme elles devaient suivre la victoire, Salammbô lui faisait ce présent afin d’exciter son courage. […] La même vision avait assailli Mâtho ; mais il la rejeta tout de suite, et son amour, qu’il refoulait, se répandit sur ses compagnons d’armes. Il les chérissait comme des portions de sa propre personne, de sa haine, et il se sentait l’esprit plus haut, les bras plus forts ; tout ce qu’il fallait exécuter lui apparut nettement. Si parfois des soupirs lui échappaient, c’est qu’il pensait à Spendius. » Une dernière fois, Flaubert s’amuse à faire faire volte-face à la fortune (mais ces revers sont dans le texte de Polybe dont il s’est inspiré), avec les deux extraits suivants à quelques lignes d’intervalle : « Hamilcar se désespérait ; tout allait périr sous le génie de Mâtho et l’invincible courage des Mercenaires ! […] Les Barbares, au milieu de la plaine, s’étaient adossés contre un monticule. Ils n’avaient aucune chance de vaincre, pas même de survivre ; mais c’étaient les meilleurs, les plus intrépides et les plus forts. » Joli tas de cadavres, à opposer au « Dormeur du val » de Rimbaud : « Sur l’étendue de la plaine, des lions et des cadavres étaient couchés, et les morts se confondaient avec des vêtements et des armures. À presque tous le visage ou bien un bras manquait ; quelques-uns paraissaient intacts encore ; d’autres étaient desséchés complètement et des crânes poudreux emplissaient des casques ; des pieds qui n’avaient plus de chair sortaient tout droit des cnémides, des squelettes gardaient leurs manteaux ; des ossements, nettoyés par le soleil, faisaient des taches luisantes au milieu du sable. »
Chapitre XV. Mâtho. C’est la fête finale, avec mariage de Narr’Havas et Salammbô, et culte à l’hermaphrodisme : « On applaudissait parmi ces femmes les Kedeschim aux paupières peintes, symbolisant l’hermaphrodisme de la Divinité ». Mâtho est supplicié façon Christ, avec plusieurs stations sur le chemin de son supplice, et reste le chéri de ces dames : « Elles brûlaient de contempler celui qui avait fait mourir leurs enfants et leurs époux ; et du fond de leur âme, malgré elles, surgissait une infâme curiosité, le désir de le connaître complètement, envie mêlée de remords et qui se tournait en un surcroît d’exécration. » On finit par lui arracher le cœur à la façon du Sacrifice humain chez les Aztèques, car notre Gustave, en haine du réalisme, est prêt à tous les sacrifices. Cette mort n’est pas sans rappeler celle d’Emma, qui parcourt Yonville avant de s’empoisonner, et que chacun frappe à sa façon. La mort subite de Salammbô qui l’aime toujours malgré l’horreur de ses plaies, évoque l’amour intact de Charles pour Emma.
Appendices & dossier
Journal de voyage. Le dossier de l’édition de la Pléiade est riche ; il occupe plus de pages que le roman. Cela commence par le journal de voyage en Algérie et en Tunisie : « Il faut absolument que je fasse un voyage en Afrique […] pour connaître à fond les paysages que je prétends décrire » ; « J’ai besoin de prendre l’air, ne serait-ce que dans un but hygiénique ». L’appel du hammam ? Cela fait sept ans qu’il n’a pas quitté la France. Il part du 12 avril au 8 juin 1858. Fidèle à son habitude des voyages, sur place, il oublie son roman et laisse venir les sensations, sans chercher l’utilité a priori. Les notations sont sèches, quasiment pas rédigées, en tout cas rédigées pour lui-même ; il ne note que l’amorce, le reste est dans ses souvenirs. Nombreux croquis sommaires ; ce que j’aime chez Flaubert, c’est qu’il est presque aussi nul que moi en dessin. La fin du voyage à partir du 24 mai est rédigée a posteriori à son retour à Croisset, le 8 juin, sans croquis. Son esprit critique porte sur certains détails du colonialisme, mais aussi sur ce qu’on pourrait appeler la mentalité indigène. Ici, il note « pas une femme » ; à Tunis, il assiste à des spectacles de « caragheuz » (= Karagöz) assez poivrés dans le genre priapique : « Quant au caragheuz, son pénis ressemblait plutôt à une poutre. Ça finissait par n’être plus indécent. Il y en a plusieurs, Caragheuz. Je crois le type en décadence. Il s’agit seulement de montrer le plus possible de phallus. Le plus grand avait un grelot qui, à chaque mouvement de reins, sonnait. Cela faisait beaucoup rire ! quel triste spectacle pour un homme de goût ! et pour un monsieur à principes. » À propos d’une « Nelly Rosemberg », il note à deux reprises : « prunelles splendides et noyées dans le sperme — visite gaye », puis : « Large bouche et dents admirables ; les yeux sont archi-noirs et la prunelle glisse sous la paupière comme un gland sous le prépuce dans une masturbation interne et incessante. Sourcils démesurés, en arcs ; elle a l’air de toujours sourire ! » S’il note à plusieurs reprises qu’il va « aux bains », on relève un seul détail suggestif comme il y en a tant dans les lettres d’Orient : « Bain turc exquis, un nègre admirable pour masseur. Celui de Kef me massait les genoux avec sa tête ». La prière finale a de quoi désarçonner : « Que toutes les énergies de la nature que j’ai aspirées me pénètrent et qu’elles s’exhalent dans mon livre ! À moi puissances de l’émotion plastique ! résurrection du passé, à moi ! à moi ! Il faut faire, à travers le Beau, vivant quand même. Pitié pour ma volonté, Dieu des Âmes ! donne-moi la Force – et l’Espoir !… »
Scénarios. Les neuf scénarios plus les scénarios par parties sont fort intéressants, car ils laissent voir la croissance de l’imagination flaubertienne, totalement libre de l’érudition historique (« là, développer et coordonner les événements historiques qui ne sont qu’un accessoire du roman »). Des éléments importants n’affleurent que dans les derniers scénarios, voire qu’à la rédaction finale. Ainsi dans le premier état, l’héroïne s’appelait-elle « Pyra », et avait-elle une liaison sexuelle avec Mâtho (« se baiser ») contrariée par « l’effet de l’inégalité sociale, et de la vie de harem ». La « jalousie » de Narr’Havas, qui aime aussi Salammbô, n’est explicite que dans les scénarios ; il est impossible de la comprendre par une lecture naïve du texte final. Certes, Narr’Havas défie Mâtho quand Spendius fait allusion au fait que Salammbô lui ferait une invite, mais après cela, il part, et le texte n’en dit plus rien. Cela constitue un exemple de ce que Gérard Genette appelle « paralipse » : une information détenue par le narrateur, et qu’il ne dévoile pas. À force de reprendre ses scénarios, Flaubert connaît intimement son récit, et comme un conteur, oublie certains éléments que le lecteur doit décrypter à la façon d’un paléontologue reconstituant à partir d’une vertèbre un dinosaure. De même, si dans le roman publié rien n’assure que Salammbô ait été déflorée par Mâtho sous la tente ; tout au contraire laisse supposer que non puisque la logique d’un récit voudrait qu’on ne laisse pas de côté la défloration d’une vierge, et le comportement respectueux de Mâtho et le fait qu’il soit appelé au feu pendant leur étreinte, laisse croire qu’il n’a pas encore atteint le sanctuaire de la donzelle ; dans les scénarios au contraire, c’est explicite : « il l’étreint sur sa poitrine et finalement la baise ». Mieux : lorsque Hamilcar fiance sa fille à Narr’Havas : « il faut qu’on voie cette scène, et la balle de Pyrrha dont le cul est encore barbouillé du foutre mercenaire ». À partir du 5e scénario, le terme « baisade sous le manteau » sera utilisé systématiquement, et cela bien sûr nous rappelle les « baisades » de Madame Bovary, toutes racontées par ellipse ; n’est-ce pas d’ailleurs la raison de l’expression « sous le manteau » ? D’ailleurs le motif de la chaînette qui se brise « comme deux vipères rebondissantes » dans cette scène clé fonctionne comme une métaphore de l’amour charnel interne à l’œuvre flaubertien, puisqu’il fait écho à la scène de la baisade d’Emma avec Léon, comme nous l’avons montré ci-dessus. Dans les scénarios suivants, on relève, outre le martellement de « baisade », la romantique formule « fouterie mystique », alors que le résumé de l’œuvre qui suit, réalisé par Flaubert pour son éditeur avant relecture définitive, n’y fait aucune allusion. C’est dans le 5e scénario qu’on relève la première allusion à Moloch ; dans le 7e, « Sallambô » trouve enfin son nom (après s’être nommée Pyra, puis Hanna), pas encore son orthographe. C’est encore plus tard, dans les scénarios par parties, que Flaubert invente le fils caché d’Hamilcar, puis le nom du « zaïmph », qui n’était jusque-là qu’un vulgaire « péplos », « manteau » ou « voile ». Pas la moindre allusion, par contre, dans tous ces scénarios, à la scène du « bataillon sacré », qui n’est peut-être venue sous la plume qu’au moment de la rédaction.
Le « chapitre explicatif » a été longtemps considéré comme perdu, et n’a été publié qu’en 2001, ayant réapparu en 1949. On comprend que Flaubert l’ait « jeté au feu », car il ne possède pas pour la description de la ville, le génie visionnaire d’un Balzac, d’un Hugo ou d’un Zola. Il se contente de dérouler les informations (dans ce qui n’était qu’un brouillon ; s’il l’avait publié, il aurait magnifié la chose…). Un détail nous laisse plus que dubitatif, c’est le chiffre de « sept cent mille habitants » (et l’auteur précise dans la « ceinture de murailles »), qui paraît au minimum doublé par rapport à la réalité historique. Voir cet article, le plus savant que j’aie trouvé sur cette matière. On relève une belle phrase anarchisante qu’on pourrait citer en exergue de maint traité de philosophie politique : « Quelquefois, il est vrai, on convoquait le peuple sur la Place, devant le temple de Baal-Khamon entre les ports et l’Acropole. Il exprimait sa volonté en poussant de grands cris. Mais elle était toujours prévue et on savait la conduire. ». La question de l’hermaphrodisme des Baal est précisée : « Baal suprême […] [à la fois mâle et femelle, il avait de la barbe et des seins]. Puis l’organe de l’homme et l’organe de la femme reproduisaient parallèlement un des côtés de cet hermaphrodite. » Des « Prostitués mâles [avec majuscule] s’occupant avec les courtisanes de Tanit à broder des voiles pour la déesse », ne seront pas repris dans le roman.
La Querelle de Salammbô commence par trois articles de Sainte-Beuve publiés dans Le Constitutionnel, qui se livre d’abord à un interminable résumé commenté (comme quoi il a existé des temps où dans la presse la place n’était pas comptée quand il s’agissait de causer culture). Sainte-Beuve a des réticences sur ce texte qu’il qualifie d’« espèce de poëme en prose », et son auteur « un pinceau que la réalité, quelle qu’elle soit, attire, mais qui, tout en cherchant, en poursuivant partout le vrai, paraît l’aimer surtout et le choyer s’il le rencontre affreux et dur. » Sainte-Beuve est un lecteur auquel rien n’échappe, par exemple il a bien repéré la jalousie de Narr’Havas amoureux en un coup d’œil de Salammbô, comme Mâtho. Regrettant les libertés que prend l’auteur avec la chronique de Polybe, il trouve que « Mâtho amoureux, ce Goliath africain faisant toutes ces folies et ces enfantillages en vue de Salammbô, ne me paraît pas moins faux ; il est aussi hors de la nature que de l’histoire. » En ce qui concerne le décorum de carton-pâte, Sainte-Beuve relève les escarboucles « formées par l’urine des lynx » du chapitre VII, et traite Flaubert de « dilettante mystificateur ». Il ne relève pas le cœur arraché de Mâtho ou d’autres choses qui nous choquent davantage, mais on se demande quelle mouche le pique de ne pas accorder au romancier le droit de romancer ! La belle page du bataillon sacré, qui a échappé aux éditeurs érudits de la Pléiade, ne lui a pas échappé, et voici le commentaire que cela inspire à notre Sainte-Beuve, lequel, faut-il le rappeler, s’est quand même tapé la meuf de son ami Victor Hugo… : « les hideuses révélations de tendresse qui se déclarent à l’heure suprême entre les Hercule et les Hylas de ces bandes dépravées ». Se taper l’épouse d’un ami permet sans doute de jouer les père la morale et d’employer pour les turpitudes d’autrui les gros mots de « hideuses » & « dépravé »… Flaubert répond à son « ami » deux jours après la parution du 3e article. Il a beau jeu de rétorquer à peu près tous les arguments en citant ses sources, et en posant cet art poétique : « Moi, j’ai voulu fixer un mirage en appliquant à l’Antiquité les procédés du roman moderne, et j’ai tâché d’être simple. » Sur la création du personnage féminin, il a cette remarque de bon sens, directement issue de sa remarque du journal « pas une femme » : « Je ne suis pas sûr de sa réalité ; car ni moi, ni vous, ni personne, aucun ancien et aucun moderne, ne peut connaître la femme orientale, par la raison qu’il est impossible de la fréquenter. »
Vient quelques jours après la critique de Guillaume Froehner publiée dans la Revue contemporaine du 31 décembre 1862. Cet historien spécialiste de l’antiquité n’y va pas par le dos du strigile, et c’est grâce à lui que cette partie du dossier mérite le nom de « querelle ». Avec une insigne cuistrerie, il relève un grand nombre d’erreurs (ou prétendues telles), jusqu’à des coquilles (par exemple « un stèle »), et compare le roman de Flaubert à celui de Théophile Gautier (Le Roman de la momie, 1857), qu’il préfère pour ses grâces (alors qu’il prétend ne pas faire une critique, mais juste une mise au point scientifique ; on comprend cependant que le roman ne lui a pas plu comme œuvre). Flaubert rétorque dans la même revue, en invoquant ses preuves, et son contradicteur répond à nouveau, et sur un ton de plus en plus insultant, puis Flaubert répond à la réponse et clôt le débat par une fin de non recevoir. Ces savants échanges ne nous apprendront pas grand-chose, si ce n’est des précisions qui figurent dorénavant dans les notes des éditions scolaires et savantes. Le cuistre n’admet pas l’existence du genre péplum avant la lettre, voilà tout.
Le dossier se termine par La Guerre des mercenaires de Polybe, traduction de Dom Vincent Thuillier (1727), celle qu’a utilisée l’auteur. Il s’agit du principal élément d’inspiration de l’histoire que raconte Flaubert, sachant que comme il le dit dans sa réplique à Sainte-Beuve, « C’est pour moi une autorité incontestable, quant aux faits ; mais tout ce qu’il n’a pas vu (ou ce qu’il a omis intentionnellement, car lui aussi, il avait un cadre et une école), je peux bien aller le chercher partout ailleurs. » Avant d’écrire l’histoire, Polybe la fit, et un siècle après ce que raconte Salammbô, il participa au siège de Carthage de 149 av. J.-C. Son récit est, ainsi que le note Flaubert, utilisé à des fins morales. Ce qui frappe c’est à quel point Flaubert a respecté le cadre de l’action, tout en instillant dans les interstices son propre récit, en appliquant sur ce squelette la chair des coutumes antiques picorées ici ou là pour en faire un organisme vivant. Ainsi pour la traduction-trahison de Spendius : « Mais qu’arriva-t-il ? souvent ou ils n’entendaient pas ce qu’il leur disait, ou les capitaines, après être convenus de quelque chose avec lui, rapportaient à leurs gens tout le contraire, les uns par ignorance, les autres par malice ». Flaubert attribue cette malice à Spendius, voilà tout. Le récit de Polybe ne dit rien évidemment de l’amour, hormis cette unique notation, lors de la reddition de Narr’Havas : « Amilcar […] lui fit serment de lui donner sa fille en mariage, pourvu qu’il demeurât fidèle aux Carthaginois. » Tout ce qui concerne Mâtho et Salammbô est inventé, mais pourquoi pas ? Une liberté avouée par Flaubert est que Hannon fut crucifié selon Polybe en Sardaigne, et que c’est un général Annibal qui le fut par Mâtho (pas le fils d’Hamilcar). La fin, le cannibalisme des mercenaires enfermés, le supplice de Mâtho, tout y est ; Flaubert n’a fait que broder.
L’Atelier de Flaubert
Ce volume de la Pléiade se termine par quelques pages d’inédits de la période 1851-1862 tirés de « l’Atelier de Flaubert ». Quelques pages d’un projet intitulé « Une nuit de Don Juan » brodent autour d’un Rodolphe amateur de baisades et d’une Anna, copie conforme d’une Bovary ou d’une Salammbô, pétrie de volupté mystique. Suit un projet intitulé « La Spirale », puis un « Ballet », enfin six « scénarios des carnets de travail », le tout à réserver aux spécialistes.
That’s all, folks !
– Lire le dossier sur Salammbô sur le site ami Méditerranées.
– Lire aussi nos articles sur Par les champs et par les grèves, Pierrot au sérail & La Tentation de Saint-Antoine, sur Madame Bovary, sur la Correspondance de Gustave Flaubert, et sur Gemma Bovery, roman graphique de Posy Simmonds inspiré de Madame Bovary.
– La question du bataillon sacré me semble illustrée, dans un tout autre contexte, par Les Maraudeurs attaquent (1962), film de Samuel Fuller basé sur une histoire vraie d’une armée d’engagés étasuniens pour une mission en Birmanie, pendant la Seconde Guerre mondiale.
– Lire notre parodie du chapitre XIII de Salammbô : « Salam Bobo », « Pfizhor ».
Voir en ligne : Le site de l’université de Rouen consacré à Salammbô
© altersexualite.com 2015
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Pour les références antiques, voir Vie de Pélopidas, chapitres XIX & XX, et Montesquieu, De l’Esprit des lois, livre IV, chapitre VIII. Voir aussi ce qu’en dit Jeremy Bentham dans Défense de la liberté sexuelle : écrits sur l’homosexualité.
 altersexualite.com
altersexualite.com