Accueil > Classiques > XIXe siècle > Erewhon, de Samuel Butler
Une autre dystopie britannique, pour lycéens & adultes
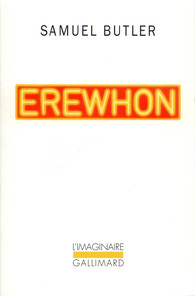 Erewhon, de Samuel Butler
Erewhon, de Samuel Butler
Gallimard, L’imaginaire, 1920 (1872), 322 p., épuisé
samedi 16 février 2019
Erewhon est présenté et traduit par Valery Larbaud. J’ai utilisé l’édition Gallimard, L’imaginaire, qui semble ne plus être disponible. Je n’avais jamais entendu nommer ce livre ni cet auteur, et il a fallu que j’en trouve mention dans Demain, les posthumains de Jean-Michel Besnier pour que j’aie envie de lire ce chef-d’œuvre. Il s’agit d’un écrivain assez fortuné pour avoir élevé des moutons en Nouvelle-Zélande, et d’ailleurs issu d’une lignée d’intellectuels. Comme votre serviteur, son livre a été refusé par les éditeurs, et il l’a publié lui-même, sauf qu’à l’époque, le public n’était pas grégaire, les critiques n’étaient pas tous des vendus, et un livre publié par son auteur pouvait être reconnu selon son mérite et non selon la marque commerciale inscrite en couverture (que les snobs appellent « éditeurs »). Bref, cette dystopie est originale en ce sens que d’une part le lieu fictif est basé sur l’expérience personnelle de l’auteur en Nouvelle-Zélande, et d’autre part, après avoir romancé une expédition rocambolesque du narrateur jusque dans cet étrange pays, l’auteur en imagine les rouages en une série de chapitres qui ressemblent à des dissertations philosophiques souvent teintées d’une ironie pince-sans-rire. Les trois chapitres consacrés au « Livre des machines » sont à citer intégralement, tellement ils sont originaux et prémonitoires. Cette partie du livre peut justifier que j’inscrive ce livre dans le thème de BTS « Corps naturel, corps artificiel ». Je me contenterai de citer quelques extraits, en vous recommandant de faire lire ce livre et de le présenter dans tous les CDI des lycées. À noter : Samuel Butler fut aussi peintre et musicien. La Tate britain possède sa toile la plus fameuse, citée par Valery Larbaud p. 17 : Mr Heatherley’s Holiday : An Incident in Studio Life.
P. 101 est nommée une chanson intitulée « La fille de l’attrapeur de rats » (« Ratcatcher’s daughter »), dont le titre me rappelle « La fille du coupeur de joints » de Thiéfaine ; mais rien n’indique qu’il y ait fait référence sciemment.
« Dans ce pays, si un homme tombe malade ou contracte une maladie quelconque, ou s’affaiblit physiquement d’une manière quelconque avant soixante-dix ans, il comparaît devant un jury composé de ses concitoyens, et s’il est reconnu coupable il est noté d’infamie et condamné plus ou moins sévèrement selon les cas. Les maladies sont classées en crimes et délits comme les violations de la loi chez nous : on est puni très sévèrement pour une maladie grave, tandis que l’affaiblissement de la vue ou de l’ouïe quand on a plus de soixante-cinq ans et qu’on s’est toujours bien porté jusque-là, n’est sujet qu’à une amende ou, à défaut de paiement, à la prison » (p. 117). Au contraire, le fait d’avoir escroqué son prochain est plutôt bien vu, et l’on doit juste consulter un « redresseur » qui vous prescrit une petite fustigation ; bref, le mal moral est traité comme en Europe on traite la maladie physique. C’est le principe même d’Erewhon dont le titre est le palindrome de « nowhere », le « wh » étant considéré comme un digramme intangible. C’est le calque d’Utopia, « en aucun lieu ».
« Pour en revenir aux coutumes funéraires d’Erewhon, il en est une que je ne peux guère passer sous silence. Lorsque quelqu’un meurt, les amis de la famille n’écrivent pas de lettres de condoléances, pas plus qu’ils n’assistent à l’éparpillement des cendres, et ils ne portent pas non plus le deuil ; mais ils envoient de petites boîtes remplies de larmes artificielles, avec le nom de l’envoyeur élégamment peint sur le couvercle. Le nombre des larmes varie de deux à quinze ou seize, selon le degré d’intimité ou de parenté ; et c’est quelquefois pour les gens une question d’étiquette très délicate que de déterminer le nombre de larmes qu’ils doivent envoyer. Si singulier que cela paraisse, on fait grand cas de cette attention, et on éprouve un vif mécontentement lorsque les gens de la part de qui on l’attendait l’omettent. Dans les temps anciens ces larmes étaient collées avec du taffetas gommé sur les joues des parents et amis du défunt, et on les portait en public pendant quelques mois après la mort d’un parent. Plus tard on les relégua sur le chapeau. De nos jours on ne les porte plus » (p. 150).
« La vérité, c’est que Mahaïna, qui n’a pas de santé, fait semblant de s’enivrer pour que ses amis la traitent avec une indulgence qu’elle ne mérite pas. Elle n’est pas assez forte pour faire ses exercices de callisthénie, et elle sait qu’on l’obligerait à les faire si elle n’invoquait pas des causes morales pour justifier son incapacité » (p. 155). J’ai été heureux de retrouver ce « callisthénie » que j’avais découvert dans Histoire de la beauté : Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours, de Georges Vigarello.
Le principe du livre inscrit dans son titre étant l’inversion des valeurs, on enseigne la « déraison », et le chapitre « Les Collèges de Déraison » contient ce savoureux paragraphe : « Et même quand, malgré tous leurs subterfuges, ils se trouvent cloués, et forcés d’exprimer une opinion précise, il y a gros à parier qu ils entreprendront de défendre une théorie dont ils savent fort bien qu’elle est fausse. Il m’arriva très souvent de lire des comptes rendus et des articles, même dans leurs meilleures publications périodiques, entre les lignes desquels je découvrais sans grandes difficultés une signification exactement opposée à celle qui était mise en avant. Et cela est si bien compris de tout le monde qu’il faut n’être qu’un débutant dans les finesses de la bonne société érewhonienne pour ne pas soupçonner instinctivement un « oui » caché dans chacun des « non » qu’on trouve sur son chemin. Sans doute cela revient bien à peu près au même en fin de compte, car il importe peu que oui se dise « oui » ou « non », du moment qu’on sait ce qu’il faut entendre ; mais notre façon plus directe d’appeler un chat un chat, et non pas un chien avec l’intention que chacun comprenne qu’il s’agit d’un chat, me paraît plus commode » (p. 232). Ce même chapitre introduit le thème de la guerre entre machinistes et « antimachinistes » (p. 233).
C’est alors ce chef-d’œuvre interne que constituent les 3 chapitres du « Livre des machines », mise en abyme d’un traité scientifique à l’intérieur de ce livre d’aventures. « Un mollusque ne possède pas beaucoup de conscience. Songez aux extraordinaires progrès qu’ont faits les machines durant ces quelques derniers siècles, et remarquez avec quelle lenteur progressent le règne végétal et le règne animal. Les machines les plus hautement organisées sont des êtres, non pas même d’hier, mais d’il y a cinq minutes, si j’ose ainsi dire, en comparaison de l’âge de la terre. Admettons, pour la facilité de ce raisonnement, qu’il existe des êtres doués de conscience depuis environ vingt millions d’années, et voyez quels progrès ont fait les machines dans ces dix derniers siècles ! Le monde ne peut-il pas durer encore vingt millions d’années ? S’il dure aussi longtemps, que ne deviendront pas les machines ? et n’est-il pas plus prudent d’étouffer le mal dans l’œuf, et de leur interdire tout progrès ultérieur ? » (p. 236).
« Tout cela est très joli, mais peu à peu, par d’imperceptibles changements, le maître perce dans le serviteur ; et nous en sommes déjà arrivés au point que l’homme souffrirait terriblement s’il était forcé de se passer de machines. Si toutes les machines étaient anéanties au même instant, de telle sorte que rien ne fût laissé à l’homme : ni un couteau, ni un levier, ni un lambeau d’habit, rien que le corps tout nu avec lequel il est venu au monde ; et si toute connaissance des lois mécaniques lui était enlevée, en sorte qu’il ne pût plus faire de machines, et toute nourriture produite par des machines détruite, et qu’ainsi la race humaine fût laissée pour ainsi dire nue sur une île déserte, – nous disparaîtrions au bout de six semaines. Quelques individus pourraient traîner encore une misérable vie, mais même ceux-là, au bout d’un an ou deux, seraient tombés au-dessous des singes. L’homme doit son âme elle-même aux machines ; elle est un produit de la machine ; il pense comme il pense, il sent comme il sent, grâce aux changements qu’ont opérés en lui les machines, et leur existence est pour lui une question de vie ou de mort, exactement comme son existence est pour elles une condition sine qua non. C’est pour cela que nous ne demandons pas la destruction totale des machines. Mais certes cela prouve aussi que nous devrions détruire toutes celles qui ne nous sont pas absolument indispensables, de peur qu’elles n’étendent plus complètement encore leur domination tyrannique sur nous » (p. 245). Quelle modernité !
« Car beaucoup paraissent disposés à accepter un avenir aussi honteux. Ils disent : « Même si l’homme devient pour les machines ce que le chien et le chat sont pour nous, il continuera pourtant à vivre et se trouvera probablement mieux à l’état domestique sous la domination bienfaisante des machines, que dans l’état sauvage où il se trouve actuellement. Nous traitons nos animaux domestiques avec beaucoup de bienveillance. Nous leur donnons tout ce que nous pensons devoir leur faire le plus de bien, et il n’y a pas de doute que notre usage de la viande a augmenté leur bonheur plutôt qu’il ne l’a diminué. De même il y a lieu de croire que les machines nous traiteront avec bienveillance, car leur existence dépendra, pour bien des choses, de la nôtre. Elles nous mèneront avec une verge de fer, mais elles ne nous mangeront pas. Elles n’auront pas seulement besoin de nous pour la reproduction et pour l’éducation de leurs jeunes, mais encore pour être à leurs ordres comme domestiques, pour récolter leur nourriture et la mettre à portée d’elles, et pour enterrer leurs morts, ou bien pour retravailler leurs membres morts et en faire de nouvelles formes de la vie mécanique » (p. 261). Quelle prescience du transhumanisme !
« Regardez bêcher un homme : son avant-bras droit s’est allongé artificiellement et sa main est devenue une jointure. La poignée de la bêche est semblable au renflement qui est au bout de l’humérus, le manche est l’os rajouté, et la lame de fer oblongue est la nouvelle forme qu’a prise la main et qui permet à son possesseur de remuer la terre d’une façon à laquelle sa main primitive n’était pas adéquate » (p. 263)
« À quel point ne vivons-nous pas déjà, disait-il, au moyen de nos membres extérieurs ? Notre physique varie avec les saisons, l’âge, le plus ou moins d’argent que nous avons. S’il pleut, nous sommes pourvus d’un organe très pratique appelé parapluie et qui est expressément combiné pour protéger nos vêtements et notre peau des effets nuisibles de la pluie. L’homme a déjà un grand nombre de membres extra-corporels, qui lui sont plus utiles qu’une grande partie de ses cheveux ou, tout au moins, que sa moustache. Sa mémoire réside dans son carnet de poche. Il devient de plus en plus complexe à mesure qu’il avance en âge. Il apparaît alors pourvu de machines à voir, ou peut-être de dents et de cheveux artificiels ; et s’il est un spécimen vraiment bien développé de sa race, il ajoutera à sa personne une large caisse placée sur des roues, avec deux chevaux et un cocher » (p. 264).
Nous passons aux chapitres jumeaux XXVI et XXVII intitulés : « Opinions d’un Prophète érewhonien sur les droits des animaux » et « sur les droits des végétaux ». Le délire végan est prévu par ce prophète : « Le vieux prophète avait permis l’usage des œufs et du lait, mais ses disciples décidèrent que manger un œuf frais, c’était détruire un poulet en puissance, et que cela équivalait presque à tuer un poulet en vie. Seuls étaient permis, et tout juste, les œufs non frais, pourvu qu’on fût bien sûr qu’ils étaient trop vieux pour pouvoir être couvés ; mais tous les œufs à vendre devaient être présentés à un inspecteur qui, après avoir constaté qu’ils étaient stériles, leur collait une étiquette sur laquelle on lisait : « Garanti pondu d’au moins trois mois », et la date de la ponte. Ces œufs, ai-je besoin de le dire, n’étaient utilisés que dans les pâtisseries et comme remède dans certains cas où le besoin urgent d’un émétique se faisait sentir. Le lait fut interdit sous le prétexte qu’on ne pouvait s’en procurer sans priver un veau de sa nourriture naturelle, ce qui était mettre sa vie en danger » (p. 270). Le terme « ultra-végétariens » est utilisé (p. 272). « Là-dessus il y eut une réaction ; des lois sévères furent votées, qui interdisaient de manger de la viande sous quelque forme que ce fût, et de vendre dans les boutiques et les marchés autre chose que des grains, des fruits et des légumes. Ces lois furent faites environ deux cents ans après la mort du vieux prophète qui avait le premier inquiété l’esprit des gens au sujet des droits des animaux. Mais à peine eurent-elles été votées que le peuple se remit à les enfreindre » (p. 272). Dans le chapitre suivant, un autre philosophe a l’idée de procéder par l’absurde, mais son absurde est ce qui se passe actuellement (au XXIe siècle) : « Mais revenons à notre philosophe. J’en ai dit assez pour montrer la tendance générale des arguments sur lesquels il s’appuyait pour démontrer que les végétaux ne sont que des animaux sous un nom différent […]. La conclusion qu’il en tirait, ou qu’il prétendait en tirer, c’était que, s’il y avait impiété à tuer et à manger les animaux, il y avait aussi impiété à tuer les végétaux et à manger leurs graines. Pas un, disait-il, ne devait être mangé, sauf ceux qui étaient morts de mort naturelle, comme par exemple les fruits tombés au pied de l’arbre et prêts à pourrir, ou les feuilles de choux qui deviennent jaunes à la fin de l’automne. Il déclara que ces produits et les autres rebuts de ce genre-là constituaient la seule nourriture qu’on pût manger la conscience tranquille. Mais même dans ces cas, on devait planter les pépins des poires et des pommes qu’on avait mangées, et les noyaux des prunes et des cerises et toutes les graines, sans quoi ce serait presque se rendre coupable d’infanticide. Quant aux grains des céréales, selon lui, il ne fallait même pas songer à les manger, car chacun de ces grains possédait une âme vivante ni plus ni moins que l’homme, et avait autant que l’homme le droit de jouir de cette âme » (p. 284).
« Il est visible que cette réponse autorisait au moins la destruction de la vie végétale quand l’homme avait besoin d’elle pour se nourrir. Et le philosophe avait démontré avec tant de force que les animaux et les végétaux étaient logés à la même enseigne que, malgré tous les cris d’indignation des Puritains, les lois qui interdisaient l’usage de la viande furent abrogées à une majorité considérable. Et ainsi, après avoir erré pendant plusieurs siècles dans le désert de la philosophie, la nation parvint à des conclusions auxquelles le sens commun était depuis longtemps arrivé » (p. 285).
« En vérité je ne vois pas comment les Erewhoniens pourront être heureux, tant qu’ils n’auront pas réussi à comprendre que la raison non corrigée par l’instinct est chose aussi dangereuse que l’instinct non corrigé par la raison » (p. 286).
Menacé car suspect à cause de sa montre, le narrateur finit par s’évader avec sa bien-aimée, en faisant fabriquer un ballon sous prétexte de demander de la pluie au dieu de l’air. Sauvé de justesse au milieu de l’Océan, il n’a de cesse, à son retour à Londres, qu’il ne planifie une expédition coloniale cynique : « Dès que le capital sera réuni, je me charge de convertir les Erewhoniens, non seulement à la vraie religion, mais aussi en une source de profits considérables pour les actionnaires » (p. 304).
– Le thème de l’homme dominé par la machine qu’il a lui-même créée et nourrie se retrouve de façon métaphorique dans un film qui n’a pas été pris assez au sérieux : La Petite boutique des horreurs (1986) de Frank Oz. Ce n’est pas une machine, mais une mystérieuse plante carnivore venue sur terre à la faveur d’une éclipse, qui dévore l’homme après l’avoir instrumentalisé pour sa croissance.
– Dans la foulée du livre de Butler, j’ai lu le pamphlet de Georges Bernanos La France contre les robots. Exilé au Brésil, Bernanos y fulmine contre l’ère des machines et tout ce qui a subjugué l’homme, en des termes qui rappellent Butler : « Je n’ai jamais pensé que la question de la Machinerie fût un simple épisode de la querelle des Anciens et des Modernes. Entre le Français du XVIIe et un Athénien de l’époque de Périclès, ou un Romain du temps d’Auguste, il y a mille traits communs, au lieu que la Machinerie nous prépare un type d’homme… Mais à quoi bon vous dire quel type d’homme elle prépare. Imbéciles ! n’êtes-vous pas les fils ou les petits-fils d’autres imbéciles qui, au temps de ma jeunesse, face à ce colossal Bazar que fut la prétendue Exposition Universelle de 1900, s’attendrissaient sur la noble émulation des concurrences commerciales, sur les luttes pacifiques de l’Industrie ?… À quoi bon, puisque l’expérience de 1914 ne vous a pas suffi ? Celle de 1940 ne vous servira d’ailleurs pas davantage. Oh ! ce n’est pas pour vous, non ce n’est pas pour vous que je parle ! Trente, soixante, cent millions de morts ne vous détourneraient pas de votre idée fixe : « Aller plus vite, par n’importe quel moyen. » Aller vite ? Mais aller où ? Comme cela vous importe peu, imbéciles ! Dans le moment même où vous lisez ces deux mots : Aller vite, j’ai beau vous traiter d’imbéciles, vous ne me suivez plus. Déjà votre regard vacille, prend l’expression vague et têtue de l’enfant vicieux pressé de retourner à sa rêverie solitaire… « Le café au lait à Paris, l’apéritif à Chandernagor et le dîner à San Francisco », vous vous rendez compte !… Oh ! dans la prochaine inévitable guerre, les tanks lance-flammes pourront cracher leur jet à deux mille mètres au lieu de cinquante, le visage de vos fils bouillir instantanément et leurs yeux sauter hors de l’orbite, chiens que vous êtes ! La paix venue vous recommencerez à vous féliciter du progrès mécanique. « Paris-Marseille en un quart d’heure, c’est formidable ! » Car vos fils et vos filles peuvent crever : le grand problème à résoudre sera toujours de transporter vos viandes à la vitesse de l’éclair. Que fuyez-vous donc ainsi, imbéciles ? Hélas ! c’est vous que vous fuyez, vous-mêmes – chacun de vous se fuit soi-même, comme s’il espérait courir assez vite pour sortir enfin de sa gaine de peau… On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Hélas ! la liberté n’est pourtant qu’en vous, imbéciles » ! » (Éd. Le Castor astral 2017, p. 82. Voir cet extrait plus large sur ce site. Lire un autre extrait du livre de Bernanos.).
Voir en ligne : Article de Wikipédia
© altersexualite.com 2018
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com