Accueil > Classiques > XIXe siècle > La Petite Fadette, de George Sand
Mythe de l’androgyne & bouc émissaire, pour le lycée
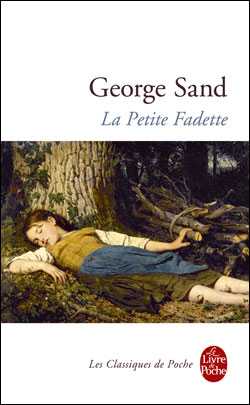 La Petite Fadette, de George Sand
La Petite Fadette, de George Sand
Le Livre de Poche, 1999 (1849), 284 p., 3,6 €.
samedi 18 avril 2020, par
George Sand (1804-1876), encore une auteure majeure que je n’avais jamais lue, honte à moi ! Je découvre donc tardivement cette écrivaine qu’on pourrait qualifier pour ce livre de précurseure de la littérature jeunesse, puisque les personnages de ce livre sont pris au berceau pour les amener au mariage en passant par les affres de l’adolescence, et qu’elle concentre son attention sur les rapports humains entre frères, entre parents et enfants, entre jeunes, et aux amours naissantes. Ce qui domine la première partie du livre, c’est une version confondante du mythe de l’androgyne de Platon, sous l’espèce de « bessons », jumeaux particulièrement fusionnels qui à l’époque, pouvaient passer pour l’allégorie d’un amour homosexuel. Puis on glisse insensiblement vers l’histoire d’un amour hétérosexuel initiatique, qui doit passer par une étape héroïque de rébellion contre une situation de bouc-émissaire. J’ai estimé que ce classique était suffisamment au cœur des préoccupations de ce site pour lui consacrer un article, en ajoutant un autre intérêt personnel : il s’agit d’un ouvrage exaltant et exhibant la ruralité avec son vocabulaire riche et suranné. Il n’y a pas une page sans au moins un de ces goûteux mots oubliés, expliqué en note dans l’édition utilisée, ce qui rappellera quelques souvenirs à ceux qui ont réussi à surmonter la même difficulté pour lire M&mnoux de votre serviteur. J’ai utilisé l’édition Livre de Poche introduite par Maurice Toesca et annotée par Marie-France Azéma.
Fadaises ? Pas si fade !
Le préfacier rappelle le contexte de la rédaction de cette œuvre faussement naïve : l’investissement de George Sand après la Révolution française de 1848, dans la Deuxième République, du moins entre sa montée à Paris le 20 mars et son retour à Nohant, désabusée, le 18 mai. Alors qu’elle avait exhorté son fils à ne pas se mêler à la bagarre et à rentrer à Nohant, c’est elle qui finit par monter à Paris et à s’activer auprès du nouveau ministre de l’Intérieur Alexandre Ledru-Rollin, rédigeant les Bulletins de la République, ce qui fait qu’elle s’amuse de donner des ordres à son fils, maire de Nohant. Très vite, elle se désolidarise du gouvernement et appelle à une nouvelle insurrection, ce qui lui vaut de quitter précipitamment Paris, mais elle revendique avec courage ce qu’elle a écrit : « Je suis en effet l’auteur du 16e Bulletin, et j’en accepte toute la responsabilité morale. […] Quand je disais dans l’abominable 16e Bulletin que le peuple a le droit de sauver la République, j’avais si fort raison que je remercie Dieu d’avoir eu cette inspiration si impolitique. Tout le monde l’avait aussi bien que moi ; mais il n’y avait qu’une femme assez folle pour oser l’écrire. Aucun homme n’eût été assez bête et assez mauvaise tête pour faire tomber de si haut une vérité si banale… Le hasard, qui est quelquefois la Providence, s’est trouvé là pour que l’étincelle mît le feu. J’en rirais sur l’échafaud si cela devait m’y envoyer » (cité p.13). On regrette d’ailleurs qu’elle ait raté une rencontre avec Victor Hugo dont l’engagement allait suivre, mais c’est oublier que les femmes à l’époque ne pouvaient avoir de fonction politique. Bref, elle se retire aux champs et écrit des « bergeries » pour ses « amis prisonniers ». Le livre est dédié « à Armand » (p. 26) ; ce n’est qu’en 1923 que fut inscrit le nom complet d’Armand Barbès, même si celui-ci a su de son vivant que le livre lui était dédié (p. 18). Comme pour son précédent livre François le Champi (1848), le narrateur est censé être un « chanvreur », c’est-à-dire un ouvrier qui vient à domicile préparer le chanvre dont on tissait les toiles. Le préfacier nous prévient d’éviter un contresens sur le mot « fadaises » par lequel l’auteure présente son œuvre : « Le mot « fadaise » ici ne vient pas du provençal fadeze – la sottise –, mais bien du berrichon « fade », […] « fade, fée », et « fadette » est le féminin de fadet, farfadet, etc. Donc les fadaises de George Sand sont des histoires de fées, non des histoires insignifiantes ou sottes » (p. 18).
« C’est tout de même une jolie paire de gars »
Dès la première page, le lexique paysan arrête la lecture comme des cailloux dans un labour : « charrois » (charrette) ; « une vigne de six journaux » (surface correspondant à une journée de travail d’un homme) ; « ouche » (verger clos proche de la maison), « guigne » (cerises ; les lecteurs de M&mnoux connaissent). Mais le mot important, c’est « bessons », les jumeaux qui adviennent au père Barbeau (et à sa femme sans doute ?). L’aîné est nommé « Sylvain, dont on fit bientôt Sylvinet […] et le cadet fut appelé Landry ». Chacun s’empresse de jacasser ses racontars sur le devenir des jumeaux, ce qui fait douter le père : « À la bonne heure ! fit le père Barbeau en se grattant la tête ; mais j’ai ouï dire que les bessons prenaient tant d’amitié l’un pour l’autre, que quand ils se quittaient ils ne pouvaient plus vivre, et qu’un des deux, tout au moins, se laissait consumer par le chagrin, jusqu’à en mourir » (ch. I). On conseille de les séparer de temps en temps, mais ils grandissent au mieux, de sorte que « chacun s’en allait disant : « C’est tout de même une jolie paire de gars. » » (ch. II), et puis la mère est trop indulgente, de sorte qu’on n’ose plus les séparer : « Bonheur ou malheur, cette amitié-là augmentait toujours avec l’âge, et le jour où ils surent raisonner un peu, ces enfants se dirent qu’ils ne pouvaient pas s’amuser avec d’autres enfants quand un des deux ne s’y trouvait pas ; et le père ayant essayé d’en garder un toute la journée avec lui, tandis que l’autre restait avec la mère, tous les deux furent si tristes, si pâles et si lâches au travail, qu’on les crut malades. Et puis quand ils se retrouvèrent le soir, ils s’en allèrent tous deux par les chemins, se tenant par la main et ne voulant plus rentrer, tant ils avaient d’aise d’être ensemble, et aussi parce qu’ils boudaient un peu leurs parents de leur avoir fait ce chagrin-là. On n’essaya plus guère de recommencer, car il faut dire que le père et la mère, mêmement les oncles et les tantes, les frères et les sœurs, avaient pour les bessons une amitié qui tournait un peu en faiblesse ». La complicité est roublarde : « Ils étaient fort malins, et quelquefois, pour qu’on les laissât tranquilles, ils faisaient mine de se disputer et de se battre ; mais ce n’était qu’un amusement de leur part, et ils n’avaient garde, en se roulant l’un sur l’autre, de se faire le moindre mal ; si quelque badaud s’étonnait de les voir en bisbille, ils se cachaient pour rire de lui, et on les entendait babiller et chantonner ensemble comme deux merles dans une branche » (ch. II). Continuons à glaner quelques mots du terroir : « Aussitôt que l’enfant vit les grands bœufs du père Caillaud, qui étaient les mieux tenus, les mieux nourris et les plus forts de race de tout le pays, il se sentit chatouillé dans son orgueil d’avoir une si belle aumaille au bout de son aiguillon » : l’aumaille, c’est l’ensemble des bêtes à cornes, du latin animalia, sur le modèle de « volaille » de volatilia.
« Comme un pigeon qui court après sa pigeonne »
Quand la décision est prise de faire embaucher l’aîné dans une ferme voisine, c’est un déchirement pour Sylvinet, qui ne peut même pas supporter que son besson soit parti à l’aube sans l’embrasser, à la demande du père : « il se prit de courir du côté de la Priche, sans même songer où il allait, mais se laissant emporter par son instinct comme un pigeon qui court après sa pigeonne sans s’embarrasser du chemin » (ch. IV). De telles comparaisons accréditent une lecture homosexuelle de la fable, d’autant que Landry craint les commérages : « Il craignit d’être moqué par les jeunes gens et les gars de la Priche pour cette amitié bessonnière qui passait pour une sorte de maladie, si bien que Sylvinet le trouva à table, buvant et mangeant comme s’il eût été toute sa vie avec la famille Caillaud ». Et quand Sylvinet survient, l’aîné réprime son premier mouvement : « Mais il n’osa, parce que ses maîtres le regardaient curieusement, se faisant un amusement de voir dans cette amitié une chose nouvelle et un phénomène de nature, comme disait le maître d’école de l’endroit » (ch. V). « Amitié bessonnière » ; « phénomène de nature » : quels beaux euphémismes ! C’est surtout pour Sylvinet que cela devient « une amitié qui tournait en fièvre et en langueur ». Il est jaloux des nouvelles amitiés de son frère : « Alors le pauvre enfant se mettait en l’esprit un souci que, devant, il n’avait eu, à savoir qu’il était le seul à aimer, et que son amitié lui était mal rendue ; que cela avait dû exister de tout temps sans être venu d’abord à sa connaissance ; ou bien que, depuis un temps, l’amour de son besson s’était refroidi, parce qu’il avait rencontré par ailleurs des personnes qui lui convenaient mieux et lui agréaient davantage » (ch. VI). Et ce qui doit arriver arrive : « Enfin Landry avait appris à danser à la Priche, et quoique ce goût lui fût venu tard, à cause que Sylvinet ne l’avait jamais eu, il dansait déjà aussi bien que ceux qui s’y prennent dès qu’ils savent marcher. Il était estimé bon danseur de bourrée à la Priche, et quoiqu’il n’eût pas encore de plaisir à embrasser les filles, comme c’est la coutume de le faire à chaque danse, il était content de les embrasser, parce que cela le sortait, par apparence, de l’état d’enfant ; et il eût même souhaité qu’elles y fissent un peu de façon comme elles font avec les hommes. Mais elles n’en faisaient point encore, et mêmement les plus grandes le prenaient par le cou en riant, ce qui l’ennuyait un peu » (ch. VII). La jalousie atteint tellement Sylvinet, qu’il s’enfuit à l’arrivée de Landry le dimanche, et que celui-ci s’en inquiète, ce qui rassure la mère qui a comme qui dirait une petite préférence pour le plus fragile : « Cette idée, que Sylvinet pouvait avoir eu envie de se détruire, passa de la tête de la mère dans celle de Landry aussi aisément qu’une mouche dans une toile d’araignée, et il se mit vivement à la recherche de son frère » (ch. VIII).
« Moitié de gars qui a perdu son autre moitié ! »
C’est là qu’intervient la Fadette, qui tout d’abord se moque de Landry sur le même ton : « Le vilain besson, moitié de gars qui a perdu son autre moitié ! » (ch. IX). Grâce à la Fadette, les frères se retrouvent, mais elle a obligé Landry à une promesse. Les deux frères se différencient parce que Landry travaille de force : « Les petites différences qu’on avait toujours observées entre eux devinrent plus marquantes, et, de leur esprit, passèrent sur leur figure. Landry, après qu’ils eurent compté quinze ans, devint tout à fait beau garçon, et Sylvinet resta un joli jeune homme, plus mince et moins couleuré que son frère. Aussi, on ne les prenait plus jamais l’un pour l’autre, et, malgré qu’ils se ressemblaient toujours comme deux frères, on ne voyait plus du même coup qu’ils étaient bessons. Landry, qui était censé le cadet, étant né une heure après Sylvinet, paraissait à ceux qui les voyaient pour la première fois, l’aîné d’un an ou deux » (ch. X). L’histoire prend alors une autre tournure, et il s’agit d’apprendre à un adolescent de discerner sagesse et beauté des apparences trompeuses. La Fadette, mal fagotée et auréolée d’une vague réputation familiale de sorcellerie, lui rappelle sa promesse et l’engage à danser avec elle et seulement elle au prochain bal, ce qui fait enrager la Madelon, une jeune coquette qui croyait avoir Landry sous sa coupe sans que rien n’ait été dit entre eux. Elle encourage les jeunes à maltraiter la Fadette, mais Landry, bien qu’il n’éprouve aucun sentiment pour Fadette, laisse parler son bon cœur : « Landry avait perdu sa honte ; il se sentait brave et fort, et un je ne sais quoi de l’homme fait lui disait qu’il remplissait son devoir en ne laissant pas maltraiter une femme, laide ou belle, petite ou grande, qu’il avait prise pour sa danseuse, au vu et su de tout le monde » (ch. XVI).
C’est le début d’un lent apprivoisement des deux jeunes gens où chacun tente d’éclairer l’autre par un assaut de bons sentiments, et loin de le flatter, en lui révélant la vérité : « Eh bien, Fanchon Fadet, puisque tu parles si raisonnablement, et que, pour la première fois de ta vie, je te vois douce et traitable, je vas te dire pourquoi on ne te respecte pas comme une fille de seize ans devrait pouvoir l’exiger. C’est que tu n’as rien d’une fille et tout d’un garçon, dans ton air et dans tes manières ; c’est que tu ne prends pas soin de ta personne. Pour commencer, tu n’as point l’air propre et soigneux, et tu te fais paraître laide par ton habillement et ton langage » (ch. XVIII). Fanchon lui répond avec la même franchise : « C’est possible que je t’aie haï un peu, répondit la petite Fadette ; mais si cela a été, cela n’est plus à partir d’aujourd’hui, et je vas te dire pourquoi, Landry. Je te croyais fier, et tu l’es ; mais tu sais surmonter ta fierté pour faire ton devoir, et tu y as d’autant plus de mérite. Je te croyais ingrat, et, quoique la fierté qu’on t’a enseignée te pousse à l’être, tu es si fidèle à ta parole que rien ne te coûte pour t’acquitter ; enfin, je te croyais poltron, et pour cela j’étais portée à te mépriser ; mais je vois que tu n’as que de la superstition, et que le courage, quand il s’agit d’un danger certain à affronter, ne te fait pas défaut. Tu m’as fait danser aujourd’hui, quoique tu en fusses bien humilié » (ch. XX). Landry veut un baiser (comme c’est coutume quand on a dansé ensemble), mais elle refuse croyant qu’il se moque. Landry est perplexe, et mettra longtemps à se défaire d’une crainte de sorcellerie : « Il faut qu’elle soit charmeuse comme on le dit, bien qu’elle s’en défende, pensait-il, car pour sûr elle m’a ensorcelé hier soir, et jamais dans toute ma vie, je n’ai senti pour père, mère, sœur ou frère, non pas, certes, pour la belle Madelon, et non pas même pour mon cher besson Sylvinet, un élan d’amitié pareil à celui que, pendant deux ou trois minutes, cette diablesse m’a causé. S’il avait pu voir ce que j’avais dans le cœur, mon pauvre Sylvinet, c’est du coup qu’il aurait été mangé par la jalousie » (ch. XX). Fadette va encore plus loin, et se persuade, et persuade presque Landry, qu’il ne peut pas l’aimer elle, qui est si laide, mais qu’il aime et est aimé de Madelon. Elle s’imagine avoir à réparer une faute en parlant à la jeune femme pour la persuader qu’il n’aime qu’elle. Mais l’autre l’envoie balader, et par chance, Landry a entendu leur conversation. Son amour naissant pour la Fadette en est renforcé. Mais voilà que Fanchon suit ses conseils, et prend soin de son apparence, de sorte que la trouvant comme tout le village, brusquement embellie, voilà de nouveaux soupçons de sorcellerie ! « Landry, la voyant si changée, laissa tomber son livre d’heures, et, au bruit qu’il fit, la petite Fadette se retourna tout à fait et le regarda, tout en même temps qu’il la regardait. Et elle devint un peu rouge, pas plus que la petite rose des buissons ; mais cela la fit paraître quasi belle, d’autant plus que ses yeux noirs, auxquels jamais personne n’avait pu trouver à redire, laissèrent échapper un feu si clair qu’elle en parut transfigurée. Et Landry pensa encore : « Elle est sorcière ; elle a voulu devenir belle de laide qu’elle était, et la voilà belle par miracle. » Il en fut comme transi de peur, et sa peur ne l’empêchait point pourtant d’avoir une telle envie de s’approcher d’elle et de lui parler, que, jusqu’à la fin de la messe, le cœur lui en sauta d’impatience » (ch. XXII). On joue alors à « je t’aime, moi non plus », et c’est tout naturel pour ce roman qui nous semble un ancêtre de la littérature jeunesse : « Et, faisant retour sur lui-même, Landry s’imagina qu’en effet la petite Fadette n’avait pour lui que de l’amitié bien tranquille ; et, parce qu’il n’était ni vain ni fanfaron, il se trouva aussi craintif et aussi peu avancé auprès d’elle que s’il n’eût point entendu de ses deux oreilles ce qu’elle avait dit de lui à la belle Madelon » (ch. XXIV). L’opinion se retourne progressivement à propos de la Fadette, compte tenu de sa métamorphose : « Et puis la raison vient, dit le père Naubin, et une fille qui s’en ressent apprend à se rendre élégante et agréable. Il est bien temps que le grelet s’aperçoive qu’elle n’est point un garçon. Mon Dieu, on pensait qu’elle tournerait si mal que ça serait une honte pour l’endroit » (ch. XXIV). Landry est bien piqué, mais songe à préserver son frère : « S’il y mettait de la précaution, c’était à cause de son besson, dont il connaissait la jalousie et qui avait eu déjà un grand effort à faire pour accepter sans dépit l’amourette que Landry avait eue pour Madelon, amourette bien petite et bien tranquille au prix de ce qu’il sentait maintenant pour Fanchon Fadet » (ch. XXVI).
« Alors toute la jeunesse femelle s’en mêla »
Cependant Sylvinet surprend à l’oreille son frère avouant son amour à une fille, sans savoir laquelle, et il s’en rend malade de jalousie, de sorte que sa mère consulte plusieurs médecins. Le narrateur (qui est censé être un homme, rappelons-le) ne manque pas une allusion misogyne : « Alors toute la jeunesse femelle s’en mêla, car lorsqu’un garçon de belle mine et de bon avoir s’occupe d’une personne, c’est comme une injure à toutes les autres, et si l’on peut trouver à mordre sur cette personne-là, on ne s’en fait pas faute. On peut dire aussi que, quand une méchanceté est exploitée par les femmes, elle va vite et loin » (ch. XXVIII). Le père Barbeau a vent de l’aventure de son fils, et le convoque ; il a même entendu dire que la Fadette serait enceinte. Aucun clash cependant car le roman se veut édifiant, et le père comme le fils, comme la Fadette, agissent en modèles de vertu. Le père : « Le père n’exigea aucune promesse, sachant bien que, dans les cas d’amour, ces promesses-là sont chanceuses, et ne voulant point compromettre son autorité ; mais il fit comprendre à Landry que ce n’était point fini et qu’il y reviendrait » (p. 197). La Fadette prend la décision qu’il faut : quitter le pays et s’engager auprès d’une vieille fille irréprochable d’un pays voisin. Elle part même sans adieux, mais Landry se précipite sur son chemin et reçoit un cadeau d’adieu : « mais elle le releva et lui donna un vrai baiser d’amour dont il faillit mourir ; car c’était le premier qu’il eût jamais reçu d’elle, ni d’aucune autre » (ch. XXIX). Sylvinet tombe en langueur, et la guérisseuse du coin livre son diagnostic :
« — Il n’y aurait qu’une chose pour sauver votre enfant, c’est qu’il aimât les femmes.
— Et justement il ne les peut souffrir, dit la mère Barbeau : jamais on n’a vu un garçon si fier et si sage, et, depuis le moment où son besson s’est mis l’amour en tête, il n’a fait que dire du mal de toutes les filles que nous connaissons. Il les blâme toutes de ce qu’une d’entre elles (et malheureusement ce n’est pas la meilleure) lui a enlevé, comme il prétend, le cœur de son besson » (ch. XXXI). Le père Barbeau finit par mener son enquête, et tout conclut en faveur de la Fadette, qui n’était pas enceinte, et dont tout le monde atteste la valeur morale. Lorsqu’elle finit par revenir dans le pays à la mort de sa grand-mère, les circonstances (j’évite de « spoiler ») lui permettent d’épouser dans les meilleures conditions Landry, et elle utilise ses capacités sinon sa sorcellerie, pour guérir Sylvinet de sa langueur psychique, de sorte qu’il retourne comme un gant ses sentiments hostiles à son égard, et tout est bien qui finit bien, dans l’hétérosexualité triomphante, ce qui n’empêche pas que ce roman est, de façon subreptice et toute symbolique, l’une des premières évocations de l’amour entre deux garçons.
Voir en ligne : La Petite Fadette, sur Wikisource
© altersexualite.com 2020
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com