Accueil > Classiques > XIXe siècle > L’Homme qui rit, de Victor Hugo
Nouvelle de 800 pages, pour lycéens courageux
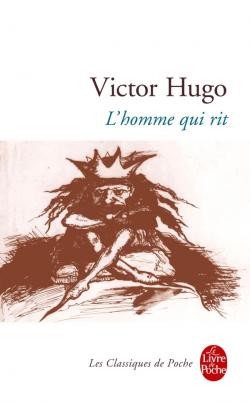 L’Homme qui rit, de Victor Hugo
L’Homme qui rit, de Victor Hugo
Le Livre de Poche, 2002 (1869), 864 p., 6,95 €
samedi 18 mai 2013
Je n’avais pas encore lu ce pensum tardif du grand homme, pas plus que Les Travailleurs de la mer, paru trois ans plus tôt. Heureusement, car si je l’avais lu avant Les Misérables, mon admiration y aurait-elle survécu ? Hugo semble s’ennuyer à Guernesey, et pond ce pesant traité d’histoire anglaise sur fond de nouvelle à la limite du fantastique. Si l’on retire les 95 % de digressions, il ne reste du roman que quelques épisodes d’une nouvelle grandguignolesque tout entière inventée pour justifier une scène finale précipitée, le fameux discours devant la chambre des Lords, qui rappelle le fameux « Discours sur la Misère » prononcé par Hugo pair de France. Une fois crachée cette Valda, Hugo jette son bouffon à la mer, et basta ! Là où le jeune Hugo de Claude Gueux en aurait fait une belle nouvelle – entendons-nous bien, une fois ôtée la graisse, cela reste une histoire splendide ! – ou une pièce saisissante, le vieil ermite de Guernesey, grand trousseur de soubrettes devant l’Éternel, nous trousse un mélo nœud-nœud en diable, avec des personnages taillés à la serpe, et une conception de l’amour qui semble tenir du missel plus que de l’alcôve. L’évanescente (Éva naissante) Dea ne fait que donner du sel à Josiane, l’aristocratique putain. J’ai utilisé l’érudite édition de Myriam Roman, avec la collaboration de Delphine Gleizes (2002). De ce noyau génial, le réalisateur Jean-Pierre Améris a tiré un des plus magistral navet de l’adaptation cinématographique, que je n’ai vu qu’après avoir terminé ma lecture. J’en causerai in cauda, comme ça se doit.
Faut-il y voir un hasard, l’année même où le mot « homosexuel » est inventé par Karl-Maria Kertbeny (mot attesté en français en 1891 seulement, après la mort de Hugo), Hugo invente le personnage du loup Homo, qui forme une sorte de couple à tous les sens du terme (paire, lien de chiens de chasse, couple d’amoureux) avec le philosophe misanthrope philanthrope Ursus, au point qu’on aurait envie de prendre homo, pardon, au mot, l’argument favori des adversaires homophobes du « mariage gay » selon lequel avec cette innovation, on pourrait aussi bien se marier avec son chien ! Ursus est présenté comme un Diogène narcissique, amateur de soliloques : « Il avait cette faculté hermaphrodite d’être son propre auditoire » (p. 45). « Sa grande affaire était de haïr le genre humain » (p. 65) : il soigne les malheureux pour qu’ils souffrent plus longtemps, façon de dissimuler sa bonté sous une misanthropie bourrue.
La tératologique nous vaut quelques pages amusantes impossibles à vérifier, tant Hugo, dès qu’il s’agit d’enfants, tomberait à pieds joints dans toutes les affaires Outreau imaginables. Par exemple, cettre légende de l’enfant en pot, digne des Idées noires de Franquin : « En Chine, de tout temps, on a vu la recherche d’art et d’industrie que voici : c’est le moulage de l’homme vivant. On prend un enfant de deux ou trois ans, on le met dans un vase de porcelaine plus ou moins bizarre, sans couvercle et sans fond, pour que la tête et les pieds passent. Le jour on tient ce vase debout, la nuit on le couche pour que l’enfant puisse dormir. L’enfant grossit ainsi sans grandir, emplissant de sa chair comprimée et de ses os tordus les bossages du vase. Cette croissance en bouteille dure plusieurs années. À un moment donné, elle est irrémédiable. Quand on juge que cela a pris et que le monstre est fait, on casse le vase, l’enfant en sort, et l’on a un homme ayant la forme d’un pot.
C’est commode ; on peut d’avance se commander son nain de la forme qu’on veut. »
Le tic de la phrase sentencieuse ajoutée en paragraphe séparé comme ci-dessus prend une proportion exceptionnelle dans ce livre. Ajouter des sentences redondantes sur des digressions qui sont déjà des sentences. Hugo yoyote de la touffe. Comme l’enfant en pot, on trouve comprimées de force dans cette dame-jeanne intitulée roman, tous le fatras que Hugo aurait naguère rangé dans des manuscrits séparés, de Choses vues, de Discours, etc. Voici un paragraphe intéressant en soi, sur le vagabondage : « On n’inquiétait ni le saltimbanque, ni le barbier ambulant, ni le physicien, ni le colporteur, ni le savant en plein vent, attendu qu’ils ont un métier pour vivre. Hors de là, et à ces exceptions près, l’espèce d’homme libre qu’il y a dans l’homme errant faisait peur à la loi. Un passant était un ennemi public possible. Cette chose moderne, flâner, était ignorée ; on ne connaissait que cette chose antique, rôder. La « mauvaise mine », ce je ne sais quoi que tout le monde comprend et que personne ne peut définir, suffisait pour que la société prît un homme au collet. Où demeures-tu ? Que fais-tu ? Et s’il ne pouvait répondre, de dures pénalités l’attendaient. » (p. 81). Hugo s’amuse à pétrifier le lecteur sous ce que Jean Gaudon appelle « effet de savoir », l’exhibition l’air de pas y toucher, de sa documentation pléthorique (comment faisait-il, à Guernesey ?). En voici un exemple amusant : « Un des à peu près de femme mêlés au groupe avait un rosaire presque pareil pour la grosseur des grains à un rosaire de derviche, et facile reconnaître pour un rosaire irlandais de Llanymthefry, qu’on appelle aussi Llanandiffry. » (p. 95).
Ça commence enfin
Après 200 pages de préparation, la rencontre entre les trois personnages principaux, longuement préparée, par laquelle aurait commencé un roman moderne (et un film), a enfin lieu. Gwynplaine, ayant recueilli Dea mourante dans la neige, frappe à la porte d’Ursus comme Jean Valjean à celle de Mgr Myriel, après avoir tenté en vain toutes les autres portes du village, et la porte s’ouvre paradoxalement, après que l’ours les eut priés de s’en aller (p. 235). Dans sa cahute minuscule, Ursus, sorte de Hugo miniature, possède toute l’érudition du proscrit. Il est capable de dénicher dans la demi-seconde l’in-folio en latin qui explique l’opération dont a été victime l’enfant (opération limitée dans les films à l’ouverture de la bouche, pour ne pas trop défigurer le jeune premier qui prend le rôle) : « La bouche fendue jusqu’aux oreilles, les gencives à nu et le nez écrasé, tu seras masque et riras toujours » dit la traduction en bas de page (p. 255). Plus loin, le texte insiste : « nares habens mutilas » (ayant les narines mutilées ; p. 385), là aussi négligé des adaptations. Hugo ne s’identifie pas qu’en Ursus, mais aussi en Lord Clancharlie, le père de Gwynplaine, exilé sous Charles II par fidélité à Cromwell : « Cet homme était hors de son pays, presque hors de son siècle » (p. 261), et en Gwynplaine lui-même. Il fait de l’ironie sur le retour à la monarchie, avec un de ces épiphonèmes dont il a le secret : « Les citoyens sont un attelage, et l’attelage n’est pas le cocher. Mettre aux voix, c’est jeter aux vents » (p. 266). Le mot épiphonème étant d’ailleurs utilisé plusieurs fois dans le roman : « L’expectoration d’une sentence soulage. Le loup est consolé par le hurlement, le mouton par la laine, la forêt par la fauvette, la femme par l’amour, et le philosophe par l’épiphonème » ; « Grumphll est un épiphonème comme un autre. Salut, population grouillante. Que vous soyez tous de la canaille, je n’en fais nul doute. Cela n’ôte rien à mon estime » (p. 44 ; p. 621). Ursus n’en est pas avare : « Je méprise scientifiquement la science. L’ignorance est une réalité dont on se nourrit ; la science est une réalité dont on jeûne. En général on est forcé d’opter : être un savant, et maigrir ; brouter, et être un âne. O citoyens, broutez ! La science ne vaut pas une bouchée de quelque chose de bon. J’aime mieux manger de l’aloyau que de savoir qu’il s’appelle le muscle psoas. » (p. 622).
Lord David Dirry-Moir et sa compagne Josiane avec qui il recule le mariage pour rester amants sont présentés en parallèle : « N’avoir de lien que le plus tard possible, cela lui semblait un prolongement du bel âge. Les jeunes hommes retardataires abondaient dans ces époques galantes ; on grisonnait dameret » (p. 283). Ce dernier mot est une sorte de « chochotte », désigne en tout cas un homme efféminé. Bref, David est un Don Juan assez sympathique dans son inconséquence, de même Josiane : « Elle vivait dans on ne sait quelle attente d’un idéal lascif et suprême. » (p. 287). Dans son érudition, Hugo cite une dizaine de précédents, parmi lesquels « Marie-Thérèse d’Espagne avait été « un peu familière » avec un nègre. D’où l’abbesse noire. » (p. 290). Plusieurs pages racontent les atrocités commises par les jeunes lords sur le peuple : « D’autres « tapaient le lion », c’est-à-dire arrêtaient en riant un passant, lui écrasaient le nez d’un coup de poing, et lui enfonçaient leurs deux pouces dans les deux yeux. Si les yeux étaient crevés, on les lui payait. » (p. 303). Du « dameret », Hugo pousse à une sorte d’Oscar Wilde avant la lettre, mais hugolien, demeure dans l’allusion cryptée : « Le vrai seigneur est celui qui goûte de l’homme du peuple ; c’est pourquoi lord David hantait les tavernes et les cours des miracles de Londres et des Cinq-Ports. Afin de pouvoir au besoin, sans compromettre son rang dans l’escadre blanche, se colleter avec un gabier ou un calfat, il mettait, quand il allait dans ces bas-fonds, une jaquette de matelot. » (p. 306). Quant à la reine Anne, Hugo emploi un néologisme qu’on aurait cru postérieur d’un siècle : « Elle ne haïssait point le fun, la farce taquine et hostile. » (p. 308). La légende des nains sur des épaules de géants trouve une belle actualisation dans une digression : « Une habitude idiote qu’ont les peuples, c’est d’attribuer au roi ce qu’ils font. Ils se battent. A qui la gloire ? au roi. Ils paient. Qui est magnifique ? Le roi. Et le peuple l’aime d’être si riche. Le roi reçoit des pauvres un écu et rend aux pauvres un liard. Qu’il est généreux ! Le colosse piédestal contemple le pygmée fardeau. Que Myrmidon est grand ! il est sur mon dos. Un nain a un excellent moyen d’être plus haut qu’un géant, c’est de se jucher sur ses épaules. Mais que le géant laisse faire, c’est là le singulier ; et qu’il admire la grandeur du nain, c’est là le bête. Naïveté humaine. » (p. 312). L’idiosyncrasie de Barkilphedro, le vrai méchant de l’histoire, nous vaut quelques belles pages sur l’ingratitude de qui reçoit un bienfait : « Le bienfait a une adhérence visqueuse et répugnante qui vous ôte vos libres mouvements. Les odieux êtres opulents et gavés dont la pitié a sévi sur vous le savent. C’est dit. Vous êtes leur chose. Ils vous ont acheté. Combien ? un os, qu’ils ont retiré à leur chien pour vous l’offrir. Ils vous ont lancé cet os à la tête. Vous avez été lapidé autant que secouru. C’est égal. Avez-vous rongé l’os, oui ou non ? Vous avez eu aussi votre part de la niche. Donc remerciez. Remerciez à jamais. Adorez vos maîtres. » (p. 347).
Une histoire d’amour sans curés mais avec pudicité curetonne
Là où notre ami Hugo est fidèle à lui-même, c’est-à-dire incohérent, c’est quand cet homme de gauche anticlérical, vivant en trouple avec femme et maîtresse, construit ses personnages d’enfants abandonnés, élevés par un misanthrope, dépourvus de la moindre doctrine assenée par quelque cureton que ce soit, comme s’ils étaient terrorisés par la culpabilité du péché originel. Cela n’a aucun sens. Au lieu de se sauter dessus à l’adolescence (ou plutôt que Gwynplaine se tape des jeunes fermières ou soubrettes en attendant que Dea grandisse), ils se fuient comme de pieuses ouailles terrorisées par l’enseignement religieux : « Gwynplaine rougissait, baissait les yeux, ne savait que devenir devant cette chair naïve, balbutiait, détournait la tête, avait peur, et s’en allait, et ce Daphnis des ténèbres prenait la fuite devant cette Chloë de l’ombre » (p. 390). Pourtant dans la même page, il évoque « Otaïti », référence à Diderot qui un siècle avant, était moins coincé que lui ! « Dea avait la beauté ; Gwynplaine avait la lumière. Chacun apportait sa dot ; et ils faisaient plus que le couple, ils faisaient la paire ; séparés seulement par l’innocence, interposition sacrée. » (p. 400). Hugo fait donc partie de ces faux libertins, qui ont besoin des coups de pied au cul de la morale catho pour marcher droit. Il en est parfois un peu conscient : « Trop de paradis, l’amour en arrive à ne pas vouloir cela. Il lui faut la peau fiévreuse, la vie émue, le baiser électrique et irréparable, les cheveux dénoués, l’étreinte ayant un but. Le sidéral gêne. L’éthéré pèse. L’excès de ciel dans l’amour, c’est l’excès de combustible dans le feu ; la flamme en souffre. » (p. 497). Ursus est un vrai père gay : « Ursus avait été pour Gwynplaine et Dea à peu près père et mère » (p. 393). Hugo nous glisse son petit conseil de grand-père pro : « Avoir des petits, c’est là le bleu. Aie des mioches, torche-les, mouche-les, couche-les, barbouille-les et débarbouille-les, que tout cela grouille autour de toi ; s’ils rient, c’est bien ; s’ils gueulent, c’est mieux ; crier, c’est vivre ; regarde-les téter à six mois, ramper à un an, marcher deux ans, grandir à quinze ans, aimer à vingt ans. Qui a ces joies, a tout » (p. 423). Quand Josiane arrive au débotté l’applaudir dans les bas-fonds de Londres, le désir saisit « cet éphèbe attardé, resté adolescent à vingt-quatre ans » (p. 508). L’amour éthéré de Dea lui fait oublier facilement la lettre enflammée et directe de la duchesse nymphomane qui lui écrit qu’elle le veut (p. 511). On est bien dans le catéchisme, et non dans un roman réaliste ! Ce n’est pas dans la sexualité qu’on retrouve le réalisme, mais dans la séance de torture de Hardquanonne. On lui propose la mansuétude d’être seulement exécuté s’il avoue, avec la largesse de bénéficier d’une « scortum ante mortem » (prostituée avant la mort) ! (p. 554). Cela n’empêche pas le malfrat de mourir de rire, au sens propre du terme : « Il a ri, cela l’a tué » (p. 570). Quand Gwynplaine se sait Lord, sa première réaction est étonnante, au regard de la suite : « Je sentais bien sous mes haillons palpiter autre chose qu’un misérable, et, quand je me tournais du côté des hommes, je sentais bien qu’ils étaient le troupeau, et que je n’étais pas le chien, mais le berger ! » (p. 599). La déclaration de Josiane, qui ne sait pas encore que Gwynplaine est destiné à être son mari, s’oppose en tout point, antithèse tellement hugolienne, à Dea : « – Je me sens dégradée près de toi, quel bonheur ! Être altesse, comme c’est fade ! Je suis auguste, rien de plus fatigant. Déchoir repose. Je suis si saturée de respect que j’ai besoin de mépris. » (p. 674). Le pauvre monstre décidément bien benêt, ne profite pas de l’occasion (autres temps, autres mœurs, dans une suite de Sofitel, on sauterait sur une belle jeune femme qui se délecterait de sauter un monstre !), et patatras ! Voilà qu’ils sont promis en mariage, et c’est la douche écossaise immédiate : « Ah ! vous êtes mon mari ! Rien de mieux. Je vous hais. » (p. 684).
Le discours à la chambre des Lords
La partie finale est constituée du scandale à la chambre des Lords. Hugo n’a pas profité une ligne de la situation géniale qu’il a mis 600 pages à créer : Gwynplaine n’essaie pas un instant de se créer une chance de ne pas échouer dans sa tentative, en explorant son domaine et en expérimentant la vie de lord et de châtelain après celle de pauvre et de vagabond. Cela n’empêche pas en attendant les plaisanteries hugoliennes, ainsi sur la pauvre Josiane : « — Épouser la duchesse Josiane, lord Mohun ! — Pourquoi pas ? — Peste ! — On serait heureux ! — On serait plusieurs. — Est-ce qu’on n’est pas toujours plusieurs ? » (p. 740). Étonnante clairvoyance en conjugalité, alliée à tant de pudibonderie ! C’est alors le fameux discours, pour lequel tout le livre ne semblait qu’un prétexte : « — Mylords, vous êtes en haut. C’est bien. » (p. 752). On souffre en lisant ce texte, caricature de ce qu’Hugo fit de mieux lorsqu’il fut pair de France. Tous les lords sans exception se paient la tronche de Gwynplaine, sauf lord David, mais après le discours, qui provoque tout le monde, Gwynplaine inclus parce qu’il a « insulté [s]a mère » ! (p. 774). La proclamation de Gwynplaine d’être « le lord des pauvres » (p. 786) est un échec au moment même où il la prononce, ayant sciemment scié la branche sur laquelle il pérorait. Hugo en fait l’allégorie du grotesque : « Il était l’Homme qui Rit, cariatide du monde qui pleure. Il était une angoisse pétrifiée en hilarité portant le poids d’un univers de calamité, et muré à jamais dans la jovialité, dans l’ironie, dans l’amusement d’autrui ; il partageait avec tous les opprimés, dont il était l’incarnation, cette fatalité abominable d’être une désolation pas prise au sérieux » (p. 788). La fin est le mélo inouï que l’on sait, publié à l’aube du naturalisme.
Dans ses carnets, Hugo se reconnaît du bout de la plume une responsabilité dans l’insuccès du roman : « J’ai voulu abuser du roman, j’ai voulu en faire une épopée. J’ai voulu forcer le lecteur à penser à chaque ligne. De là une sorte de colère du public contre moi » (cité p. 844). On se demande en quoi l’abus éhonté des digressions peut s’apparenter à l’épopée ! Ce livre ressemble à tout sauf à une épopée !
Le film de Jean-Pierre Améris
Il convient maintenant de faire un sort au navet sorti sur les écrans fin 2012, et qui a fait un four mérité. Jean-Pierre Améris a transformé ce conte de l’affrontement grotesque entre le peuple et l’aristocratie en une bluette romantique. Il a évacué d’un coup les 95 % de gras, les digressions, mais des 5 % d’ortolan qui restait, il a fait un fade potage, qui a d’ailleurs peine à remplir les 90 minutes réglementaires de ce qu’on appelle film, le genre de machin destiné à servir de support pour les 10 minutes subséquentes de publicité sur France Télévision. Exit les motifs qui faisaient sens. Plus de naufrage, plus de bouteille à la mer errant et reparaissant, plus de Green-box, plus de « Chaos vaincu », le spectacle inventé par Ursus et qui vaut le succès à la compagnie. Cette mise en abyme du roman porte tout le sens, mais on l’a remplacé par une niaiserie romantique avec bisous baveux de Dea et Gwynplaine. Exit les personnages qui faisaient sens. Lord David Dirry-Moir, alias Tom-Jim-Jack ; le tavernier Maître Nicless, le wapentake, disparus. Barkilphedro devient le « chambellan » du nouveau lord (mais aussi bien valet de chambre), et son esprit diabolique tellement hugolien disparaît avec sa fonction si poétique de « déboucheur de bouteilles de l’océan ». La reine Anne, qu’on ne voit que dans la scène du discours à la chambre des lords, ce qui est un non-sens, car on doit y saluer le trône vide, est une vieille peau, comme la plupart des aristocrates qu’on voit dans le film, dont la hideur de vieillards contraste avec la grâce juvénile de Gwynplaine, message d’une grande finesse. La jolie petite balafrounette dont on a décoré le bellâtre qui tient ce rôle est attendrissante et ne l’empêcherait guère de faire la une de Têtu (les rares fois où Mylène Farmer ne serait pas disponible). Rien à voir avec le monstre au visage entièrement défiguré pour qu’il soit méconnaissable qu’avait imaginé Hugo. Mais sans doute les agents des jeunes acteurs mignonnets répugnent-ils à ce qu’on écorne le seul talent de leurs poulains, la joliesse de leur visage. D’un roman chaste dépourvu du moindre baiser, on fait une soupe bourrée jusqu’à la gueule de galoches baveuses, sans oublier la ridicule coucherie avec Josiane, avec ahanements dignes de Brigitte Lahaie.
Un seul regret, puisque je me suis forcé à visionner ce sombre navet jusqu’au trognon, qu’on ne nous ait pas montré au moins les jolies fesses d’un monstre si hideux : j’en aurais eu pour mon argent. Quand à l’acteur célèbre qui joue Ursus, cette tonne, comme dirait Cyrano, comment peut-il incarner le philosophe famélique qui sacrifie son maigre repas pour sauver deux orphelins, et dont la devise, citée ci-dessus, est « En général on est forcé d’opter : être un savant, et maigrir ; brouter, et être un âne » ? On a même droit à l’inévitable séquence où cette tourte besogne une soubrette dans la cahute. Les héros philanthropes de Hugo, comme Jean Valjean, sont asexués, Monsieur Améris ; ils ne besognent pas la soubrette ! Au lieu d’être l’objet de l’arbitraire royal et de bénéficier du hasard du retour de la bouteille à la mer, Gwynplaine est reconnu par Hardquanonne dans son spectacle. Le bandit lui avait d’ailleurs fait ses adieux sur le bateau (alors que dans le roman, il est emprisonné à Londres, et que tous les passagers du bateau sombrent). Dès la première minute où Ursus le recueille, Ursus prononce le mot « comprachicos », alors que dans le roman, Gwynplaine ignore tout de son origine jusqu’à l’interrogatoire d’Hardquanonne. On perd tous les motifs symboliques des « hommes qui rient », le squelette bitumé du début, qu’on exhibe au vent pour effrayer le peuple (« La toile, collée aux os, offrait des reliefs comme une robe de statue. Le crâne, fêlé et fendu, avait l’hiatus d’un fruit pourri. Les dents étaient demeurées humaines, elles avaient conservé le rire. Un reste de cri semblait bruire dans la bouche ouverte »), et Hardquanonne, justement, qui meurt de rire. Au lieu de contempler ce squelette, dans les premières minutes, c’est un crucifix que fixe le garçon qui joue Gwynplaine enfant. Quelle niaiserie ! De phrases du roman je n’en ai reconnu que deux, celle sur les mioches citée ci-dessus, et celle où Josiane dit « Le monstre que tu es dehors, je le suis dedans. » Mais comme on a retiré tout ce qui permettait de comprendre cette phrase, et qu’on a ajouté une coucherie absente du roman – où l’absence de cette coucherie fait sens – cela n’a aucun sens.
Qu’aurait-il fallu faire ? Voilà un roman qui pose un défi à l’adaptation, dans un autre genre que Zazie dans le métro : que faire de 95 % de digression ? Comment adapter un roman dont l’histoire n’est qu’une infime partie ? Je dirai, tirer au moins quelques phrases du 95 % de digression, et s’arranger avec la légende Hugo pour faire de notre Homère vieillissant le double vociférant depuis Jersey, puis Guernesey, contre Napoléon le petit, d’Ursus hurlant dans sa roulotte, puis sa Green-Box, contre les lords. Double d’Ursus, du vieux Clancharlie, mais aussi de Gwynplaine. Une page formidablement hugolienne est à prendre comme une allégorie de la création romanesque, c’est quand Ursus use de ses dons d’« engastrimythe » (ventriloque [1]) pour cacher à Dea la mort de Gwynplaine, en jouant tous les rôles de la pièce : « Alors Ursus devint extraordinaire. Ce ne fut plus un homme, ce fut une foule. Force de faire la plénitude avec le vide, il appela à son secours une ventriloquie prodigieuse. Tout l’orchestre de voix humaines et bestiales qu’il avait en lui entra en branle à la fois. Il se fit légion. Quelqu’un qui eût fermé les yeux eût cru être dans une place publique un jour de fête ou un jour d’émeute. Le tourbillon de bégaiements et de clameurs qui sortait d’Ursus chantait, clabaudait, causait, toussait, crachait, éternuait, prenait du tabac, dialoguait, faisait les demandes et les réponses, tout cela à la fois. Les syllabes ébauchées rentraient les unes dans les autres. Dans cette cour où il n’y avait rien, on entendait des hommes, des femmes, des enfants. C’était la confusion claire du brouhaha. A travers ce fracas, serpentaient, comme dans une fumée, des cacophonies étranges, des gloussements d’oiseaux, des jurements de chats, des vagissements d’enfants qui tettent. On distinguait l’enrouement des ivrognes. Le mécontentement des dogues sous les pieds des gens bougonnait. Les voix venaient de loin et de près, d’en haut et d’en bas, du premier plan et du dernier. L’ensemble était une rumeur, le détail était un cri. Ursus cognait du poing, frappait du pied, jetait sa voix tout au fond de la cour, puis la faisait venir de dessous terre. C’était orageux et familier. Il passait du murmure au bruit, du bruit au tumulte, du tumulte à l’ouragan. Il était lui et tous. Soliloque et polyglotte. De même qu’il y a le trompe-l’œil, il y a le trompe-l’oreille. Ce que Protée faisait pour le regard, Ursus le faisait pour l’ouïe. Rien de merveilleux comme ce fac-similé de la multitude » (II, 7, II).
Est-il à la portée d’un scénariste adaptant Hugo de savoir qu’à défaut d’être pair d’Angleterre, il fut pair de France, et qu’il prononça le fameux discours sur la misère ? On aurait pu imaginer quelques montages montrant ce vertige, écho à ce texte vertigineux. En attendant, je tâcherai de voir d’anciennes adaptations au hasard des rétrospectives. Sur le site de l’Ina, on trouve un téléfilm de Jean Kerchbron (1971), qui d’après quelques extraits, est au moins plus conforme au livre. Une belle séquence, par exemple, montre ce que font aux enfants les comprachicos.
Sur le site d’RFI, on trouve un article de Sophie Torlotin intitulé sans rire « Jean-Pierre Améris respecte Victor Hugo ». Quand on ne sait pas, madame Torlotin, on demande à des spécialistes de Hugo, ou on se tait. D’ailleurs, cela a-t-il un sens, pour un réalisateur, de « respecter » l’auteur du livre adapté ? En tout cas, cet article nous apprend que Tim Burton voulait le faire. Eh bien, qu’il le fasse, puisque Améris ne l’a pas fait ! L’article du Figaro est aussi à pisser de rire tellement la flatterie s’y fait mielleuse : « Un mélodrame romantique au fuselage très contemporain, propulsé par une fougue juvénile ». Heureusement, ces critiques de complaisance ne suffisent pas à ameuter les foules. Et ces journaux s’étonnent de servir à emballer les harengs !
– Le thème de l’Homme qui rit est bien mieux exploité dans le film L’Apollonide : Souvenirs de la maison close (2011) de Bertrand Bonello ainsi que dans Le Dahlia noir, de Brian de Palma (2006).
– Allez donc plutôt admirer Les Misérables dans la superbe adaptation de Raymond Bernard (1934). Une version magnifiquement restaurée en 2012 est actuellement sur les écrans. Près de 5 heures de génie. Mais où sont les neiges d’antan ?
– Lire notre article sur Les Travailleurs de la mer, autre roman qu’on peut considérer comme une mise en abyme de Hugo sous l’avatar de Gilliat. Et aussi Claude Gueux et Hernani, et pour tout savoir de la vie de Victor Hugo, lire notre article sur Victor Hugo. Tome I. Avant l’exil., de Jean-Marc Hovasse.
Voir en ligne : Version PDF gratuite du roman sur In Libro Veritas
© altersexualite.com, 2013
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Le mot « Engastrimute » fit déjà l’objet d’un emploi et d’une remarque par Diderot dans Jacques le Fataliste et son maître.
 altersexualite.com
altersexualite.com