Accueil > Voyages > Asie > La Thaïlande par les livres (2) : Terre de Mousson, de Pira Sudham ; Paradis (...)
Corruption, prostitution, sexualité : difficile d’échapper à sa réputation !
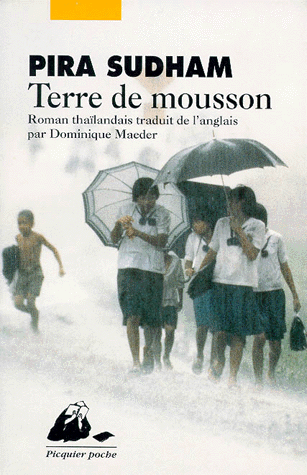 La Thaïlande par les livres (2) : Terre de Mousson, de Pira Sudham ; Paradis Blues, de John Saul ; Bangkok Tatoo, de John Burdett
La Thaïlande par les livres (2) : Terre de Mousson, de Pira Sudham ; Paradis Blues, de John Saul ; Bangkok Tatoo, de John Burdett
Picquier, 1988, 274 p., épuisé ; Rivages poche, 1988, 384 p., épuisé ; Presses de la Cité, 2005, 360 p., 20,5 €.
samedi 10 mars 2012
Comme cela m’est déjà arrivé pour quelques voyages, je préfère vous avertir : politiquement correct, s’abstenir. Globalement, je me suis ennuyé en Thaïlande. J’avais voulu me contenter de visiter un maximum de sites entre Bangkok et le Triangle d’Or, négligeant d’un revers de pensée les plages du sud, trop vulgaires pour ma haute intellectualité (et pourtant, j’ai lu Sur la plage, de Jean-Didier Urbain, qui devrait m’avoir ôté ce préjugé). Souffrant d’une surdose de temples, j’ai regretté de n’avoir pas panaché mon voyage d’un chouïa de farniente balnéaire, où, endossant les habits du sociologue, j’eusse étudié fort doctement, avec la retenue et le doigté que vous me connaissez, les mœurs de l’homo europeanus en goguette ! Je ne pense pas retourner un jour dans ce pays, car quitte à me dorer sur des plages et alcooliser mon foie, je choisirai des destinations plus proches et qui m’allèchent davantage. Bref, heureusement que j’avais apporté des bouquins passionnants : la Thaïlande des livres m’a enchanté quand m’exaspérait le Siam de chair et de sueur ! Après un premier volet consacré à l’Abbé de Choisy, et ne touchant la Thaïlande que du bout des doigts, plongeons dans l’univers du sexe… euh pardon, de la Thaïlande, avec trois romans plus récents.
Plan de l’article
Terre de Mousson, de Pira Sudham
Paradis Blues, de John Saul
Bangkok Tatoo, de John Burdett
Les katoey et l’hétéro moyen, et autres remarques
Terre de Mousson, de Pira Sudham
Pira Sudham (né en 1942) est un auteur thaïlandais écrivant en anglais. Terre de Mousson (1989) est traduit par Dominique Maeder. Ce livre est un roman partiellement autobiographique basé sans doute sur des souvenirs d’enfance de l’auteur, né dans l’Isan, famille de paysans pauvres, et grâce à sa réussite scolaire, ayant bénéficié d’une bourse pour étudier en Nouvelle-Zélande. Le personnage du livre suit le même genre de trajectoire, mais va étudier à Londres. La première partie est consacrée à la chronique de la vie paysanne dans la grande pauvreté [1]. Le récit à la troisième personne se focalise sur quelques personnages autour de l’instituteur, qui consacre sa vie à aider ce village qui n’est pas le sien, jusqu’à susciter jalousies et suspicion, et de Prem, alias « Le Têtard », petit garçon assez faible mais fort en thème, appelé à suivre des études prestigieuses, personnage proche de ce qu’on sait de l’auteur. Les croyances villageoises ont la vie dure, les enfants ont peur de Prem parce que, ayant failli mourir, il a été adopté par un esprit. Les femmes refusent d’épouser un double veuf, craignant que « son grain de beauté noir sur les bourses » (p. 29) ne leur réserve un mauvais sort. Prem se révolte intérieurement « contre tout ce qui faisait de moi un Thaï, contre ma vie de garçon docile » (p. 88). Il surprend le chef du village vendant à son profit l’aide alimentaire. À son arrivée à Londres pour plusieurs années d’étude, il découvre Hyde Park et son célèbre Speaker’s Corner et remarque, caustique, qu’un ancien Premier ministre de Thaïlande, suite à un voyage à Londres, avait voulu créer un Speaker’s Corner : « le Hyde Park thaï devint un lieu d’arrestation en masse, et fut finalement interdit » (p. 109). À Londres, Prem est seul, mais il fait des connaissances. Un riche londonien lui vient en aide suite à une agression, et devient un ami. Cela nous met la puce à l’oreille, et ce n’est que vers la fin du livre que l’on nous apprendra que les autorités reprochent au personnage de « fréquente[r] des homosexuels » (p. 221). Il est amené à partager l’appartement d’un fils de bonne famille thaï, qui se prend d’amitié pour lui, et lui fait découvrir la grande vie. Ils deviennent un vrai couple gai, sauf que juste au moment où le lecteur commence à se démanger, Prem se met à se faire des petites amies, lesquelles apprécient avec lui le sexe sans amour (p. 133). Une partie du roman glisse vers le roman policier, puisque Prem est témoin du suicide d’un célèbre compositeur, qu’il est suspecté un moment d’avoir aidé à mourir. L’acmé du roman est ce moment où il se dispute avec son ami aisé, incapable de comprendre une révolte dans son pays. Mais au lieu de prendre le parti des révoltés, ce à quoi semblait conduire le récit, Prem se résigne, en choisissant la prêtrise bouddhiste et le renoncement à l’Occident, dans la troisième partie.
De passage à Bangkok, Prem entre dans un « lieu hétérosexuel », où il observe le jeu des filles et des « farangs » (étrangers). Il fait la conversation à l’un d’eux, et découvre qu’il est homosexuel et s’est trompé d’endroit. Il propose de l’aider à trouver ledit endroit, mais dans une scène inversée de l’agression vécue à Londres, Prem intervient alors que le farang allait se faire détrousser (p. 229). On s’amuse des vœux du « bhikkhu » (moine) que devient Prem : « tu n’auras pas de relation sexuelle, même pas avec un animal » (p. 267) ! Quel malheur ! En effet, les moines sont (pour moi) les seuls thaïs qui aient au moins une allure sexy [2], avec leurs robes de couleurs ocre ou rouge-orange dénudant une épaule. Attention, dans ce Bouddhisme theravada il y a aussi de nombreux novices, des adolescents ; les prêtres sont les plus âgés.
Paradis Blues, de John Saul

C’est la première fois que j’ai l’occasion de lire un livre de cet écrivain important qu’est le canadien John Ralston Saul (né en 1947). Paradis Blues, paru en 1988, a été traduit aussitôt de l’anglais par Henri Robillot. Il est publié dans la collection Rivages Poches, en 384 pages. C’est donc l’exact contemporain du précédent, et on constate quelques points communs, même si le sujet et le ton diffèrent radicalement. Le héros au nom banal, John Field, est un ancien journaliste recasé dans les affaires, mais en indépendant. Le roman le présente en biais par une entrée en matière à l’américaine, comme un sex addict, collectionneur de toutes les MST possibles et imaginables. Il consulte un personnage haut en couleurs, médecin, militant, humaniste, métis, Michaël alias Meechaï pour les Thaïs, qui se révélera utile pour tous les rebondissements de l’intrigue. « Ecoute, quand je ne suis pas malade, qu’est-ce que je veux ? Baiser. Pas frénétiquement, pas plus que la moyenne des gens. Ce désir est sans doute le sentiment le plus naturel, le plus irrésistible et le plus persistant du monde. Là-dessus, j’attrape une de tes saloperies et crac, je n’ai plus envie de baiser. Crac. Plus de désir. Et il n’est pas là question de morale. La douleur tue le désir. C’est même un concept chrétien. Les maladies vénériennes sont donc amies de la chasteté. » (p. 20). Cette saillie donne le ton de l’ouvrage : la Thaïlande est vécue par ce personnage, installé depuis 20 ans dans le pays, père d’une métisse maintenant adolescente, comme un paradis sexuel, ce qui n’empêche pas que Michaël version Meechaï milite contre le tourisme sexuel, mais aussi pour l’emploi des préservatifs et une campagne de vasectomies gratuites (p. 100) ! Un ami journaliste de John explique même que « l’abstinence sexuelle chez les jeunes filles aussitôt après la puberté entraîne des dommages physiques qui expliquent sans doute pourquoi tant de femmes occidentales ne peuvent parvenir à l’orgasme » (p. 172). Pour une autre amie : « Les prostituées font partie du libéralisme […]. C’est la monogamie que je réprouve. Dès qu’elle a été introduite dans les mœurs, ç’a été la fin des concubines, et la prostitution s’est mise à prospérer. » (p. 256). Les premières pages pourraient faire croire que le roman ignore le sida, mais non, une fête chez une amie de John met en scène un groupe de riches homos thaïs et leurs « gitons », qui plaisantent lourdement sur le sida. On apprend au détour d’une page que le roi Rama VI est un « roi pédéraste qui aimait les uniformes et les boy-scouts » (p. 240).
L’intrigue principale, digne des meilleurs romans d’espionnage, est amenée incidemment, donc très habilement, sous la forme d’une mission commerciale au Laos qu’une amie de John lui propose comme un petit service à lui rendre. Un autre ami, ambassadeur du Canada, en profite pour lui demander de rencontrer un couple de chercheurs canadiens dont il est inquiet. Il se trouve que la femme est une ancienne amante de John, mais qui ne l’est pas ? Bref, John rencontre le couple, et le lendemain matin, l’homme et la femme sont retrouvés sauvagement assassinés. Suit une course poursuite à la James Bond du Laos à la Thaïlande, au cours de laquelle John, qui s’est retrouvé mêlé par hasard à cette affaire qui lui est égale, doit sauver sa peau, celle de sa fille, et celle d’une jeune fille dont il fait connaissance incidemment, aussi malade de MST que lui, et que sa maladie, sans son intervention, condamnerait à un sort fatal. Le thème de la sexualité prend tellement de place, et l’affaire d’espionnage est tellement téléphonée qu’on peut se demander si elle n’est pas un prétexte pour donner son avis sans en avoir l’air sur la sexualité occidentale et orientale moderne. Par exemple, une amie maquerelle thaïe explique candidement à John que « Farang tous pareils. Ils aiment filles thaïes parce que si petites. Fait croire l’homme sa queue plus grosse. » (p. 289). Suit une discussion passionnante où John s’efforce d’expliquer sa quête d’une « fille de rêve », en s’opposant à la fois aux romantiques et aux jouisseurs qui méprisent les femmes et les croient interchangeables : « Regarde les romantiques. Selon eux, si tu aimes, les détails physiques ne comptent pas. Eh bien, si les détails physiques ne comptent pas, nous sommes comme tes chiens. […] Et pour les superathlètes, quand les lumières sont éteintes, tous les cons se valent. […] Ce qu’il y a de drôle, c’est qu’ils disent la même chose que les romantiques. […] Il faut haïr les femmes pour dire que leurs corps ne comptent pas ou que leurs cons sont tous pareils. » (p. 291).
Côté roman noir, on retient quand même une scène fascinante dans un abattoir à cochons (p. 273), où un tueur est abattu, égorgé et vidé comme un vulgaire porc, ce qui rappelle les explications de Michel Pastoureau dont il est question dans cet article (mais aussi les pages sur le cannibalisme du Voyage fait en la terre du Brésil de Jean de Léry au XVIe siècle). Le roman est aussi l’occasion pour le lecteur intéressé surtout par le thème exotique, de découvrir que la Thaïlande n’a guère changé depuis 1988. Ainsi le thème des inondations, qu’on a cru découvrir fin 2011 (peu avant mon départ, une couverture médiatique hypertrophiée a dégoûté les trois-quarts des candidats touristes, alors que ces inondations n’affectaient quasiment pas les lieux touristiques !) est-il récurrent dans le roman : le personnage adapte sa stratégie de transport aux inondations, alors qu’il doit échapper à une pléiade de tueurs à gages ! La corruption s’en mêle, et un certain général Krit veille à ce que les pompes soient réservées à certains beaux quartiers (p. 75) : exactement ce qui a provoqué la colère des Bangkokiens en 2011 !
Le roman fait penser à L’âge de raison de Sartre, en ce sens que le personnage principal est toujours en action pendant un nombre de jours resserré, pour résoudre en même temps et sans jamais perdre son flegme, plusieurs problèmes importants mais divergents mettant en cause plusieurs personnages qui gravitent autour de lui, et qui ignorent les énormes soucis qui le préoccupent en dehors de celui que chacun d’entre eux lui pose. Cette Thaïlande romanesque m’a fasciné, un peu comme les « filles de rêve » de John, et la Thaïlande réelle m’a parue aussi interchangeable que les femmes pour ces queutards !
Bangkok Tatoo, de John Burdett

Voici un roman plus récent, et pourtant dans la lignée des précédents. Il s’agit d’un vrai polar, faisant partie d’une série avec le même personnage, Sonchaï Jitpleecheep, flic métis fils d’une prostituée et d’un ancien soldat américain dont il ignore l’identité mais qu’il essaie de retrouver. C’est le deuxième de la série de John Burdett (né en 1951), après Bangkok 8 ; il est paru en 2005, traduit en 2006 aux Presses de la Cité par Thierry Piélat.
Dans un style plus actuel et disons moins littéraire, le narrateur s’adresse directement au lecteur « farang », et tâche de lui faire réviser ses idées préconçues sur les « filles de bar, en lesquelles vous voyez des esclaves sexuelles opprimées et victimes d’une société phallocrate » (p. 27), alors qu’« elles sont le cœur même de notre pays » (p. 138). Le crime de départ, disons le meurtre apéritif, est celui d’un espion américain, sincèrement fasciné par l’Orient, amoureux du Japon et d’une prostituée, et ayant réussi à la rendre amoureuse. Il est censé enquêter sur l’islam dans le sud du pays, suite aux attentats du 11 septembre, ce qui nous emmène, et la CIA avec nous, sur une fausse piste mais nous permet d’apprendre l’existence d’une prostitution de bas étage spécialisée dans la clientèle malaise et musulmane (p. 86). Enfin tout ça se sait au fil des pages, aussi vais-je vous laisser découvrir l’intrigue, qui a l’avantage de nous faire visiter les quartiers chauds de Bangkok, gay et hétéro, et de nous présenter un personnage de jeune homme, Lek, qui se destine au statut de khatoey (écrit sans h dans la traduction), et bénéficie du soutien de Sonchaï. Cela nous vaut une visite dramatisante du splendide parc Lump(h)ini (écrit sans le h, mais dans les noms thaïs transcrits avec un « ph », il se prononce « p ».) la nuit, où Lek est censé découvrir son destin : « La moitié des prostituées sont des katoey ici, lâche-t-il. Elles ont tout perdu, même l’humanité la plus élémentaire. Ce ne sont que des… que des bêtes » (p. 231). On s’amuse de retrouver des thèmes mineurs qui constituent des leitmotivs de ces romans, par exemple le thème des toilettes vues comme un « fossé culturel » (parce que les Thaïs mettent leurs pieds sur les cuvettes occidentales), p. 83 du roman de Burdett, et p. 373 de celui de John Saul ! On remarque un hommage au roman de Pira Sudham, car la trajectoire de Lek le ladyboy est la même que celle de Prem, il est originaire du village de Napo dans l’Isaan, et a été dévoué à un esprit, sauf que « il y avait un hic […] L’esprit était féminin » (p. 48). Les meurtres sont particulièrement raffinés à l’asiatique. Celui aux anguilles (p. 156) constitue une variante délicate et goûtue du supplice du rat honoré par Octave Mirbeau dans Le jardin des supplices. Sinon, quelques émasculations et autre arrachement d’épiderme tatoué raviront les plus exigeants. Le ton politiquement incorrect permet à l’auteur quelques remarques sans doute bien vues, par exemple : « Les Nippons sont encore plus racistes que nous » (p. 328) : c’est lui qui le dit ; moi, je les trouve pas du tout racistes, ces niakoués [3] ! Citons la mise au point finale : « L’industrie du sexe est moins importante, par habitant, en Thaïlande que dans d’autres pays. Si elle est plus célèbre, c’est sans doute parce que les Thaïs sont moins saintes-nitouches que beaucoup d’autres peuples. La plupart des touristes qui se rendent en Thaïlande y passent d’excellentes vacances sans rien y trouver de sordide ». On ne saurait mieux dire : c’est exaspérant cette réputation non seulement de prostitution mais de pédophilie. Quand on voit que les Thaïs sont graciles et de petite taille, ça relativise la notion de « pédophilie » : un Thaï de 18 ans en paraît déjà 14… Ce que l’on rencontre le plus souvent, ce sont des Occidentaux âgés qui ont épousé des locales elles-mêmes assez âgées, et qui retournent au pays voir la famille. Mais déjà en France, dès qu’il y a dix ans d’écart dans un couple, les langues de vipères de la jalousie entrent en érection…
Les katoey et l’hétéro moyen, et autres remarques
Ayant saisi au vol quelques remarques d’hétéros français bon teint à propos des katoey, voici quelques remarques : ils, ou plutôt elles (l’hétéro parlant d’un katoey à un autre hétéro l’appelle « il » pour bien montrer à quel point on ne la lui fait pas) pullulent, on ne voit que ça ma bonne dame ; « ils » se prostituent parmi les vraies filles, et « ils » ont l’air d’avoir de la clientèle. Mais l’hétéro qui vous parle de « ils », lui, non. Alors de quel ciel tombent-ils, ces clients ? Sans doute des clients homos qui se paient un voyage à l’autre bout du monde pour se taper une prostituée avec une bite et des nibards. Conclusion : les katoeys font ça pour le fun et n’ont aucun client, « ils » vivent d’eau fraîche et du vent, et nos amis hétéros aficionados des quartiers chauds ne sont pas du tout de gros hypocrites qui adorent se faire enculer par une vraie bite plutôt que par la courgette que madame a rapportée du Carouf. Ou se taper un mec en faisant semblant de croire que c’est une vraie fille, parce qu’ils en crèvent d’envie mais culpabilité judéo-christiano-islamique quand tu nous tiens !
Une remarque qu’aurait pu faire l’abbé de Choisy, intéressé à la chose : la langue thaï, qui constitue quasiment un isolat (sauf que son alphabet est dérivé du khmer ancien lui-même dérivé du dévanâgari), possède une particularité énonciative que je n’avais jusque-là remarquée dans aucune langue (mais j’espère que de nombreux lecteurs cultivés éclaireront ma lanterne à ce propos [4]). Quand on salue une personne, on ne lui dit pas, comme dans la plupart des langues : « Bonjour Monsieur » ou « Bonjour Madame », histoire de l’assurer qu’on a bien remarqué la bite ou la cramouille qu’il ou elle a entre les jambes. Non, le thaï est la seule langue que je connaisse où l’on a la politesse de préciser : « Bonjour, je suis un homme », ou « Bonjour, je suis une femme », c’est-à-dire : « Bonjour, être humain dont je n’ai pas l’impolitesse extravagante de prétendre deviner le sexe en le voyant habillé (ou en entendant sa voix au téléphone prononcer « allo »), mais je me contente, pour mettre fin à la gêne qu’il éprouve, dans ce pays truffé de khatoeys ou du moins de bipèdes pas très poilus, de lui annoncer le sexe auquel moi j’appartiens, en espérant que, pour mettre fin de même au trouble que j’éprouve, il voudra bien me répondre en précisant son sexe sans que je commette l’impolitesse occidentale de lui en supposer un d’avance ». Cela donne : « Sawadee ka » si vous êtes une femme, quel que soit le sexe de votre interlocuteur, et « Sawadee krap » si vous êtes un homme. Voyez ce site. Les pages de conversation disponibles dans les guides que j’ai consultés omettent de préciser une chose aussi déstabilisante, comme sur le site signalé ci-dessus, qui se contente de dire (homme) et (femme), sans préciser « si vous vous êtes un homme et non votre interlocuteur », de sorte que pendant les premiers jours du voyage, on se trompe jusqu’à ce qu’une situation finisse par nous mettre la puce à l’oreille, et ce d’autant plus que « ka » est très proche de « krap », surtout avec la prononciation thaï dans laquelle les tonalités comptent autant que les sons. Étonnant, ce lien entre une particularité linguistique et la mode androgyne et transgenre. Est-ce l’œuf qui fait la poule, ou la poule qui fait l’œuf ? En tout cas, lorsque vous vous baladez à Chiang Mai et que vous entendez les masseuses ou prostituées vous interpeller (100 fois par heure), quand vous entendez une voix de crécelle, vous pouvez vous demander si ce n’est pas justement une khatoey qui s’amuse, en déformant sa voix, de l’ironie qu’il y a à annoncer une couleur si sujette à caution. À part ça, je sais que comme les hommes, toutes les langues sont aussi belles, aussi valables, mais disons que j’éprouve à peu près le même plaisir à entendre la douce crécelle ou disons l’ineffable crissement de griffes de chat essayant d’escalader une paroi en fer que constitue pour mes oreilles rétives le thaï, que par exemple la langue albanaise ou la tchèque. Bref, je suis un sale raciste, je l’avoue.
Vous remarquerez qu’en Thaïlande, même à la saison dite fraîche, en décembre, c’est-à-dire quand j’y suis allé, la climatisation est toujours à fond et partout. Dans les ascenseurs des hôtels, dans la moindre épicerie, dans le train de nuit — et là c’est mieux : IMPOSSIBLE de débrancher cette merde ! — ; dans le minibus dans lequel on vous trimballe même le matin à 7 heures quand la température extérieure est de 14 degrés. Vous arrivez à l’hôtel à la fraîche, emmitouflé dans l’écharpe que vous avez pensé à apporter parce qu’on ne vous la fait plus, et le connard de bagagiste qui vous fait attendre votre bagage un quart d’heure s’empresse de mettre en route l’instrument de torture dans votre chambre, comme si sa science du touriste était réduite à l’équation « touriste = viande à frigo ». Certes en plein été par 40 degrés, vous l’auriez déjà mis en branle (la clim, pas le bagagiste !) mais là, par 18 degrés et avec l’angine que leur saloperie vous a déjà collée dans tout le pays, vous vous en passeriez. Ce qui est étonnant c’est qu’on nous amuse avec des « voie moyenne » qui seraient propres au bouddhisme, mais en ce qui concerne la clim, c’est toujours à donf de chez donf. Voie moyenne, mon cul ! Développement durable, mon cul !
– Lisez l’article consacré à L’abbé de Choisy, qui découvrit le Siam avec des yeux occidentaux au XVIIe siècle.
– Et pour un pays d’Asie du sud-est garantie à 0 % de temples khmers, voir le voyage aux Philippines.
© altersexualite. com, 2012. Les photos sont de Lionel Labosse.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] À opposer à la vision tragique de certains passages de Un barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras
[2] Mais d’un point de vue purement esthétique, ma préférence va aux moines népalais tout de rouge vêtus…
[3] Hum ! Savez-vous que cette insulte provient du vietnamien « nhà quê », qui désigne les paysans avec déjà une connotation raciste. Cela me fait penser à mon grand-père dont un des « mots » honorés dans la famille est sa réponse à une infirmière qui lui demandait s’il était agriculteur : « — Que non, madame, je suis un paysan ! »
[4] Je découvre en 2016 une particularité étonnante de l’ancienne langue des Incas, dans le même domaine du genre.
 altersexualite.com
altersexualite.com