Accueil > Culture générale et expression en BTS > Seuls avec tous > Psychologie des foules, de Gustave Le Bon
Emporté par la foule, formons-nous un seul corps ? pour étudiants et adultes
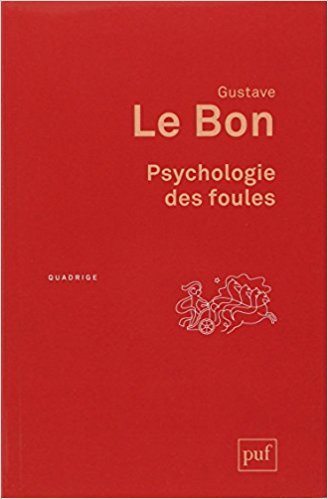 Psychologie des foules, de Gustave Le Bon
Psychologie des foules, de Gustave Le Bon
Puf, Quadrige, 1895, 136 p., 10,5 €.
samedi 13 avril 2019
Psychologie des foules de Gustave Le Bon (1841-1931) est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « Seuls avec tous ». Je l’ai choisi parce que c’est un essai court et abordable pour les étudiants, et puis c’est un des « livres qui ont changé le monde » selon un classement récent (cf. Wikipédia). L’auteur est un intellectuel inclassable, qui a plusieurs casquettes, médecin, anthropologue, et à l’instar de Machiavel, son œuvre dont le livre qui fait l’objet de cet article est le sommet, a été diversement appréciée, utilisée par les grands manipulateurs de foules du XXe siècle autant que par leurs adversaires. Son analyse s’efforce à l’objectivité, il dégage les avantages et les inconvénients des foules, et il est considéré comme fondateur de la psychologie sociale. Cet article contiendra surtout des extraits utilisables en classe. À noter que l’on trouve sur Wikisource une version plus ancienne du texte, avec uniquement des différences stylistiques, comme si l’auteur s’était amusé à dire la même chose en changeant l’ordre des mots, à la façon des élèves ou internautes pompeurs qui cherchent à dissimuler leur fraude. En cette année 2019, les propos de Gustave Le Bon résonnent avec certains mouvements de foules, comme le mouvement des Gilets jaunes ou la pétition Affaire du siècle, tous deux recélant à la fois des côtés positifs puisque leurs motivations sont plutôt généreuses, et des idées effrayantes puisqu’ils illustrent la capacité de mobilisation et de suivisme des réseaux et mouvements sociaux dès qu’un sujet se trouve séduire le troupeau.
L’ère des foules
Voici le constat posé en introduction : « Alors que nos antiques croyances chancellent et disparaissent, que les vieilles colonnes des sociétés s’effondrent tour à tour, l’action des foules est l’unique force que rien ne menace et dont le prestige grandisse toujours. L’âge où nous entrons sera véritablement l’ère des foules » (p. 2). D’où l’intérêt pour l’homme d’État : « La connaissance de la psychologie des foules constitue la ressource de l’homme d’État qui veut, non pas les gouverner - la chose est devenue aujourd’hui bien difficile - mais tout au moins ne pas être trop complètement gouverné par elles.
La psychologie des foules montre à quel point les lois et les institutions exercent peu d’action sur leur nature impulsive et combien elles sont incapables d’avoir des opinions quelconques en dehors de celles qui leur sont suggérées » (p. 5).
Livre premier : l’âme des foules
« Le fait le plus frappant présenté par une foule psychologique est le suivant : quels que soient les individus qui la composent, quelque semblables ou dissemblables que puissent être leur genre de vie, leurs occupations, leur caractère ou leur intelligence, le seul fait qu’ils sont transformés en foule les dote d’une sorte d’âme collective. Cette âme les fait sentir, penser et agir d’une façon tout à fait différente de celle dont sentirait, penserait et agirait chacun d’eux isolément. Certaines idées, certains sentiments ne surgissent ou ne se transforment en actes que chez les individus en foule.
La foule psychologique est un être provisoire, composé d’éléments hétérogènes pour un instant soudés, absolument comme les cellules d’un corps vivant forment par leur réunion un être nouveau manifestant des caractères fort différents de ceux que chacune de ces cellules possède » (p. 11). La foule rassemble et nivelle les hommes par la bas : « Les hommes les plus dissemblables par leur intelligence ont des instincts, des passions, des sentiments parfois identiques. Dans tout ce qui est matière de sentiment : religion, politique, morale, affections, antipathies, etc., les hommes les plus éminents ne dépassent que bien rarement le niveau des individus les plus ordinaires » (p. 12). « L’individu en foule est un grain de sable au milieu d’autres grains de sable que le vent soulève à son gré » (p. 14). « Criminelles, les foules le sont souvent, certes, mais, souvent aussi, héroïques. On les amène aisément à se faire tuer pour le triomphe d’une croyance ou d’une idée, on les enthousiasme pour la gloire et l’honneur, on les entraîne presque sans pain et sans armes comme pendant les croisades, pour délivrer de l’infidèle le tombeau d’un Dieu, ou, comme en 93, pour défendre le sol de la patrie. Héroïsmes évidemment un peu inconscients, mais c’est avec de tels héroïsmes que se fait l’histoire. S’il ne fallait mettre à l’actif des peuples que les grandes actions froidement raisonnées, les annales du monde en enregistreraient bien peu » (p. 15).
J’insère ici, pour illustrer ces actions héroïques des foules, une photo de la chute de la statue d’Enver Hoxha, à Tirana le 20 février 1991. Voir également une vidéo de cet événement. Voyez mon cours de BTS sur le thème « Seuls avec tous ».

« Les foules sont partout féminines, mais les plus féminines de toutes sont les foules latines. Qui s’appuie sur elles peut monter très haut et très vite, mais en côtoyant sans cesse la roche Tarpéienne et avec la certitude d’en être précipité un jour » (p. 19). Les foules ont besoin de héros légendaires : « Il n’est même pas besoin que les siècles aient passé sur les héros pour que leur légende soit transformée par l’imagination des foules. La transformation se fait parfois en quelques années. Nous avons vu de nos jours la légende de l’un des plus grands héros historiques se modifier plusieurs fois en moins de cinquante ans. Sous les Bourbons, Napoléon devint une sorte de personnage idyllique philanthrope et libéral, ami des humbles, qui, au dire des poètes, devaient conserver son souvenir sous le chaume pendant bien longtemps. Trente ans après, le héros débonnaire était devenu un despote sanguinaire usurpateur du pouvoir et de la liberté, ayant sacrifié trois millions d’hommes uniquement à son ambition » (p. 25).
« La violence des sentiments des foules est encore exagérée, dans les foules hétérogènes surtout, par l’absence de responsabilité. La certitude de l’impunité, d’autant plus forte que la foule est plus nombreuse et la notion d’un pouvoir momentané considérable dû au nombre, rendent possibles à la collectivité des sentiments et des actes impossibles à l’individu isolé. Dans les foules, l’imbécile, l’ignorant et l’envieux sont libérés du sentiment de leur nullité et de leur impuissance, que remplace la notion d’une force brutale, passagère, mais immense » (p. 26). « La foule n’étant impressionnée que par des sentiments excessifs, l’orateur qui veut la séduire doit abuser des affirmations violentes. Exagérer, affirmer, répéter et ne jamais tenter de rien démontrer par un raisonnement, sont les procédés d’argumentation familiers aux orateurs des réunions populaires » (p. 26). Je ne comprends pas trop l’affirmation suivante : « En fait, elles ont des instincts conservateurs irréductibles et comme tous les primitifs un respect fétichiste pour les traditions, une horreur inconsciente des nouveautés capables de modifier leurs conditions réelles d’existence. Si la puissance actuelle des démocraties avait existé à l’époque où furent inventés les métiers mécaniques, la vapeur et les chemins de fer, la réalisation de ces inventions eût été impossible, ou seulement au prix de révolutions répétées. Heureusement pour les progrès de la civilisation, la suprématie des foules n’a pris naissance que lorsque les grandes découvertes de la science et de l’industrie étaient déjà accomplies » (p. 29).
Voici un extrait utilisable en classe : « Les plus parfaits gredins eux-mêmes, par le fait seul d’être réunis en foule, acquièrent parfois des principes de moralité très stricts. Taine fait remarquer que les massacreurs de Septembre venaient déposer sur la table des comités les portefeuilles et les bijoux trouvés sur leurs victimes et si aisés à dérober. La foule hurlante, grouillante et misérable qui envahit les Tuileries pendant la Révolution de 1848, ne s’empara d’aucun des objets qui l’éblouirent et dont un seul représentait du pain pour bien des jours.
Cette moralisation de l’individu par la foule n’est certes pas une règle constante, mais elle s’observe fréquemment et même dans des circonstances beaucoup moins graves que celles que je viens de citer. Au théâtre, je l’ai déjà dit, la foule réclame du héros de la pièce des vertus exagérées, et une assistance, même composée d’éléments inférieurs, se montre parfois très prude. Le viveur professionnel, le souteneur, le voyou gouailleur, murmurent souvent devant une scène un peu risquée ou un propos léger, fort anodins pourtant auprès de leurs conversations habituelles.
Donc, les foules adonnées souvent à de bas instincts, donnent aussi parfois l’exemple d’actes de moralité élevés. Si le désintéressement, la résignation, le dévouement absolu à un idéal chimérique ou réel sont des vertus morales, on peut dire que les foules possèdent parfois ces vertus à un degré que les plus sages philosophes ont rarement atteint. Elles les pratiquent sans doute avec inconscience, mais qu’importe. Si les foules avaient raisonné souvent et consulté leurs intérêts immédiats, aucune civilisation ne se fût développée peut-être à la surface de notre planète, et l’humanité n’aurait pas d’histoire » (p. 30).
« Association de choses dissemblables, n’ayant entre elles que des rapports apparents, et généralisation immédiate de cas particuliers, telles sont les caractéristiques de la logique collective. Ce sont des associations de cet ordre que présentent toujours aux foules les orateurs qui savent les manier. Seules elles peuvent les influencer. Une chaîne de raisonnements rigoureux serait totalement incompréhensible aux foules, et c’est pourquoi il est permis de dire qu’elles ne raisonnent pas ou raisonnent faux, et ne sont pas influençables par un raisonnement. La faiblesse de certains discours ayant exercé une influence énorme sur leurs auditeurs étonne parfois à la lecture ; mais on oublie qu’ils furent faits pour entraîner des collectivités, et non pour être lus par des philosophes. L’orateur, en communication intime avec la foule, sait évoquer les images qui la séduisent. S’il réussit, son but a été atteint ; et un volume de harangues ne vaut pas les quelques phrases ayant réussi à séduire les âmes qu’il fallait convaincre » (p. 34).
« Rien ne frappe davantage l’imagination populaire qu’une pièce de théâtre. Toute la salle éprouve en même temps les mêmes émotions, et si ces dernières ne se transforment pas aussitôt en actes, c’est que le spectateur le plus inconscient ne peut ignorer qu’il est victime d’illusions, et qu’il a ri ou pleuré à d’imaginaires aventures. Quelquefois cependant les sentiments suggérés par les images sont assez forts pour tendre, comme les suggestions habituelles, à se transformer en actes. On a souvent raconté l’histoire de ce théâtre populaire dramatique obligé de faire protéger à la sortie l’acteur qui représentait le traître, pour le soustraire aux violences des spectateurs indignés de ses crimes imaginaires. C’est là, je crois, un des indices les plus remarquables de l’état mental des foules, et surtout de la facilité avec laquelle on les suggestionne. L’irréel a presque autant d’importance à leurs yeux que le réel. Elles ont une tendance évidente à ne pas les différencier » (p. 36). En l’absence de référence, on accordera une confiance toute relative à la prétendue « histoire de ce théâtre populaire ».
« Ce ne sont donc pas les faits en eux-mêmes qui frappent l’imagination populaire, mais bien la façon dont ils se présentent. Ces faits doivent par condensation, si je puis m’exprimer ainsi, produire une image saisissante qui remplisse et obsède l’esprit. Connaître l’art d’impressionner l’imagination des foules c’est connaître l’art de les gouverner (p. 37).
« On n’est pas religieux seulement quand on adore une divinité, mais quand on met toutes les ressources de l’esprit, toutes les soumissions de sa volonté, toutes les ardeurs du fanatisme au service d’une cause ou d’un être devenu le but et le guide des sentiments et des actions.
L’intolérance et le fanatisme constituent l’accompagnement nécessaire d’un sentiment religieux. Ils sont inévitables chez ceux qui croient posséder le secret du bonheur terrestre ou éternel. Ces deux traits se retrouvent dans tous les hommes en groupe lorsqu’une conviction quelconque les soulève. Les Jacobins de la Terreur étaient aussi foncièrement religieux que les catholiques de l’Inquisition, et leur cruelle ardeur dérivait de la même source.
Les convictions des foules revêtent ces caractères de soumission aveugle, d’intolérance farouche, de besoin de propagande violente inhérents au sentiment religieux ; on peut donc dire que toutes leurs croyances ont une forme religieuse. Le héros que la foule acclame est véritablement un dieu pour elle. Napoléon le fut pendant quinze ans, et jamais divinité n’eut de plus parfaits adorateurs. Aucune n’envoya plus facilement les hommes à la mort. Les dieux du paganisme et du christianisme n’exercèrent jamais un empire plus absolu sur les âmes » (p. 40).
Les bouleversements analogues à ceux que je viens de citer ne sont possibles que quand l’âme des foules les fait surgir. Les plus absolus despotes seraient impuissants à les déchaîner. Les historiens montrant la Saint-Barthélemy comme l’œuvre d’un roi, ignorent la psychologie des foules tout autant que celle des rois. de semblables manifestations ne peuvent sortir que de l’âme populaire. le pouvoir le plus absolu du monarque le plus despotique ne va guère plus loin que d’en hâter ou d’en retarder un peu le moment. ce ne sont pas les rois qui firent ni la Saint-Barthélemy, ni les guerres de Religion, pas plus que Robespierre, Danton ou Saint-Just ne firent la Terreur. Derrière de pareils événements on retrouve toujours l’âme des foules.
Livre II : les opinions et les croyances des foules
« Les conservateurs les plus tenaces des idées traditionnelles, et qui s’opposent le plus obstinément à leur changement, sont précisément les foules, et notamment les catégories des foules qui constituent les castes. J’ai déjà insisté sur cet esprit conservateur et montré que beaucoup de révoltes n’aboutissent qu’à des changements de mots. À la fin du dernier siècle, devant les églises détruites, les prêtres expulsés ou guillotinés, la persécution universelle du culte catholique, on pouvait croire que les vieilles idées religieuses avaient perdu tout pouvoir ; et cependant après quelques années les réclamations universelles amenèrent le rétablissement du culte aboli » (p. 47). Selon ce chapitre, les 5 facteurs des croyances des foules sont la race, les traditions, le temps, les institutions politiques et sociales, l’instruction et l’éducation.
« L’État, qui fabrique à coups de manuels tous ces diplômés, ne peut en utiliser qu’un petit nombre et laisse forcément les autres sans emploi. Il lui faut donc se résigner à nourrir les premiers et à avoir pour ennemis les seconds. Du haut en bas de la pyramide sociale, la masse formidable des diplômés assiège aujourd’hui les carrières. Un négociant peut très difficilement trouver un agent pour aller le représenter dans les colonies, mais c’est par des milliers de candidats que les plus modestes places officielles sont sollicitées. Le département de la Seine compte à lui seul vingt mille instituteurs et institutrices sans emploi, et qui, méprisant les champs et l’atelier, s’adressent à l’État pour vivre. Le nombre des élus étant restreint, celui des mécontents est forcément immense. Ces derniers sont prêts pour toutes les révolutions, quels qu’en soient les chefs et le but poursuivi. L’acquisition de connaissances inutilisables est un moyen sûr de transformer l’homme en révolté » (p. 53).
« Les foules sont un peu comme le sphinx de la fable antique. Il faut savoir résoudre les problèmes que leur psychologie nous pose ou se résigner à être dévoré par elles.
En étudiant l’imagination des foules, nous avons vu qu’elles sont impressionnées surtout par des images. Si l’on ne dispose pas toujours de ces images, il est possible de les évoquer par l’emploi judicieux des mots et des formules. Maniés avec art, ils possèdent vraiment la puissance mystérieuse que leur attribuaient jadis les adeptes de la magie. Ils provoquent dans l’âme des multitudes les plus formidables tempêtes, et savent aussi les calmer. On élèverait une pyramide plus haute que celle du vieux Khéops avec les seuls ossements des victimes de la puissance des mots et des formules.
La puissance des mots est liée aux images qu’ils évoquent et tout à fait indépendante de leur signification réelle. Ceux dont le sens est le plus mal défini possèdent parfois le plus d’action. Tels, par exemple, les termes : démocratie, socialisme, égalité, liberté, etc., dont le sens est si vague que de gros volumes ne suffisent pas à le préciser. Et pourtant une puissance vraiment magique s’attache à leurs brèves syllabes, comme si elles contenaient la solution de tous les problèmes. Ils synthétisent des aspirations inconscientes variées et l’espoir de leur réalisation.
La raison et les arguments ne sauraient lutter contre certains mots et certaines formules. On les prononce avec recueillement devant les foules ; et, tout aussitôt, les visages deviennent respectueux et les fronts s’inclinent. Beaucoup les considèrent comme des forces de la nature, des puissances surnaturelles. Ils évoquent dans les âmes des images grandioses et vagues, mais le vague même qui les estompe augmente leur mystérieuse puissance. On peut les comparer à ces divinités redoutables cachées derrière le tabernacle et dont le dévot n’approche qu’en tremblant.
Les images évoquées par les mots étant indépendantes de leur sens, varient d’âge en âge, de peuple à peuple, sous l’identité des formules. À certains mots s’attachent transitoirement certaines images : le mot n’est que le bouton d’appel qui les fait apparaître » (p. 59-60). [1]
Le photogramme des Temps modernes de Charlie Chaplin correspond à une séquence du film où Charlot ramasse un drapeau tombé d’un camion, l’agite pour attirer l’attention du chauffeur. Il est alors rejoint par une manifestation, dont il paraît le leader avec son drapeau, et le voilà arrêté par la police ! Il me semble correspondre aux propos de Gustave Le Bon.
Quand les mots sont usés, il convient de les changer sans toucher aux choses qu’ils représentent : « Le judicieux Tocqueville fait remarquer que le travail du Consulat et de l’Empire consista surtout à habiller de mots nouveaux la plupart des institutions du passé, à remplacer par conséquent des mots évoquant de fâcheuses images dans l’imagination par d’autres dont la nouveauté empêchait de pareilles évocations. La taille est devenue contribution foncière ; la gabelle, l’impôt du sel ; les aides, contributions indirectes et droit réunis ; la taxe des maîtrises et jurandes s’est appelée patente, etc. » (p. 62). Caustique, le Gustave, hein !
« les mots démocratie et socialisme, d’un usage si fréquent aujourd’hui […] correspondent, en réalité, à des idées et des images complètement opposées dans les âmes latines et dans les âmes anglo-saxonnes. Chez les Latins, le mot démocratie signifie surtout effacement de la volonté et de l’initiative de l’individu devant celles de l’État. Ce dernier est chargé de plus en plus de diriger, de centraliser, de monopoliser et de fabriquer. C’est à lui que tous les partis sans exception, radicaux, socialistes ou monarchistes, font constamment appel. Chez l’Anglo-Saxon, celui d’Amérique notamment, le même mot démocratie signifie au contraire développement intense de la volonté et de l’individu, effacement de l’État, auquel en dehors de la police, de l’armée et des relations diplomatiques, on ne laisse rien diriger, pas même l’instruction. Le même mot possède donc chez ces deux peuples des sens absolument contraires » (p. 63).
« Avec tous les progrès, la philosophie n’a pu encore offrir aux peuples aucun idéal capable de les charmer. Les illusions leur étant indispensables, ils se dirigent d’instinct, comme l’insecte allant à la lumière, vers les rhéteurs qui leur en présentent. Le grand facteur de l’évolution des peuples n’a jamais été la vérité, mais l’erreur. Et si le socialisme voit croître aujourd’hui sa puissance, c’est qu’il constitue la seule illusion vivante encore. Les démonstrations scientifiques n’entravent nullement sa marche progressive. Sa principale force est d’être défendu par des esprits ignorant assez les réalités des choses pour oser promettre hardiment à l’homme le bonheur. L’illusion sociale règne actuellement sur toutes les ruines amoncelées du passé, et l’avenir lui appartient. Les foules n’ont jamais eu soif de vérités. Devant les évidences qui leur déplaisent, elles se détournent, préférant déifier l’erreur, si l’erreur les séduit. Qui sait les illusionner est aisément leur maître ; qui tente de les désillusionner est toujours leur victime » (p. 64). Évidemment chacun remplacera dans la phrase, selon ses convictions, « socialisme » par « capitalisme » ou autre…
Comme dans son premier livre, Le Bon ne voit pas tout en noir du côté des foules : « Laissons donc la raison aux philosophes, mais ne lui demandons pas trop d’intervenir dans le gouvernement des hommes. Ce n’est pas avec la raison et c’est souvent malgré elle, que se sont créés des sentiments tels que l’honneur, l’abnégation, la foi religieuse, l’amour de la gloire et de la patrie, qui ont été jusqu’ici les grands ressorts de toutes les civilisations » (p. 67).
Voici un long extrait sur les meneurs :
« Dès qu’un certain nombre d’êtres vivants sont réunis, qu’il s’agisse d’un troupeau d’animaux ou d’une foule d’hommes, ils se placent d’instinct sous l’autorité d’un chef, c’est-à-dire d’un meneur.
Dans les foules humaines, le meneur joue un rôle considérable. Sa volonté est le noyau autour duquel se forment et s’identifient les opinions. La foule est un troupeau qui ne saurait se passer de maître.
Le meneur a d’abord été le plus souvent un mené hypnotisé par l’idée dont il est ensuite devenu l’apôtre. Elle l’a envahi au point que tout disparaît en dehors d’elle, et que toute opinion contraire lui paraît erreur et superstition. Tel Robespierre, hypnotisé par ses chimériques idées, et employant les procédés de l’Inquisition pour les propager.
Les meneurs ne sont pas, le plus souvent, des hommes de pensée, mais d’action. Ils sont peu clairvoyants, et ne pourraient l’être, la clairvoyance conduisant généralement au doute et à l’inaction. Ils se recrutent surtout parmi ces névrosés, ces excités, ces demi-aliénés qui côtoient les bords de la folie. Si absurde que soit l’idée qu’ils défendent ou le but qu’ils poursuivent, tout raisonnement s’émousse contre leur conviction. Le mépris et les persécutions ne font que les exciter davantage. Intérêt personnel, famille, tout est sacrifié. L’instinct de la conservation lui-même s’annule chez eux, au point que la seule récompense qu’ils sollicitent souvent est le martyre. L’intensité de la foi confère à leurs paroles une grande puissance suggestive. La multitude écoute toujours l’homme doué de volonté forte. Les individus réunis en foule perdant toute volonté se tournent d’instinct vers qui en possède une.
De meneurs, les peuples n’ont jamais manqué : mais tous ne possèdent pas, il s’en faut, les convictions fortes qui font les apôtres. Ce sont souvent des rhéteurs subtils, ne poursuivant que leurs intérêts personnels et cherchant à persuader en flattant de bas instincts. L’influence qu’ils exercent ainsi reste toujours éphémère. Les grands convaincus qui soulèvent l’âme des foules, les Pierre l’Ermite, les Luther, les Savonarole, les hommes de la Révolution, n’ont exercé de fascination qu’après avoir été d’abord subjugués eux-mêmes par une croyance. Ils purent alors créer dans les âmes cette puissance formidable nommée la foi, qui rend l’homme esclave absolu de son rêve.
Créer la foi, qu’il s’agisse de foi religieuse, politique ou sociale, de foi en une œuvre, en une personne, en une idée, tel est surtout le rôle des grands meneurs. De toutes les forces dont l’humanité dispose, la foi a toujours été une des plus considérables, et c’est avec raison que l’Évangile lui attribue le pouvoir de soulever les montagnes. Doter l’homme d’une foi, c’est décupler sa force. Les grands événements de l’histoire furent souvent réalisés par d’obscurs croyants n’ayant que leur foi pour eux. Ce n’est pas avec des lettrés et des philosophes, ni surtout avec des sceptiques, qu’ont été édifiées les religions qui ont gouverné le monde, et les vastes empires étendus d’un hémisphère à l’autre.
Mais, de tels exemples s’appliquent aux grands meneurs, et ces derniers sont assez rares pour que l’histoire en puisse aisément marquer le nombre. Ils forment le sommet d’une série continue, descendant du puissant manieur d’hommes à l’ouvrier qui, dans une auberge fumeuse, fascine lentement ses camarades en remâchant sans cesse quelques formules qu’il ne comprend guère, mais dont, selon lui, l’application doit amener la sûre réalisation de tous les rêves et de toutes les espérances.
Dans chaque sphère sociale, de la plus haute à la plus basse, dès que l’homme n’est plus isolé, il tombe bientôt sous la loi d’un meneur. La plupart des individus, dans les masses populaires surtout, ne possédant, en dehors de leur spécialité, aucune idée nette et raisonnée, sont incapables de se conduire. Le meneur leur sert de guide. Il peut être remplacé à la rigueur, mais très insuffisamment, par ces publications périodiques qui fabriquent des opinions pour leurs lecteurs et leur procurent des phrases toutes faites les dispensant de réfléchir.
L’autorité des meneurs est très despotique, et n’arrive même à s’imposer qu’en raison de ce despotisme. On a remarqué combien facilement ils se font obéir sans posséder cependant aucun moyen d’appuyer leur autorité, dans les couches ouvrières les plus turbulentes. Ils fixent les heures de travail, le taux des salaires, décident les grèves, les font commencer et cesser à heure fixe.
Les meneurs tendent aujourd’hui à remplacer progressivement les Pouvoirs publics à mesure que ces derniers se laissent discuter et affaiblir. Grâce à leur tyrannie, ces nouveaux maîtres obtiennent des foules une docilité beaucoup plus complète que n’en obtint aucun gouvernement. Si, par suite d’un accident quelconque, le meneur disparaît et n’est pas immédiatement remplacé, la foule redevient une collectivité sans cohésion ni résistance. Pendant une grève des employés d’omnibus à Paris, il a suffi d’arrêter les deux meneurs qui la dirigeaient pour la faire aussitôt cesser. Ce n’est pas le besoin de la liberté, mais celui de la servitude qui domine toujours l’âme des foules. Leur soif d’obéissance les fait se soumettre d’instinct à qui se déclare leur maître » (pp. 69-71)
« L’affirmation pure et simple, dégagée de tout raisonnement et de toute preuve, est un des plus sûrs moyens de faire pénétrer une idée dans l’esprit des foules. Plus l’affirmation est concise, plus elle est dépourvue de toute apparence de preuve et de démonstration, plus elle a d’autorité. Les livres religieux et les codes de tous les âges ont toujours procédé par simple affirmation. Les hommes d’État appelés à défendre une cause politique quelconque, les industriels propageant leurs produits par l’annonce, connaissent la valeur de l’affirmation » (p. 73). Et toi donc, notre bon Gustave !?
Encore un long extrait sur la contagion : « Lorsqu’une affirmation a été suffisamment répétée, avec unanimité dans la répétition, comme cela arrive pour certaines entreprises financières achetant tous les concours, il se forme ce qu’on appelle un courant d’opinion et le puissant mécanisme de la contagion intervient. Dans les foules, les idées, les sentiments, les émotions, les croyances possèdent un pouvoir contagieux aussi intense que celui des microbes. Ce phénomène s’observe chez les animaux eux-mêmes dès qu’ils sont en foule. Le tic d’un cheval dans une écurie est bientôt imité par les autres chevaux de la même écurie. Une frayeur, un mouvement désordonné de quelques moutons s’étend bientôt à tout le troupeau. La contagion des émotions explique la soudaineté des paniques. Les désordres cérébraux, comme la folie, se propagent aussi par la contagion. On sait combien est fréquente l’aliénation chez les médecins aliénistes. On cite même des formes de folie, l’agoraphobie, par exemple, communiquées de l’homme aux animaux.
La contagion n’exige pas la présence simultanée d’individus sur un seul point ; elle peut se faire à distance sous l’influence de certains événements qui orientent tous les esprits dans le même sens et leur donnent les caractères spéciaux aux foules, surtout quand les esprits sont préparés par les facteurs lointains que j’ai étudiés plus haut. Ainsi par exemple, l’explosion révolutionnaire de 1848, partie de Paris, s’étendit brusquement à une grande partie de l’Europe et ébranla plusieurs monarchies. […]
La contagion est assez puissante pour imposer aux hommes non seulement certaines opinions mais encore certaines façons de sentir. C’est elle qui fait mépriser à une époque telle œuvre, le Tannhauser, par exemple, et qui, quelques années plus tard, la fait admirer par ceux-là même qui l’avaient le plus dénigrée.
Par le mécanisme de la contagion et très peu par celui du raisonnement, se propagent les opinions et les croyances. C’est au cabaret, par affirmation, répétition et contagion que s’établissent les conceptions actuelles des ouvriers. Les croyances des foules de tous les âges ne se sont guère créées autrement. Renan compare avec justesse les premiers fondateurs du christianisme « aux ouvriers socialistes répandant leurs idées de cabaret en cabaret » ; et Voltaire avait déjà fait observer à propos de la religion chrétienne que « la plus vile canaille l’avait seule embrassée pendant plus de cent ans ».
Dans les exemples analogues à ceux que je viens de citer, la contagion, après s’être exercée dans les couches populaires, passe ensuite aux couches supérieures de la société. C’est ainsi que, de nos jours, les doctrines socialistes commencent à gagner ceux qui en seraient pourtant les premières victimes. Devant le mécanisme de la contagion, l’intérêt personnel lui-même s’évanouit.
Et c’est pourquoi toute opinion devenue populaire finit par s’imposer aux couches sociales élevées, si visible que puisse être l’absurdité de l’opinion triomphante. Cette réaction des couches sociales inférieures sur les couches supérieures est d’autant plus curieuse que les croyances de la foule dérivent toujours plus ou moins de quelque idée supérieure restée souvent sans influence dans le milieu où elle avait pris naissance. Cette idée supérieure, les meneurs subjugués par elle s’en emparent, la déforment et créent une secte qui la déforme de nouveau, puis la répand de plus en plus déformée dans les foules. Devenue vérité populaire, elle remonte en quelque sorte à sa source et agit alors sur les couches élevées d’une nation. C’est en définitive l’intelligence qui guide le monde, mais elle le guide vraiment de fort loin. Les philosophes créateurs d’idées sont depuis longtemps retournés à la poussière, lorsque, par l’effet du mécanisme que je viens de décrire, leur pensée finit par triompher » (pp. 74-76).
Sur l’idée du prestige, Le Bon ne craint pas de jouer les iconoclastes : « L’histoire, l’histoire littéraire et artistique surtout, étant seulement la répétition des mêmes jugements que personne n’essaie de contrôler, chacun finit par répéter ce qu’il apprit à l’école. Il existe certains noms et certaines choses auxquels nul n’oserait toucher. Pour un lecteur moderne, l’œuvre d’Homère dégage un incontestable et immense ennui ; mais qui oserait le dire ? [2] Le Parthénon, dans son état actuel, est une ruine assez dépourvue d’intérêt ; mais il possède un tel prestige qu’on ne le voit plus qu’avec tout son cortège de souvenirs historiques. Le propre du prestige est d’empêcher de voir les choses telles qu’elles sont et de paralyser nos jugements. Les foules toujours, les individus le plus souvent, ont besoin d’opinions toutes faites. Le succès de ces opinions est indépendant de la part de vérité ou d’erreurs qu’elles contiennent ; il réside uniquement dans leur prestige » (p. 78).
« Les croyances et les opinions des foules forment ainsi deux classes bien distinctes. D’une part, les grandes croyances permanentes, se perpétuant plusieurs siècles, et sur lesquelles une civilisation entière repose. Telles, autrefois, la conception féodale, les idées chrétiennes, celles de la réforme. Tels, de nos jours, le principe des nationalités, les idées démocratiques et sociales. D’autre part, les opinions momentanées et changeantes dérivées le plus souvent des conceptions générales que chaque âge voit apparaître et mourir : telles les théories qui guident les arts et la littérature à certains moments, celles, par exemple, qui produisent le romantisme, le naturalisme, etc. Aussi superficielles que la mode, elles changent comme les petites vagues naissant et s’évanouissant perpétuellement à la surface d’un lac aux eaux profondes » (p. 83).
« Prenons, par exemple, une courte période, 1790 à 1820 seulement, c’est-à-dire trente ans, la durée d’une génération. Nous y voyons les foules, d’abord monarchiques, devenir révolutionnaires, puis impérialistes, puis encore monarchiques. En religion, elles évoluent pendant le même temps du catholicisme à l’athéisme, puis au déisme, puis retournent aux formes les plus exagérées du catholicisme. Et ce ne sont pas seulement les foules, mais également ceux les dirigeant qui subissent de pareilles transformations. On voit ces grands Conventionnels, ennemis jurés des rois et ne voulant ni dieux ni maîtres, devenir humbles serviteurs de Napoléon, puis porter pieusement des cierges dans les processions sous Louis XVIII » (p. 87).
« L’évolution ainsi opérée depuis trente ans est frappante. À l’époque précédente, peu éloignée pourtant, les opinions possédaient encore une orientation générale ; elles dérivaient de l’adoption de quelque croyance fondamentale. Le fait seul d’être monarchiste donnait fatalement, aussi bien en histoire que dans les sciences, certaines idées arrêtées et le fait d’être républicain conférait des idées tout à fait contraires. Un monarchiste savait pertinemment que l’homme ne descend pas du singe, et un républicain savait non moins pertinemment qu’il en descend. Le monarchiste devait parler de la Révolution avec horreur, et le républicain avec vénération. Certains noms, tels que ceux de Robespierre et de Marat, devaient être prononcés avec des mines dévotes, et d’autres, comme ceux de César, d’Auguste et de Napoléon ne pouvaient être articulés sans invectives. Jusque dans notre Sorbonne prévalait cette naïve façon de concevoir l’histoire.
Aujourd’hui devant la discussion et l’analyse, toute opinion perd son prestige ; ses angles s’usent vite, et il survit bien peu d’idées capables de nous passionner. L’homme moderne est de plus en plus envahi par l’indifférence.
Ne déplorons pas trop cet effritement général des opinions. Que ce soit un symptôme de décadence dans la vie d’un peuple, on ne saurait le contester. Les voyants, les apôtres, les meneurs, les convaincus en un mot, ont certes une bien autre force que les négateurs, les critiques et les indifférents : mais n’oublions pas qu’avec la puissance actuelle des foules, si une seule opinion pouvait acquérir assez de prestige pour s’imposer, elle serait bientôt revêtue d’un pouvoir tellement tyrannique que tout devrait aussitôt plier devant elle. L’âge de la libre discussion serait alors clos pour longtemps. Les foules représentent des maîtres pacifiques quelquefois, comme l’étaient à leurs heures Héliogabale [3] et Tibère ; mais elles ont aussi de furieux caprices. Une civilisation prête à tomber entre leurs mains est à la merci de trop de hasards pour durer bien longtemps. Si quelque chose pouvait retarder un peu l’heure de l’effondrement, ce serait précisément l’extrême mobilité des opinions et l’indifférence croissante des foules pour toutes les croyances générales » (p. 90).
Livre III : Classification et description des diverses catégories de foules
Les « foules hétérogènes » d’abord, se différencient par leur nationalité : « Les tentatives faites par les socialistes pour fusionner dans de grands congrès les représentants de la population ouvrière de chaque pays, ont toujours abouti aux plus furieuses discordes. Une foule latine, si révolutionnaire ou si conservatrice qu’on la suppose, fera invariablement appel, pour réaliser ses exigences, à l’intervention de l’État. Elle est toujours centralisatrice et plus ou moins césarienne. Une foule anglaise ou américaine, au contraire, ne connaît pas l’État et ne s’adresse qu’à l’initiative privée. Une foule française tient avant tout à l’égalité, et une foule anglaise à la liberté. Ces différences de races engendrent presque autant d’espèces de foules qu’il y a de nations » (p. 94).
Pour les foules « criminelles », voici un exemple historique : « On peut citer comme exemple typique le meurtre du gouverneur de la Bastille, M. de Launay. Après la prise de cette forteresse, le gouverneur, entouré d’une foule très excitée, recevait des coups de tous côtés. On proposait de le pendre, de lui couper la tête, ou de l’attacher à la queue d’un cheval. En se débattant, il frappa par mégarde d’un coup de pied l’un des assistants. Quelqu’un proposa, et sa suggestion fut acclamée aussitôt par la foule, que l’individu atteint coupât le cou au gouverneur.
« Celui-ci, cuisinier sans place, demi-badaud qui est allé à la Bastille pour voir ce qui s’y passait, juge que, puisque tel est l’avis général, l’action est patriotique, et croit même mériter une médaille en détruisant un monstre. Avec un sabre qu’on lui prête, il frappe sur le col nu ; mais le sabre mal affilé ne coupant pas, il tire de sa poche un petit couteau à manche noir et (comme, en sa qualité de cuisinier, il sait travailler les viandes) il achève heureusement l’opération.

On voit clairement ici le mécanisme précédemment indiqué. Obéissance à une suggestion d’autant plus puissante qu’elle est collective, conviction chez le meurtrier d’avoir commis un acte fort méritoire, et conviction naturelle puisqu’il a pour lui l’approbation unanime de ses concitoyens. Un acte semblable peut être légalement, mais non psychologiquement, qualifié de criminel » (p. 97). J’ai choisi pour illustrer ce passage une fresque de l’Église San Maurizio al Monastero Maggiore de Milan, le Martyr de Saint Stéphane (v. 1550) attribué à un méconnu Evangelista Luini.
« Connaissant la psychologie des castes et celle des autres catégories de foules, je ne vois aucun cas où, accusé à tort d’un crime, je ne préférerais avoir affaire à des jurés plutôt qu’à des magistrats. Avec les premiers, j’aurais beaucoup de chances d’être reconnu innocent et très peu avec les seconds. Redoutons la puissance des foules, mais beaucoup plus encore celle de certaines castes. Les unes peuvent se laisser convaincre, les autres ne fléchissent jamais » Pan, sur le bec ! (p. 105).
Dans le domaine électoral, le prestige aide, mais pas seulement : « Mais la possession du prestige ne suffit pas pour assurer le succès au candidat. L’électeur tient à voir flatter ses convoitises et ses vanités ; le candidat doit l’accabler d’extravagantes flagorneries, ne pas hésiter à lui faire les plus fantastiques promesses. Devant des ouvriers, on ne saurait trop injurier et flétrir leurs patrons. Quant au candidat adverse, on tâchera de l’écraser en établissant par affirmation, répétition et contagion qu’il est le dernier des gredins, et que personne n’ignore qu’il a commis plusieurs crimes. Inutile, bien entendu, de chercher aucun semblant de preuve. Si l’adversaire connaît mal la psychologie des foules, il essaiera de se justifier par des arguments, au lieu de répondre simplement aux affirmations calomnieuses par d’autres affirmations également calomnieuses ; et n’aura dès lors aucune chance de triompher.
Le programme écrit du candidat ne doit pas être très catégorique, car ses adversaires pourraient le lui opposer plus tard ; mais son programme verbal ne saurait être trop excessif. Les réformes les plus considérables peuvent être promises sans crainte. Sur le moment, ces exagérations produisent beaucoup d’effet, et pour l’avenir n’engagent en rien. L’électeur ne se préoccupe nullement en effet par la suite de savoir si l’élu a suivi la profession de foi acclamée, et sur laquelle l’élection est supposée avoir eu lieu » (p. 108). Ces propos précèdent l’invention de procédés d’enregistrement sonores, mais on dirait que cela n’y fait rien. Trump semble avoir lu Gustave Le Bon !
« Les inconvénients du suffrage universel sont évidemment trop visibles pour être méconnus. On ne saurait contester que les civilisations furent l’œuvre d’une petite minorité d’esprits supérieurs constituant la pointe d’une pyramide, dont les étages, s’élargissant à mesure que décroît la valeur mentale, représentent les couches profondes d’une nation. La grandeur d’une civilisation ne peut assurément dépendre du suffrage d’éléments inférieurs, représentant uniquement le nombre. Sans doute encore les suffrages des foules sont souvent bien dangereux. Ils nous ont déjà amené plusieurs invasions ; et avec le triomphe du socialisme, les fantaisies de la souveraineté populaire nous coûteront sûrement beaucoup plus cher encore » (p. 111).
Une assez longue citation de Jules Simon mérite d’être reproduite à son tour ici :
« Deux mois avant d’être tout-puissant, Louis-Napoléon n’était rien.
« Victor Hugo monta à la tribune. Il n’y eut pas de succès. On l’écouta, comme on écoutait Félix Pyat ; on ne l’applaudit pas autant. « Je n’aime pas ses idées, me dit Vaulabelle en parlant de Félix Pyat ; mais c’est un des plus grands écrivains et le plus grand orateur de la France. » Edgar Quinet, ce rare et puissant esprit, n’était compté pour rien. Il avait eu son moment de popularité avant l’ouverture de l’Assemblée ; dans l’Assemblée, il n’en eut aucune.
« Les assemblées politiques sont le lieu de la terre où l’éclat du génie se fait le moins sentir. On n’y tient compte que d’une éloquence appropriée au temps et au lieu, et des services rendus non à la patrie, mais aux partis. Pour qu’on rendît hommage à Lamartine en 1848 et à Thiers en 1871, il fallut le stimulant de l’intérêt urgent, inexorable. Le danger passé, on fut guéri à la fois de la reconnaissance et de la peur. »
J’ai reproduit le passage qui précède pour les faits qu’il contient, mais non pour les explications, qu’il propose. Elles sont d’une psychologie médiocre. Une foule perdrait aussitôt son caractère de foule si elle tenait compte aux meneurs des services rendus, soit à la patrie, soit aux partis. La foule subit le prestige du meneur et ne fait intervenir dans sa conduite aucun sentiment d’intérêt ou de reconnaissance » (p. 115). Un témoignage utile lorsqu’on propose un discours de Totor à nos élèves. Les contemporains, ça leur en touchait l’une sans faire bouger l’autre !
« Malgré toutes les difficultés de leur fonctionnement, les assemblées parlementaires représentent la meilleure méthode que les peuples aient encore trouvée pour se gouverner et surtout se soustraire le plus possible au joug des tyrannies personnelles. Elles sont certainement l’idéal d’un gouvernement, au moins pour les philosophes, les penseurs, les écrivains, les artistes et les savants, en un mot pour tout ce qui constitue le sommet d’une civilisation. Elles ne présentent d’ailleurs que deux dangers sérieux, le gaspillage forcé des finances et une restriction progressive des libertés individuelles » (p. 120).
Mais Gustave Le Bon identifie un second danger des assemblées, la restriction des libertés, et ses propos rejoignent ceux de Jeremy Bentham dans ce long extrait que j’ai isolé :
« Cette réduction progressive des libertés se manifeste pour tous les pays sous une forme spéciale […] : la création d’innombrables mesures législatives, toutes généralement d’ordre restrictif, conduit nécessairement à augmenter le nombre, le pouvoir et l’influence des fonctionnaires chargés de les appliquer. Ils tendent ainsi progressivement à devenir les véritables maîtres des pays civilisés. Leur puissance est d’autant plus grande, que, dans les incessants changements de gouvernements, la caste administrative échappant à ces changements, possède seule l’irresponsabilité, l’impersonnalité et la perpétuité. Or, de tous les despotismes, il n’en est pas de plus lourds que ceux qui se présentent sous cette triple forme.
La création incessante de lois et de règlements restrictifs entourant des formalités les plus byzantines les moindres actes de la vie, a pour résultat fatal de rétrécir progressivement la sphère dans laquelle les citoyens peuvent se mouvoir librement. Victimes de cette illusion qu’en multipliant les lois, l’égalité et la liberté se trouvent mieux assurées, les peuples acceptent chaque jour de plus pesantes entraves.
Ce n’est pas impunément qu’ils les acceptent. Habitués à supporter tous les jougs, ils finissent bientôt par les rechercher, et, perdre toute spontanéité et toute énergie. Ce ne sont plus que des ombres vaines, des automates passifs, sans volonté, sans résistance et sans force.
Mais les ressorts qu’il ne trouve plus en lui-même, l’homme est alors bien forcé de les chercher ailleurs. Avec l’indifférence et l’impuissance croissantes des citoyens, le rôle des gouvernements est obligé de grandir encore. Ces derniers doivent avoir forcément l’esprit d’initiative, d’entreprise et de conduite que les particuliers ont perdu. Il leur faut tout entreprendre, tout diriger, tout protéger. L’État devient alors un dieu tout-puissant. Mais l’expérience enseigne que le pouvoir de telles divinités ne fut jamais ni bien durable ni bien fort.
La restriction progressive de toutes les libertés chez certains peuples, malgré une licence qui leur donne l’illusion de les posséder, semble résulter de leur vieillesse tout autant que d’un régime quelconque. Elle constitue un des symptômes précurseurs de cette phase de décadence à laquelle aucune civilisation n’a pu échapper jusqu’ici » (p. 123).
Dernier extrait, la conclusion de l’ouvrage :
« Avec l’évanouissement progressif de son idéal, la race perd de plus en plus ce qui faisait sa cohésion, son unité et sa force. L’individu peut croître en personnalité et en intelligence, mais en même temps aussi l’égoïsme collectif de la race est remplacé par un développement excessif de l’égoïsme individuel accompagné de l’affaissement du caractère et de l’amoindrissement des aptitudes à l’action. Ce qui formait un peuple, une unité, un bloc, finit par devenir une agglomération d’individus sans cohésion et que maintiennent artificiellement pour quelque temps encore les traditions et les institutions. C’est alors que divisés par leurs intérêts et leurs aspirations, ne sachant plus se gouverner, les hommes demandent à être dirigés dans leurs moindres actes, et que l’État exerce son influence absorbante.
Avec la perte définitive de l’idéal ancien, la race finit par perdre aussi son âme. Elle n’est plus qu’une poussière d’individus isolés et redevient ce qu’elle était à son point de départ : une foule. Elle en présente tous les caractères transitoires sans consistance et sans lendemain. La civilisation n’a plus aucune fixité et tombe à la merci de tous les hasards. La plèbe est reine et les barbares avancent. La civilisation peut sembler brillante encore parce qu’elle conserve la façade extérieure créée par un long passé, mais c’est en réalité un édifice vermoulu que rien ne soutient plus et qui s’effondrera au premier orage.
Passer de la barbarie à la civilisation en poursuivant un rêve, puis décliner et mourir dès que ce rêve a perdu sa force, tel est le cycle de la vie d’un peuple » (p. 125).
C’est sur cette prophétie que se termine notre lecture de Psychologie des foules de Gustave Le Bon.
– Le poème en prose de Charles Baudelaire « Les foules » (qui fait partie de la liste officielle du thème) est bien éloigné du livre de Gustave Le Bon. Sauf le dernier paragraphe qui traite des meneurs, par « foule » Baudelaire entend « peuple ».
– Le Soleil brille pour tout le monde (1953) de John Ford présente une belle scène de tentative de lynchage d’un bouc émissaire, quand le juge Priest à force d’argumentation en situation difficile, parvient à sauver le jeune noir U.S. Grant Woodford de la furie des lyncheurs en attendant que le vrai coupable soit trouvé.
– Il est étonnant que le livre de Le Bon ne contienne aucune occurrence du mot « ochlocratie » (pouvoir du peuple), qu’on trouve pourtant dans Du Contrat social, de Jean-Jacques Rousseau.
Voir en ligne : Article de Wikipédia sur le livre
© altersexualite.com 2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] J’ajouterais que d’autres mots font perdre le sens commun aux foules dès lors qu’ils sont utilisés. Voyez avec le mot « pédophilie » par exemple, qui a entraîné récemment la condamnation d’un prélat pour « non dénonciation d’agression sexuelle ». Notez bien le mot « agression sexuelle », qui couvre tout et son contraire, depuis la main aux fesses jusqu’au crime sadique. Aucun intellectuel, pas plus qu’aucun plombier (pour reprendre l’idée de Gustave Le Bon que la foule nivelle les catégories sociales) ne s’est ému que l’on condamne un homme qui n’a commis aucun crime pour « non dénonciation ». Notez que l’on n’a pas employé le mot « délation ». Et aucun commentateur à ma connaissance ne s’est interrogé, puisque on en est à instaurer un délit de « non délation », sur l’opportunité de légiférer sur la dénonciation obligatoire des islamistes en voie de passer à la violence armée. Et tant qu’on y est, a-t-on légiféré pour forcer les prêtres ayant reçu la confession d’un assassinat, de le dénoncer ? CQFD.
[2] Pour avoir osé dire que La Princesse de Clèves était un pensum, un président de république récent perdit de son prestige…
[3] En ce qui concerne celui-ci, l’article de Wikipédia fournit une belle illustration des propos de Le Bon sur le retournement subit des foules : « Héliogabale veut alors faire arrêter les meneurs mais une foule furieuse envahit le palais impérial et massacre l’empereur. Son corps est traîné à travers les rues de Rome, puis la populace tente de jeter le cadavre aux égouts, mais, comme les conduits sont trop étroits, le cadavre de l’empereur est finalement jeté dans le Tibre depuis le pont Æmilius ».
 altersexualite.com
altersexualite.com