Accueil > Classiques > Œuvres, de Georges-Louis Leclerc de Buffon (1) : Sciences naturelles et (...)
Un classique oublié à redécouvrir.
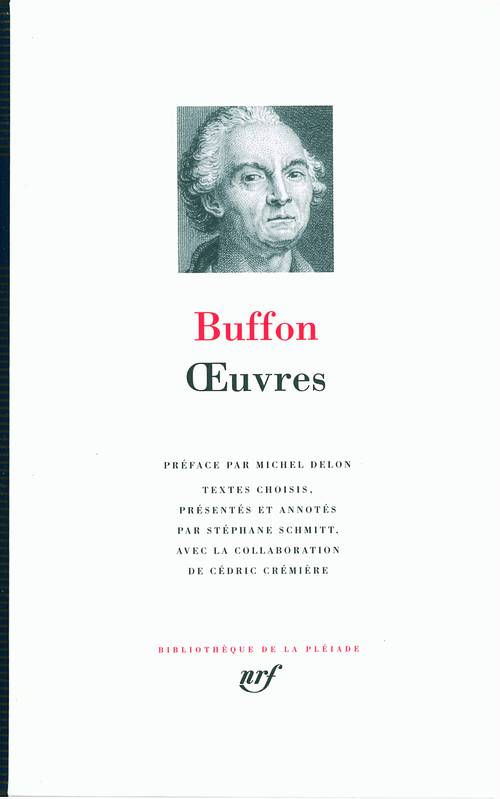 Œuvres, de Georges-Louis Leclerc de Buffon (1) : Sciences naturelles et Histoire naturelle de l’homme
Œuvres, de Georges-Louis Leclerc de Buffon (1) : Sciences naturelles et Histoire naturelle de l’homme
La Pléiade, 2007 (1749-1788), 1678 p., 66 €
samedi 18 juillet 2020, par
Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1789) aura laissé une œuvre monumentale parallèle à l’Encyclopédie, œuvre plus ou moins oubliée à la fois dans le domaine scientifique et littéraire. Le volume d’Œuvres publié par la Pléiade en 2007 par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière et une préface de Michel Delon permet de renouer avec ce grand esprit et fin prosateur. S’il n’a pas participé directement à l’Encyclopédie, ses œuvres y ont été pillées par paragraphes entiers, sans que son nom soit toujours mentionné, même par les auteurs du site ENCCRE. Mathématicien de formation, Buffon ayant été assez jeune nommé intendant du Jardin du roi en 1739, se dirige vers l’histoire naturelle, botanique, zoologie & minéralogie. Il publie trois volumes en 1749, puis 33 jusqu’en 1789, avec divers collaborateurs dont Louis Jean-Marie Daubenton, natif comme lui de Montbard. Bernard-Germain de Lacépède prendra la suite et publiera 8 volumes entre 1788 & 1804 consacrés aux animaux que Buffon n’avait pas pu traiter. Honoré de Balzac s’identifiera à Buffon, le citera et l’utilisera pour sa Comédie humaine. Avant de commencer vous pourriez feuilleter un album de planches d’illustrations de ses œuvres sur le site que lui consacre la BNF. Ce 1er article est consacré aux sciences naturelles et à l’Histoire naturelle de l’homme ; un 2e article est consacré à l’Histoire naturelle des animaux
Un scientifique et un vulgarisateur
Buffon se livre à quelques expériences pratiques, sur les bois ou sur la perception des couleurs par exemple. C’est aussi un grand observateur, capable de remarquer ce que pour la plupart nous avons devant nous sans le voir. Il a le don de décrire dans un style limpide. Enfin, c’est un vulgarisateur, qui semble avoir tout lu ce qui s’est publié avant lui. Il en fait la synthèse, et il cite toutes ses sources en bas de page, quitte parfois à propager des erreurs car en ce qui concerne les contrées lointaines, il est parfois contraint de croire tout ce qu’il lit. Sur l’homme, on sait peu de choses. Michel Delon rapporte une réputation souvent gommée par pudeur, un goût « pour les femmes, ou plutôt pour les petites filles », selon son biographe Marie-Jean Hérault de Séchelles. À sa mort, un témoignage « rappelle le tempérament robuste du disparu, son avidité de présences féminines qui n’était compensée que par le sens du travail et la passion de la gloire ». Enfin, c’est un Buffon « peu bégueule, qui était plus porté sur les réalités tangibles que sur les subtilités morales du désir et qui ne s’est marié, sans doute par amour, que tardivement » (p. XXIII). Alors qu’il s’était fâché avec son père, remarié à 50 ans avec une femme de 22 ans, Buffon épouse à 45 ans une femme de vingt ans !
Les premières œuvres proposées par cette anthologie sont une préface à une traduction de deux ouvrages de sciences naturelles de Stephen Hales ; traductions d’ailleurs assez libres, où le traducteur même ses propres remarques. On passe rapidement à l’Histoire naturelle, qui commence par un Premier discours qui expose la méthode de Buffon, puis un Second discours consacré à l’Histoire et théorie de la terre.
J’ai cité dans différents articles des extraits de ces œuvres, que je reprends ici. Voyage au centre de la terre de Jules Verne gagne à être confronté à des extraits du Second discours sur la façon dont était appréhendé l’intérieur de la terre par le grand naturaliste, qui était toujours très lu dans le cadre scolaire à l’époque de Jules Verne. « […] nous ne pouvons pénétrer que dans l’écorce de la Terre, & les plus grandes cavités, les mines les plus profondes ne descendent pas à la huit millième partie de son diamètre ; nous ne pouvons donc juger que de la couche extérieure & presque superficielle, l’intérieur de la masse nous est entièrement inconnu : on sait que, volume pour volume, la Terre pèse quatre fois plus que le Soleil ; on a aussi le rapport de sa pesanteur avec les autres planètes, mais ce n’est qu’une estimation relative, l’unité de mesure nous manque, le poids réel de la matière nous étant inconnu, en sorte que l’intérieur de la Terre pourrait être ou vide ou rempli d’une matière mille fois plus pesante que l’or, & nous n’avons aucun moyen de le reconnaître ; à peine pouvons nous former sur cela quelques conjectures raisonnables » (p. 70) […] « je vois que les volcans se trouvent tous dans les hautes montagnes, qu’il y en a un grand nombre dont les feux sont entièrement éteints, que quelques-uns de ces volcans ont des correspondances souterraines, & que leurs explosions se font quelquefois en même temps. J’aperçois une correspondance semblable entre certains lacs & les mers voisines ; ici sont des fleuves & des torrents qui se perdent tout à coup & paraissent se précipiter dans les entrailles de la terre ; là est une mer intérieure où se rendent cent rivières qui y portent de toutes parts une énorme quantité d’eau, sans jamais augmenter ce lac immense, qui semble rendre par des voies souterraines tout ce qu’il reçoit par ses bords » (p. 73). Le mythe de l’Atlantide n’est pas évoqué ni dans le texte de Verne ni dans les notes, mais en relisant cet extrait du même discours de Buffon, on ne peut s’empêcher d’y songer : « Par exemple, si nous nous prêtons un instant à supposer à supposer que l’Ancien et le Nouveau Monde ne faisaient autrefois qu’un seul continent, et que, par un violent tremblement de terre le terrain de l’ancienne Atlantide de Platon se soit affaissé, la mer aura nécessairement coulé de tous côtés pour former l’océan Atlantique, et par conséquent aura laissé à découvert de vastes continents, qui sont peut-être ceux que nous habitons ; ce changement a donc pu se faire tout à coup par l’affaissement de quelque vaste caverne dans l’intérieur du globe, et produire par conséquent un déluge universel ; ou bien ce changement ne s’est pas fait tout à coup, et il a fallu peut-être beaucoup de temps, mais enfin il s’est fait, et je crois même qu’il s’est fait naturellement » (p. 87). Cet extrait révèle la façon de procéder par hypothèses de Buffon.
Nous passons à De la formation des planètes. L’auteur rivalise avec les textes religieux, et les notes signalent les phrases censurées par les autorités religieuses jésuites et celles qui tentaient de les amadouer. Buffon aura d’ailleurs peu affaire auxdites autorités. Une « Correspondance avec la Sorbonne » (p. 409 sq.) mentionne 14 propositions sujettes à caution, mais Buffon se contenta de publier cet avertissement dans les volumes suivants, sans modifier les volumes précédents dans leurs réimpressions ! Les jansénistes furent plus sévères, mais se contentèrent de fulminer.
Histoire naturelle de l’homme
Dans la partie de l’introduction de l’Histoire naturelle générale consacrée à l’homme, je relève que le mot « testicule » s’utilise aussi pour les femelles : « Je pense donc que les molécules organiques renvoyées de toutes les parties du corps dans les testicules et dans les vésicules séminales du mâle, et dans les testicules ou dans telle autre partie qu’on voudra de la femelle, y forment la liqueur séminale » (p. 168). Ce paragraphe sur la masturbation nous amuse : « Les jeunes gens qui s’épuisent, et qui par des irritations forcées déterminent vers les organes de la génération une plus grande quantité de liqueur séminale qu’il n’en arriverait naturellement, commencent par cesser de croître, ils maigrissent et tombent enfin dans le marasme, et cela parce qu’ils perdent par des évacuations trop souvent réitérées la substance nécessaire à leur accroissement et à la nutrition de toutes les parties de leur corps » (p. 176). À ajouter aux Origines de la sexologie 1850-1900 de Sylvie Chaperon. Il est étonnant que ce savant propre à toutes les vérifications expérimentales n’en ai pas diligenté dans ce domaine. C’était pourtant facile de choisir des couples de frères, jumeaux par exemple, et de vérifier par une expérimentation randomisée en double aveugle l’existence de ce « marasme » au bout de quelques années d’expérience ! Il faut dire que la lecture de l’article « manustupration » de l’Encyclopédie nous édifie sur la nature des « expériences » dont se prévaut l’auteur de ce tissu de conneries !
Nous voici dans l’Histoire naturelle de l’homme, chapitre De l’enfance. Contrairement à la masturbation, Buffon combat une idée reçue et une habitude, l’emmaillotement des nourrissons (et les corsets), en arguant des coutumes des sauvages. J’ai cité ce paragraphe dans l’article sur Histoire de la beauté : Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours de Georges Vigarello : « À peine l’enfant est-il sorti du sein de la mère, à peine jouit-il de la liberté de mouvoir et d’étendre ses membres, qu’on lui donne de nouveaux liens, on l’emmaillote, on le couche la tête fixe et les jambes allongées, les bras pendants à côté du corps, il est entouré de linges et de bandages de toute espèce qui ne lui permettent pas de changer de situation ; heureux si on ne l’a pas serré au point de l’empêcher de respirer, et si on a eu la précaution de le coucher sur le côté, afin que les eaux qu’il doit rendre par la bouche puissent tomber d’elles-mêmes, car il n’aurait pas la liberté de tourner la tête sur le côté pour en faciliter l’écoulement. Les peuples qui se contentent de couvrir ou de vêtir leurs enfants sans les mettre au maillot, ne font-ils pas mieux que nous ? les Siamois les Japonais, les Indiens, les Nègres [1], les sauvages du Canada, ceux de Virginie, du Brésil, et la plupart des peuples de la partie méridionale de l’Amérique, couchent les enfants nus sur des lits de coton suspendus, ou les mettent dans des espèces de berceaux couverts et garnis de pelleteries. Je crois que ces usages ne sont pas sujets à autant d’inconvénients que le nôtre ; on ne peut pas éviter, en emmaillotant les enfants, de les gêner au point de leur faire ressentir de la douleur ; les efforts qu’ils font pour se débarrasser sont plus capables de corrompre l’assemblage de leur corps, que les mauvaises situations où ils pourraient se mettre eux-mêmes s’ils étaient en liberté. Les bandages du maillot peuvent être comparés aux corps que l’on fait porter aux filles dans leur jeunesse ; cette espèce de cuirasse, ce vêtement incommode, qu’on a imaginé pour soutenir la taille et l’empêcher de se déformer, cause cependant plus d’incommodités et de difformités qu’il n’en prévient » (p. 198). Attention : ce texte est cité dans L’Émile de Rousseau, mais il est de Buffon !
Le début de l’article « De la puberté » est un excellent texte complémentaire pour l’étude du personnage de Chérubin dans Le Mariage de Figaro : « La puberté accompagne l’adolescence et précède la jeunesse. Jusqu’alors la Nature ne paraît avoir travaillé que pour la conservation & l’accroissement de son ouvrage, elle ne fournit à l’enfant que ce qui lui est nécessaire pour se nourrir et pour croître ; il vit, ou plutôt il végète d’une vie particulière, toujours faible, renfermée en lui-même, et qu’il ne peut communiquer ; mais bientôt les principes de vie se multiplient, il a non seulement tout ce qui lui faut pour être, mais encore de quoi donner l’existence à d’autres. Cette surabondance de vie, source de la force & de la santé, ne pouvant plus être contenue au-dedans, cherche à se répandre au-dehors ; elle s’annonce par plusieurs signes ; l’âge de la puberté est le printemps de la Nature, la saison des plaisirs. Pourrons-nous écrire l’histoire de cet âge avec assez de circonspection pour ne réveiller dans l’imagination que des idées philosophiques ? » (p. 212). À noter : comme beaucoup d’articles de Buffon, des parties de son texte ont été intégrées telles quelles dans certains articles de L’Encyclopédie, comme l’article « Puberté » ou « Emmaillotter » sans que le nom de Buffon apparaisse. Il est désigné par des périphrases comme « j’en emprunterai la description du physicien philosophe, à qui nous devons l’histoire naturelle de l’homme ». La notion de copyright était balbutiante à l’époque ! Une autre anecdote sur le pillage de Buffon par l’Encyclopédie concerne l’article « Eunuque ». Voici l’information donnée par Buffon : « Les eunuques auxquels on n’a ôté que les testicules, ne laissent pas de sentir de l’irritation dans ce qui leur reste, et d’en avoir le signe extérieur, même plus fréquemment que les autres hommes ; cette partie qui leur reste n’a cependant pris qu’un très petit accroissement, car elle demeure à peu près dans le même état où elle était avant l’opération ; un eunuque fait à l’âge de sept ans, est, à cet égard à vingt ans comme un enfant de sept ans, ceux au contraire, qui n’ont subi l’opération que dans le temps de la puberté, ou un peu plus tard, sont à peu près comme les autres hommes » (p. 216). L’article de l’Encyclopédie commet une erreur de copie qui inverse le sens de Buffon, en écrivant « on n’a laissé que les testicules » au lieu de « on n’a ôté que les testicules ». C’est ce qu’explique Marie-Laure Delmas dans un article érudit : « Le fait est certain, & cela suffit » : regard des lumières sur l’eunuque ». Or c’est amusant, mais cette explication rejaillit sur une erreur d’interprétation d’un texte célébrissime de Montesquieu que j’ai eu l’honneur de rectifier, ce qui me valut les félicitations du Pr René Pommier.
Voici un beau paragraphe progressiste sur la virginité : « Les hommes jaloux des primautés en tout genre, ont toujours fait grand cas de tout ce qu’ils ont cru pouvoir posséder exclusivement et les premiers ; c’est cette espèce de folie qui a fait un être réel de la virginité des filles. La virginité qui est un être moral, une vertu qui ne consiste que dans la pureté du cœur, est devenue un objet physique dont tous les hommes se sont occupés ; ils ont établi sur cela des opinions, des usages, des cérémonies, des superstitions, et même des jugements et des peines ; les abus les plus illicites, les coutumes les plus déshonnêtes, ont été autorisés ; on a soumis à l’examen de matrones ignorantes, et exposé aux yeux de médecins prévenus, les parties les plus secrètes de la Nature, sans songer qu’une pareille indécence est un attentat contre la virginité, que c’est la violer que de chercher à la reconnaître, que toute situation honteuse, tout état indécent dont une fille est obligée de rougir intérieurement, est une vraie défloration » (p. 221). Étonnante modernité chez ce pourfendeur de la masturbation ! Et il poursuit sur l’hymen : « Ambroise Paré, Dulaurent, Graaf, Pineus, Dionis, Mauriceau, Palfyn et plusieurs autres anatomistes aussi fameux et tout au moins aussi accrédités que les premiers que nous avons cités, soutiennent au contraire que la membrane de l’hymen n’est qu’une chimère, que cette partie n’est point naturelle aux filles, et ils s’étonnent de ce que les autres en ont parlé comme d’une chose réelle et constante ; ils leur opposent une multitude d’expériences par lesquelles ils se sont assurés que cette membrane n’existe pas ordinairement ; ils rapportent les observations qu’ils ont faites sur un grand nombre de filles de différents âges, qu’ils ont disséquées et dans lesquelles ils n’ont pu trouver cette membrane, ils avouent seulement qu’ils ont vu quelquefois, mais bien rarement, une membrane qui unissait des protubérances charnues, qu’ils ont appelées caroncules myrtiformes, mais ils soutiennent que cette membrane était contre l’état naturel. Les anatomistes ne sont pas plus d’accord entre eux sur la qualité et le nombre de ces caroncules ; sont-elles seulement des rugosités du vagin ? sont-elles des parties distinctes et séparées ? sont-elles des restes de la membrane de l’hymen ? le nombre en est-il constant ? N’y en a-t-il qu’une seule ou plusieurs dans l’état de virginité ? » (p. 222). Il mentionne aussi l’infibulation, mais c’est pour retourner le compliment contre ses contemporains : « On dit qu’ils emploient pour cette infibulation des femmes un fil d’amiante, parce que cette matière n’est pas sujette à la corruption. Il y a certains peuples qui passent seulement un anneau ; les femmes sont soumises, comme les filles, à cet usage outrageant pour la vertu, on les force de même à porter un anneau, la seule différence est que celui des filles ne peut s’ôter, et que celui des femmes a une espèce de serrure, dont le mari seul a la clef. Mais pourquoi citer des nations barbares, lorsque nous avons de pareils exemples aussi près de nous ? La délicatesse dont quelques-uns de nos voisins se piquent sur la chasteté de leurs femmes est-elle autre chose qu’une jalousie brutale et criminelle ? » (p. 226). L’article « Virginité » de l’Encyclopédie reprend une bonne partie de ce texte, mais en nommant Buffon, pour une fois. Sur la polygamie, là encore Buffon exerce un bon sens dont il a été incapable sur la masturbation : « L’état naturel des hommes après la puberté est celui du mariage ; un homme ne doit avoir qu’une femme, comme une femme ne doit avoir qu’un homme ; cette loi est celle de la Nature, puisque le nombre des femelles est à peu près égal à celui des mâles ; ce ne peut donc être qu’en s’éloignant du droit naturel, et par la plus injuste de toutes les tyrannies, que les hommes ont établi des lois contraires ; la raison, l’humanité, la justice réclament contre ces sérails odieux, où l’on sacrifie à la passion brutale ou dédaigneuse d’un seul homme la liberté et le cœur de plusieurs femmes dont chacune pourrait faire le bonheur d’un autre homme. Ces tyrans du genre humain en sont-ils plus heureux ? environnés d’eunuques et de femmes inutiles à eux-mêmes et aux autres hommes, ils sont assez punis, ils ne voient que les malheureux qu’ils ont faits » (p. 227). Le mariage est nécessaire parce que son absence génère des troubles : « L’effet extrême de cette irritation dans les femmes est la fureur utérine ; c’est une espèce de manie qui leur trouble l’esprit et leur ôte toute pudeur, les discours les plus lascifs, les actions les plus indécentes accompagnent cette triste maladie et en décèlent l’origine » (p. 228). Buffon condamne l’institution du « congrès », acception oubliée dont les notes nous expliquent d’après le dictionnaire de Trévoux, qu’il s’agissait d’une épreuve publique « de la puissance ou de l’impuissance des gens mariés » (p. 1457) : « Cette partie de notre corps est donc moins à nous qu’aucune autre, elle agit ou elle languit sans notre participation, ses fonctions commencent et finissent dans de certains temps, à un certain âge ; tout cela se fait sans nos ordres, et souvent contre notre consentement. Pourquoi donc l’homme ne traite-t-il pas cette partie comme rebelle, ou du moins comme étrangère ? pourquoi semble-t-il lui obéir ? est-ce parce qu’il ne peut lui commander ?
Sur quel fondement étaient donc appuyées ces lois si peu réfléchies dans le principe et si déshonnêtes dans l’exécution ? comment le congrès a-t-il pu être ordonné par des hommes qui doivent se connaître eux-mêmes et savoir que rien ne dépend moins d’eux que l’action de ces organes, par des hommes qui ne pouvaient ignorer que toute émotion de l’âme, et surtout la honte, sont contraires à cet état, et que la publicité et l’appareil seul de cette épreuve étaient plus que suffisants pour qu’elle fût sans succès ? » (p 231). La « superfétation », ou double conception, mot rencontré chez Casanova, engendre une réflexion basée sur un exemple : « J’ajouterai un fait qui prouve que l’orifice de la matrice ne se ferme pas immédiatement après la conception, ou bien que s’il se ferme la liqueur séminale du mâle entre dans la matrice en pénétrant à travers le tissu de ce viscère. Une femme de Charles-Town, dans la Caroline méridionale accoucha en 1714 de deux jumeaux qui vinrent au monde tout de suite l’un après l’autre ; il se trouva que l’un était un enfant nègre et l’autre un enfant blanc, ce qui surprit beaucoup les assistants. Ce témoignage évident de l’infidélité de cette femme à l’égard de son mari, la força d’avouer qu’un nègre qui la servait était entré dans sa chambre un jour que son mari venait de la quitter et de la laisser dans son lit, et elle ajouta pour s’excuser que ce nègre l’avait menacée de la tuer, et qu’elle avait été contrainte de le satisfaire. […] Ce fait ne prouve-t-il pas aussi que la conception de deux ou de plusieurs jumeaux ne se fait pas toujours dans le même temps ? et ne paraît-il pas favoriser beaucoup mon opinion sur la pénétration de la liqueur séminale au travers du tissu de la matrice ? » (p. 234).
L’article « De l’âge viril. Description de l’homme » contient aussi de belles pages. Variation sur « l’habit ne fait pas le moine » : « Nous sommes si fort accoutumés à ne voir les choses que par l’extérieur, que nous ne pouvons plus reconnaître combien cet extérieur influe sur nos jugements, même les plus graves et les plus réfléchis ; nous prenons l’idée d’un homme, et nous la prenons par sa physionomie qui ne dit rien, nous jugeons dès lors qu’il ne pense rien ; il n’y a pas jusqu’aux habits et à la coiffure qui n’influent sur notre jugement ; un homme sensé doit regarder ses vêtements comme faisant partie de lui-même, puisqu’ils en font en effet partie aux yeux des autres, et qu’ils entrent pour quelque chose dans l’idée totale qu’on se forme de celui qui les porte » (p. 238). La « métoposcopie » est l’ancêtre de la physiognomonie, et Buffon n’a pas l’air d’y croire : « Il faut donc avouer que tout ce que nous ont dit les physionomistes est destitué de tout fondement, et que rien n’est plus chimérique que les inductions qu’ils ont voulu tirer de leurs prétendues observations métoposcopiques » (p. 248), il se livre à une dissertation sur les expressions du visage, agrémentée d’une gravure (p. 249), dont j’ai trouvé un exemplaire plus propre sur le site BIU santé Paris Descartes

Il prolonge sa réflexion sur les parties du visage par des informations sur les modifications corporelles : « Il y a des peuples qui en agrandissent prodigieusement le lobe, en le perçant et en y mettant des morceaux de bois ou de métal, qu’ils remplissent successivement par d’autres morceaux plus gros, ce qui fait avec le temps un trou énorme dans le lobe de l’oreille, qui croît toujours à proportion que le trou s’élargit » (p. 248). C’est alors une réflexion sur la diversité des usages : « La bizarrerie et la variété des usages paraissent encore plus dans la manière différente dont les hommes ont arrangé les cheveux et la barbe ; les uns, comme les Turcs, coupent leurs cheveux et laissent croître leur barbe ; d’autres, comme la plupart des Européens, portent leurs cheveux ou des cheveux empruntés et rasent leur barbe ; les Sauvages se l’arrachent et conservent soigneusement leurs cheveux ; les nègres se rasent la tète par figures, tantôt en étoiles, tantôt à la façon des religieux, et plus communément encore par bandes alternatives, en laissant autant de plein que de rasé, et ils font la même chose à leurs petits garçons ; les Talapoins de Siam font raser la tête et les sourcils aux enfants dont on leur confie l’éducation ; chaque peuple a sur cela des usages différents, les uns font plus de cas de la barbe de la lèvre supérieure que de celle du menton ; d’autres préfèrent celle des joues et celle du dessous du visage ; les uns la frisent, les autres la portent lisse. Il n’y a pas bien longtemps que nous portions les cheveux du derrière de la tête épars et flottants, aujourd’hui nous les portons dans un sac ; nos habillements sont différents de ceux de nos pères, la variété dans la manière de se vêtir est aussi grande que la diversité des nations, et ce qu’il y a de singulier, c’est que de toutes les espèces de vêtements nous avons choisi l’une des plus incommodes, et que notre manière, quoique généralement imitée par tous les peuples de l’Europe, est en même temps de toutes les manières de se vêtir celle qui demande le plus de temps, celle qui me paraît être le moins assortie à la Nature » (p. 250). On apprend des choses étonnantes : « Les deux mamelles sont posées sur la poitrine, celles des femmes sont plus grosses et plus éminentes que celles des hommes, cependant elles paraissent être à peu près de la même consistance, et leur organisation est assez semblable, car les mamelles des hommes peuvent former du lait comme celles des femmes ; on a plusieurs exemples de ce fait, et c’est surtout à l’âge de puberté que cela arrive ; j’ai vu un jeune homme de quinze ans faire sortir d’une de ses mamelles plus d’une cuillerée d’une liqueur laiteuse, ou plutôt de véritable lait » (p. 253). Vous m’en donnerez un litre ! « La forme du dos n’est pas fort différente dans l’homme de ce qu’elle est dans plusieurs animaux quadrupèdes, la partie des reins est seulement plus musculeuse et plus forte, mais les fesses qui sont les parties les plus inférieures du tronc, n’appartiennent qu’à l’espèce humaine, aucun des animaux quadrupèdes n’a de fesses ; ce que l’on prend pour cette partie sont leurs cuisses. L’homme est le seul qui se soutienne dans une situation droite et perpendiculaire ; c’est à cette position des parties inférieures qu’est relatif ce renflement au haut des cuisses qui forme les fesses » (p. 254). Je me disais aussi !
Ce chapitre contient un long développement sur les proportions du corps humain, qu’on dirait inspiré de L’Homme de Vitruve. Je l’ai aussi inclus dans un article sur Venise, à propos d’un buste d’Antinoüs au Palazzo Grimani. Notez l’orthographe particulière du mot « dessein » pour « dessin » : « Il a donc fallu des observations répétées pendant longtemps pour trouver un milieu entre ces différences, afin d’établir au juste les dimensions des parties du corps humain, et de donner une idée des proportions qui font ce que l’on appelle la belle nature : ce n’est pas par la comparaison du corps d’un homme avec celui d’un autre homme, ou par des mesures actuellement prises sur un grand nombre de sujets, qu’on a pu acquérir cette connaissance, c’est par les efforts qu’on a faits pour imiter et copier exactement la Nature, c’est à l’art du dessein (sic) que l’on doit tout ce que l’on peut savoir en ce genre, le sentiment et le goût ont fait ce que la mécanique ne pouvait faire : on a quitté la règle et le compas pour s’en tenir au coup d’œil, on a réalisé sur le marbre toutes les formes, tous les contours de toutes les parties du corps humain, et on a mieux connu la Nature par la représentation que par la Nature même ; dès qu’il y a eu des statues, on a mieux jugé de leur perfection en les voyant, qu’en les mesurant. C’est par un grand exercice de l’art du dessein et par un sentiment exquis, que les grands statuaires sont parvenus à faire sentir aux autres hommes les justes proportions des ouvrages de la Nature ; les Anciens ont fait de si belles statues, que, d’un commun accord, on les a regardées comme la représentation exacte du corps humain le plus parfait. Ces statues qui n’étaient que des copies de l’homme, sont devenues des originaux, parce que ces copies n’étaient pas faites d’après un seul individu, mais d’après l’espèce humaine entière bien observée, et si bien vue qu’on n’a pu trouver aucun homme dont le corps fût aussi bien proportionné que ces statues ; c’est donc sur ces modèles que l’on a pris les mesures du corps humain, nous les rapporterons ici comme les dessinateurs les ont données. On divise ordinairement la hauteur du corps en dix parties égales, que l’on appelle faces en terme d’art, parce que la face de l’homme a été le premier modèle de ces mesures : on distingue aussi trois parties égales dans chaque face, c’est-à-dire dans chaque dixième partie de la hauteur du corps ; cette seconde division vient de celle que l’on a faite de la face humaine en trois parties égales » (éd. Pléiade, p. 255).
Nous voici au chapitre « De la vieillesse et de la mort », dont l’incipit est cette sublime page de prose utilisée dans le cours de BTS « Corps naturel, corps artificiel ».
« Tout change dans la Nature, tout s’altère, tout périt ; le corps de l’homme n’est pas plutôt arrivé à son point de perfection, qu’il commence à déchoir : le dépérissement est d’abord insensible, il se passe même plusieurs années avant que nous nous apercevions d’un changement considérable, cependant nous devrions sentir le poids de nos années mieux que les autres ne peuvent en compter le nombre ; et comme ils ne se trompent pas sur notre âge en le jugeant par les changements extérieurs, nous devrions nous tromper encore moins sur l’effet intérieur qui les produit, si nous nous observions mieux, si nous nous flattions moins, et si dans tout, les autres ne nous jugeaient pas toujours beaucoup mieux que nous ne nous jugeons nous-mêmes.
Lorsque le corps a acquis toute son étendue en hauteur et en largeur par le développement entier de toutes ses parties, il augmente en épaisseur ; le commencement de cette augmentation est le premier point de son dépérissement, car cette extension n’est pas une continuation de développement ou d’accroissement intérieur de chaque partie par lesquels le corps continuerait de prendre plus d’étendue dans toutes ses parties organiques, et par conséquent plus de force et d’activité, mais c’est une simple addition de matière surabondante qui enfle le volume du corps et le charge d’un poids inutile. Cette matière est la graisse qui survient ordinairement à trente-cinq ou quarante ans, et à mesure qu’elle augmente, le corps a moins de légèreté et de liberté dans ses mouvements, ses facultés pour la génération diminuent, ses membres s’appesantissent, il n’acquiert de l’étendue qu’en perdant de la force et de l’activité.
D’ailleurs les os et les autres parties solides du corps ayant pris toute leur extension en longueur et en grosseur, continuent d’augmenter en solidité, les sucs nourriciers qui y arrivent, et qui étaient auparavant employés à en augmenter le volume par le développement, ne servent plus qu’à l’augmentation de la masse, en se fixant dans l’intérieur de ces parties ; les membranes deviennent cartilagineuses, les cartilages deviennent osseux, les os deviennent plus solides, toutes les fibres plus dures, la peau se dessèche, les rides se forment peu à peu, les cheveux blanchissent, les dents tombent, le visage se déforme, le corps se courbe, etc. Les premières nuances de cet état se font apercevoir avant quarante ans, elles augmentent par degrés assez lents jusqu’à soixante, par degrés plus rapides jusqu’à soixante et dix ; la caducité commence à cet âge de soixante et dix ans, elle va toujours en augmentant ; la décrépitude suit, et la mort termine ordinairement avant l’âge de quatre-vingt-dix ou cent ans la vieillesse et la vie. »
Ce paragraphe aurait pu me permettre de mieux comprendre l’attitude de mon amie Catherine face à la mort : « La plupart des hommes meurent donc sans le savoir, et dans le petit nombre de ceux qui conservent de la connaissance jusqu’au dernier soupir, il ne s’en trouve peut-être pas un qui ne conserve en même temps de l’espérance, et qui ne se flatte d’un retour vers la vie ; la Nature a, pour le bonheur de l’homme, rendu ce sentiment plus fort que la raison. Un malade dont le mal est incurable, qui peut juger son état par des exemples fréquents et familiers, qui en est averti par les mouvements inquiets de sa famille, par les larmes de ses amis, par la contenance ou l’abandon des médecins, n’en est pas plus convaincu qu’il touche à sa dernière heure ; l’intérêt est si grand qu’on ne s’en rapporte qu’à soi, on n’en croit pas les jugements des autres, on les regarde comme des alarmes peu fondées : tant qu’on se sent et qu’on pense, on ne réfléchit, on ne raisonne que pour soi, et tout est mort que l’espérance vit encore » (p. 276).
10 pages de tableaux statistiques sur l’espérance de vie sont reproduites dans cette édition. Cela corrobore ce que j’avais remarqué en Éthiopie : une fois passées les toutes premières années, l’espérance de vie augmente considérablement : « On voit par cette table qu’on peut espérer raisonnablement, c’est-à-dire, parier un contre un qu’un enfant qui vient de naître ou qui a zéro d’âge, vivra huit ans ; qu’un enfant qui a déjà vécu un an ou qui a un an d’âge, vivra encore trente-trois ans ; qu’un enfant de deux ans révolus vivra encore trente-huit ans ; qu’un homme de vingt ans révolus vivra encore trente-trois ans cinq mois ; qu’un homme de trente ans vivra encore vingt-huit ans, et ainsi de tous les autres âges » (p. 293).
Variétés dans l’espèce humaine
Le long chapitre « Variétés dans l’espèce humaine » est un condensé de toute la littérature de voyage de l’époque, dont elle compile les idées reçues autant que les idées progressistes. Buffon ne fait pas dans le politiquement correct ! Il affine ses réflexions au fil du descriptif des peuples des 5 continents. Voici un petit aperçu de ses réflexions sur les Lapons : « Non seulement ces peuples se ressemblent par la laideur, la petitesse de la taille, la couleur des cheveux et des yeux, mais ils ont aussi tous à peu près les mêmes inclinations et les mêmes mœurs, ils sont tous également grossiers, superstitieux, stupides. […] Ils n’ont, pour ainsi dire, aucune idée de religion ni d’un être suprême, la plupart sont idolâtres, et tous sont très superstitieux, ils sont plus grossiers que sauvages, sans courage, sans respect pour soi-même, sans pudeur ; ce peuple abject n’a de mœurs qu’assez pour être méprisé. Ils se baignent nus et tous ensemble, filles et garçons, mère et fils, frères et sœurs, et ne craignent point qu’on les voie dans cet état ; en sortant de ces bains extrêmement chauds ils vont se jeter dans une rivière très froide. Ils offrent aux étrangers leurs femmes et leurs filles, et tiennent à grand honneur qu’on veuille bien coucher avec elles ; cette coutume est également établie chez les Samoyèdes, les Borandiens, les Lapons et les Groenlandais » (p. 310). Voici pour Japonais & Chinois : « Les Japonais et les Chinois sont donc une seule et même race d’hommes qui se sont très anciennement civilisés, et qui diffèrent des Tartares plus par les mœurs que par la figure ; la bonté du terrain, la douceur du climat, le voisinage de la mer ont pu contribuer à rendre ces peuples policés, tandis que les Tartares éloignés de la mer et du commerce des autres nations, et séparés des autres peuples du côté du midi par de hautes montagnes, sont demeurés errants dans leurs vastes déserts, sous un ciel dont la rigueur, surtout du côté du nord, ne peut être supportée que par des hommes durs et grossiers » (p. 319). De longs développements sont consacrés, pour différents peuples, aux albinos ou « nègres blancs », ou encore « blafards », phénomène inconnu à l’époque, donnant lieu à des théories fumeuses sur l’origine la couleur de la peau. Il y a d’abord les « Chacrelas » : « il y a dans cette ile de Java une nation qu’on appelle Chacrelas, qui est toute différente, non seulement des autres habitants de cette île, mais même de tous les autres Indiens. Ces Chacrelas sont blancs et blonds, ils ont les yeux faibles, et ne peuvent supporter le grand jour ; au contraire ils voient bien la nuit, le jour ils marchent les yeux baissés et presque fermés » (p. 324). Au sud de l’Inde, la débauche est de mise : « Ces Naires ne peuvent avoir qu’une femme, mais les femmes peuvent prendre autant de maris qu il leur plaît. Le P. Tachard, dans sa lettre au P. de La Chaise, datée de Pontichéri du 16 février 1702, dit que dans les castes ou tribus nobles, une femme peut avoir légitimement plusieurs maris, qu’il s’en est trouvé qui en avaient eu tout à la fois jusqu’à dix, qu’elles regardaient comme autant d’esclaves qu’elles s’étaient soumis par leur beauté. Cette liberté d’avoir plusieurs maris est un privilège de noblesse que les femmes de condition font valoir autant qu’elles peuvent, mais les bourgeoises ne peuvent avoir qu’un mari ; il est vrai qu’elles adoucissent la dureté de leur condition par le commerce qu’elles ont avec les étrangers, auxquels elles s’abandonnent sans aucune crainte de leurs maris et sans qu’ils osent leur rien dire. Les mères prostituent leurs filles le plus jeunes qu’elles peuvent » (p. 334). Voici des précisions sur le piercing : « Les femmes des îles du golfe Persique sont, au rapport des voyageurs Hollandais, brunes ou jaunes et fort peu agréables, elles ont le visage large et de vilains yeux ; elles ont aussi des modes et des coutumes semblables à celles des femmes indiennes, comme celles de se passer dans le cartilage du nez des anneaux et une épingle d’or au travers de la peau du nez près des yeux ; mais il est vrai que cet usage de se percer le nez pour porter des bagues et d’autres joyaux, s’est étendu beaucoup plus loin, car il y a beaucoup de femmes chez les Arabes qui ont une narine percée pour y passer un grand anneau, et c’est une galanterie chez ces peuples de baiser la bouche de leurs femmes à travers ces anneaux, qui sont quelquefois assez grands pour enfermer toute la bouche dans leur rondeur » (p. 338). Buffon fait l’éloge du métissage : « Le sang de Perse, dit Chardin, est naturellement grossier, cela se voit aux Guèbres qui sont le reste des anciens Persans, ils sont laids, mal faits, pesants, ayant la peau rude et le teint coloré ; cela se voit aussi dans les provinces les plus proches de l’Inde où les habitants ne sont guère moins mal faits que les Guèbres, parce qu’ils ne s’allient qu’entre eux ; mais dans le reste du royaume le sang Persan est présentement devenu fort beau par le mélange du sang Géorgien et Circassien, ce sont les deux nations du monde où la Nature forme de plus belles personnes : aussi il n’y a presque aucun homme de qualité en Perse qui ne soit né d’une mère Géorgienne ou circassienne ; le roi lui-même est ordinairement Géorgien ou Circassien d’origine du côté maternel ; et comme il y a un grand nombre d’années que ce mélange a commencé de se faire, le sexe féminin est embelli comme l’autre, et les Persanes sont devenues fort belles et fort bien faites, quoique ce ne soit pas au point des Géorgiennes » (p. 338).
Le secret des Persanes contre la stérilité a été ignoré de Montesquieu : « celles qui sont stériles s’imaginent que pour devenir fécondes il faut passer sous les corps morts des criminels qui sont suspendus aux fourches patibulaires, elles croient que le cadavre d’un mâle peut influer, même de loin, et rendre une femme capable de faire des enfants. Lorsque ce remède singulier ne leur réussit pas, elles vont chercher les canaux des eaux qui s’écoulent des bains, elles attendent le temps où il y a dans ces bains un grand nombre d’hommes, alors elles traversent plusieurs fois l’eau qui en sort, et lorsque cela ne leur réussit pas mieux que la première recette, elles se déterminent enfin à avaler la partie du prépuce qu’on retranche dans la circoncision ; c’est le souverain remède contre la stérilité » (p. 339). Voici une coutume égyptienne philanthrope : « dans toutes les villes et villages le long du Nil on trouve des filles destinées aux plaisirs des voyageurs sans qu’ils soient obligés de les payer ; c’est l’usage d’avoir des maisons d’hospitalité toujours remplies de ces filles, et les gens riches se font en mourant un devoir de piété de fonder ces maisons et de les peupler de filles qu’ils font acheter dans cette vue charitable » (p. 342). Retour en Géorgie et citation de Jean Chardin : « Les hommes ont aussi de bien mauvaises qualités, ils sont tous élevés au larcin, ils l’étudient, ils en font leur emploi, leur plaisir et leur honneur, ils content avec une satisfaction extrême les vols qu’ils ont faits, ils en sont loués, ils en tirent leur plus grande gloire ; l’assassinat, le vol, le mensonge, c’est ce qu’ils appellent de belles actions ; le concubinage, la bigamie, l’inceste, sont des habitudes vertueuses en Mingrélie, l’on s’y enlève les femmes les uns aux autres, on y prend sans scrupule sa tante, sa nièce, la tante de sa femme, on épouse deux ou trois femmes à la fois, et chacun entretient autant de concubines qu’il veut. Les maris sont très peu jaloux, et quand un homme prend sa femme sur le fait avec son galant, il a le droit de le contraindre à payer un cochon, et d’ordinaire il ne prend pas d’autre vengeance, le cochon se mange entre eux trois. Ils prétendent que c’est une très bonne et très louable coutume d’avoir plusieurs femmes et plusieurs concubines, parce qu’on engendre beaucoup d’enfants qu’on vend argent comptant, ou qu’on échange pour des hardes et pour des vivres » (p. 348).
Voilà pour nos amis Sénégalais : « il y a parmi eux d’aussi belles femmes, à la couleur près, que dans aucun autre pays du monde, elles sont ordinairement très bien faites, très gaies, très vives et très portées à l’amour, elles ont du goût pour tous les hommes, et particulièrement pour les blancs qu’elles cherchent avec empressement, tant pour se satisfaire que pour en obtenir quelque présent ; leurs maris ne s’opposent point à leur penchant pour les étrangers, et ils n’en sont jaloux que quand elles ont commerce avec des hommes de leur nation, ils se battent même souvent à ce sujet à coups de sabre ou de couteau, au lieu qu’ils offrent souvent aux étrangers leurs femmes, leurs filles ou leurs sœurs, et tiennent à honneur de n’être pas refusés. Au reste, ces femmes ont toujours la pipe à la bouche, et leur peau ne laisse pas d’avoir aussi une odeur désagréable lorsqu’elles sont échauffées, quoique l’odeur de ces Nègres du Sénégal soit beaucoup moins forte que celle des autres Nègres ; elles aiment beaucoup à sauter et à danser au bruit d une calebasse, d’un tambour ou d’un chaudron, tous les mouvements de leurs danses sont autant de postures lascives et de gestes indécents ; elles se baignent souvent et elles se liment les dents pour les rendre plus égales ; la plupart des filles avant que de se marier se font découper et broder la peau de différentes figures d’animaux, de fleurs, etc. » (p. 362). Et pour la Guinée (attention, ces noms ne recoupent pas les pays actuels) : « Quoique les Nègres de Guinée soient d’une santé ferme et très bonne, rarement arrivent-ils cependant à une certaine vieillesse, un Nègre de cinquante ans est dans son pays un homme fort vieux, ils paraissent l’être dès l’âge de quarante ; l’usage, prématuré des femmes est peut-être la cause de la brièveté de leur vie ; les enfants sont si débauchés, et si peu contraints par les pères et mères, que dès leur plus tendre jeunesse ils se livrent à tout ce que la nature leur suggère ; rien n’est si rare que de trouver dans ce peuple quelque fille qui puisse se souvenir du temps auquel elle a cessé d’être vierge » (p. 365). « On préfère dans nos îles les Nègres d’Angola à ceux du Cap-Vert pour la force du corps, mais ils sentent si mauvais lorsqu’ils sont échauffés, que l’air des endroits par où ils ont passé en est infecté pendant plus d’un quart d’heure ; ceux du cap Vert n’ont pas une odeur si mauvaise à beaucoup près que ceux d’Angola, et ils ont aussi la peau plus belle et plus noire, le corps mieux fait, les traits du visage moins durs, le naturel plus doux et la taille plus avantageuse » (p. 367). Pour la question de l’odeur, rappelons qu’à cette époque, on ne se lavait pas à l’eau en France ! Les Hottentots ont droit à un cliché sur le « tablier hottentot » (macronymphie) et une anecdote : « Par tous ces témoignages il est aisé de voir que les Hottentots ne sont pas de vrais nègres, mais des hommes qui dans la race des noirs commencent à se rapprocher du blanc, comme les Maures dans la race blanche commencent à s’approcher du noir ; ces Hottentots sont au reste des espèces de sauvages fort extraordinaires, les femmes surtout, qui sont beaucoup plus petites que les hommes, ont une espèce d’excroissance ou de peau dure et large qui leur croît au-dessus de l’os pubis, et qui descend jusqu’au milieu des cuisses en forme de tablier ; Thévenot dit la même chose des femmes égyptiennes, mais qu’elles ne laissent pas croître cette peau et qu’elles la brûlent avec des fers chauds, je doute que cela soit aussi vrai des Égyptiennes que des Hottentotes ; quoi qu’il en soit, toutes les femmes naturelles du Cap sont sujettes à cette monstrueuse difformité, qu’elles découvrent à ceux qui ont assez de curiosité ou d’intrépidité pour demander à la voir ou à la toucher. Les hommes de leur côté sont tous à demi eunuques, mais il est vrai qu’ils ne naissent pas tels et qu’on leur ôte un testicule ordinairement à l’âge de huit ans, et souvent plus tard. M. Kolbe dit avoir vu faire cette opération à un jeune Hottentot de dix-huit ans ; les circonstances dont cette cérémonie est accompagnée, sont si singulières que je ne puis m’empêcher de les rapporter ici d’après le témoin oculaire que je viens de citer.
Après avoir bien frotté le jeune homme de la graisse des entrailles d’une brebis qu’on vient de tuer exprès, on le couche à terre sur le dos, on lui lie les mains et les pieds, et trois ou quatre de ses amis le tiennent ; alors le prêtre (car c’est une cérémonie religieuse) armé d’un couteau bien tranchant fait une incision, enlève le testicule gauche et remet à la place une boule de graisse de la même grosseur, qui a été préparée avec quelques herbes médicinales ; il coud ensuite la plaie avec l’os d’un petit oiseau qui lui sert d’aiguille et un filet de nerf de mouton ; cette opération étant finie on délie le patient, mais le prêtre avant que de le quitter le frotte avec de la graisse toute chaude de la brebis tuée ou plutôt il lui en arrose tout le corps avec tant d’abondance que lorsqu’elle est refroidie, elle forme une espèce de croûte, il le frotte en même temps si rudement que le jeune homme qui ne souffre déjà que trop, sue à grosses gouttes et fume comme un chapon qu’on rôtit ; ensuite l’opérateur fait avec ses ongles des sillons dans cette croûte de suif d’une extrémité du corps à l’autre, et pisse dessus aussi copieusement qu’il le peut, après quoi il recommence à le frotter encore, et il recouvre avec la graisse les sillons remplis d’urine. Aussitôt chacun abandonne le patient, on le laisse seul plus mort que vif, il est obligé de se traîner comme il peut dans une petite hutte qu’on lui a bâtie exprès tout proche du lieu où s’est faite l’opération, il y périt ou il y recouvre la santé sans qu’on lui donne aucun secours, et sans aucun autre rafraîchissement ou nourriture que la graisse qui lui couvre tout le corps et qu’il peut lécher s’il le veut : au bout de deux jours il est ordinairement rétabli, alors il peut sortir et se montrer, et pour prouver qu’il est en effet parfaitement guéri, il se met à courir avec autant de légèreté qu’un cerf » (p. 372).
Voici une conclusion qui relativise ces usages étonnants : « Je ne crois donc pas devoir m’étendre beaucoup sur ce qui a rapport aux coutumes de ces nations sauvages, tous les auteurs qui en ont parlé n’ont pas fait attention que ce qu’ils nous donnaient pour des usages constants et pour les mœurs d’une société d’hommes, n’étaient que des actions particulières à quelques individus souvent déterminés par les circonstances ou par le caprice ; certaines nations, nous disent-ils, mangent leurs ennemis, d’autres les brûlent, d’autres les mutilent, les unes sont perpétuellement en guerre, d’autres cherchent à vivre en paix ; chez les unes on tue son père lorsqu’il a atteint un certain âge, chez les autres les pères et mères mangent leurs enfants, toutes ces histoires sur lesquelles les voyageurs se sont étendus avec tant de complaisance se réduisent à des récits de faits particuliers, et signifient seulement que tel sauvage a mangé son ennemi, tel autre l’a brûlé ou mutilé, tel autre a tué où mangé son enfant, et tout cela peut se trouver dans une seule nation de sauvages comme dans plusieurs nations, car toute nation où il n’y a ni règle, ni loi, ni maître, ni société habituelle, est moins une nation qu’un assemblage tumultueux d’hommes barbares et indépendants, qui n’obéissent qu’à leurs passions particulières, et qui, ne pouvant avoir un intérêt commun, sont incapables de se diriger vers un même but, et de se soumettre à des usages constants, qui tous supposent une suite de desseins raisonnés et approuvés par le plus grand nombre » (p. 382). Mais on poursuit nonobstant : « ils prennent assez indifféremment pour femmes leurs parentes ou des étrangères ; leurs cousines germaines leur appartiennent de droit, et on en a vu plusieurs qui avaient en même temps les deux sœurs ou la mère et la fille, et même leur propre fille ; ceux qui ont plusieurs femmes les voient tour à tour chacune pendant un mois, ou un nombre de jours égal, et cela suffit pour que ces femmes n’aient aucune jalousie ; ils pardonnent assez volontiers l’adultère à leurs femmes, mais jamais à celui qui les a débauchées » (p. 386).
Plusieurs développements sont consacrés aux albinos (le mot n’est pas utilisé), qui étonnent Buffon : « Ce qui peut encore faire croire que ces hommes blancs ne sont en effet que des individus qui ont dégénéré de leur espèce, c’est qu’ils sont tous beaucoup moins forts et moins vigoureux que les autres, et qu’ils ont les yeux extrêmement faibles ; on trouvera ce dernier fait moins extraordinaire, lorsqu’on se rappellera que parmi nous les hommes qui sont d’un blond blanc, ont ordinairement les yeux faibles, j’ai aussi remarqué qu’ils avaient souvent l’oreille dure : et on prétend que les chiens qui sont absolument blancs et sans aucune tache, sont sourds, je ne sais si cela est généralement vrai, je puis seulement assurer que j’en ai vu plusieurs qui l’étaient en effet » (p. 390). La couleur des noirs fait l’objet d’un étonnement constant : « M. Littre, qui fit en 1702 la dissection d’un Nègre, observa que le bout du gland qui n’était pas couvert du prépuce, était noir comme toute la peau, et que le reste qui était couvert était parfaitement blanc : cette observation prouve que l’action de l’air est nécessaire pour produire la noirceur de la peau des Nègres ; leurs enfants naissent blancs, ou plutôt rouges, comme ceux des autres hommes, mais deux ou trois jours après qu’ils sont nés, la couleur change, ils paraissent d’un jaune basané qui se brunit peu à peu, et au septième ou huitième jour, ils sont déjà tout noirs » (p. 402). La conclusion semble pesée au coin du bon sens : « Pour moi j’avoue qu’il m’a toujours paru que la même cause qui nous brunit lorsque nous nous exposons au grand air et aux ardeurs du soleil, cette cause qui fait que les Espagnols sont plus bruns que les Français, et les Maures plus que les Espagnols, fait aussi que les nègres le sont plus que les Maures : d’ailleurs nous ne voulons pas chercher ici comment cette cause agit, mais seulement nous assurer qu’elle agit, et que ses effets sont d’autant plus grands et plus sensibles, qu’elle agit plus fortement et plus longtemps » (p. 404). Et l’on est libre de ne pas approuver ce point de vue européocentrique : « Le climat le plus tempéré est depuis le 40e degré jusqu’au 50e, c’est aussi sous cette zone que se trouvent les hommes les plus beaux et les mieux faits, c’est sous ce climat qu’on doit prendre l’idée de la vraie couleur naturelle de l’homme, c’est là ou l’on doit prendre le modèle ou l’unité à laquelle il faut rapporter toutes les autres nuances de couleur et de beauté, les deux extrêmes sont également éloignés du vrai et du beau : les pays policés situés sous cette zone, sont la Géorgie, la Circassie, l’Ukraine, la Turquie d’Europe, la Hongrie, l’Allemagne méridionale, l’Italie, la Suisse, la France, et la partie septentrionale de l’Espagne, tous ces peuples sont aussi les plus beaux et les mieux faits de toute la Terre » (p. 406). L’expression « du vrai et du beau » a de quoi étonner chez un homme des Lumières, mais cela me rappelle les propos de son contemporain Casanova sur la beauté de la forme et l’étymologie de « difforme ».
Des époques de la nature
Dans cette anthologie de la Pléiade, on retrouve la géologie sur les 200 dernières pages, après le long morceau que constitue l’Histoire naturelle des animaux, que nous avons traitée dans un deuxième article. C’est avec « Des époques de na nature », paru seulement en 1778, soit près de 30 ans après les premiers volumes, que Buffon revient sur une hypothèse qu’il avait rejetée en 1849, celle d’une croyance en un « feu central » propre à la Terre, ce qui demandera une longue justification pour prévenir les réactions de la Sorbonne quant à la remise en question de l’âge de la terre. Voici le paragraphe qui ouvre cette justification de 6 pages : « Mais, avant d’aller plus loin, hâtons-nous de prévenir une objection grave, qui pourrait même dégénérer en imputation. Comment accordez-vous, dira-t-on, cette haute ancienneté que vous donnez à la matière, avec les traditions sacrées, qui ne donnent au monde que six ou huit mille ans ? Quelque fortes que soient vos preuves, quelque fondés que soient vos raisonnements, quelque évidents que soient vos faits, ceux qui sont rapportés dans le Livre sacré ne sont-ils pas encore plus certains ? Les contredire, n’est-ce pas manquer à Dieu, qui a eu la bonté de nous les révéler ? » Suit une exégèse du texte de la Genèse, basée sur la traduction (notamment l’usage de l’imparfait : « la terre était informe »), mais aussi sur les langues anciennes, qui vise à faire dire à la Bible que la création du ciel et de la terre n’aurait pas eu lieu tels qu’ils sont, et que les 6 jours de la Création seraient « six espaces de temps » (p. 1213). Il établit un distinguo malin : « […] toute raison, toute vérité venant également de Dieu, il n’y a de différence entre les vérités qu’il nous a révélées et celles qu’il nous a permis de découvrir par nos observations et nos recherches ; il n’y a, dis-je, d’autre différence que celle d’une première faveur faite gratuitement, à une seconde grâce qu’il a voulu différer et nous faire mériter par nos travaux ; et c’est par cette raison que son interprète n’a parlé aux premiers hommes, encore très ignorants, que dans le sens vulgaire, et qu’il ne s’est pas élevé au-dessus de leurs connaissances, qui, bien loin d’atteindre au vrai système du monde, ne s’étendaient pas même au-delà des notions communes, fondées sur le simple rapport des sens […] » (p. 1213). La Genèse pour les nuls !
Buffon raconte la création du système solaire telle qu’il l’a conçue par intuition et expérimentation dans sa Grande Forge de Buffon, en étudiant la façon dont une boule de fer incandescent se refroidit par exemple, et il arrive à des précisions étonnantes qui ne nuisent pas à la poésie : « Ainsi dans ces premières vingt-cinq mille années, le globe terrestre, d’abord lumineux et chaud comme le soleil, n’a perdu que peu à peu sa lumière et son feu : son état d’incandescence a duré pendant deux mille neuf cent trente-six ans, puisqu’il a fallu ce temps pour qu’il ait été consolidé jusqu’au centre ». On note de nombreux mots dont soit Buffon a été le premier utilisateur, soit il a contribué à illustrer un sens nouveau, comme « intermède », « incandescence », « fomenter », « consolider », etc. Si je résume, le système solaire a été créé par le choc d’une comète sur le soleil, qui a libéré une grande quantité de matière en fusion du soleil. Cette matière s’est projetée dans le même plan, engendrant les six planètes connues à son époque, et selon leur vitesse de rotation, leur densité, et leur éloignement du soleil, celles-ci par leur rotation et la force centrifuge, ont de la même façon que le soleil les a créés, créé des satellites ou l’anneau de Saturne. La rotation à l’époque de l’incandescence explique aussi l’aplatissement de la terre et autres planètes aux pôles, et le renflement à l’Équateur, qui avait été démontré par Newton et que les savants français étaient en train de vérifier au pôle Nord et à l’Équateur.
Le début de la Troisième époque « Lorsque les eaux ont couvert nos continents » me fait penser à Voyage au centre de la terre de Jules Verne, qui semble avoir beaucoup été inspiré de Buffon : « À la date de trente ou trente-cinq mille ans de la formation des planètes, la Terre se trouvait assez attiédie pour recevoir les eaux sans les rejeter en vapeurs. Le chaos de l’atmosphère avait commencé de se débrouiller : non seulement les eaux, mais toutes les matières volatiles que la trop grande chaleur y tenait reléguées et suspendues tombèrent successivement ; elles remplirent toutes les profondeurs, couvrirent toutes les plaines, tous les intervalles qui se trouvaient entre les éminences de la surface du globe, et même elles surmontèrent toutes celles qui n’étaient pas excessivement élevées » (p. 1246). Buffon annonce d’ultimes inondations de ce type : « […] il est néanmoins très certain qu’en général les mers baissent tous les jours de plus en plus, et qu’elles baisseront encore à mesure qu’il se fera quelque nouvel affaissement, soit par l’effet des volcans et des tremblements de terre, soit par des causes plus constantes et plus simples ; car toutes les parties caverneuses de l’intérieur du globe ne sont pas encore affaissées ; les volcans et les secousses des tremblements de terre en sont une preuve démonstrative. Les eaux mineront peu à peu les voûtes et les remparts de ces cavernes souterraines, et lorsqu’il s’en écroulera quelques-unes, la surface de la Terre se déprimant dans ces endroits formera de nouvelles vallées dont la terre viendra s’emparer. Néanmoins comme ces événements, qui dans les commencements devaient être très fréquents, sont actuellement assez rares, on peut croire que la terre est à peu près parvenue à un état assez tranquille pour que ses habitants n’aient plus à redouter les désastreux effets de ces grandes convulsions » (p. 1268).

La quatrième époque s’intitule « Lorsque les eaux se sont retirées, et que les volcans ont commencé d’agir ». On y trouve une mémorable « Carte de la chaîne des montagnes de Langres », que je reproduis ici car les gravures sont rares dans la partie non animalière de ce volume. Plutôt que la numérisation par Gallica, il s’agit d’une photo du livre avec la carte déployée, que j’ai prise au musée Buffon de Montbard. Voici la Cinquième époque : « Lorsque les éléphants et les autres animaux du Midi ont habité les terres du Nord ». La Sixième époque est « Lorsque s’est faite la séparation des continents ». Buffon y avère la légende des géants de Patagonie dans un extrait amusant avec le recul : « Mais n’est-il pas singulier que ce soit dans quelques-unes de ces dernières contrées qu’existent encore de nos jours les géants de l’espèce humaine, tandis qu’on n’y voit que des pygmées dans le genre des animaux ? Car on ne peut douter qu’on n’ait rencontré dans l’Amérique méridionale des hommes en grand nombre, tous plus grands, plus carrés, plus épais et plus forts que ne le sont tous les autres hommes de la Terre. Les races de géants, autrefois si communes en Asie, n’y subsistent plus : pourquoi se trouvent-elles en Amérique aujourd’hui ? Ne pouvons-nous pas croire que quelques géants, ainsi que les éléphants, ont passé de l’Asie en Amérique, où, s’étant trouvés pour ainsi dire seuls, leur race s’est conservée dans ce continent désert, tandis qu’elle a été entièrement détruite par le nombre des autres hommes dans les contrées peuplées : une circonstance me paraît avoir concouru au maintien de cette ancienne race de géants dans le continent du nouveau monde ; ce sont les hautes montagnes qui le partagent dans toute sa longueur et sous tous les climats : or on sait qu’en général les habitants des montagnes sont plus grands et plus forts que ceux des vallées ou des plaines. Supposant donc quelques couples de géants passés d’Asie en Amérique, où ils auront trouvé la liberté, la tranquillité, la paix, ou d’autres avantages que peut-être ils n’avaient pas chez eux, n’auront-ils pas choisi dans les terres de leur nouveau domaine celles qui leur convenaient le mieux, tant pour la chaleur que pour la salubrité de l’air et des eaux ? Ils auront fixé leur domicile à une hauteur médiocre dans les montagnes ; ils se seront arrêtés sous le climat le plus favorable à leur multiplication ; et comme ils avaient peu d’occasions de se mésallier, puisque toutes les terres voisines étaient désertes, ou du moins tout aussi nouvellement peuplées par un petit nombre d’hommes bien inférieurs en force, leur race gigantesque s’est propagée sans obstacles et presque sans mélange ; elle a duré et subsisté jusqu’à ce jour, tandis qu’il y a nombre de siècles qu’elle a été détruite dans les lieux de son origine en Asie, par la très grande et plus ancienne population de cette partie du monde » (p. 1319).
La Septième époque : « Lorsque la puissance de l’homme a secondé celle de la nature » commence par une évocation des premières sociétés humaines condensée en une page, digne de Rousseau : « Les premiers hommes, témoins des mouvements convulsifs de la Terre, encore récents et très fréquents, n’ayant que les montagnes pour asiles contre les inondations, chassés souvent de ces mêmes asiles par le feu des volcans, tremblants sur une terre qui tremblait sous leurs pieds, nus d’esprit et de corps, exposés aux injures de tous les éléments, victimes de la fureur des animaux féroces, dont ils ne pouvaient éviter de devenir la proie ; tous également pénétrés du sentiment commun d’une terreur funeste, tous également pressés par la nécessité, n’ont-ils pas très promptement cherché à se réunir, d’abord pour se défendre par le nombre, ensuite pour s’aider et travailler de concert à se faire un domicile et des armes ? Ils ont commencé par aiguiser en forme de hache ces cailloux durs, ces jades, ces pierres de foudre, que l’on a cru tombées des nues et formées par le tonnerre, et qui néanmoins ne sont que les premiers monuments de l’art de l’homme dans l’état de pure nature : il aura bientôt tiré du feu de ces mêmes cailloux en les frappant les uns contre les autres ; il aura saisi la flamme des volcans, ou profité du feu de leurs laves brûlantes pour le communiquer, pour se faire jour dans les forêts, les broussailles ; car avec le secours de ce puissant élément, il a nettoyé, assaini, purifié les terrains qu’il voulait habiter ; avec la hache de pierre, il a tranché, coupé les arbres, menuisé le bois, façonné les armes et les instruments de première nécessité ; et, après s’être munis de massues et d’autres armes pesantes et défensives, ces premiers hommes n’ont-ils pas trouvé le moyen d’en faire d’offensives plus légères pour atteindre de loin ? Un nerf, un tendon d’animal, des fils d’aloès ou l’écorce souple d’une plante ligneuse leur ont servi de corde pour réunir les deux extrémités d’une branche élastique dont ils ont fait leur arc ; ils ont aiguisé d’autres petits cailloux pour en armer la flèche ; bientôt ils auront eu des filets, des radeaux, des canots, et s’en sont tenus là tant qu’ils n’ont formé que de petites nations composées de quelques familles, ou plutôt de parents issus d’une même famille, comme nous le voyons encore aujourd’hui chez les sauvages qui veulent demeurer sauvages, et qui le peuvent, dans les lieux où l’espace libre ne leur manque pas plus que le gibier, le poisson et les fruits. Mais dans tous ceux où l’espace s’est trouvé confiné par les eaux ou resserré par les hautes montagnes, ces petites nations, devenues trop nombreuses, ont été forcées de partager leur terrain entre elles, et c’est de ce moment que la Terre est devenue le domaine de l’homme ; il en a pris possession par ses travaux de culture, et l’attachement à la patrie a suivi de très près les premiers actes de sa propriété : l’intérêt particulier faisant partie de l’intérêt national, l’ordre, la police et les lois ont dû succéder, et la société prendre de la consistance et des forces » (p. 1326).
Buffon évoque un peuple disparu, qu’il situe dans ce que l’on devait appeler la Tartarie, et qui aurait réussi à acquérir des connaissances astronomiques perdues, puis retrouvées. Il est sans pitié pour les « sauvages », encore moins pour les « barbares » qui leur ont succédé, et ébauche un discours anti-colonialiste : « Comparez en effet la Nature brute à la Nature cultivée ; comparez les petites nations sauvages de l’Amérique avec nos grands peuples civilisés ; comparez même celles de l’Afrique, qui ne le sont qu’à demi ; voyez en même temps l’état des terres que ces nations habitent, vous jugerez aisément du peu de valeur de ces hommes par le peu d’impression que leurs mains ont faites sur leur sol : soit stupidité, soit paresse, ces hommes à demi brutes, ces nations non policées, grandes ou petites, ne font que peser sur le globe sans soulager la Terre, l’affamer sans la féconder, détruire sans édifier, tout user sans rien renouveler. Néanmoins la condition la plus méprisable de l’espèce humaine n’est pas celle du sauvage, mais celle de ces nations au quart policées, qui de tout temps ont été les vrais fléaux de la nature humaine, et que les peuples civilisés ont encore peine à contenir aujourd’hui ; ils ont, comme nous l’avons dit, ravagé la première terre heureuse, ils en ont arraché les gerbes du bonheur et détruit les fruits de la science. Et de combien d’autres invasions cette première irruption des barbares n’a-t-elle pas été suivie ! C’est de ces mêmes contrées du Nord, où se trouvaient autrefois tous les biens de l’espèce humaine, qu’ensuite sont venus tous ses maux. Combien n’a-t-on pas vu de ces débordements d’animaux à face humaine, toujours venant du Nord ravager les terres du Midi ? Jetez les yeux sur les annales de tous les peuples, vous y compterez vingt siècles de désolation, pour quelques années de paix et de repos » […] « Il a fallu six cents siècles à la Nature pour construire ses grands ouvrages, pour attiédir la terre, pour en façonner la surface et arriver à un état tranquille ; combien n’en faudra-t-il pas pour que les hommes arrivent au même point et cessent de s’inquiéter, de s’agiter et de s’entre-détruire ? Quand reconnaîtront-ils que la jouissance paisible des terres de leur patrie suffit à leur bonheur ? Quand seront-ils assez sages pour rabattre de leurs prétentions, pour renoncer à des dominations imaginaires, à des possessions éloignées, souvent ruineuses ou du moins plus à charge qu’utiles ? L’empire de l’Espagne, aussi étendu que celui de la France en Europe, et dix fois plus grand en Amérique, est-il dix fois plus puissant ? L’est-il même autant que si cette fière et grande nation se fût bornée à tirer de son heureuse terre tous les biens qu’elle pouvait lui fournir ? Les Anglais, ce peuple si sensé, si profondément pensant, n’ont-ils pas fait une grande faute en étendant trop loin les limites de leurs colonies ? Les Anciens me paraissent avoir eu des idées plus saines de ces établissements ; ils ne projetaient des émigrations que quand leur population les surchargeait, et que leurs terres et leur commerce ne suffisaient plus à leurs besoins. Les invasions des barbares, qu’on regarde avec horreur, n’ont-elles pas eu des causes encore plus pressantes lorsqu’ils se sont trouvés trop serrés dans des terres ingrates, froides et dénuées, et en même temps voisines d’autres terres cultivées, fécondes et couvertes de tous les biens qui leur manquaient ? Mais aussi que de sang ont coûté ces funestes conquêtes, que de malheurs, que de pertes les ont accompagnées et suivies ! » (p. 1333).
Je relève un autre argument sur le changement climatique dû à la déforestation, comme déjà dans le chapitre consacré à l’âne (p. 566) : « Une seule forêt de plus ou de moins dans un pays suffit pour en changer la température : tant que les arbres sont sur pied, ils attirent le froid, ils diminuent par leur ombrage la chaleur du soleil, ils produisent des vapeurs humides qui forment des nuages et retombent en pluie, d’autant plus froide qu’elle descend de plus haut ; et si ces forêts sont abandonnées à la seule nature, ces mêmes arbres tombés de vétusté pourrissent froidement sur la terre, tandis qu’entre les mains de l’homme ils servent d’aliment à l’élément du feu, et deviennent les causes secondaires de toute chaleur particulière. Dans les pays de prairies, avant la récolte des herbes, on a toujours des rosées abondantes et très souvent de petites pluies, qui cessent dès que ces herbes sont levées : ces petites pluies deviendraient donc plus abondantes et ne cesseraient pas, si nos prairies, comme les savanes de l’Amérique, étaient toujours couvertes d’une même quantité d’herbes qui, loin de diminuer, ne peut qu’augmenter par l’engrais de toutes celles qui se dessèchent et pourrissent sur la terre » (p. 1336). Un résumé de l’action de l’homme sur la nature est saisissant : « Sur trois cents espèces d’animaux quadrupèdes et quinze cents espèces d’oiseaux qui peuplent la surface de la terre, l’homme en a choisi dix-neuf ou vingt ; et ces vingt espèces figurent seules plus grandement dans la nature et font plus de bien sur la terre que toutes les autres espèces réunies ». Une note de Buffon donne la liste des vingt espèces : « L’éléphant, le chameau, le cheval, l’âne, le bœuf, la brebis, la chèvre, le cochon, le chien, le chat, le lama, la vigogne, le buffle. Les poules, les oies, les dindons, les canards, les paons, les faisans, les pigeons » (p. 1338). Même constat en ce qui concerne les végétaux : « Nous pouvons de même donner la date très moderne de nos meilleurs fruits à pépins et à noyaux, tous différents de ceux des anciens auxquels ils ne ressemblent que de nom : d’ordinaire les choses restent, et les noms changent avec le temps ; ici c’est le contraire, les noms sont demeurés, et les choses ont changé ; nos pêches, nos abricots, nos poires sont des productions nouvelles auxquelles on a conservé les vieux noms des productions antérieures. Pour n’en pas douter, il ne faut que comparer nos fleurs et nos fruits avec les descriptions ou plutôt les notices que les auteurs grecs et latins nous en ont laissées, toutes leurs fleurs étaient simples et tous leurs arbres fruitiers n’étaient que des sauvageons assez mal choisis dans chaque genre, dont les petits fruits âpres ou secs n’avaient ni la saveur ni la beauté des nôtres » (p. 1340). On frise même la tentation de l’eugénisme en conclusion, mais ce n’est qu’un message pacifiste : « Et que ne pourrait-il pas sur lui-même, je veux dire sur sa propre espèce, si la volonté était toujours dirigée par l’intelligence ? Qui sait jusqu’à quel point l’homme pourrait perfectionner sa nature, soit au moral, soit au physique ? Y a-t-il une seule nation qui puisse se vanter d’être arrivée au meilleur gouvernement possible, qui serait de rendre tous les hommes, non pas également heureux, mais moins inégalement malheureux, en veillant à leur conservation, à l’épargne de leurs sueurs et de leur sang par la paix, par l’abondance des subsistances, par les aisances de la vie et les facilités pour leur propagation : voilà le but moral de toute société qui chercherait à s’améliorer » (p. 1342).
Histoire naturelle des minéraux
Ce volume des Œuvres de la Pléiade se termine par deux extraits de l’Histoire naturelle des minéraux. Du premier article « De la figuration des minéraux », je tire l’une des plus longues phrases de la littérature française, juste pour expliquer la différence entre minéraux et végétaux ou animaux, qui réside dans l’absence d’« intussusception », ce mot déjà maintes fois rencontré sous la plume buffonienne : « J’ai reconnu que les gens peu accoutumés aux idées abstraites, ont peine à concevoir les moules intérieurs et le travail de la nature sur la matière dans les trois dimensions à la fois ; dés lors ils ne concevront pas mieux qu’elle ne travaille que dans deux dimensions pour figurer les minéraux : cependant rien ne me paraît plus clair, pourvu qu’on ne borne pas ses idées à celles que nous présentent nos moules artificiels ; tous ne sont qu’extérieurs, et ne peuvent que figurer les surfaces, c’est-à-dire opérer sur deux dimensions ; mais l’existence du moule intérieur et son extension, c’est-à-dire ce travail de la nature dans les trois dimensions à la fois, sont démontrées par le développement de tous les germes dans les végétaux, de tous les embryons dans les animaux, puisque toutes leurs parties, soit extérieures, soit intérieures, croissent proportionnellement, ce qui ne peut se faire que par l’augmentation du volume de leur corps dans les trois dimensions à la fois : ceci n’est donc point un système idéal fondé sur des suppositions hypothétiques, mais un fait constant démontré par un effet général, toujours existant, et à chaque instant renouvelé dans la Nature entière ; tout ce qu’il y a de nouveau dans cette grande vue, c’est d’avoir aperçu qu’ayant à sa disposition la forme pénétrante de l’attraction, et celle de la chaleur, la Nature peut travailler l’intérieur des corps et brasser la matière dans les trois dimensions à la fois, pour faire croître les êtres organisés, sans que leur forme s’altère en prenant trop ou trop peu d’extension dans chaque dimension : un homme, un animal, un arbre, une plante, en un mot tous les corps organisés, sont autant de moules intérieurs dont toutes les parties croissent proportionnellement, et par conséquent s’étendent dans les trois dimensions à la fois ; sans cela l’adulte ne ressemblerait pas à l’enfant, et la forme de tous les êtres se corromprait dans leur accroissement : car, en supposant que la Nature manquât totalement d’agir dans l’une des trois dimensions, l’être organisé serait bientôt non seulement défiguré, mais détruit, puisque son corps cesserait de croître à l’intérieur par la nutrition, et dès lors le solide, réduit à la surface, ne pourrait augmenter que par l’application successive des surfaces les unes contre les autres, et par conséquent d’animal ou végétal il deviendrait minéral, dont effectivement la composition se fait par la superposition de petites lames presque infiniment minces qui n’ont été travaillées que sur les deux dimensions de leur surface en longueur et en largeur, au lieu que les germes des animaux et des végétaux ont été travaillés non seulement en longueur et en largeur, mais encore dans tous les points de l’épaisseur, qui fait la troisième dimension ; en sorte qu’il n’augmente pas par agrégation comme le minéral, mais par la nutrition, c’est-à-dire par la pénétration de la nourriture dans toutes les parties de son intérieur, et c’est par cette intussusception de la nourriture que l’animal et le végétal se développent et prennent leur accroissement sans changer de forme » (p. 1352). Ouf !
Le second article « Pétrifications et fossiles » commence par un joli texte qui ressemble à l’expérience du bateau de Thésée : « Tous les corps organisés, surtout ceux qui sont solides, tels que les bois et les os, peuvent se pétrifier en recevant dans leurs pores les sucs calcaires ou vitreux ; souvent même à mesure que la substance animale ou végétale se détruit, la matière pierreuse en prend la place ; en sorte que sans changer de forme, ces bois et ces os se trouvent convertis en pierre calcaire, en marbres, en cailloux, en agates, etc. L’on reconnaît évidemment dans la plupart de ces pétrifications, tous les traits de leur ancienne organisation, quoiqu’elles ne conservent aucune partie de leur première substance, la matière en a été détruite et remplacée successivement par le suc pétrifiant auquel leur texture, tant intérieure qu’extérieure a servi de moule, en sorte que la forme domine ici sur la matière au point d’exister après elle » (p. 1355). J’apprécie également une belle idée toujours pas expérimentée pour donner un coup de jeune aux pompes funèbres : « on cite aussi les bois convertis en cailloux dans certaines rivières, et je suis persuadé qu’on pourrait par notre art imiter la Nature, et pétrifier les corps avec de l’eau convenablement chargée de matière pierreuse : et cet art, s’il était porté à sa perfection, serait plus précieux pour la postérité que l’art des embaumements » (p. 1362).

Pour en terminer avec notre ami Buffon, voici une sorte d’adieu et de testament écolo pour les générations futures : « Je le répète, c’est à regret que je quitte ces objets intéressants, ces précieux monuments de la vieille Nature, que ma propre vieillesse ne me laisse pas le temps d’examiner assez pour en tirer les conséquences que j’entrevois, mais qui n’étant fondées que sur des aperçus, ne doivent pas trouver place dans cet ouvrage, où je me suis fait une loi de ne présenter que des vérités appuyées sur des faits. D’autres viendront après moi, qui pourront supputer le temps nécessaire au plus grand abaissement des mers, et à la diminution des eaux par la multiplication des coquillages, des madrépores et de tous les corps pierreux qu’elles ne cessent de produire ; ils balanceront les pertes et les gains de ce globe dont la chaleur propre s’exhale incessamment, mais qui reçoit en compensation tout le feu qui réside dans les détriments des corps organisés ; ils en concluront que si la chaleur du globe était toujours la même, et les générations d’animaux et de végétaux toujours aussi nombreuses, aussi promptes, la quantité de l’élément du feu augmenterait sans cesse, et qu’enfin au lieu de finir par le froid et la glace, le globe pourrait périr par le feu. Ils compareront le temps qu’il a fallu pour que les détriments combustibles des animaux et végétaux aient été accumulés dans les premiers âges, au point d’entretenir pendant des siècles le feu des volcans ; ils compareront, dis-je, ce temps avec celui qui serait nécessaire pour qu’à force de multiplications des corps organisés, les premières couches de la terre fussent entièrement composées de substances combustibles, ce qui dès lors pourrait produire un nouvel incendie général, ou du moins un très grand nombre de nouveaux volcans ; mais ils verront en même temps que la chaleur du globe diminuant sans cesse, cette fin n’est point à craindre, et que la diminution des eaux, jointe à la multiplication des corps organisés, ne pourra que retarder de quelques milliers d’années l’envahissement du globe entier par les glaces, et la mort de la Nature par le froid » (p. 1365).
– On profitera d’un séjour en Bourgogne pour visiter au village de Buffon et à Montbard sa ville natale, la Grande Forge de Buffon ainsi que le petit musée Buffon et le château. Voyez cet article. La photo d’un bureau de Buffon avec son véritable secrétaire a été prise par votre serviteur au musée de Montbard.
Voir en ligne : Buffon sur le site de l’Académie française
© altersexualite.com 2019-2020.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Buffon ne mettait pas de majuscule à nègre ; la Pléiade en rajoute, comme elle le fait à blanc ou à sauvages, ce qui ne me semble pas une bonne idée, alors même que des orthographes anciennes sont préservées, par exemple « temple » pour « tempe ».
 altersexualite.com
altersexualite.com