Accueil > Culture générale et expression en BTS > Corps naturel, corps artificiel > Études sur l’hystérie, de Sigmund Freud & Josef Breuer
Freud avant la psychanalyse : la somatisation, quand le corps relaie l’esprit.
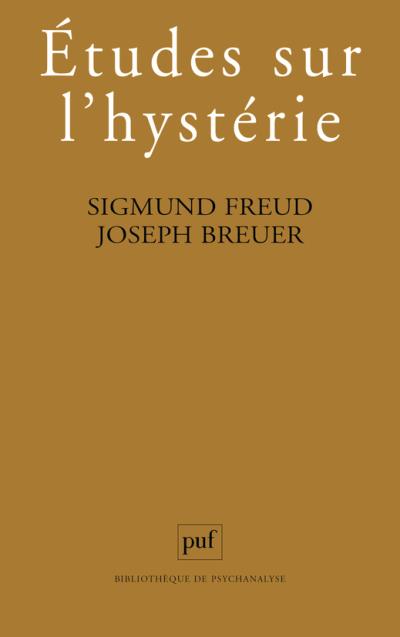 Études sur l’hystérie, de Sigmund Freud & Josef Breuer
Études sur l’hystérie, de Sigmund Freud & Josef Breuer
PUF, Bibliothèque de psychanalyse, 1956 (1895), 260 p., 22 €.
samedi 22 décembre 2018
Études sur l’hystérie est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème « Corps naturel, corps artificiel ». Il s’agit d’un essai fondateur de Freud, coécrit avec Josef Breuer, datant d’avant l’invention de la psychanalyse, où Freud expérimente ce qu’il a appris notamment auprès du professeur Jean-Martin Charcot. Je vous renvoie pour approfondir à l’article de Wikipédia sur ce livre, Études sur l’hystérie, ainsi qu’à l’article sur la polémique suscitée en 2005 par la publication de Le Livre noir de la psychanalyse. Je me contenterai de citer quelques extraits, assortis de brefs commentaires, n’étant pas du tout légitime à commenter ce genre d’ouvrage. Les réflexions sur l’hystérie et la somatisation m’ont cependant intéressé au plus haut point lors de la rédaction de mon roman M&mnoux (Publibook, 2018). La réflexion sur la sexualité est fondamentale, et il faut tenir compte de l’avertissement préliminaire de censure sur cet aspect.
Errements scientifiques
Dès l’avant-propos de la première édition, Freud & Breuer reconnaissent un problème qu’il serait malhonnête de leur imputer comme une fraude scientifique compte tenu de l’état des esprits occidentaux à leur époque relativement à la sexualité : « Il s’ensuit que nous avons rarement été en mesure de justifier complètement l’opinion que nous avons pu nous faire et qui est la suivante : c’est à la sexualité, source de traumatismes psychiques, et facteur motivant du rejet et du refoulement de certaines représentations hors du conscient, qu’incombe, dans la pathogenèse de l’hystérie, un rôle prédominant. Nous nous sommes vus obligés d’exclure de notre exposé justement les observations à contenu fortement sexuel. » Cela va mieux en le disant, mais ne jugeons pas Freud & son comparse sans tenir compte du contexte dans lequel ils opérèrent ! De page en page, on relève l’aveu d’erreurs. Ainsi, p. 46, Freud, dans son traitement de Mme Emmy von N…, « effac[e] de sa mémoire, non seulement le souvenir plastique, mais tout l’ensemble de cette réminiscence, comme si elle n’y avait jamais été mêlée ». Il déclare en note : « Dans mon ardeur, j’étais sans doute, cette fois-là, allé trop loin. Un an et demi plus tard, quand je revis Mme Emmy alors relativement bien portante, elle se plaignit, chose étrange, de ne pouvoir se souvenir que fort imparfaitement de faits très importants de sa vie. Elle y voyait une preuve de l’affaiblissement de sa mémoire, tandis que je me gardai bien de lui expliquer les raisons de cette amnésie particulière. » Quelques pages plus loin, il avoue un « mésusage » : « Je me permets alors une plaisanterie suggestive qui constitue le seul innocent mésusage de l’hypnose que j’aie d’ailleurs eu à me reprocher dans le cas de cette malade. Je lui affirme que le séjour à …tal lui apparaîtrait désormais si lointain qu’elle ne pourrait même pas se rappeler le nom exact de cet endroit quand elle voudrait en parler et que, chaque fois, elle hésiterait entre …berg, …tal, …wald., etc., ce qui advint bientôt et fut le seul trouble du langage que l’on put observer chez elle jusqu’au jour où, sur une remarque faite par le Dr Breuer, je la débarrassai de cette compulsion à la paramnésie » (p. 62). Freud va jusqu’à jouer les hypnotiseurs de foire : « Pendant la séance d’hypnose que j’entrepris pour la débarrasser de ses inhibitions relatives au train, elle parut elle-même mécontente des réponses qu’elle donnait, et m’exprima la crainte de n’être plus aussi docile qu’auparavant sous hypnose. Je décidai de la convaincre du contraire et, écrivant quelques mots sur une feuille de papier, je la lui tendis en disant : « Au déjeuner, vous me verserez comme hier un verre de vin rouge, et dès que je porterai le verre à mes lèvres, vous me direz : « S’il vous plaît remplissez aussi mon « verre ». Au moment où je saisirai la bouteille, vous vous écrierez : « Non, je vous remercie, il vaut mieux pas. » Ensuite vous tirerez de votre poche le papier sur lequel ces mots sont tracés. » Cela se passait le matin ; quelques heures plus tard toute cette petite scène se déroula exactement comme je l’avais prescrit, et avec tant de naturel, qu’aucun des nombreux convives ne s’en aperçut. Elle parut, en me demandant du vin, être en proie à une lutte intérieure – elle ne buvait jamais de vin – et, après m’avoir donné son contre-ordre avec un visible soulagement, elle fouilla dans sa poche, en tira la feuille de papier sur laquelle elle put lire les mots qu’elle avait prononcés, secoua la tête et me regarda avec stupeur » (p. 66). Plus tard, il se livre à une autre facétie : « Un jour où elle était entrée en chancelant dans la pièce, un bras appuyé sur celui de son père et s’aidant d’un parapluie dont le bout était déjà fortement usé, je m’impatientai et lui criai pendant l’hypnose : « Ça suffit comme ça ! Pas plus tard que demain matin, votre parapluie se cassera dans votre main et vous serez obligée de rentrer chez vous sans parapluie. Désormais, vous n’en aurez plus besoin. » J’ignore comment je pus être assez bête pour chercher à suggestionner un parapluie, j’en eus honte ensuite et ne soupçonnai pas que mon intelligente patiente se chargerait, auprès de son père qui était médecin et assistait à la séance, de mon sauvetage » (p. 78). Il lui arrive de déclarer une patiente guérie, faute de temps pour approfondir : « Nous avions tous deux l’impression d’avoir achevé notre tâche, néanmoins je me disais que, malgré tout, l’abréaction de la tendance réprimée n’avait pas été poussée jusqu’au bout » (p. 125 ; abréaction : Réaction émotive par laquelle le malade se libère, par des gestes ou des mots, de tendances refoulées dans le subconscient). Freud définit la somatisation : « Pourquoi donc des douleurs dans les jambes sont-elles venues remplacer une souffrance morale ? Les circonstances, dans le cas en question, indiquent que cette douleur somatique n’a pas été créée par la névrose, mais seulement que celle-ci s’en est servie, l’a augmentée et maintenue. J’ajouterai tout de suite que dans la plupart des algies hystériques qu’il m’a été donné d’observer, les choses se passaient de façon analogue : une douleur d’origine réellement organique avait réellement existé au début. Ce sont les douleurs les plus communément répandues parmi les êtres humains qui semblent être le plus souvent appelées à jouer ce rôle dans l’hystérie ; en particulier les douleurs périostiques et névralgiques dans les maladies dentaires, les maux de tête émanant de diverses sources et, tout aussi souvent, les douleurs rhumatismales musculaires si fréquemment méconnues. » Il précise que « Cette douleur primitivement rhumatismale devint chez la malade le symbole mnémonique de ses pénibles émois psychiques » (p. 139), c’est-à-dire qu’il se crée un rapport entre douleur physique et psychique. Une belle phrase de Joseph Breuer reprend la métaphore des nains sur des épaules de géants de Bernard de Chartres : « Quand une science progresse rapidement, les pensées exprimées d’abord par quelques-uns deviennent aussitôt la propriété de tous. Ainsi toute personne qui cherche de nos jours à exposer sa façon de voir touchant l’hystérie et son fondement psychique, ne saurait éviter d’énoncer et de répéter nombre d’idées appartenant à autrui, idées qui, ayant d’abord été la propriété d’un seul, sont devenues bien commun. Il est à peine possible de découvrir chaque fois, qui les a d’abord formulées et l’on risque de s’attribuer à soi-même ce qui a déjà été dit par d’autres » (p. 147). Breuer se livre d’ailleurs à une série fort intéressante de métaphores électriques, reprises et amplifiées de page en page : « Il va de soi que la production d’un travail effectif nécessite une plus grande dépense d’énergie que le simple fait d’être prêt à travailler (de même que, dans l’installation électrique prise comme exemple une plus grande quantité d’énergie s’écoule quand beaucoup d’ampoules ou de machines s’y trouvent intercalées). Lorsque le fonctionnement est normal, la quantité d’énergie libérée ne dépasse pas celle nécessitée par le travail à accomplir à ce moment-là. Mais le cerveau se comporte comme une installation à capacité de production limitée incapable de produire, en même temps, de grandes quantités de lumière et de travail mécanique. Peu d’énergie lumineuse reste disponible quand il y a transmission de forces et inversement. Ainsi un individu qui fait de grands efforts musculaires ne peut absolument pas se livrer à des réflexions prolongées. L’attention, lorsqu’elle se concentre sur un certain domaine sensoriel, provoque une chute de potentiel dans les autres parties du cerveau qui utilise, de ce fait, une quantité d’énergie variable mais limité » (p. 155). Breuer infirme l’idée de ses prédécesseurs selon laquelle les hystériques seraient débiles : « Parmi les hystériques se trouvent, pensons-nous, certains sujets possédant l’intelligence la plus lucide, la volonté la plus forte, l’esprit le plus critique. L’hystérie n’exclut à aucun degré les dons psychiques que le sujet possède en puissance, mais que la maladie l’empêche d’utiliser. La patronne des hystériques, sainte Thérèse, ne fut-elle pas une femme géniale, ayant le sens pratique le plus développé ? » (p. 187). Il est fait mention une seule fois, par Breuer, d’hystérie masculine : « Au début des hystéries graves, on observe généralement, pendant un certain temps, un syndrome que l’on aurait le droit de qualifier d’hystérie aiguë (dans les anamnèses de certains hommes hystériques, on parle, dans la plupart de ces cas, d’« inflammation du cerveau », chez les femmes hystériques, l’ovarite entraîne le diagnostic de péritonite) » (p. 190).
Dans le dernier chapitre, Freud explique comment il renonce peu à peu à l’hypnose : « Je remarquai seulement que, chez certains patients, la difficulté paraissait encore accrue du fait qu’ils s’opposaient même à ce qu’on essayât de les hypnotiser. Je me dis alors un beau jour que les deux cas pourraient bien être identiques et signifier l’un comme l’autre un refus. Un sujet qui se méfie de l’hypnose, qu’il exprime ou non ce refus, ne peut être hypnotisé. J’ignore si je dois persévérer dans cette façon de voir. Quoi qu’il en soit, je réussis à me passer de l’hypnose et à retrouver sans son concours les souvenirs pathogènes » (p. 215). Freud décrit l’architecture de la conscience avec l’image d’un fruit : « J’ai indiqué que le groupement de ces sortes de souvenirs en une pluralité d’assises, de strates linéaires se présentait comme un dossier d’actes, un paquet, etc., et caractérisait la formation d’un thème. Ces thèmes sont autrement groupés encore, ce que je ne saurais décrire qu’en disant qu’ils sont concentriquement disposés autour du noyau pathogène. Il n’est pas difficile de dire ce que représente cette stratification, ni suivant quelle proportion croissante ou décroissante elle se produit. Ce sont des strates présentant une résistance égale, résistance qui croît lorsqu’on s’approche du noyau, donc des zones comportant une égale altération de la conscience, zones dans lesquelles s’étalent les différents thèmes. Les strates les plus extérieures comprennent les souvenirs (ou faisceaux de souvenirs) qui peuvent le plus facilement revenir à la mémoire et sont toujours clairement conscients. À mesure que l’on pénètre plus profondément au travers de ces couches, la reconnaissance des souvenirs qui émergent se fait plus difficile jusqu’au moment où l’on se heurte au noyau central des souvenir dont le patient persiste à nier l’existence lors de leur apparition » (p. 234).

Transfert
C’est à la fin du livre qu’apparaissent le mot et la notion de « transfert » : « 3° Quand la malade craint de reporter sur la personne du médecin les représentations pénibles nées du contenu de l’analyse. C’est là un fait constant dans certaines analyses. Le transfert au médecin se réalise par une fausse association (voir p. 52). J’en donnerai ici un exemple. Chez l’une de mes patientes, un certain symptôme hystérique tirait son origine du désir éprouvé longtemps auparavant, mais aussitôt rejeté dans l’inconscient, de voir l’homme avec qui elle avait alors conversé, la serrer affectueusement dans ses bras et lui soustraire un baiser. Or il advient, à la fin d’une séance, qu’un désir semblable surgit chez la malade par rapport à ma personne ; elle en est épouvantée, passe une nuit blanche et, à la séance suivante où, cependant, elle ne refuse pas de se laisser traiter, le procédé reste entièrement inopérant. Après avoir appris de quelle difficulté il s’agissait et être parvenu à la surmonter, je puis reprendre le travail et voilà que le désir qui a tant effrayé la malade s’avère le plus proche des souvenirs pathogènes, celui même que faisait nécessairement prévoir l’enchaînement logique des faits. Les choses s’étaient déroulées de la façon suivante : le contenu du désir avait surgi dans le conscient de la malade, mais sans être accompagné du souvenir des circonstances accessoires capables de situer ce désir dans le passé. Le désir actuel se trouva rattaché, par une compulsion associative, à ma personne évidemment passée au premier plan des préoccupations de la malade. Dans cette mésalliance – à laquelle je donne le nom de faux rapport – l’affect qui entre en jeu est identique à celui qui avait jadis incité ma patiente à repousser un désir interdit. Depuis que je sais cela, je puis, chaque fois que ma personne se trouve ainsi impliquée, postuler l’existence d’un transfert et d’un faux rapport. Chose bizarre, les malades sont en pareil cas toujours dupes » (p. 245). Le livre se termine sur une métaphore choquante : « J’ai souvent mentalement comparé la psychothérapie cathartique aux interventions chirurgicales et je qualifie mes cures d’opérations psychothérapiques en les comparant à l’ouverture d’une cavité pleine de pus, au grattage d’une carie, etc. Cette analogie se trouve confirmée non pas tant par la suppression des parties malades que par l’établissement de conditions plus favorables à l’évolution du processus de guérison.
Hystérie et personnalité
Ayant surtout affaire à des clientes aisées, Freud & Breuer remettent en cause les opinions de leurs confrères : « Si l’observation de Mme Cécilie M… nous avait montré que l’hystérie, sous sa forme la plus grave, n’est pas incompatible avec les dons les plus riches et les plus originaux – fait que rend d’ailleurs évident la biographie des femmes qui se sont illustrées dans l’histoire et les lettres – nous trouvions en Mme Emmy v. N… une preuve de ce que l’hystérie n’exclut ni un caractère impeccable, ni la recherche de buts bien définis. Nous avions affaire à une femme remarquable, d’une haute moralité, prenant au sérieux ses devoirs et dont l’intelligence et l’énergie vraiment viriles, la grande culture et l’amour de la vérité, nous en imposaient à tous deux, alors que son souci du bien-être des gens d’une situation inférieure à la sienne, sa modestie innée et l’élégance de ses manières en faisaient réellement une grande dame. Qualifier une femme comme elle de « dégénérée » serait modifier, jusqu’à le rendre méconnaissable, le sens de ce mot. Il convient d’établir une discrimination nette entre les concepts de « prédisposés » et de « dégénérés », sans quoi l’on sera obligé d’admettre que l’humanité doit une bonne part de ses grandes acquisitions aux efforts d’individus « dégénérés » » (p. 81). Le cas de « Miss Lucy R… » est intéressant en ce qu’il présente une gouvernante, soumise donc à des impératifs professionnels : « en réalité, ce qui aurait pu ne prendre qu’une séance en exigea plusieurs, parce que la malade ne pouvait venir qu’à mes heures de consultation, pendant lesquelles je ne pouvais lui consacrer que peu d’instants. En outre, ces entretiens avaient lieu tout au plus une fois par semaine parce que ses obligations ne lui permettaient pas de faire plus souvent le long trajet de la fabrique à mon domicile. Nous nous interrompions donc au beau milieu de notre conversation et il fallait, la fois suivante, en renouer le fil coupé » (p. 85). Le cas « Katharina » pousse Freud à un humour légèrement condescendant : « Je me retrouvai donc en face d’une névrosée, car il ne pouvait guère s’agir d’autre chose chez cette grande et forte fille à la mine chagrine. Intéressé d’apprendre que des névroses pouvaient si bien prospérer à plus de 2 000 mètres d’altitude, je continuai à questionner la jeune fille. Je reproduis ici l’entretien tel qu’il s’est gravé dans ma mémoire, sans modifier le dialecte local de mon interlocutrice » (p. 98).
Voici la différence entre affection organique et psychique : « Tout malade atteint d’une affection organique, s’il n’est, en outre, un nerveux, parvient à décrire ses douleurs tranquillement et avec certitude, à dire si elles sont lancinantes, si elles surgissent par intervalles, de quel point à quel autre elles se diffusent et ce qui, à son avis, les provoque. Le neurasthénique (hypocondriaque affecté de névrose d’angoisse) qui décrit son mal donne l’impression d’accomplir un travail mental bien au-dessus de ses forces. Ses traits sont contractés et grimaçants comme s’il était dominé par quelque pénible émotion, sa voix se fait stridente, il cherche ses expressions, rejette toute qualification de ses douleurs proposée par le médecin, même lorsque l’exactitude de cette dernière est ensuite indubitablement reconnue. Il pense évidemment que la langue est trop pauvre pour lui permettre de dépeindre ses sensations ; ses sentiments eux-mêmes sont quelque chose d’unique, de jamais vu encore, que l’on ne saurait parvenir à décrire parfaitement. C’est pourquoi il n’est jamais las de donner toujours de nouveaux détails, et s’il est forcé de s’interrompre, il garde sûrement l’impression de n’avoir pas réussi à se faire comprendre du médecin » (p. 107). « On peut donc dire que, somme toute, il n’existait pas là un seul et unique symptôme somatique lié à de multiples complexes mnémoniques, mais une pluralité de symptômes semblables qui, superficiellement considérés, paraissaient avoir fusionné pour donner un seul symptôme. Je n’ai, bien entendu, pas cherché à délimiter les zones douloureuses correspondant à tel ou tel émoi psychique parce que, comme je l’observai, l’attention de la malade ne s’y appliquait pas.
En revanche, je m’intéressai à la façon dont s’était bâti sur ces zones douloureuses tout le complexe symptomatique de l’abasie » (p. 118 ; abasie : perte plus ou moins complète de la faculté de marcher. Cf. ci-dessous, un exemple dans un film de Charles Chaplin).
Breuer nous donne une explication fort claire d’un aspect de la somatisation, l’extériorisation des émotions par le comportement : « Néanmoins les affects « actifs », « sténiques » [1], compensent la poussée d’excitation par une décharge motrice. Les cris et les sauts de joie, le tonus musculaire accru de la colère, les vociférations, les représailles, permettent à l’excitation de se décharger par certains mouvements. La souffrance morale, elle, se débarrasse de l’excitation par des efforts respiratoires et par des sécrétions : les sanglots et les larmes. Chacun peut journellement constater que ces réactions tendent à diminuer et à apaiser l’excitation. Comme nous l’avons déjà souligné, ce fait a été traduit par les locutions : « pleurer tout son saoul », « se décharger de sa colère », etc. Ce dont on se débarrasse alors, c’est justement de l’excitation cérébrale accrue » (p. 160). Ses explications sont très pédagogiques, comme lorsqu’il explique ce phénomène fort simple : « Cette substitution d’une excitation des voies périphériques à une excitation cérébrale devant conditionner une représentation paraît peut-être plus admissible lorsqu’on pense à la situation inverse, celle où il y a absence de tout réflexe préformé. Prenons un exemple tout à fait grossier, celui du réflexe sternutatoire. Quand la muqueuse nasale, irritée, ne peut, pour un motif quelconque, déclencher ce réflexe préformé, le sujet éprouve, comme chacun sait, une sensation d’irritation et de tension. C’est cette irritation qui, n’arrivant pas à se déverser par les voies motrices, se répand dans le cerveau et empêche tout autre genre d’activité. Ce très banal exemple nous montre le schéma du processus qui se déroule lorsque les réflexes les plus compliqués n’arrivent pas à se déclencher. L’irritation que provoque un besoin de vengeance est essentiellement semblable à la précédente et nous pouvons observer, jusque dans les sphères les plus élevées des réalisations humaines ce même processus. Goethe ne pouvait s’accommoder des événements avant d’y avoir appliqué son activité littéraire. Il s’agit, dans son cas, du réflexe préformé d’un affect et tant que la réaction ne s’est pas produite, une pénible irritation accrue subsiste » (p. 165). Les hystériques sont selon Breuer l’opposé des hypocondres : « leur besoin de sensations les pousse, quand débute leur maladie, à interrompre le cours monotone de leur existence par toutes sortes d’ « incidents », qui constituent, est-il besoin de le dire ? surtout des phénomènes pathologiques. L’autosuggestion y concourt souvent. Les malades y inclinent toujours davantage en vertu de leur besoin de maladie, trait surprenant aussi pathognomonique de l’hystérie que la peur des maladies l’est de l’hypocondrie » (p. 197).
Importance de la sexualité
Dans le cas « Mme Emmy von N… », Freud relève que « C’est évidemment le caractère érotique de cette petite aventure qui l’avait poussée à m’en faire un récit inexact. L’expérience m’avait appris qu’un récit incomplet fait en état d’hypnose ne provoquait aucun effet curatif et je tenais, dès lors, pour insuffisant tout récit n’ayant fourni aucun progrès. Peu à peu j’avais appris à discerner d’après l’expression des malades la dissimulation d’une partie essentielle de leurs conflits » (p. 61). « Il est impossible que des émois de cet ordre ne laissent aucune séquelle ; elle m’avait donc donné, sans doute, de l’histoire de sa vie, une édition ad usum delphini. La patiente montrait dans tout son comportement, mais sans affectation, ni pruderie, la plus grande décence. Cependant, quand je me rappelle avec quelle réserve elle m’avait raconté, pendant l’hypnose, la petite aventure de sa femme de chambre à l’hôtel, j’en viens à soupçonner que cette femme d’un tempérament violent, si capable d’éprouver des sentiments passionnés, avait dû mener une lutte serrée pour vaincre ses besoins sexuels et s’épuiser psychiquement beaucoup à l’époque, en essayant d’étouffer cet instinct, le plus puissant de tous. »
C’est à Breuer qu’il revient d’expliquer la naissance de l’instinct sexuel : « À la puberté, la sexualité fournit une première poussée vague, indéterminée, dénuée de but. Au cours du développement, il doit (normalement) s’établir un lien entre cette excitation endogène, due au fonctionnement des glandes sexuelles, et la perception ou la représentation du sexe opposé, et l’on voit aussi se produire le phénomène merveilleux de l’amour voué à une seule personne. C’est à cette dernière alors que revient tout l’émoi libéré par l’instinct sexuel. Elle devient une « représentation affective », c’est-à-dire que, du fait de son actualisation dans la conscience, elle déclenche une excitation qui, en réalité, émane d’une autre source : les glandes sexuelles. L’instinct sexuel est certainement la source la plus abondante des poussées d’excitation prolongées (et par là des névroses) ; ces poussées se trouvent inégalement réparties dans le système nerveux. À leurs degrés d’intensités les plus élevés, le cours des représentations est perturbé, la valeur des idées, modifiée et, dans l’acte sexuel, la pensée est presque totalement abolie. La perception, l’élaboration psychique des impressions sensorielles sont, elles aussi, atteintes. L’animal généralement craintif, méfiant, devient aveugle et sourd devant le danger. En revanche, l’intensité de l’instinct agressif – tout au moins chez les mâles – s’accroît ; l’animal paisible se fait dangereux jusqu’au moment où l’excitation se trouve déchargée grâce aux efforts moteurs de l’acte sexuel » (p. 159). Breuer explique comment sexualité et hystérie sont associés : dans les hystéries de la puberté, puis dans le mariage (à son époque) : « Les adolescentes – car c’est, en effet, de celles-ci qu’il s’agit surtout – se comportent de façon très différente à l’égard des représentations et des sensations sexuelles qui les assaillent. Certaines y réagissent très calmement, très naturellement, parfois en ignorant tout ce domaine, en n’en tenant aucun compte. D’autres réagissent à la manière des garçons ; c’est, en général, le cas des paysannes et des ouvrières. D’autres encore cherchent avidement, avec une curiosité plus ou moins morbide, ce qui, dans les conversations ou dans les livres, pourrait les renseigner sur la sexualité. Certaines enfin, douées d’une nature délicate, très sensibles à la sexualité en même temps que très pures moralement, tiennent tout ce qui est sexuel pour incompatible avec leur moralité et le considèrent comme une saleté et une souillure. Elles éliminent de leur conscient la sexualité. Les représentations affectives de celle-ci, qui ont provoqué des phénomènes somatiques, une fois qu’elles ont été rejetées deviennent inconscientes.
La tendance à rejeter ce qui est sexuel se renforce encore du fait qu’à l’excitation sensuelle des vierges se mêle une crainte de l’inconnu, du soupçonné, de ce qui va se produire. Chez le jeune homme sain, normal, au contraire, on ne trouve qu’un instinct purement agressif. La jeune fille pressent, dans Éros, la force terrible qui va régler son destin, en décider, et c’est ce qui l’épouvante. Sa tendance à ne pas regarder les faits en face et à chasser hors du conscient le motif de la crainte s’en trouve renforcée. Le mariage suscite de nouveaux traumatismes sexuels et l’on peut s’étonner de voir que la nuit des noces n’exerce pas plus souvent d’action pathogène puisqu’elle comporte maintes fois, non pas une séduction érotique, mais un viol. Quoi qu’il en soit l’hystérie n’est pas rare chez les jeunes femmes et l’on peut fréquemment l’attribuer à cette initiation. Elle disparaît par la suite, une fois que la révélation au plaisir sexuel a été réalisée et le traumatisme, effacé.
Mais d’autres traumatismes sexuels peuvent encore survenir au cours de bien des vies conjugales. Certaines histoires de malades que nous avons dû nous abstenir de publier relatent un grand nombre d’exigences et de pratiques perverses de la part du mari, etc. Je ne pense pas exagérer en prétendant que le lit conjugal est, chez les femmes, à l’origine de la plupart des névroses graves » […] « Les naïves observations de nos prédécesseurs, qui ont donné au mot « hystérie » un sens que nous lui avons en partie conservé, sont plus proches de la vérité que les toutes récentes opinions émises à ce propos et suivant lesquelles la sexualité est reléguée à peu près au dernier plan, cela afin d’épargner aux malades des reproches d’ordre moral. Il est certain que les besoins sexuels varient, suivant les individus, autant chez les normaux que chez les hystériques et qu’ils ne sont pas plus puissants chez ces derniers. Mais ce sont ces besoins qui les ont rendus malades et, en grande partie justement, parce que ces malades les ont combattus en repoussant la sexualité » (pp. 199-200). Une note de bas de page précise : « Il est bien dommage que les cliniciens ignorent ce facteur pathogène ou ne le mentionnent qu’en passant alors qu’il est pourtant l’un des plus importants. C’est là un fait d’expérience que le praticien se devrait de faire connaître aux jeunes médecins. Ceux-ci passent généralement en aveugles devant la sexualité, tout au moins en ce qui concerne leurs malades ». Freud évoque un cas où le médecin de famille lui a révélé l’origine des troubles de sa patiente, une gouvernante pédophile (le mot n’est pas employé) : « Avant même que je puisse poursuivre cette analyse, une occasion me fut offerte de parler à l’un de mes collègues qui avait, autrefois, été le médecin attitré de la famille. Il me donna les renseignements suivants : à l’époque où il soignait, pour ses premiers accès, cette adolescente physiquement bien développée, il fut frappé de la façon excessivement tendre dont elle et la gouvernante se traitaient. Ayant conçu certains soupçons, il avertit la grand-mère et l’invita à surveiller ces relations. Peu de temps après, la vieille dame lui apprit que la gouvernante avait l’habitude de faire des visites nocturnes à l’enfant, dans son lit et que c’était après de semblables nuits que l’on découvrait celle-ci en proie à son accès. Sans hésiter, ils décidèrent alors, en évitant tout scandale, d’éloigner cette dépravatrice de la jeunesse. On fit croire aux enfants et à leur mère également que la gouvernante quittait la maison pour se marier » (p. 222).
Relation incestueuse avunculaire
Le cas « Katharina » est intéressant car présente a priori un double inceste avunculaire : Katharina avait surpris son « oncle » au lit avec sa cousine Franziska, ce qui aurait entraîné le divorce de la tante & de l’oncle. Mais le nœud n’est pas là : « Puis, à ma grande surprise, Katharina lâche le fil de son récit et me raconte deux séries d’histoires antérieures de deux à trois ans à l’incident traumatisant. La première série comporte des faits où le même oncle chercha à la séduire elle-même alors qu’elle avait 14 ans. Faisant en sa compagnie une excursion dans la vallée, ils avaient passé la nuit à l’auberge. Il était resté au café pour boire et jouer aux cartes, et elle, ayant sommeil, alla de bonne heure se coucher dans la chambre à deux lits située à l’étage au-dessus. Ne dormant pas encore à poings fermés quand son oncle monta à son tour, elle se rendormit bientôt, mais fut soudain réveillée en « sentant le corps de l’oncle » dans sa couche » (p. 102).
Or une note à la fin du cas révèle le pot aux roses : « Complément de 1924. – Bien des années s’étant écoulées depuis lors, je me crois autorisé à enfreindre la règle de discrétion que je m’étais imposée et à ajouter que Katharina était non la nièce, mais la fille de l’aubergiste. La maladie de la jeune fille avait donc été causée par les tentatives de son propre père. Dans une observation de malade, il faudrait toujours éviter de semblables altérations ; elle n’est naturellement pas aussi insignifiante que le simple déplacement des faits d’une montagne à une autre. » Je me suis retrouvé face aux mêmes difficultés lors de la rédaction de mon roman M&mnoux, quand j’avais à intégrer des relations incestueuses, dont j’ai mélangé les données sans altérer la nature des faits. Mais un scientifique peut-il agir en romancier ? C’est ce que Freud semble suggérer : « je m’étonne moi-même de constater que mes observations de malades se lisent comme des romans et qu’elles ne portent pour ainsi dire pas ce cachet sérieux, propre aux écrits des savants. Je m’en console en me disant que cet état de choses est évidemment attribuable à la nature même du sujet traité et non à mon choix personnel. Le diagnostic par localisation, les réactions électriques, importent peu lorsqu’il s’agit d’étudier l’hystérie, tandis qu’un exposé détaillé des processus psychiques, comme celui que l’on a coutume de trouver chez les romanciers, me permet, en n’employant qu’un petit nombre de formules psychologiques, d’acquérir quelques notions du déroulement d’une hystérie. Ces sortes d’observations doivent être jugées comme celles d’ordre psychiatrique, mais présentent sur elles un avantage : le rapport étroit qui existe entre l’histoire de la maladie et les symptômes morbides, rapport que nous recherchons vainement dans les biographies d’autres psychoses » (p. 127).
– Les Feux de la rampe (Limelight) (1952) de Charles Chaplin est un excellent témoignage sur la conception freudienne de l’hystérie, et un grand film sur le corps. Lire « Limelight – Splendeurs et misère d’un mot : l’hystérie » de Serge Tisseron. La paralysie – ou plutôt « abasie », pour reprendre le terme freudien (cf. ci-dessus) – des jambes de la jeune danseuse que Calvero-Chaplin sauve du suicide, est somatique. Mais le jeu des jambes est un point commun entre le clown et la ballerine, dès la scène de départ où, bien que titubant et alcoolisé, Calvero la sauve du suicide en enfonçant sa porte, la seule chose d’elle qu’il enfoncera (Tisseron voit dans la 1re scène d’ouverture de la porte avec la clé une métaphore sexuelle, mais il y en a deux pour le même prix !). Le comique des scènes de spectacle rêvées puis réelles données par le vieux clown, reposent souvent sur la marche ou la démarche, notamment le sketch d’anthologie qui réunit Buster Keaton et Chaplin, où ce dernier a les jambes qui rétrécissent, et les retend par un geste violent, comme on tend une chaussette repliée sur elle-même, représentation symbolique de la résilience attendue de la jeune fille. Le vieux Chaplin renoue avec le Charlot de ses débuts ; il situe d’ailleurs l’action en 1914. Le spectacle de danse mis en abyme n’est pas qu’un faire valoir, mais un véritable ballet dont la musique est une des plus fameuses de Chaplin en personne. Après que le metteur en scène a résumé le script, on croit en être débarrassé, mais non, on a droit à tout le spectacle, mais comme nous sommes au cinéma, le virtuose de la caméra nous offre la vision panoptique de ce chef-d’œuvre en multipliant les angles de prise de vue, et le spectacle est vu depuis la salle, depuis les coulisses, depuis les cintres, etc. La vedette en reste le corps, libéré de l’hystérie par une cure retentissante, non plus la parodie de cure freudienne du début, mais la claque libératoire de la médecine pré-freudienne ! Le script interfère d’ailleurs avec le récit cadre, puisqu’il s’agit d’une jeune fille mourante, qui meurt certes, contrairement au récit-cadre, mais ressuscite par le pouvoir de l’art. La mort tragique du clown a lieu suite à une impressionnante cabriole de Chaplin, depuis la scène, il tombe dans la fosse d’orchestre et s’encastre dans la grosse caisse. Il y reste tel un escargot et n’en sort que pour mourir d’une crise cardiaque. Belle métaphore du corps de l’artiste de music-hall, pris comme un mollusque dans les instruments de son art. La liste du BO nous propose Le Mécano de la « General » (1926) de Buster Keaton, que j’aimerais revoir, mais Limelight est pas mal non plus !
Un autre film qui évoque l’hystérie et sa cure, est La Fièvre dans le sang (1961) d’Elia Kazan. Nathalie Wood et Warren Beatty y incarnent des jeunes gens des années 1920, juste avant le krach, fils et fille de bonne famille, purs produits de la répression sexuelle qui engendre l’hystérie (et non du seul puritanisme américain comme le prétend l’article de Wikipédia). Leurs corps les mène vers une satisfaction sexuelle que le code moral en vigueur leur refuse. Ils ne peuvent le supporter et en subissent de dures conséquences. Elia Kazan raconte un moment charnière de l’histoire de l’humanité, moment où les enfants ne peuvent plus croire aux conneries imposées par les parents. La psychiatrie et même la psychanalyse ont leur place dans le film, dix ans avant la mort de Freud.
Voir en ligne : Article de Wikipédia
© altersexualite.com 2018
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Le mot s’écrit d’habitude « sthénique » ; opposé à « asthénique », il désigne un état caractérisé par l’énergie, la vigueur.
 altersexualite.com
altersexualite.com