Accueil > Culture générale et expression en BTS > Corps naturel, corps artificiel > Demain, les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ?, de (...)
Éthique, morale et petits robots, pour étudiants et adultes
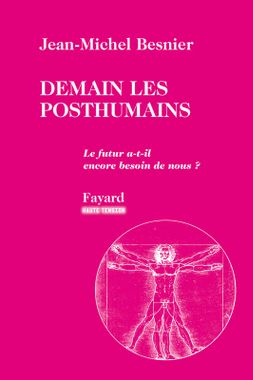 Demain, les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ?, de Jean-Michel Besnier
Demain, les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ?, de Jean-Michel Besnier
Hachette littératures, Haute tension, 2009, 216 p., 18 €.
samedi 19 janvier 2019
Demain, les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ? est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème « Corps naturel, corps artificiel ». C’est un essai typique du style philosophique actuel : globalement illisible pour 95 % de la population. Comment les philosophes peuvent-ils majoritairement utiliser ce style à couper au couteau ? L’immense majorité de nos étudiants n’y comprendront rien ; moi-même j’ai parfois du mal à distinguer parmi les idées jonglées par l’auteur, celles qu’il rejette de celles qu’il soutient. Mais sur 208 pages, il reste quand même plusieurs passages parfaitement compréhensibles noyés dans cette masse fuligineuse, et beaucoup d’informations fort intéressantes sur certaines doctrines philosophiques, de nombreuses références livresques ou filmiques, n’ayant pour la plupart que peu de rapport avec le thème du corps. Il n’est pas question uniquement du corps artificiel dans cet essai, mais plus largement de tous les changements que l’activité de l’homme doit faire subir à la nature, lui y compris, et c’est un aspect positif de cet essai.
De l’humanisme à l’« immaîtrise »
La problématique de l’ouvrage est formulée à la fin de l’avant-propos : « Mais comment obtenir que le posthumanisme signifie l’extension de nos valeurs aux réalités créées par nos technologies (par exemple, aux clones, aux cyborgs ou aux robots), plutôt que l’annonce de notre autosuppression ou de notre désertion ? » Dans l’introduction (qui suit l’avant-propos), nous trouvons un éloge de l’« immaîtrise » : « Après tout, dans la nature, la sélection aléatoire des espèces impose le meilleur. Pourquoi n’en serait-il pas de même dans le domaine des technosciences ? Ne plus tout à fait savoir ce que l’on fait n’est peut-être pas plus dangereux que de croire agir délibérément en vue de réaliser le bonheur des gens. En revendiquant de cette manière une sorte de droit à l’immaîtrise, c’est-à-dire aussi à l’irresponsabilité, on perd évidemment les illusions de l’autonomie, mais pour gagner peut-être la possibilité de réouvrir un avenir imprévu et salutaire » (p. 15). Un philosophe autrichien, Peter Sloterdijk, est évoqué. Il considérait que « l’humanisme issu de la Grèce puis revivifié avec la Renaissance européenne n’est plus crédible. […] Ses valeurs, principalement fondées sur l’amitié nouée autour d’une commune fréquentation des œuvres littéraires, sont aujourd’hui surannées et, au mieux, incantatoires. Son idéal de domination de la nature a révélé sa nocivité. » Ce philosophe « eut l’audace d’invoquer la perspective d’un posthumanisme susceptible de livrer une nouvelle échelle de valeurs, en phase avec la situation contemporaine créée essentiellement par la démesure des moyens technoscientifiques que nous avons développés. […] Ainsi, le clonage reproductif, en nous permettant de fabriquer techniquement l’homme, nous imposerait de remettre en question l’idée que nous nous en faisions et d’en amender ou d’en élargir le concept » (p. 17). Ces phrases pourtant compréhensibles (ce qui n’est pas souvent le cas dans le livre) sont ambiguës en ce sens qu’on a du mal à savoir si les affirmations sont à mettre au crédit de la personne citée seulement, et si l’auteur en approuve ou non le contenu. Idem pour la problématique du clone : « Or, un clone n’a pas sa place dans ce monde, selon Habermas, car lui font défaut les attributs de naissance qui ouvrent la mémoire générationnelle sans laquelle il n’est pas de culture humaine. Comment, demande-t-il, un clone pourrait-il se raconter aux autres et s’approprier l’histoire singulière qui façonne pour chacun de nous son identité personnelle ? […] Que valent pour lui les arguments plaidant en faveur de l’accueil du clone dans la communauté humaine, au même titre que de celui du handicapé mental ou même de l’animal domestique ? N’est-il pas sensible aux indices conduisant à douter de la possibilité pour l’homme d’être isolé encore longtemps du reste de la nature, dans une éternelle et arrogante spécificité ? » (p. 19). Besnier semble prendre la défense du clone : « Comparé au cyborg, le clone, dont on se demande s’il pourrait être « un homme comme un autre », semblerait moins dérangeant. Ne défiant pas plus les repères de la filiation que le premier Indien venu, qui déclare appartenir non pas à ses parents mais à la Terre et à l’ordre d’une nature homogène, on voit mal pourquoi la société des hommes devrait maintenir le clone dans ses marges et, éventuellement, accuser de « crime contre l’espèce humaine » son producteur » (p. 21).
L’intro aboutit à un distinguo bienvenu entre morale et éthique, continué dans le chapitre I : « La situation créée de nos jours par la technique signale-t-elle une semblable mise en échec de la morale ? S’il est probable qu’elle bouscule bel et bien l’ordre du permis et du défendu qui en est le fondement, cela ne signifie pas qu’elle invalide la recherche du bien-vivre individuel et collectif que les Grecs nommaient « éthique » (p. 22) ; « Moins abstraite et moins unilatérale, l’éthique est plus ambitieuse : cherchant à identifier les critères du bien-vivre individuel et collectif, elle tient compte des circonstances et des éléments qui composent l’environnement existentiel des hommes – et donc de la présence des animaux et des machines autour d’eux. Sa vocation est d’assurer la cohérence et la pacification des rapports de l’individu avec ce qui l’entoure » (p. 28). Besnier cite un grand nombre de livres ou films relevant souvent de la dystopie, dont certains qu’il m’a donné envie de lire, comme Erewhon, de Samuel Butler (p. 33). Un paragraphe inutilement contourné évoque un écrivain qui en évoque un autre, mais il est question en fait d’une théorie du philosophe Alfred Korzybski sur le langage A et le langage non-A, lequel « s’interdit en effet de réduire un sujet à son attribut et n’ignore pas combien les préjugés culturels peuvent imposer des critères susceptibles de biaiser les jugements de valeur » (p. 52). Le transhumanisme est sartrien : « Les utopistes du posthumain ne s’y trompent pas : si l’on peut souhaiter « refaire » l’homme, c’est que rien ne s’oppose en lui à son remodelage, c’est que sa malléabilité est première, que son absence d’essence l’ouvre à tous les possibles. Son existence est en effet contingente, comme l’enseignent aussi bien l’évolutionnisme darwinien que l’existentialisme sartrien » (p. 57).
« L’ère du cyborg » et l’homme augmenté
Le chapitre 3 « L’ère du cyborg » entame une réflexion fil rouge de l’ouvrage : « On reconnaîtra ici les trois ingrédients des prophéties transhumanistes qu’on entend énoncer, par exemple, dans l’environnement des centres de recherches axées sur des programmes du type NBIC : fin de la naissance, grâce aux perspectives ouvertes par le clonage et l’ectogenèse ; fin de la maladie, grâce aux promesses des biotechnologies et de la nanomédecine ; fin de la mort non voulue, grâce aux techniques dites d’uploading, c’est-à-dire au téléchargement de la conscience sur des matériaux inaltérables dont les puces de silicium ne sont que la préfiguration » (p. 68). On en apprend sur l’étymologie : « Le corps n’y a rien gagné, assurément : il reste en trop, la prison de l’âme, l’équivalent du tombeau auquel Platon aimait à le comparer, jouant de la proximité des mots « sêma » (tombeau) et « soma » (corps). Le thème de la honte de l’homme devant le progrès qui lui échappe est un autre fil rouge de l’essai : « Günther Anders a baptisé, en 1958, la pathologie déclarée dominante aujourd’hui : “la honte prométhéenne”. Le nom résume l’essentiel : « la honte qui s’empare de l’homme devant l’humiliante qualité des choses qu’il a lui-même fabriquées ». Étrange situation qui donne sa pleine mesure à la dépression dont nous faisons le signe du temps présent : le degré atteint par nos techniques nous persuade que nous ne saurions plus être à la hauteur et la honte que nous en concevons touche au plus intime de l’humain » (p. 75). Jean-Michel Besnier pose alors une expression qui reviendra souvent dans son essai : la « fatigue d’être soi » : « « […] Qu’après l’homme ce soit encore l’homme, voilà en vérité le comble du désespoir ». La voilà bien avouée cette extrême fatigue d’être soi que j’évoquais plus haut et qui justifie l’attente de la singularité » (p. 85).
Le chapitre 4 : « La nature de l’homme augmenté » commence par le cas longuement développé d’Oscar Pistorius (avant le fait divers qui lui vaudra plus tard la une médiatique) : « Oscar Pistorius appartient à la catégorie des handicapés physiques, bénéficiaires à ce titre de l’attention et du soin des bien portants. Il est né sans tibia et avec des malformations du pied qui l’ont contraint à être amputé au-dessous du genou, à l’âge de onze mois. Cet infirme est cependant devenu un athlète, médaille d’or au 200 mètres lors des Jeux paralympiques d’Athènes de 2004 et qui court le 400 mètres en 46,34 secondes, aussi vite que la titulaire féminine de la médaille d’or aux Jeux olympiques de cette même année. Ses prouesses ne doivent rien au dopage mais tout à une prothèse en fibre de carbone – une prothèse dont le design et l’ergonomie rangent Pistorius dans une catégorie bien embarrassante que le précédent chapitre a décrite : celle des cyborgs » (p. 92) ; « On alla même jusqu’à imaginer la folie qui pourrait conduire certains athlètes à vouloir s’automutiler afin de pouvoir disposer de semblables prothèses. Pour ces raisons, on refusa tout d’abord à Pistorius la possibilité d’être sélectionné parmi les hommes dépourvus d’artifices, ceux qu’on devrait peut-être désigner comme humains à part entière. L’athlète eut beau objecter que sa prothèse lui a toujours tenu lieu de membres inférieurs, qu’il ne l’a jamais perçue comme un artifice susceptible d’augmenter ses performances, mais seulement comme ses propres jambes, soumises par lui à l’entraînement le plus rigoureux aux fins d’incarner les idéaux olympiques, rien n’y fit. D’un être « diminué », la technique a fait un homme « augmenté » et, au lieu de s’en réjouir, on soupçonne là quelque calamiteuse dénaturation, susceptible de dicter de mauvais exemples et de dévoyer l’humain dans son contraire » (p. 92) ; « Le fait que nous répugnions à compter comme l’un des nôtres, éventuellement comme le meilleur, un être auquel manque quelque chose que nous possédons (des jambes), par la grâce de la nature, et qui compense ce déficit par son énergie systématiquement déployée (l’entraînement) et le génie d’ingénieurs en biomécanique (une prothèse) – ce fait est troublant et rend problématique la cohérence de nos engagements en faveur du progrès indéfini revendiqué par les Lumières. À l’heure où l’arrachement à la nature offre sa pleine mesure, grâce aux technologies, nous nous surprenons à paniquer et à nous découvrir bien moins enclins à la Modernité. Seuls les transhumanistes seraient en ce sens conséquents et dépasseraient la simple incantation moderniste, pour proclamer la nécessité de réfuter tout à fait la naturalité en nous » (p. 95).

– Voir un reportage (en anglais) sur l’athlète sud-africain Oscar Pistorius à l’entraînement, en 2012. Un autre reportage le montre pendant son procès, exhibant ses moignons à la demande de son avocat pour prouver sa vulnérabilité sans ses prothèses, ce qui correspond à la photo ci-dessus.
Les Animaux dénaturés de Vercors est évoqué p. 93, mais seulement pour en tirer une réflexion sur « L’indéfinition des frontières entre l’homme et l’animal ». L’auteur oublie que cette définition de l’homme cherchée par le protagoniste vise à empêcher des capitalistes d’employer les Tropis comme des animaux et non comme des hommes, donc comme des esclaves. Si l’on appliquait la réflexion de Vercors aux cyborgs ou aux clones, cela enrichirait la réflexion de J.-M. Besnier, en ce sens qu’un pouvoir quel qu’il soit, économique ou politique, pourrait produire des clones ou des cyborgs dans un but malsain. D’où l’intérêt de la science-fiction. Les réflexions de J.-M. Besnier sur l’écologie me semblent pertinentes : « Reste que la question se trouve posée du fait des outrances de l’écologie dite profonde : comment éviter que la défense de la Nature ne verse dans une religion de la Nature ? Comment la dégager d’une métaphysique portée à sacraliser la totalité, sous le nom de Nature ? » (p. 107). Il invoque alors Nietzsche et sa volonté de « dédiviniser » la nature, défi « tellement étranger aux adorateurs de Gaïa » (p. 109). C’est ce qui me semble en œuvre dans le délire « végan », mais le livre publié en 2009, ne les évoque pas nommément. P. 116, il évoque « les réactions fanatiques de ceux qui, pour battre en brèche l’anthropocentrisme des Modernes, réclament le retour aux attitudes archaïques de soumission à l’égard de la Nature, aux illusions animistes de toujours ou au désir mystique de symbiose avec le Grand Tout » (p. 116).
Qui est l’autre de l’homme ?
Dans le chapitre 5 « Un accablant désir de machine », on apprend que « Les Japonais misent sur la réalisation de robots androïdes pour compenser le vieillissement de leur population et pour s’épargner le recours à une immigration contraire à leur tradition d’isolement » (p. 120). Mais la réflexion vaut aussi pour nous (et pour une fois le propos est compréhensible !) : « Serait-ce donc que la perspective ouverte par la prolifération dans notre environnement de robots androïdes nous contraindrait à expérimenter le fait du caractère foncièrement instrumental des relations interindividuelles que notre monde nous porte désormais à entretenir ? Comme si l’on devait se dire qu’il y a déjà longtemps que notre rapport aux autres se trouve réduit à l’élémentaire, qu’il n’est guère plus riche que celui de la vieille femme solitaire avec son chat » (p. 123). L’homme se voit contester son originalité : « Ce qu’il croit encore pouvoir se réserver comme son privilège exclusif et qui ne relève pas, espère-t-on, d’automatismes (la poésie, l’humour, le sentiment esthétique ou amoureux, la foi religieuse…) lui est contesté chaque jour davantage par l’arrogance des sciences de la cognition. N’entendent-elles pas traduire en termes d’algorithmes la moindre de ses intuitions ou bien expliquer comme autant de mécanismes neuronaux ou hormonaux ce dont il était le plus fier ? » (p. 137). Le philosophe est sensible – chose rare – aux problèmes triviaux que le commun des mortels subit chaque jour : « Déjà, au quotidien, la frustration est grande pour l’usager des transports en commun auquel l’automate refuse inexplicablement de délivrer un billet, pour le client auquel un message téléphonique ordonne d’obéir à sa logique imbécile » ; « La technique est un facteur de mésestime de soi. Apparue pour compenser le défaut originel des hommes, elle se déploie tant et si bien qu’elle accroît en eux le sentiment de leur nullité » (pp. 137-8).
Le chapitre 6 « La défaite des identités » nous prévient d’un risque : « La mainmise de l’informatique sur notre quotidien, la promotion d’une société de la connaissance fondée sur l’essor des sciences et techniques d’information et de communication, ne nous mettent pas à l’abri de l’amnésie, loin s’en faut. L’oubli numérique, comme on le nomme, est déjà la hantise des ingénieurs qui redoutent qu’à moyen terme nous ne soyons plus capables de lire les fichiers électroniques sur lesquels nous avons enregistré ce que nous ne consignons plus dans les livres » (p. 145). Il a tellement raison, que 9 ans après ce livre, je n’ai pour ma part jamais entendu ou lu le moindre article s’inquiétant d’une quelconque forme de dépôt légal des publications sur des sites tels que celui sur lequel vous êtes en train de lire cet article, productions intellectuelles tellement minables qu’aucun édile n’a jamais pensé qu’il faudrait songer à en garder une trace. Eh oui, en 2018, on considère toujours qu’un catalogue de voyage ou un livre de Barbara Cartland est digne d’être conservé à la Bibliothèque nationale, mais que tous les articles de tou(te)s les blogueurs/euses sont destinés à ne pas même avoir existé lorsqu’ils mourront…
Besnier étend sa réflexion à « L’usager des technologies dites intelligentes [qui] s’accoutume et jouit même de cette dépossession qui le soulage de n’avoir pas à « retenir ». Ce faisant, il opte sans le savoir pour un régime qui implique la rupture de la continuité, laquelle façonnait l’affirmation de son identité. Le posthumain apparaît, là encore, comme disposé à écarter tout ce qui pouvait contribuer à construire délibérément la spécificité humaine. Témoin et bénéficiaire de notre démission devant le pouvoir des machines, il annonce une situation dans laquelle on acceptera d’oublier - non pas pour faire table rase et reconstruire ensuite, mais en se disant que ce qui demeurera, malgré tout, est seul ce qui méritait de survivre » (p. 146). L’ère des cyborgs aurait pour avantage « de nous débarrasser des oppositions et des hiérarchies toujours assujettissantes, en particulier pour les femmes », et de citer le Manifeste cyborg » (1984) de Donna Haraway. Dans le champ des études posthumaines, on « nous invite à percevoir des degrés là où l’on avait imposé des frontières. Et c’est là précisément que la question de l’identité menace de devenir insoluble : s’il n’y a plus de différence de nature entre l’homme, l’animal et la machine, mais de simples différences de degré entre des organisations plus ou moins complexes – et si l’intelligence est capable d’habiter peu ou prou chacun des niveaux de ces organisations – alors l’affirmation d’une identité qui séparera le même d’un autre apparaîtra arbitraire et violente. Sans doute devrions-nous, sachant cela, nous en remettre à la sagesse des bouddhistes qui sont convaincus de l’unité du Grand Tout et de la vanité des préjugés par lesquels nous nous prêtons une individualité irréductible » (p. 163). Il cite un livre d’entretiens réunis par Réda Benkirane : La Complexité, vertiges et promesses (2006) : « Si nous pouvions grâce aux capacités de calcul faire en sorte que les communautés soient reliées en temps réel, nous introduirions un niveau supplémentaire au sein de l’espèce humaine qui rendrait difficile la définition précise d’un être humain. Cela élargirait notre manière d’opérer en tant qu’espèce vivante. La vie artificielle peut réellement être pensée comme une étape supplémentaire dans le cours de l’évolution » (p. 171).
Le chapitre 7 « Le culte de l’émergence » évoque en passant les robots de sexe, phénomène qu’il trouve « plutôt alarmant » (p. 178), en s’appuyant sur un article du Monde publié en 2008 : « Faire l’amour en 2050 » : « Avoir des relations sexuelles avec un robot sera bientôt possible ». Article intéressant pour un corpus de BTS. En ce domaine, les craintes affichées par l’auteur sont révélatrices du problème que la sexualité pose décidément aux penseurs : nous verrons bientôt les propos alarmistes de Françoise Héritier sur la sexualité masculine. Pour une fois que les riches producteurs de Hollywood et directeurs de fonds monétaires pourront assouvir leur sexualité compulsive avec des robots et non avec des femmes de ménage ou des otaries (comme les désigne Mona Chollet), cela devrait être réjouissant, non ? Quant à l’impact de ces technologies qui font si peur, faut-il rappeler que la sous-alimentation touche actuellement 800 millions de personnes dans le monde ? Ce problème ne doit-il pas être résolu avant de s’inquiéter que des millions de personnes fassent l’acquisition de robots dont le coût excède celui de la nourriture nécessaire pour la durée de vie d’un être humain ?
André Leroi-Gourhan est cité p. 184 : « Dans Le Geste et la Parole, livre qui décrit l’Homo sapiens comme le résultat d’une triple acquisition – la station verticale, le dégagement de la main, et la maîtrise des outils et du langage –, il en vient à la question qui nous occupe : « Est-il possible de prolonger la trajectoire humaine ? » […] « on pourrait imaginer à long terme un changement majeur lié à la perte de l’usage de la main, à celles de la denture et de la station debout. Et Leroi-Gourhan s’aventure à imaginer une extinction de l’homme qui rencontre la représentation véhiculée par la figure contemporaine du cyborg : « Une humanité anodonte et qui vivrait couchée en utilisant ce qui lui resterait de membres antérieurs pour appuyer sur des boutons n’est pas complètement inconcevable et certains romans d’anticipation, à force de brasser toutes les formules possibles, ont créé des "Martiens" ou des "Vénusiens" qui se rapprochent de cet idéal évolutif » (p. 185). On songe aux Morlocks et aux Éloïs de H.-G. Wells. Le concept philosophique d’émergence est expliqué, attribué à Jean-Pierre Dupuy (Pour un catastrophisme éclairé, Seuil, 2002) : « la catastrophe est impossible avant qu’elle se réalise, mais quand elle le fait, elle projette dans le passé le possible qu’elle fut en réalité. C’est la structure même de l’émergence : imprévisible au moment où elle se produit – en ce sens, parfaitement « libre » –, elle impose qu’on l’insère comme une possibilité dans la trajectoire passée dont elle résulte nécessairement – en ce sens, parfaitement « déterminée » » (p. 199). Et l’émergence rejoint l’immaîtrise évoquée supra : « Ainsi le thème de l’émergence s’offre-t-il en toile de fond de cette effrayante aspiration à être débarrassé des oripeaux de l’humain. La science et la technique modernes ont perdu l’idéal cartésien de maîtrise qui les définissait. L’immaîtrise est le nouvel idéal régulateur et elle implique à terme l’annulation même de l’initiative humaine » (p. 199).
Conclusion de la conclusion : « De ce point de vue, les utopies posthumaines accomplissent la fonction critique de toute utopie : percer à jour les folies du monde réel, derrière l’imaginaire ou les fantasmes qu’il produit, afin d’orienter le présent vers un avenir désirable » (p. 208).
Voir en ligne : Article sur France Culture
© altersexualite.com 2018
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com