Accueil > Culture générale et expression en BTS > « De la musique avant toute chose ? » > Le Pianiste, livre de Wladyslaw Szpilman & film de Roman (...)
Quand il ne vous reste que la musique
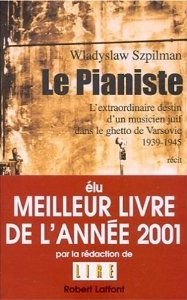 Le Pianiste, livre de Wladyslaw Szpilman & film de Roman Polanski
Le Pianiste, livre de Wladyslaw Szpilman & film de Roman Polanski
Robert Laffont, 2001 (1946), 270 p., 18,1 €
samedi 29 août 2020, par
Le Pianiste (1946 / 2001) de Wladyslaw Szpilman (1911-2000) est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « De la musique avant toute chose ? », ainsi que le film qu’en a tiré Polanski. Je l’ai choisi parce que je suis un admirateur de l’œuvre de Roman Polanski, et particulièrement de ce film, un chef-d’œuvre et l’un des plus grands films sur les persécutions nazies envers les juifs (la Shoah).
Wladyslaw Szpilman était un jeune virtuose du piano et compositeur prolifique, célèbre en Pologne mais peu connu en dehors de son pays. Seul de sa famille, il survécut par hasard et grâce à sa renommée de musicien, à l’extermination particulièrement méthodique des juifs du ghetto de Varsovie. Un « juste », c’est-à-dire un Allemand qui s’opposa au nazisme et sauva des juifs, fut le dernier à l’aider à survivre aux ultimes soubresauts de la guerre dans les ruines de Varsovie. Szpilman écrivit ce livre sans fioritures à chaud, juste après la guerre, ce qui explique sans doute la précision des détails et des dates, mais dans la Pologne communiste, cela ne plut guère. On imposa des changements au texte, et le livre fut oublié jusqu’à ce que le fils de l’auteur le fasse traduire peu avant la mort de son père, et que Roman Polanski en tire matière à son film, qui sortit malheureusement juste après la mort du pianiste.
Ce qui me fascine dans le film comme dans le livre, c’est la nature de anti-héros du personnage, non pas dans un sens ironique de subversion de l’héroïsme, mais dans le sens où quoi qu’il fasse, l’héroïsme du personnage se cantonne à survivre coûte que coûte, notamment à partir du moment où il se retrouve seul au monde sans sa famille, et donc sans personne pour qui se sacrifier. Le titre original du film était « Une ville meurt » ; c’est sans doute sous l’influence du scenario de Polanski, avec un rôle amplifié de la musique que le titre du film s’est imposé au livre, mais cela va de pair avec l’occultation du fait que Szpilman n’était pas seulement pianiste, mais aussi un compositeur populaire.
À la fin août 1939, les Allemands marchent sur la Pologne. L’auteur et sa famille se perçoivent comme Polonais, mais ne suivent pas le mouvement de certains qui quittent la ville pour tenter d’éviter l’irréparable. C’est la première d’une suite de décisions du même ordre par fatalisme, la famille puis l’auteur se laissant aller au gré de la tempête, avec pour seul gouvernail la maxime édictée par la mère : « quoi qu’il puisse nous arriver, il valait mieux l’endurer ensemble » : « S’aventurer hors de la cité ne servirait à rien ; si la mort m’attendait, je mourrais plus vite chez moi. Et puis il fallait que quelqu’un veille sur ma mère et mes sœurs. au cas où mon père et Henryk partiraient, me suis-je dit. Lorsque nous en avons discuté tous ensemble, cependant, il s’est avéré qu’ils avaient eux aussi choisi de demeurer sur place » (p. 20). Il se porte cependant volontaire pour creuser des tranchées autour de la ville, « afin d’empêcher l’avance des chars allemands » : « Le premier jour du chantier, un vieux Juif en caftan et chapeau orthodoxe pelletait la terre à côté de moi. Il s’activait avec une ferveur toute biblique, se battait avec son outil comme s’il s’était agi d’un ennemi mortel, l’écume aux lèvres, ses traits pâles ruisselant de sueur, son maigre corps secoué de frissons, tous les muscles douloureusement contractés » (p. 26). Il lui recommande de s’arrêter, mais le vieux explique : « J’ai une boutique en ville, moi ! ». C’est la première mention dans le livre du mot « Juif ». Il persiste à se rendre à la radio et à jouer du piano en direct : « Ce 23 septembre, donc, mon récital d’œuvres de Chopin a constitué l’ultime programme musical retransmis en direct de Varsovie. Pendant tout le temps que je jouais, les obus explosaient tout près du studio, des immeubles voisins étaient la proie des flammes. Dans ce vacarme, j’arrivais à peine à entendre mon piano. À la fin, j’ai dû attendre deux longues heures avant que le bombardement ne perde assez d’intensité pour me permettre de me risquer dehors. De retour à l’appartement, j’ai été accueilli par mes parents, mes sœurs et mon frère comme si je venais de me relever de ma tombe. Ils étaient persuadés que j’avais été tué. Notre bonne était la seule à juger que toute cette inquiétude n’avait pas de sens : « Il avait ses papiers sur lui, n’est-ce pas ? a-t-elle souligné ; s’il était mort, ils auraient vivement su où le transporter. »
Le même jour, à trois heures et quart de l’après-midi, Radio Pologne cessait d’émettre. Ils étaient en train de passer un enregistrement du Concerto pour piano en do majeur de Rakhmaninov, dont le deuxième mouvement empreint d’une beauté sereine venait juste de s’achever, lorsqu’une bombe allemande a détruit le transformateur électrique de la station. Dans toute la ville, les postes ont été réduits au silence » (p. 31). Varsovie capitule le 27 septembre, réduite à l’état de décombres, et les persécutions antisémites commencent : « Quelques jours plus tard, les murs de Varsovie se sont couverts d’une proclamation signée du commandement nazi. Rédigée en allemand et en polonais, elle promettait à la population le retour à une existence normale sous la protection du Reich. Un paragraphe était spécialement consacré aux Juifs, leur garantissant tous leurs droits et l’inviolabilité de leurs biens, ainsi que leur complète sécurité personnelle » (p. 34). Cela prend vite un tour concret : « Des voitures banalisées sillonnaient les rues, venant soudain se garer le long du trottoir dès qu’un Juif était en vue. Une portière s’ouvrait alors, une main surgissait dehors, l’index recourbé : « Toi, viens ! » À l’issue de ces enlèvements sommaires, leurs victimes faisaient le récit de ces premiers exemples de brutalités, qui se limitaient encore à des gifles, des horions, parfois des tabassages en règle. Mais en raison même de leur nouveauté ceux qui avaient subi ces traitements en étaient particulièrement révoltés, une claque reçue d’un Allemand étant jugée déshonorante : ils allaient mettre du temps à comprendre que ces gestes de violence n’avaient pas plus de signification morale que la ruade ou le coup de patte d’un animal » (p. 38). « Au cours de la seconde moitié de novembre, sans aucune explication préalable, les Allemands ont entrepris de condamner avec des fils barbelés les rues débouchant au nord de la rue Marszalkowska. Et puis, à la fin du mois, ils ont publié un communiqué auquel personne n’a été en mesure de croire tout d’abord, tant il dépassait ce que nous avions pu redouter dans nos appréhensions les plus secrètes. Les Juifs avaient jusqu’au 5 décembre pour se munir de brassards blancs sur lesquels une étoile de David devait être cousue en fil bleu. Notre statut de parias devait donc être proclamé aux yeux de tous. Plusieurs siècles de progrès allaient être effacés d’un seul coup : nous étions replongés en plein Moyen Âge » (p. 50). […] « C’est au pire moment de cette vague de froid que des centaines de Juifs déportés de l’ouest du pays ont commencé à arriver dans Varsovie. En fait, ils n’étaient qu’une minorité à y parvenir vivants. Entassés dans des wagons à bestiaux aux portes condamnées, ils restaient sans nourriture, ni boisson, ni couvertures pendant les jours entiers que ces terribles convois mettaient souvent pour atteindre la capitale » (p. 51).
Raffinement de cruauté, les Allemands confient l’organisation des persécutions à un « conseil juif » : « Les Allemands avaient préféré s’épargner ce souci, confiant cette tâche au Conseil juif en charge de l’administration communautaire. En clair, nous devions programmer nous-mêmes notre extermination, préparer notre ruine de nos propres mains. C’était une forme de suicide collectif légalement codifié. […] Le Conseil a décidé d’épargner la majeure partie de l’élite intellectuelle. À raison de mille zlotys par tête, il se chargeait d’envoyer un prolétaire juif à la place des personnes théoriquement enregistrées. Évidemment, cet argent ne finissait pas toujours dans la poche des malheureux supplétifs, loin de là : il fallait que les fonctionnaires du Conseil vivent, eux aussi. Et ils vivaient fort bien, ma foi, ne manquant jamais de vodka ni de quelques friandises à côté » (p. 52). Un beau passage illustre le rapport entre la musique et la réalité : « Le 20 mai, un de mes collègues, un violoniste, est arrivé chez nous après le déjeuner. Nous nous disposions à jouer une sonate de Beethoven que nous n’avions pas exécutée ensemble depuis longtemps, ce qui nous procurait à l’avance un grand plaisir. D’autres amis étaient là aussi, et Mère, désireuse de me rendre le moment encore plus agréable, avait réussi à trouver du café. C’était une belle journée ensoleillée. Nous étions tous d’excellente humeur, savourant le café et les délicieux gâteaux qu’elle avait préparés. Nous savions que les Allemands étaient aux portes de Paris mais personne ne s’en inquiétait vraiment – la Marne était là, après tout, cette ligne de défense immuable sur laquelle tous les mouvements viennent s’immobiliser, tout comme dans le point d’orgue de la deuxième partie du scherzo en si mineur de Chopin, lorsque la vague tempétueuse des croches finit par mourir sur l’accord final… À ce point, les Allemands reflueraient vers leur frontière aussi rapidement qu’ils avaient avancé, annonçant la fin du conflit et la victoire des Alliés.
Après le café, nous nous sommes disposés à jouer. Je me suis installé au piano, entouré par des connaisseurs, tout un auditoire capable de goûter le ravissement que j’avais l’intention de faire naître en eux-mêmes comme en moi. Le violoniste est venu se placer à ma droite. À ma gauche s’est assise une charmante jeune fille, une amie de Regina qui se disposait à tourner les pages de la partition pour moi. Qu’aurais-je pu souhaiter de plus pour atteindre au parfait bonheur à ce moment ? Nous n’attendions plus que ma sœur Halina, qui était descendue au magasin passer un appel téléphonique. Quand elle est revenue, elle tenait un journal entre ses mains. Une édition spéciale, dont la une était barrée de deux mots en énormes caractères, sans doute les plus gros qu’ils aient eus à l’imprimerie : « PARIS EST TOMBÉ ! ».
J’ai posé mon front sur le clavier et, pour la première fois depuis le début de cette guerre, j’ai fondu en larmes » (p. 54).
Voici ce scherzo de Chopin interprété par David Kadouch avec ce commentaire de France musique : « [Chopin] fait du scherzo une œuvre poétique et dramatique, loin du mouvement de scherzo beethovénien ou classique (conçu comme un “divertissement”). Le premier scherzo, qui commence Presto con fuoco, en est un parfait exemple : après deux accords joués fortissimo, c’est un déluge de montées-descentes frénétiques, plein de force dramatique. La partie centrale Molto piu lento, jouée en si majeur, est un retour au calme temporaire avant la reprise du thème qui vaut à ce Scherzo le surnom de “Banquet infernal”. » À nous de voir si la métaphore de Szpilman est pertinente.
En novembre, c’est la mise en place du ghetto : « des panneaux sont apparus à l’entrée des rues qui allaient marquer par la suite les limites du ghetto juif, annonçant aux passants que ces artères étaient contaminées par le typhus et devaient donc être évitées. Un peu plus tard, l’unique quotidien en langue polonaise publié par les Allemands à Varsovie allait dispenser le commentaire officiel à ce sujet. Non contents d’être des parasites sociaux, les Juifs étaient aussi des agents de contamination. Mais ils n’allaient pas être enfermés dans un ghetto, non, précisait l’article ; ce terme lui-même ne devait pas être utilisé, les Allemands constituant une race bien trop cultivée et généreuse pour confiner les Juifs, aussi parasitaires et néfastes fussent-ils, dans un espace dont l’idée remontait au Moyen Âge et qui n’avait donc plus sa place au sein de l’« ordre nouveau » européen. Par contre, un quartier séparé allait être défini dans la ville, réservé aux Juifs, où ils bénéficieraient d’une liberté totale et pourraient continuer à pratiquer les coutumes de leur race. Et si cette zone devait être entourée d’un mur, c’était uniquement par précaution hygiénique, afin d’empêcher le typhus et d’autres « maladies juives » de se répandre dans le reste de la cité. Cette charitable mise au point était accompagnée d’une petite carte qui reproduisait les frontières précises du futur ghetto. » Résultat : « Un demi-million de personnes étaient soudain à la recherche d’un toit dans une partie déjà surpeuplée de la capitale, qui pouvait difficilement accueillir plus de cent mille habitants » (p. 56).

Le typhus et les autres maladies sont d’autant plus redoutables que les gens sont confinés, ce qui nous renvoie à l’expérience du Coronavirus en 2020 : « En comparaison, la surpopulation du Petit Ghetto n’atteignait pas un degré aussi critique : trois ou quatre personnes s’y partageaient une pièce et avec un peu de dextérité il était encore possible de circuler dehors sans entrer en collision avec d’autres piétons. Et même si tous les détours et louvoiements ne leur épargnaient finalement pas un contact physique, l’expérience n’était pas trop dangereuse car la majorité des habitants étaient des intellectuels ou des bourgeois relativement prospères, c’est-à-dire moins susceptibles d’être couverts de vermine et déterminés à éliminer les poux que chacun ramenait de la moindre incursion dans le Grand Ghetto » (p. 65).
Le goulot d’étranglement pour traverser une rue empruntée par les non-juifs, est l’occasion d’un sinistre divertissement de la soldatesque nazie : « Plus l’attroupement grossissait, plus son agitation et sa nervosité s’intensifiaient. Tous savaient que les gardes allemands s’ennuyaient à ce poste, qu’ils étaient à l’affût de la moindre distraction. Ils aimaient particulièrement organiser une sorte de bal sinistre. D’abord, ils allaient chercher des musiciens dans les ruelles latérales : avec la misère générale, en effet, les petits orchestres de rue s’étaient multipliés. Ensuite, ils choisissaient dans la foule ceux dont ils trouvaient l’allure particulièrement comique et leur ordonnaient de danser la valse devant eux. Alors les musiciens s’installaient au pied d’un immeuble, les policiers faisaient dégager une portion de trottoir et l’un d’eux adoptait le rôle de chef d’orchestre en frappant les interprètes s’ils avisaient de ne pas jouer assez vite, tandis que les autres contemplaient ce spectacle donné sous la contrainte. Des couples d’infirmes, de vieillards, de personnes très corpulentes alliées à d’autres d’une maigreur extrême se mettaient à virevolter sous les yeux horrifiés de la foule. Si quelqu’un était exceptionnellement grand, il était sûr de se voir imposer pour partenaire un nabot, ou un enfant. Autour de la « piste de danse », les Allemands hurlaient de rire en criant : « Plus vite ! Allez, encore plus vite ! Tout le monde doit danser ! »
Qu’ils jugent spécialement hilarant ces pauvres hères grotesquement appariés et ils les forçaient à continuer, encore et encore. Et alors qu’ils perdaient une fois l’opportunité de traverser, puis deux, puis trois, les malheureux danseurs étaient contraints de s’agiter au rythme de la valse, hors d’haleine, pleurant de fatigue, luttant pour ne pas tomber, espérant vainement un geste de miséricorde » (p. 66). Un passage fidèlement reproduit dans le film, en moins cruel, et qui fait aussi penser au film On achève bien les chevaux (1969) de Sydney Pollack.

La musique fournit au narrateur un moyen de subsister : « Ma carrière de pianiste en temps de guerre a débuté au Café Nowoczesna, rue Nowolipki. Aussi dérisoire qu’elle m’ait semblé, la vie avait fini par me tirer de ma léthargie, me forçant à chercher un moyen de gagner de quoi subsister. Et j’en avais trouvé un, grâce au Ciel. Mon travail ne me donnait guère le loisir de broyer du noir, et puis de savoir que la survie de tous mes proches dépendait de mes maigres cachets d’interprète m’a conduit à surmonter peu à peu le désespoir sans fond dans lequel j’avais sombré » (p. 75). Dans ce café il est aux premières loges pour observer les profiteurs de guerre : « Le ghetto n’avait pas besoin de ce trafic pour survivre, en réalité. La plupart des sacs et des colis qui transitaient par le mur étaient des dons dispensés par des Polonais aux plus démunis des Juifs. La véritable contrebande, celle à grande échelle, était contrôlée par des hommes puissants, des magnats du marché noir tels que Kon ou Heller. Leurs opérations étaient bien moins risquées, pratiquement sans danger : en temps voulu, des gardes préalablement achetés regardaient ailleurs tandis que des colonnes entières de chariots passaient la porte du ghetto sous leur nez. Avec leur agrément tacite, nourriture, alcools de prix, victuailles des plus raffinées, tabac arrivé tout droit de Grèce, fanfreluches et parfums français étaient ainsi introduits sans encombre.
J’étais bien placé pour les voir tous les jours, ces articles coûteux. Le Café Nowoczesna n’était en effet fréquenté que par les richards et leurs cavalières couvertes de diamants et de bijoux en or. Au son des bouchons de champagne fusant en l’air, des grues outrageusement maquillées vendaient leurs charmes aux profiteurs de guerre installés devant des tables bien garnies. C’est ici que j’allais perdre deux de mes grandes illusions : celle que nous étions tous solidaires face à l’adversité, et celle que tous les Juifs savaient apprécier la musique » (p. 78). « Au Nowoczesna, personne ne prêtait la moindre attention à ce que je jouais. Plus je tapais sur mon piano, plus les convives élevaient la voix tout en s’empiffrant et en trinquant. Chaque soir, entre mon public et moi, c’était une lutte ouverte à qui arriverait à imposer son vacarme sur l’autre. Une fois, un client a même envoyé un serveur me demander de m’interrompre un instant parce que je l’empêchais d’éprouver la qualité des pièces de vingt dollars-or que l’un de ses commensaux venait de lui vendre. Il les faisait doucement tinter contre le guéridon en marbre, les portait à son oreille entre deux doigts et écoutait intensément la manière dont ils sonnaient, seule et unique musique agréable à son oreille » (p. 79). Encore un passage fidèlement retranscrit dans le film, au risque d’une interprétation antisémite.
Le typhus fait des ravages, colporté par des poux, et Szpilman raconte la légende du Dr Weigel (en fait Rudolf Weigl) qui mit fin aux ravages du typhus et sauva des Polonais et des juifs. Mais avant cela, « Le typhus en est arrivé à emporter près de 5000 habitants tous les mois » (p. 82). Cela me rappelle le chapitre du livre du Pr Raoult sur le typhus au Burundi. Il n’y a pas que les profiteurs de guerre : « Quand il avait refusé d’entrer dans les forces policières juives, soutenant que c’était un repaire de bandits, Henryk avait eu entièrement raison. Les jeunes recrues étaient pour la plupart issues des milieux les plus aisés et plusieurs de nos relations en faisaient partie. Le choc n’en a donc été que plus grand lorsque nous avons vu ces hommes dont nous serrions jadis la main et qui hier encore jouissaient d’une bonne réputation, se conduire désormais de façon aussi méprisable. On aurait dit que la mentalité gestapiste était devenue une seconde nature chez eux. Il suffisait qu’ils endossent leur uniforme et empoignent leur matraque en caoutchouc pour changer du tout au tout. Ils n’avaient plus d’autre ambition que de travailler avec la Gestapo, de complaire à ses officiers, de parader dans les rues avec eux, de faire montre de leur maîtrise de la langue allemande et de rivaliser avec leurs maîtres dès qu’il s’agissait d’accabler la population juive. Ce qui ne les avait pas empêchés de constituer un orchestre de jazz de la police, lequel, entre parenthèses, était d’excellent niveau… » (p. 91). Polanski va amalgamer ces éléments dans son scénario : le responsable de la police juif à tête d’aryen vient proposer à Wladeck et Henryk d’intégrer sa police, et l’orchestre en question, et ce sera lui qui sauvera Wladeck de la déportation en le tirant du convoi.
Les Allemands tournent des films de propagande pour faire croire que les juifs sont bien traités, voire qu’ils se livrent à la débauche : « ils ont même conduit un troupeau de femmes et d’hommes aux bains publics, les ont forcés à se déshabiller et à se laver tous ensemble, et cette scène très étonnante a été filmée dans ses moindres détails » (p. 95). L’été 42 marque la fin de la survie aux apparences de normalité : « À cette époque, nous projetions Goldfeder et moi d’organiser un concert en matinée qui marquerait le premier anniversaire de la formation de notre duo. Il était prévu pour le samedi 25 juillet 1942, dans les jardins du Sztuka. Pleins d’optimisme et entièrement accaparés par ce projet que nous nous étions donné tant de mal à préparer, nous refusions tout bonnement l’idée qu’il puisse ne pas se tenir. Alors que si peu de temps nous en séparait, nous avons préféré croire que ces rumeurs allaient se révéler une nouvelle fois sans aucun fondement. Le 19 juillet, un dimanche, j’ai joué encore une fois en plein air, dans le patio d’un café de la rue Nowolipki, sans me douter un seul instant que ce serait mon dernier concert de l’ère du ghetto. Il y avait foule, certes, mais l’humeur générale était plutôt sombre » (p. 101). Le narrateur dénonce le rôle des fascistes ukrainiens et lituaniens particulièrement barbares : « Toute guerre fait émerger au sein des minorités nationales une fraction trop lâche pour se battre ouvertement, trop inconsistante pour jouer un quelconque rôle politique, mais assez veule pour se transformer en bourreaux stipendiés par l’une ou l’autre des puissances du conflit. Au cours de celle-ci, ce sont les fascistes ukrainiens et lituaniens qui ont occupé cette place » (p. 110 ; c’est un des aspects censurés par les communistes lors de la parution du livre en 1946, et rétabli pour cette traduction). La barbarie peut arborer le masque du cynisme le plus cruel, et c’est une des plus bouleversantes pages, où la musique joue un rôle, et où pour une fois l’auteur commente son récit par une ironie du désespoir.
« Un peu plus tard, vers le 5 du même mois [août 42], je descendais la rue Gesia à la faveur d’une courte pause dans mon travail quand j’ai vu Janusz Korczak et ses orphelins quitter le ghetto.
L’évacuation des orphelinats créés par ce grand philanthrope venait d’être ordonnée et les Allemands entendaient que les enfants partent seuls. Korczak, qui avait déjà été assez fortuné pour rester en vie, avait réussi à les persuader de l’arrêter, lui aussi. Après avoir passé tant d’années avec ses petits protégés, il ne voulait pas les abandonner dans cet ultime voyage. Et comme il entendait leur rendre l’épreuve moins difficile il leur avait expliqué qu’il s’agissait d’une excursion à la campagne, qu’ils allaient enfin sortir des murs étouffants du ghetto pour découvrir des prairies en fleurs, des ruisseaux où ils pourraient se baigner, des bois remplis de groseilles et de champignons… Il leur avait recommandé de revêtir leurs plus beaux habits et c’est ainsi qu’ils sont apparus sous mes yeux, deux par deux, bien habillés et le cœur en fête.
La petite colonne était emmenée par un SS qui en bon Allemand aimait les enfants, même ceux qu’il conduisait dans l’autre monde. Il avait été particulièrement charmé par un garçon d’une douzaine d’années, un jeune violoniste qui avait pris son instrument sous le bras. Il lui a demandé de se placer en tête de la procession et de jouer des airs entraînants. C’est de cette manière qu’ils se sont mis en route. Lorsque je les ai croisés rue Gesia, les bambins ravis chantaient tous en chœur, accompagnés par le petit violoniste. Korczak portait deux des plus jeunes orphelins, lesquels rayonnaient aussi tandis qu’il leur racontait quelque conte merveilleux.
Je suis certain que même bien plus tard, au camp, lorsque le gaz zyklon B commençait à attaquer leurs poumons et qu’une terreur indicible succédait soudain à l’espoir, je suis certain que « Papy Docteur » a dû parvenir à leur murmurer, dans un dernier effort : « Tout va bien, les enfants, tout ira bien », et qu’il a au moins essayé d’épargner aux petits dont il avait la charge l’approche effrayante de la mort » (p. 114).
La scène qui précède n’a pas été retenue dans le scénario du film, alors qu’elle aurait été très cinématographique, mais lui-même orphelin rescapé à Cracovie, peut-être le réalisateur a-t-il voulu éviter une trop forte implication ? Je note pour mémoire quelques exemples de la plus extrême violence, car il faut se souvenir que les hommes sont capables de cela : « Des cadavres étaient allongés là. […] Des hommes, surtout, mais on voyait aussi une jeune femme et deux petites filles, toutes les trois avec le crâne affreusement ouvert. Le mur qui les surplombait portait des traces de sang et de matière cervicale séchée. Celles-là avaient été assassinées selon une méthode chère aux occupants nazis : tenues par les jambes et projetées la tête la première contre les briques. De grosses mouches noires s’affairaient sur les flaques sanguinolentes à terre et sur les corps qui semblaient enfler et pourrir à vue d’œil dans cette chaleur » (p. 117). L’objectivité réaliste est ici je pense, la politesse du désespoir. Le « on voyait » qui est souvent une maladresse de narration, prend ici un sens très fort. Les juifs sont raflés les uns après les autres, et malgré quelques faveurs dues à son réseau amical, qu’il partage toujours avec sa famille unie, leur tour vient d’être amenés à la gare. Scène émouvante minimaliste : « En réunissant nos dernières petites pièces, nous n’avons pu lui acheter qu’un seul caramel à la crème. Père l’a découpé en six parts avec son couteau de poche. C’est le dernier repas que nous avons pris tous ensemble » (p. 123).

Le « on voyait » trouve son équivalent dans le film par une utilisation du Steadicam lors de la scène après la rafle, dans l’attente du train, qui n’est pas sans rappeler le plan-séquence historique de En route pour la gloire de Hal Ashby suivant David Carradine parmi la foule des travailleurs. Quelques instants plus tard, alors que la famille est poussée avec la foule dans des wagons qui puent le chlore : « Nous étions environ à mi-chemin de la voie lorsque j’ai entendu soudain crier : « Hé ! Szpilman, par ici, par ici ! » Quelqu’un m’a attrapé par le collet et m’a tiré sans ménagement de l’autre côté du cordon de policiers. Qui avait osé ? Je ne voulais pas être séparé de ma famille. Je voulais rester avec eux ! » (p. 125). Il ne saura jamais qui l’a sauvé, mais on se doute que c’est là encore sa renommée qui a joué son rôle d’ange gardien. Le film propose une réponse : c’est le chef de la police juive, qui le tire brusquement du convoi et de son apathie, sans un mot de trop. Le narrateur est désormais seul au monde, sans aucune famille : « J’ai pivoté sur moi-même et je suis parti en chancelant devant moi, dans la rue déserte, secoué de sanglots, poursuivi par les cris étouffés de tous ces êtres enfermés dans le train. On aurait cru le pépiement oppressé d’oiseaux en cage qui sentent un danger mortel fondre sur eux » (p. 126). En plus d’un plan dans la rue déserte mais jonchée de meubles abandonnés, symboles par excellence depuis toujours de la tragédie de la diaspora juive, le film ajoute une autre idée : il le montre découvrant toute une famille massacrée jonchant le sol, et lui avec son brassard, abasourdi. Ces meubles abandonnés me rappellent le spectacle Un violon sur le toit vu à Berlin, et d’ailleurs la seule musique juive du film, quand le fou amuse les soldats nazis, m’y a fait penser aussi (musique traditionnelle Klezmer). À ce point de la tragédie, ce sont les juifs eux-mêmes qui sont réduits à l’état de meubles.
Le narrateur trouve un emploi comme terrassier en dehors du ghetto, ce qui lui donne l’occasion d’être reconnu par plusieurs personnes qui lui apportent spontanément aide ou soutien, malgré les risques. Un juif qui grâce à son physique « aryen » est passé inaperçu, et le directeur de l’orchestre philharmonique de Varsovie, qui lui dit la vérité sur sa famille : « Vous ne les reverrez plus jamais » (p. 132). « En quelques mots, il avait fait voler en éclats l’édifice trompeur que je m’étais acharné à maintenir sur pied. C’est seulement bien plus tard que je suis arrivé à reconnaître qu’il avait eu raison de me parler ainsi : la perte de mes illusions, la reconnaissance de l’inéluctabilité de la mort m’ont conféré l’énergie nécessaire pour que je parvienne à survivre au moment critique » (p. 133).
La scène du chantier dans le film me semble faire allusion à la tour de Babel. Les ouvriers « briquètent des briques » selon la formule de la Bible et les hissent sur les échafaudages du bâtiment. Une des rares allusions (enfin selon mon interprétation) à la religion juive dans ce film et ce livre. Il faut dire que le livre étant paru initialement en Pologne communiste, la religion devait sans doute en être écartée. La confusion des langues est à l’œuvre dans ce film : les personnages s’expriment en anglais, sauf les nazis en allemand, et le narrateur aussi quand il parle avec le capitaine. La présence du polonais est rare, par exemple une inscription bilingue dans le tramway, pour interdire la partie réservée aux Allemands.

L’insurrection du ghetto
Le narrateur comme sans y penser, participe à l’insurrection du ghetto : « Si elles étaient fondées, cela signifiait que les Allemands poursuivaient notre complète extermination : nous n’étions que soixante mille environ à être restés à Varsovie, alors quel besoin auraient-ils eu de déporter encore un groupe aussi restreint ? L’idée d’une résistance organisée était de plus en plus fréquemment évoquée. Les jeunes, en particulier, étaient décidés à se battre. Ici et là, des tentatives ont été menées de fortifier en secret des immeubles du ghetto qui pourraient servir de bastions au cas où le pire devrait se produire. Il faut croire que les nazis ont eu vent de ces préparatifs puisqu’ils se sont empressés d’annoncer par voie d’affiche qu’aucune opération d’évacuation ne serait menée. C’était ce que nous répétaient aussi nos gardes chaque jour, et pour se montrer encore plus convaincants ils nous ont officiellement autorisés à acheter cinq kilos de pommes de terre et une miche de pain par personne dans la partie « aryenne » de la ville pour les rapporter dans le ghetto. Leur bienveillance est allée jusqu’à permettre à un représentant de notre groupe de se déplacer librement afin de réaliser ces achats pour nous tous. Nous avons choisi un garçon courageux qui répondait au sobriquet de « Majorek », le Petit Major. Les Allemands ne se doutaient pas que, sur nos instructions, il allait établir le contact entre le mouvement de résistance clandestine du ghetto et les organisations polonaises antinazies à l’extérieur » (p. 142). « Bientôt, les premiers actes de représailles se sont produits dans le ghetto, avant tout contre les collaborateurs et les éléments corrompus de notre communauté. L’un des plus sinistres officiers de la police juive, Lejkin, a été abattu. Il était tristement connu pour le zèle qu’il mettait à traquer ses coreligionnaires et à livrer son quota de victimes à l’Umschlagplatz. Peu après, un certain First, l’homme de liaison entre la Gestapo et le Conseil du ghetto, recevait la mort des mains de partisans juifs. Les traîtres parmi nous ont appris ce qu’était la peur » (p. 143). À la Saint-Sylvestre 1943, un officier nazi particulièrement brutal surnommé Tchic-Tchac, ivre, donne des ordres absurdes (mais potentiellement tragiques) : « Alors que nous avions reformé les rangs, il nous a lancé encore un autre ordre inattendu : « Chantez ! » Nous l’avons observé, surpris. Il a manqué perdre l’équilibre, s’est rétabli en lâchant un rot sonore ; « Chantez quelque chose de gai ! » Très amusé par sa plaisanterie, il a commencé à s’éloigner. Soudain, il s’est arrêté et il nous a invectivés, d’un ton menaçant : « Et chantez bien, et chantez fort ! »
Je ne sais pas qui a été le premier à entonner l’air, ni pourquoi c’est cette chanson de soldat qui lui est venue à l’esprit. En tout cas, nous avons joint notre voix à la sienne. Le principal était d’obéir.
C’est seulement aujourd’hui, en repensant à la scène, que je m’aperçois à quel point le cocasse se mêle souvent à la tragédie. Car en cette nuit de réveillon une poignée de Juifs exténués descendaient les rues d’une cité où les manifestations de patriotisme polonais étaient punies de mort depuis des années en chantant à pleins poumons, et en toute impunité, l’hymne si évocateur de la conscience nationale polonaise : « Hej, strzelcy wraz ! », « Ohé, francs tireurs, debout ! » » (p. 146). Scène transcrite dans le film, avec une chanson en langue anglaise, mais dont les paroles sont dûment traduites par les sous-titres, sur fond de convoi de juifs dans la neige, avec les ombres des Allemands. Comme incidemment, le narrateur participe à l’insurrection, en se cachant derrière le groupe : « Mon groupe y participait aussi : Majorek, qui nous rapportait chaque jour de la ville des sacs de pommes de terre, dissimulait sous les légumes des munitions que nous répartissions entre nous et que nous faisions entrer dans le ghetto cachées sous le pantalon, le long des jambes. C’était là un risque très sérieux, qui un jour a failli se terminer en tragédie pour nous tous » (p. 148). Suit une anecdote où effectivement, le narrateur a senti le vent du boulet, comme on dit, anecdote reprise dans le film, mais Polanski accentue ici l’héroïsme du personnage, peut-être pour renforcer le contraste avec la période de clandestinité, où il vit les choses en spectateur. Une nouvelle anecdote de violence brutale et gratuite précède juste une des premières révoltes, et chose rare, elle est suivie d’une réflexion digne de Hannah Arendt sur la banalité du mal : « Un garçon d’une dizaine d’années est passé en courant sur le trottoir. Il était très pâle, et si effrayé qu’il en a oublié d’enlever sa casquette devant un policier allemand qui arrivait en sens inverse. Celui-ci s’est arrêté et, sans articuler un mot, il a sorti son pistolet, l’a braqué contre la tempe du petit et a fait feu. Le gamin est tombé, les bras agités de soubresauts, puis tout son corps s’est raidi et il a expiré. Imperturbable, l’Allemand a remis son arme à la ceinture avant de poursuivre sa route. Je l’ai observé de là où je me trouvais. Il n’avait pas les traits d’une brute endurcie, ni même l’air d’être en colère. C’était un homme « normal », posé, qui venait d’accomplir l’une de ses multiples tâches quotidiennes et l’avait aussitôt éliminée de son esprit car des missions autrement plus importantes l’attendaient…
Nous étions déjà de l’autre côté lorsqu’une fusillade a éclaté derrière nous. Pour la première fois, c’étaient des groupes d’ouvriers juifs qui, sur le point d’être encerclés dans le ghetto, répondaient à la terreur nazie par les armes » (p. 151). « Dans d’autres immeubles, les habitants s’étaient sommairement barricadés et avaient accueilli les SS par un feu nourri, décidés à périr l’arme à la main et non dans les chambres à gaz. À l’hôpital juif, les nazis avaient traîné dehors les malades à peine vêtus, les avaient entassés dans des camions à ridelles, en plein froid, et les avaient envoyés à Treblinka. Mais grâce à cette première manifestation de résistance juive organisée ils n’ont pu rafler qu’environ cinq mille personnes en l’espace de cinq jours, soit la moitié seulement du nombre qu’ils s’étaient fixé » (p. 152).
Du confinement au déconfinement
L’avant-dernière étape de la descente aux enfers de Szpilman commence le 13 février 1943 : grâce à des musiciens polonais résistants qui risquent leur vie pour aider des juifs, il entame une vie de cachettes, de logement en logement. C’est la première fois qu’il retire son brassard de juif, et marche vite dans l’obscurité en espérant « ne pas croiser un Allemand au pied d’un réverbère, pour le cas où il apercevrait mes traits » (p. 154). Au début, il est logé successivement chez les uns ou les autres, tous d’anciens amis comme le directeur de la radio, ou amis d’amis. Chez l’un d’eux, très brève scène émouvante : « Peu après, mes mains se posaient sur un clavier pour la première fois en l’espace de sept mois. Sept mois au cours desquels j’avais perdu tous les êtres aimés, survécu à la liquidation du ghetto et aidé à démolir ses murs en coltinant de la chaux et des briques… J’avais d’abord résisté aux invites de Mme Gebsczynska mais j’ai finalement cédé : mes doigts gourds ont parcouru péniblement les touches, produisant des sons qui m’ont semblé étranges, irritants » (p. 157). Dans la cache suivante, il ne doit pas faire le moindre bruit, car il entend toutes les disputes des voisins de palier qui doivent ignorer son existence ; passage fidèlement transcrit dans le film : « Après un quart d’heure de parfaite harmonie conjugale, cependant, le temps tournait à l’orage, la discorde éclatait et leur collection d’épithètes commençait à s’étendre à d’autres espèces animales pour finir invariablement avec le porc. À ce stade, une réconciliation devait se produire puisque le silence régnait un moment. Ensuite, je percevais une troisième voix, celle du piano sur lequel la jeune femme se mettait à taper avec entrain et un nombre respectable de fausses notes. Mais ce pianotage ne durait pas très longtemps, non plus, car bientôt s’élevaient des reproches ulcérés : « Ah ! d’accord, très bien, je ne joue plus, alors ! Tu n’écoutes jamais quand je fais de la musique ! » Et la querelle reprenait de plus belle, et désormais c’étaient des noms d’oiseaux qui pleuvaient…
En les écoutant, j’ai souvent pensé avec tristesse que j’aurais tant donné pour le bonheur de m’asseoir devant ce vieil instrument désaccordé qui était la cause de toutes ces scènes de ménage, à côté » (p. 160). Wladeck apprend la suite de l’insurrection par les journaux, ce que modifie Polanski : il y assiste en spectateur impuissant depuis la fenêtre de sa cache, et en tire une culpabilité dont il témoigne à la Polonaise résistante qui le ravitaille, laquelle lui dit que le sacrifice de ces juifs va encourager les Polonais à suivre leur exemple. Dans une cachette, il survit dix jours avec une miche de pain en attendant le retour de ses sauveteurs, qui ne pouvaient pas approcher de l’immeuble. Un jeune homme trahit sa confiance en n’assurant pas sa charge d’approvisionnement, et en faisant une quête pour le pianiste, dont il s’approprie le revenu. Encore heureux que cela rapporte plus que de le vendre aux nazis ! Le sort de ce traître n’est pas précisé, mais en principe il n’y avait pas photo ! Sa présence ayant été décelée par les voisins qui tambourinent à la porte et lui demandent ses papiers (scène amplifiée dans le film car une femme l’identifie comme juif et veut l’arrêter), il doit fuir précipitamment la cache, au mois d’août. Il dissimule son état hirsute et ses traits sémites et se décide à tenter sa chance chez d’anciens amis (alors que dans le film il se présente à une adresse notée sur un papier « en cas d’urgence »). Nouvelle cache, cette fois au cœur du quartier des officiers allemands, en face de leur hôpital. Il est soigné d’une jaunisse par un médecin résistant, et tâche de supporter ce confinement strict de presque deux années (qui relativise celui que l’on nous imposa en 2020) en réglant ses journées comme du papier à musique : « Je tenais absolument à mener une vie aussi régulière que possible : le matin, de neuf à onze heures, je travaillais mon anglais puis je lisais deux heures ; ensuite, je me préparais à déjeuner et de nouveau c’était l’apprentissage de la langue de Shakespeare et la lecture jusqu’à la tombée de la nuit » (p. 173).

Les affres de la faim sont subsumées par cette nature morte à la pomme de terre, qui me rappelle un tableau vu au musée des Beaux-Arts de Dijon : Le Repas des humbles, de Laurent Adenot.

C’est depuis cette cache qu’il assiste en spectateur impuissant aux derniers soubresauts de la guerre, avec toujours la barbarie des Ukrainiens qui assouvissent aveuglément leur soif de sang (p. 193). Cela dure encore plusieurs mois jusque fin 1944. L’immeuble où il est caché brûle alors qu’il ne peut en sortir. Il croit mourir, avale des comprimés, mais se réveille vivant, épargné par miracle dans l’immeuble calciné. Il en sort, se réfugie dans l’hôpital déserté, puis retourne se cacher dans le grenier de son ancien immeuble. C’était le chapitre éponyme de l’ancien titre : « Une ville meurt ». « Novembre approchant, le froid s’est installé, notamment la nuit. Pour ne pas basculer dans la folie, j’ai résolu de me fixer une discipline de vie immuable. J’avais gardé mes deux seuls trésors, mon stylo à encre et ma montre Oméga d’avant-guerre que je chérissais comme la prunelle de mes yeux, la remontant scrupuleusement pour qu’elle m’aide à respecter mon emploi du temps intangible. En fait, je passais toutes mes journées allongé afin d’économiser mes faibles forces, ne sortant de mon immobilité qu’à midi, pour prendre une biscotte et une tasse d’eau, en veillant à économiser au maximum mes réserves. Du matin jusqu’à cette maigre collation, je restais les yeux fermés, à repasser dans ma tête toutes les partitions que j’avais pu exécuter dans ma vie, mesure par mesure, ligne par ligne. Cet exercice mnémotechnique allait s’avérer fort utile par la suite : lorsque j’ai recommencé à travailler après-guerre, je connaissais toujours mon répertoire et j’avais même mémorisé des œuvres entières, comme si je n’avais cessé de pratiquer la musique pendant toutes ces années. Ensuite, de midi au crépuscule, je concentrais mon esprit sur les livres que j’avais lus, je répétais en moi-même des listes de vocabulaire anglais, je me dispensais des cours muets en cette langue, me posant des questions et essayant d’y répondre sans faute » (p. 196). C’est en cherchant de la nourriture dans un des immeubles de la rue dévastée que Wladeck est surpris par un officier allemand, et c’est la scène-clé, que je donne en intégralité (ch. 17 et 18, pp. 206 sq.) :
« Au bout de deux jours, je suis parti en quête de vivres. Cette fois, j’avais l’intention de m’en procurer en quantité suffisante pour ne pas avoir à ressortir de ma cachette trop souvent. Je devais mener mes recherches en plein jour car les lieux ne m’étaient pas encore très familiers et sans lumière j’aurais fini par me perdre. Dans l’une des cuisines, j’ai trouvé un placard qui contenait plusieurs boîtes de conserve, ainsi que des boîtes et des sacs dont j’ai entrepris d’inspecter le contenu avec soin. Très absorbé à dénouer des cordes et à dévisser des couvercles, je n’ai rien entendu jusqu’à ce qu’une voix s’élève soudain, juste dans mon dos.
– Mais qu’est-ce que vous fabriquez ici ?
Un officier allemand était adossé au comptoir de la cuisine, les bras croisés sur la poitrine. Il était grand, avec beaucoup de prestance.
– Que faites-vous là ? a-t-il répété à voix basse. Alors vous ne savez pas que l’état-major des forces spéciales de Varsovie doit s’installer dans ce bâtiment d’un jour à l’autre ?
Je me suis laissé tomber sur la chaise qui se trouvait près du placard. Je sentais brusquement, avec la certitude instinctive du somnambule, que mes forces me trahiraient si je tentais d’échapper à ce nouveau coup du sort. Alors je suis resté à ma place, haletant, fixant d’un regard morne cette apparition. Un long moment s’est écoulé avant que je ne puisse balbutier :
« Faites ce que vous voulez de moi. Je ne bougerai pas d’ici.
– Je n’ai pas l’intention de vous faire quoi que ce soit ! a répliqué l’officier en haussant les épaules. Eh bien, quel est votre métier ?
– Je… Je suis pianiste. »
Il m’a observé avec une attention accrue, d’un air clairement soupçonneux, puis son regard a dérivé vers le reste de l’appartement. Il venait d’avoir une idée, apparemment.
« Vous voulez bien venir avec moi ? »
Nous sommes passés à côté, dans ce qui avait été la salle à manger, puis encore dans une autre pièce où un piano se dressait contre l’un des murs. Il a pointé l’index sur l’instrument.
« Jouez quelque chose ! »
Comment ? Monsieur l’officier ignorait-il que tous les SS des environs allaient arriver en courant dès qu’ils entendraient les premières notes ? Je l’ai dévisagé avec perplexité, sans bouger, et il a dû percevoir mon embarras puisqu’il a ajouté d’un ton rassurant :
« Ne vous inquiétez pas, je vous assure. Si quelqu’un vient, vous irez vous cacher dans le garde-manger et je dirai que c’est moi qui voulais l’essayer, ce piano… »
Quand j’ai posé mes doigts sur le clavier, j’ai senti qu’ils tremblaient. Habitué que j’avais été à gagner ma vie en plaquant des accords, je devais donc la sauver maintenant de la même manière ! Quel changement !… Et ces doigts agités de frissons, privés d’exercice depuis deux ans et demi, raidis par le froid et la saleté, embarrassés par des ongles que je n’avais pu couper depuis l’incendie qui avait failli m’emporter ! Pour ne rien arranger, l’instrument se trouvait dans une pièce dont les fenêtres avaient été brisées et les réactions de sa caisse imprégnée d’humidité seraient sans doute désastreuses.
J’ai joué le Nocturne en Ut dièse mineur de Frédéric Chopin. Le son vitreux des cordes mal tendues s’est répandu dans l’appartement désert, est allé flotter sur les ruines de la villa d’en face pour revenir en échos étouffés, d’une rare mélancolie. Lorsque j’ai terminé le morceau, le silence n’en a semblé que plus oppressant, irréel. Un chat solitaire s’est mis à miauler dans la rue. Puis il y a eu un coup de feu en bas, ce bruit agressif, sans appel, si typiquement allemand…
L’officier me regardait sans rien dire. Au bout de quelques minutes, il a poussé un soupir avant de murmurer :
« En tout cas vous ne devez pas rester ici. Je vais vous sortir de là. En dehors de Varsovie, dans un village, vous serez moins en danger.
J’ai secoué la tête, lentement mais avec fermeté.
« Non, je ne partirai pas. Je ne peux pas.
À cette réponse, il a sursauté. Il venait enfin de comprendre pour quelle raison je me cachais parmi ces ruines, visiblement.
– Vous… Vous êtes juif ? m’a-t-il demandé d’une voix oppressée.
– Oui. »
Pour la première fois depuis notre rencontre, il a décroisé les bras et s’est assis dans le fauteuil qui flanquait le piano, comme si cette révélation demandait à être mûrement considérée.
« Euh, oui, certes… Sa voix était à peine audible. Dans ce cas je comprends, en effet… Il est resté plongé dans ses réflexions, puis une autre question lui est venue. Votre cachette, où est-elle ?
– Le grenier.
– Montrez-moi comment c’est, là-haut. »
Nous sommes montés ensemble. Il a inspecté les lieux avec un soin et une compétence qui lui ont permis de découvrir ce que je n’avais pas encore remarqué moi-même : à l’aplomb du faîtage, juste au-dessus de l’entrée, il y avait une soupente en planches pratiquement impossible à discerner dans la pénombre. Aussitôt, il m’a déclaré que je ferais mieux de me cacher dans ce recoin, puis il m’a aidé à chercher une échelle pour y accéder. Une fois en sécurité sur ce perchoir, je n’aurais qu’à l’enlever et à la ranger près de moi.
Tandis que nous concevions et mettions en application cette idée, il m’a demandé si j’avais de quoi manger. Je lui ai répondu que non. N’était-ce pas lui qui m’avait interrompu dans mes recherches, après tout ?
« D’accord, ne vous souciez pas de cela, s’est-il empressé d’affirmer, comme s’il regrettait la surprise qu’il m’avait causée en apparaissant dans la cuisine. Je vous apporterai des vivres. »
C’est alors que je me suis enhardi jusqu’à poser à mon tour une question, qui me brûlait la langue depuis trop longtemps.
« Vous êtes allemand ? »
Si je l’avais insulté, son visage n’aurait pas viré au rouge plus soudainement. Il était tellement mal à l’aise qu’il ne contenait plus sa voix lorsqu’il s’est écrié en retour :
– Oui, oui ! Et honteux de l’être, après tout ce qui s’est passé… »
D’un geste sec, il m’a tendu la main et il m’a laissé là, interdit. »
Il est temps de s’arrêter pour regarder cette video exceptionnelle : Wladyslaw Szpilman joue ce Nocturne en 1997 chez lui, 3 ans avant sa mort. Il a 86 ans, et cela fait 52 ans qu’il l’a joué pour sauver sa vie devant cet officier allemand. Préparez vos mouchoirs…
Le narrateur passe Noël puis le nouvel an en se cachant toujours : « Pour m’occuper l’esprit, j’ai repensé à tous les Noëls que j’avais vécus, avant et pendant la guerre. Au début, j’avais un foyer, des parents, des sœurs et un frère. Ensuite, nous avions perdu notre maison, mais nous étions restés ensemble, au moins. Puis je m’étais retrouvé seul, quoique au sein d’un groupe. Et maintenant j’étais devenu sans doute l’être le plus esseulé au monde. Même le héros de Defoe, Robinson Crusoé, cet archétype de la solitude humaine, avait gardé l’espoir qu’un de ses semblables apparaisse, il s’était consolé en se répétant que cela finirait par se produire et c’était ce qui l’avait maintenu en vie. Alors que moi, il me suffisait de surprendre des pas pour être pris d’une terreur mortelle et pour aller me cacher au plus vite. L’isolement absolu était la condition de ma survie » (p. 214). On note l’allusion à la fête chrétienne, et aucune allusion à la religion juive dans tout le livre. Son martyre prend fin le 14 janvier 1945, mais étant vêtu d’un manteau miliaire laissé par l’officier façon Saint-Martin, il manque être abattu avant de parvenir à faire comprendre la méprise… Il est soigné et remis sur pied en deux semaines. Dans l’épilogue il se soucie du sort de l’officier allemand à qui il avait donné son nom au cas où il puisse à son tour l’aider, mais celui-ci avait été fait prisonnier par les Russes. Szpilman conclut sur l’immeuble qu’il construisait pendant sa brève période dans le bâtiment : « Il m’arrive parfois de donner des concerts dans l’immeuble du 8 rue Narbutt, à Varsovie, là où ma brigade d’ouvriers juifs a été employée, là où j’ai charrié des briques et de la chaux, là où mes compagnons d’esclavage ont été abattus quand les appartements destinés aux officiers nazis ont été achevés. Ces belles habitations, ils n’ont pas pu en profiter très longtemps, d’ailleurs…
Ce bâtiment existe toujours. Il abrite maintenant une école. Je joue pour des enfants polonais qui n’imaginent pas les souffrances, l’angoisse mortelle dont leurs salles de classe lumineuses ont jadis été le théâtre.
Et je prie pour qu’ils n’aient jamais à connaître cette peur et ces tourments » (p. 223). À noter que les Robinson Crusoé de Varsovie est le nom officiel donné aux quelques 1000 Polonais, juifs ou non, qui se sont abrités dans les ruines de Varsovie entre le 25 octobre 1944 et le 14 janvier 1945, alors que Varsovie était déclarée zone militaire allemande, dans un état de ruines que rendent parfaitement les prises de vues de la fin du film.

En annexe on trouve quelques pages du Journal du capitaine Wilm Hosenfeld (1895-1952), que celui-ci a pu faire parvenir à sa famille. Il avait combattu lors de la Première Guerre, et était affecté à une tâche logistique en Pologne. Sa réprobation du nazisme était basée sur des convictions religieuses profondes. « Il est difficile de croire de telles choses et pour ma part j’essaie de ne pas leur accorder de crédit, non pas tant par inquiétude pour l’avenir de notre peuple, qui devra expier ces monstruosités un jour ou l’autre, mais parce que je n’arrive pas à penser qu’Hitler poursuive un but pareil, ni qu’il y ait des Allemands capables de donner de tels ordres. Si c’est par malheur le cas, il ne peut y avoir qu’une explication : ce sont des malades, des anormaux ou des fous » (p. 233). « Quels lâches nous sommes, à nous croire au-dessus de pareilles horreurs sans rien faire pour les en empêcher ! Nous serons punis, nous aussi, et nos enfants le seront aussi, bien qu’innocents, parce que nous devenons des complices en tolérant que tous ces crimes soient perpétrés » (p. 236).
Une postface de Wolf Biermann donne quelques explications historiques : « Quand ce livre a été publié pour la première fois, en 1946, il portait le titre de l’un de ses chapitres, Une ville meurt. Très vite retiré des librairies par les laquais polonais de Staline, il n’a plus été réédité jusqu’à ce jour, ni en Pologne ni ailleurs. À une époque où les pays conquis par l’armée Rouge voyaient la poigne de leurs libérateurs se refermer sur leur gorge, la nomenklatura d’Europe de l’Est ne pouvait tolérer de témoignages aussi directs, aussi sincères, aussi exigeants que celui-ci. Ils étaient trop porteurs d’amères vérités sur ces Russes, ces Polonais, ces Ukrainiens, ces Lettons, ces Juifs qui dans leur déroute en étaient venus à collaborer avec les occupants nazis » (p. 252).
Et voici un hommage aux résistants polonais : « Des chiffres, encore des chiffres : sur les trois millions et demi de Juifs qui vivaient jadis en Pologne, deux cent quarante mille ont survécu à l’occupation nazie. Certes, l’antisémitisme local était virulent bien avant l’invasion allemande, et cependant trois à quatre cent mille Polonais ont risqué leur vie pour sauver des Juifs. Un tiers des seize mille Aryens honorés à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, étaient d’origine polonaise. Pourquoi un calcul aussi précis ? Parce que si tout le monde sait que la violence antisémite a fini par devenir partie intégrante des traditions de ce pays on ignore très souvent qu’aucun autre peuple d’Europe n’a soustrait autant de Juifs à la main meurtrière des nazis. Si vous cachiez un Juif en France, vous risquiez la prison ou la déportation ; en Allemagne, cela vous coûtait la vie ; en Pologne, c’était toute votre famille qui était massacrée avec vous » (p. 253). Voici enfin des nouvelles du rescapé : « Wladyslaw Szpilman a retrouvé son piano à la radio de Varsovie dès la fin de la guerre. Les programmes de la station ont repris précisément avec son interprétation de l’œuvre de Chopin qu’il était en train de jouer le jour de 1939 où un déluge de bombes allemandes avait réduit l’émetteur au silence. On pourrait dire que la retransmission de ce Nocturne en Ut dièse mineur n’avait donc été que brièvement interrompue : six années, le temps que Herr Hitler puisse exécuter sa partition sur la scène mondiale… » (p. 259). Il me semble que Wolf Biermann commet une confusion avec le film, car dans le livre, ce qui a été interrompu par la guerre, c’est plutôt un concerto de « Rakhmaninov ». Wolf Biermann souhaite que le capitaine allemand soit honoré dans l’Allée des Justes du musée Yad Vashem à Jérusalem, ce qui d’ailleurs est chose faite depuis 2009. Voici une plaque commémorative célébrant Wladyslaw Szpilman, à Varsovie :

Le Pianiste, de Roman Polanski
Le Pianiste (2002) est le fim éponyme de Roman Polanski. Né à Paris, en 1933, Roman Polanski retourne vivre à Cracovie en Pologne à l’âge de 3 ans. Il connaît l’expérience du ghetto de Cracovie dès 1939. Il échappe à la déportation, contrairement à ses parents et à sa sœur. Sa mère, enceinte, meurt à Auschwitz. Échappé du ghetto, il se réfugie à la campagne chez des fermiers avant de revenir à Cracovie où, devenu vagabond, il trompe la vigilance allemande et survit grâce à l’entraide clandestine d’habitants et d’autres enfants, et grâce au marché noir. Il a alors dix ans. Il ne revoit son père qu’en 1945, lors du retour de celui-ci du camp de concentration de Mauthausen (source Wikipédia). C’est dire si lorsqu’il adapte ce roman, il sait de quoi il parle, même s’il choisit le détour d’une expérience d’un musicien déjà célèbre avant la guerre, transformé en paria, ce qui a de quoi dérouter ceux qui ne perçoivent que les voies verticales de l’autobiographie. L’adaptation est fidèle pour de nombreux détails, et le fait que la plupart des scènes du film qui transcrivent fidèlement les pages du roman, soient dépourvues de paroles, renforce l’aspect témoin objectif et impuissant, anti-héros du personnage éponyme. Une légère inflexion héroïque au récit est donnée lors des entrevues successives avec le réseau de résistance du ghetto, où Wladek cherche à se rendre utile, et y participe activement, ce qui est absent du livre, dans lequel il le fait sans avoir cherché à le faire, peut-être par modestie d’auteur. De même lorsqu’il se la joue Jean-Paul Belmondo lors de l’attaque de l’hôpital, en sautant du toit sur un balcon, s’accrochant à la gouttière, alors que cela fait des mois qu’il est confiné dans un appartement ; puis il escalade un mur pour se sauver dans les ruines. Une autre inflexion est donnée avec le personnage de Dorota, une Polonaise non-juive, violoniste et admiratrice du pianiste, qui intervient dès le début du récit, scandalisée par les conditions faites aux juifs. Dans le livre ce n’est que dans le 3e tiers que les amis polonais du pianiste interviennent. C’est sans doute une exigence vieille comme le mode d’ajouter une pincée de glamour, une amorce de romance aux films les plus tragiques. Lors de la scène au restaurant, il y a aussi une spectatrice qui essaie de vamper le pianiste, ce qui atténue l’autre scène au même moment, du profiteur de guerre qui fait tinter ses pièces. Mais le livre évoque des « grues » dans ce restaurant, sans préciser qu’elles le prenaient lui pour cible ! Quelques scènes de cruauté barbare des Allemands sont filmées avec froideur, mais (à moins que j’aie mal observé) il n’est pas fait allusion à la participation active des fascistes ukrainiens et lituaniens, et les scènes les plus choquantes du récit sont mises de côté (assassinat d’un garçon, massacre de femmes tête contre un mur, défilé des orphelins). Une scène est transformée en récit par le frère du narrateur lors d’un repas, mais déjà dans le livre c’est une scène rapportée et non vue. Lors de la période de vie clandestine, le narrateur va de cachette en cachette, et il retombe sur Dorota, mariée, ce qui relance cette amorce romantique. C’est d’ailleurs une suite de Bach, seule musique allemande, le reste de la bande-son étant exclusivement du Frédéric Chopin, compositeur polonais, enfin plutôt franco-polonais, comme Polanski. Wladeck observe Dorota enceinte jouer du violoncelle, juste avant d’être installé dans une cache où il y a un piano, dont il joue de mémoire sans toucher le clavier pour ne pas faire de bruit, là encore scène ajoutée ou plutôt modifiée qui justifie le nouveau titre du livre.
Un film autobiographique ?
J’ai déjà exprimé mon opinion sur l’aspect autobiographique sous-jacent du film de Polanski, dans cet article. En voici un extrait :
« Je voudrais juste revenir sur l’interrogation finale de Thomas Sotinel, dans son article pour Le Monde du 25.09.2002 : « Au bout de deux heures et demie d’un film digne dans son refus presque systématique de la manipulation des émotions, mais aussi rebutant par sa réticence obstinée à tomber les masques, l’énigme reste entière. Qui saura jamais pourquoi, de l’histoire qui lui est sans doute la plus proche, Polanski a tiré l’un de ses films les moins personnels ? »
Ne serait-ce pas au contraire métaphoriquement que Polanski nous parle de lui-même dans ce film le plus personnel de sa carrière ?
Cet artiste condamné, au nom d’une faute qu’il n’a pas commise, à errer de cache en cache, jusqu’à un grenier sordide, en attendant que « ça s’arrête » : comment ne pas y voir Polanski errant de pays en pays, traqué par la folie d’un juge pour une faute qu’il a commise, mais qu’il a peut-être commise avec des circonstances atténuantes liées à ce qu’il aurait enduré dans son enfance ? Il y a peu de filmographie mentionnant tant de pays divers : tous ceux qui ont offert asile au réalisateur. Et ces deux scènes clés où le pianiste exerce son art en situation tragique. Première scène : il joue en silence sur un clavier pour ne pas faire de bruit, alors qu’il est caché dans l’antre du monstre, en face de l’hôpital allemand. Deuxième scène : il joue, pour la première fois depuis deux années, devant l’officier allemand qui l’aide, à quelques mois de la libération par les communistes. Il est horriblement sale, pouilleux, couvert de vermine, et ses mains noires de crasse retrouvent merveilleusement toute leur vigueur et courent sur le clavier. N’est-ce pas Polanski, indirectement, qui crie : « vous voyez comme je suis sale de ce crime dont vous me poursuivrez jusqu’à la mort ; mais rien ne m’empêchera de jouer ma partition avec mes mains sales » ? J’ajouterai que la tentative de retrouver et de réhabiliter le capitaine allemand renoue avec le thème du pardon au cœur de La Jeune fille et la mort, thème toujours cuisant dans la seconde partie de la vie de Polanski. Les deux films d’ailleurs se terminent par un concert.
– Le 8 mars 2020, jour du droit des femmes, une « tribune de cent avocates » vient balayer les tombereaux d’injures déversées sur Roman Polanski lors de la soirée des Césars, une semaine auparavant. Ce pseudo-féminisme – celui des Césars et aux slogans crétins dans les rues – aux allures de tank qui ne regarde pas ses victimes est vraiment la honte de la France actuelle. Vive Polanski !
Voir en ligne : Le site en français consacré à l’auteur et à sa carrière
© altersexualite.com 2020
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com