Accueil > Essais & Documentaires (adultes) > Queer Zones 3, de Sam Bourcier
Plus queer que moi, tu meurs, pour éducateurs
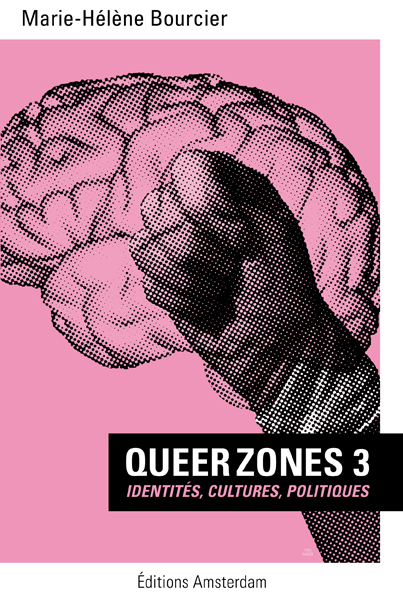 Queer Zones 3, de Sam Bourcier
Queer Zones 3, de Sam Bourcier
Éditions Amsterdam, 2011, 360 p., 15 €.
samedi 8 mars 2014
Sam Bourcier [1] est normalien (ancien élève de l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud) et maître de conférences. Il est un des introducteurs en France de la théorie queer, après sa découverte éblouie de Trouble dans le genre, de Judith Butler en anglais, bien avant sa traduction tardive en français. Il crée l’association Zoo en 1996, milite dans les milieux BDSM, et s’oppose à ceux qu’il nomme « homonormatifs » (et que j’appellerais pour ma part « orthosexuels »). Il enseigne dans différentes universités, notamment Lille III. Il a publié trois volumes de Queer Zones, en 2001, 2005 et 2011. Ce 3e volume est, comme les précédents, un recueil d’articles ou d’entrevues précédemment parus. Bien qu’ayant brièvement rencontré Marie-Hélène Bourcier (Je conserve le nom féminin car cela s’est passé ainsi) lors d’une émission de Pink TV dont elle était co-animatrice, je n’avais jamais pris le temps de lire un de ses livres. Lacune comblée en 2013 : comme j’avais été contacté pour participer à une émission Service public de Guillaume Erner, sur France Inter dont elle était également invitée : « Le couple ne passera pas par moi ! », j’en ai profité pour lire un de ses bouquins. C’est fort intéressant, mais autant vous prévenir : c’est du costaud, 100 % caustique et polémique ! Entre un démolissage en règle de Catherine Breillat et un démolissage d’amoureuse contrariée de Judith Butler, toute l’intelligentsia en prend pour son grade, et les « homonormatifs » en passant. Il est difficile de critiquer un livre qui est lui-même majoritairement constitué de critiques. Aussi n’entrerai-je pas forcément dans les détails de chaque article. La lecture de Bourcier est une aventure en soi que je vous encourage à tenter !
Modernisme et féminismes
C’est par un réjouissant démolissage en règle de Catherine Breillat que commence cette première section de l’ouvrage. Ce premier article est un des plus brillants, et l’un des plus compréhensibles pour le commun des mortels. L’abondance des références précises, des notes de bas de page témoigne d’un véritable travail intellectuel et d’une rigueur rares. Ce qui est reproché à Breillat, c’est son « universalisme », son refus de se reconnaître comme féministe (sachant qu’il ne convient pas non plus d’être « essentialiste », si j’ai bien compris). Le refus de l’universalisme et l’importance de l’affirmation des minorités en tant que telles, queer ou non, est un des thèmes principaux de ce recueil. Plus précisément, Bourcier relève une contradiction entre l’anticléricalisme « d’une Breillat qui tonne contre le « monothéisme à couilles » et la religion qui opprime les femmes mais se consacre à corps perdu à la mystique de l’art pour l’art dont les accents chrétiens sont bien là » (p. 53). À travers ce cas clinique, Bourcier s’en prend aux tenants du modernisme, dont Paris est devenu « La Mecque », la France étant « le pays le plus rétif à la prise en compte des industries culturelles et de la culture de masse » (p. 54).
L’article suivant au titre provocateur : « L’opium des connes » complète l’exposé du malaise, en montrant que même des féministes pro-sexe comme Virginie Despentes se targuent parfois de sentiments anti-féministes, symptôme pour Bourcier de « l’impossibilité d’avoir accès en 2000, en France, à une vision différenciée des multiples options féministes disponibles. Soit qu’elles n’y existent pas, comme le féminisme prosexe par exemple, soit que le féminisme ne puisse apparaître dans les médias que comme une caricature ou se résume au féminisme antiporno » (p. 80).
Ready for the cultural turn ?
La section II explique ce que c’est que les « études culturelles », traduction française (pour une fois) préférée par Bourcier à « cultural studies ». Il y voit un « décentrement du majoritaire », c’est-à-dire qu’en gros il ne s’agit pas de faire des thèses sur, mais avec les minoritaires, de les encourager à étudier eux-mêmes leurs communautés et ce qui les concerne. Puisqu’il est question de traduction, Bourcier s’explique dans une entrevue, sur le choix en 1996 de ne pas traduire le mot « Queer », puis de recourir quand même à « la concaténation « transpédégouine » qui résolvait un autre problème de traduction culturelle : celui de ne pas traduire le terme queer au profit d’une identité sexuelle et de genre en particulier au détriment des autres et de réinjecter l’injure [présente dans le mot queer] » (p. 106). Reste à savoir pourquoi Bourcier persiste (même dans l’émission de France Inter de 2013, cf. ci-dessus) à ignorer l’existence d’une part d’une évolution du mot « queer », dans un sens moins marginal, incluant tous les LGBT même les « homonormatifs » (en gros tous ceux qui étaient susceptibles jadis de recevoir l’injure), d’autre part l’existence de l’autre tentative de traduction par « allosexuel » / « altersexuel ». On suppute que c’est parce qu’il n’est pas d’accord avec, mais ce n’est pas parce qu’on n’est pas d’accord qu’il faut ignorer une tentative de traduction, agréée par la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada. Or dans l’émission de Pink TV évoquée ci-dessus, mon essai Altersexualité, Éducation et Censure avait été présenté (en 2006 !). Quel manque de curiosité pour une universitaire qui ne cesse de reprocher aux universitaires majoritaires leur mépris des minorités et leur comportement de « mandarins »… Quant aux « études culturelles », « elles sont plus intéressées par les relectures théoriques des références théoriques (sic) et la création d’univers référentiels inattendus, mixtes et efficaces » (p. 108). Bref, un vrai jeu de quilles dont les victimes seront les pontes de l’université française, par exemple Kristeva, Derrida ou Foucault, accusés de « duplicité culturelle » – avec pour les deux derniers en plus le fait de rester « au placard en France, taisant […] une sexualité différente outre-Atlantique » (p. 110). Certains étudiants sont accusés de devenir « des poulains ou des petits fonctionnaires de la pensée » (p. 113), syndrome de « La Malinche » (p. 105 et 109). C’est que Bourcier ne fait pas dans la demi-mesure : il se moque des sociologues qui font « de la météo de genre », car de son côté il a « dépassé le stade du « trouble dans le genre » » (p. 131). Il précise « Les essentialistes, on le sait, ce sont les homonormatifs d’aujourd’hui, qui brament pour le mariage et les droits » (p. 136). Dans une entrevue décontractée avec un journal universitaire, Bourcier se définit avec peine : « comment née depuis la France, j’ai compris que j’étais lesbienne, comment je suis devenue gouine à Londres, SM via San Francisco sans y avoir mis les pieds, puis queer et maintenant bon je ne pourrais pas dire que je suis lesbienne… je devrais plutôt me définir comme une butch genderqueer » (p. 137 ; là encore je ne peux pas modifier le genre). Dans ce même cadre des « études culturelles », il évoque l’apport des « performances », jusqu’aux « perf post-porn », pour lesquelles il recommande ce site, puis se livre à un vibrant éloge de l’évolution du porno, avec l’influence des festivals de films porno, de Paris ou Berlin, que les pouvoirs publics devraient subventionner plus crânement (et, branlant du chef, j’opine !). Le Commerce des pissotières, de Laud Humphreys, est présenté dans cette entrevue comme un exemple de « cultural studies », et Bourcier de regretter que le dossier de la polémique suscitée par l’ouvrage ait été écarté de la traduction (p. 155).
Yes we queer !
Cette 3e et dernière section enchaîne par un article entièrement consacré au « porno durable » ou « porno vert » (pp. 173 & 181). Ce nouveau porno modifie les conditions sociales et financières des acteurs et des réalisateurs, et constitue pour les actrices notamment un mode d’« empowerment » qui relègue les attaques féministes du porno traditionnel dans un ringardisme hors d’âge. On a parfois droit à des détails dont on se demande comment ils tombent dans la soupe : « une sodomie de Rocco Siffredi, c’est quinze jours sans pouvoir s’asseoir et donc sans travailler » (p. 182). Glups ! J’en connais qui demanderaient à voir ! Puis la question transgenre est abordée, avec ses évolutions récentes dues aux technologies, notamment chez les FtM (Female to Male), concomitantes avec un changement d’attitude : si « la règle fut longtemps de nier son passé « dans l’autre sexe » » (p. 208), les transgenres ont maintenant tendance à faire leur coming out en tant que « trans », et souvent à se passer des « opérations « du bas » et notamment la phalloplastie et la métaoidioplastie par opposition à celles du haut (mammectomie) » (p. 209). L’exemple développé des mémoires de Max Wolf Valerio, FtM devenu assez macho, est fort intéressant, et remet en cause les positions de « la culture séparatiste lesbienne féministe » (p. 211).
Un long article est consacré au BDSM, dont l’auteur se proclame adepte. Là, j’avoue avoir du mal à suivre le propos. Si je résume la thèse : « Pourquoi le BDSM, si pratique pour dénaturaliser, pervertir, resignifier ou bien tout simplement réagir à des dynamiques de pouvoir opprimantes […] n’a pas été articulé à l’époque contemporaine de manière à transformer, à réduire les écarts ou les déséquilibres de pouvoir constatés au quotidien dans notre culture » (p. 231). Et de regretter qu’il n’y ait pas de coming out BDSM. Le coming out posthume « du milliardaire Forbes » est signalé en note (p. 232). J’ai du mal à suivre aussi le dégommage de Lacan et de Freud (sans oublier le marquis de Sade), sorte d’exercices imposés qui deviennent lassants tant c’est à la mode. Bourcier s’adresse à des initiés, et on a envie de le renvoyer à « Des nains sur des épaules de géants », le mot fameux de Bernard de Chartres. Ce long article se termine sur un slogan à la Besancenot, toujours à propos du BDSM : « Il y a contrat et contrat et il faut garder en mémoire que le contrat est aussi le bras armé du capitalisme et du libéralisme » (p. 280). Tout ça pour en arriver là ? Bref, à mon humble avis, et sans passer par Lacan ou Freud, s’il s’agit de remettre en cause par une activité les rapports de pouvoir, le BDSM me semble aussi pertinent comme pratique que les jeux de rôle, le football, le naturisme, la danse, les pubs, la boxe, ou à peu près n’importe quelle activité sociale qui réunit des classes différentes. Bref, ces développements sur le BDSM me passionnent autant que si je lisais une revue de passionnés de Harley-Davidson, de Mylène Farmer ou d’aéromodélisme. C’est une passion, avec ses adeptes, qui sont capables de prendre leur pied en en parlant. Enfin, le simple fait de mentionner que Forbes en était adepte donne à mon avis – humble ! – les limites des prétentions révolutionnaires de ce hobby. Je sens que je vais me faire incendier, mais j’aime ça !
Les « homonormatifs »
Un article est consacré à la question du mariage gay, et plusieurs allusions dans d’autres articles. Par exemple dans le feu d’artifice final consacré à Judith Butler : « Au début du XXIe siècle, l’écart s’est sensiblement creusé entre les agendas homonormatif et homorépublicain (les unions civiles, le mariage, l’adoption, la lutte contre l’homophobie Coca Cola à l’échelle globale) et les agendas queer qui privilégient l’entrée des droits des genres […] le gender fuck [niquer son genre / les genres], la critique du capitalisme et du néolibéralisme, la déconstruction de l’universalisme, les politiques de coalition avec les travailleurs du sexe, les lesbiennes, les personnes trans et les QOC (queer of colour), la lutte antiraciste, le combat contre l’homonationalisme et les nationalismes sexuels ainsi que la revendication d’un réel accès à la sphère publique et aux médias qui ne soit pas sanctionné par un renoncement à ses spécificités » (p. 299). On a l’impression d’un kit de pensée toute faite, un sac à dos gonflé à bloc de munitions pour s’aventurer dans le désert de la Pensée. Bref, Queer = anticapitalisme et antiracisme. Ah, bon ! Dans le kit, n’oublions pas l’accusation récurrente d’être « bien français » (p. 300), qui caractérise tous les défauts intellectuels impardonnables. Y compris cette citation, on relève 6 occurrences de « France » ou « français » dans la même page. Un ami me faisait remarquer qu’on pourrait créer une variété de Point Godwin désignant non pas le moment où dans une discussion on utilise une comparaison avec le nazisme, mais où l’on utilise l’expression « c’est bien français » ! Bourcier serait champion ! [2]. Ce rejet de ce qui est « français » dans le domaine de l’intellect est d’autant plus étonnant que dans ce dernier article consacré à dégommer « la seconde Butler », Bourcier explique le divorce qui s’est produit entre le mouvement queer étasunien et le mouvement queer français, dont il est un des leaders, et revendique en gros que « Rome n’est plus dans Rome, elle est toute où je suis », ou du moins, le queer n’est plus dans Butler, il est tout où Bourcier est… On ne trouve aucune allusion au fait qu’en 2010, Judith Butler se soit manifestée spectaculairement contre l’évolution homonationaliste que dénonce également Bourcier (cf. cet article, mais quasiment tout l’article est basé sur une rencontre publique à Paris à l’ENS, et une anecdote racontée par Butler lors de cette conférence, sur une interpellation de Butler à San Francisco, par une trans, qui ne savait pas que Butler était incognito dans le public.
Pour en revenir au propos sur le mariage gay, on est ravi d’apprendre que Bourcier était contre. Dommage qu’il n’ait pas davantage participé au débat. Je relève par exemple une phrase que je bois comme du petit lait : « d’autres stratégies étaient possibles, par exemple celle consistant à exiger que de nouvelles formes contractuelles de liens, d’intimité, de vie à plusieurs, attestées ou possibles, connaissent une ou des traductions sociales et culturelles » (p. 283). Bigre ! Ce n’est rien d’autre que le Contrat universel que je propose dans mon essai (paru un an après ce livre) et que Bourcier a semblé balayer d’un revers de phrase dans cette émission de France Inter par laquelle je commençais cet article ! Et d’autres perles qui m’agréent ô combien : « Blanc ou rose, le symbole d’égalité que constitue le mariage peut donc être considéré comme une forme de discrimination. Il exclut les célibataires et les travailleuses du sexe et invite à la clandestinisation du sexe » (p. 284). Et encore : « Entre la reconnaissance de choix de vie différents et la nécessité d’inventer d’autres possibilités, il semblerait qu’il y ait de la place pour des politiques LGBTQ qui, même dans le cadre d’une réflexion sur le mariage et les formes de filiation, se situent plus dans une tradition de progressisme sexuel et politique qui ne fasse pas l’impasse sur les liens entre droits sexuels et sociaux, race et mariage, genres et mariage » (p. 289) ; enfin : « Il serait sans doute intéressant de réformer le code civil de manière à supprimer la référence et l’incarnation obligée à un système de genre binaire et normatif » (p. 290).
Le langage bourciérien
Un mot sur la langue utilisée par l’auteur. C’est un des points faibles du livre, ou plutôt un point qui le cantonne à un lectorat extrêmement pointu, celui des gens qui entendent couramment, en plus de l’anglais, le normalien et le lacanien. Quand on ne fait que baragouiner ces idiomes, ce qui est mon cas, on ne peut que surfer sur le sens. On sourit quand Bourcier reproche à Barthes d’abuser de « jargon linguistique structuraliste » (p. 236), alors que lui-même jargonne à tire-larigot, usant de toutes les ressources de l’ironie, du jeu de mots, du néologisme savant, de l’allusion pour initiés, sans s’interdire ici ou là une bonne grosse vulgarité pour échapper à l’accusation de mandarinage. Quand on croit tomber sur une coquille, on a toujours un doute, par ex : « resciologisation » (p. 258) est-il une coquille pour « resocio… » ou bien un néologisme / calembour sur la racine latine « scio » ? Voulez-vous un exemple presque au hasard ? « Qu’ils soient lévinassiens ou « éthiques », le but de ces changements est de rediriger le pouvoir performatif vers des politiques néo-humanistes et universalistes adressées au monde straight » (p. 306). Révérence garder, ça frise parfois le pipotron. Le lien entre cette langue et le fond du propos est que Sam Bourcier parle en initié à des initiés, mais oublie souvent que le mouvement queer tel qu’il le définit lui, est ultra-marginal, et qu’il existe des conceptions plus inclusives, disons le mot, peut-être moins extrêmes, moins « séparatistes », de ce mouvement :« Cette multiplication des possibilités sexuelles est une évolution spécifique des subcultures queer et trans qui ne se retrouve pas dans la culture gaie » (p. 331). Certes, de même que les fanatiques de Harley-Davidson ne se retrouvent pas dans les mouvements motards ; mais est-ce pour cela qu’il est absolument nécessaire de les considérer comme des êtres si différents, si à part, des autres motards, qu’on ne puisse même pas utiliser le même mot pour les désigner ? Et vive l’altersexualité !
– Lire, chez le même éditeur, L’Inversion de la question homosexuelle, d’Éric Fassin.
– Le 11 avril 2019, Sam Bourcier intervient sur France Culture dans « Le grain à moudre » face à Bérénice Levet suite à l’agression d’une femme trans, Julia, en marge d’une manifestation d’Algériens. Sam Bourcier, en bon stalinien Queer, hurle à l’« homonationalisme » et au « cryptoracisme » (écouter vers 4’30) face à Bérénice Levet qui ose rappeler que cette agression n’est pas le fait de n’importe qui, mais de musulmans. Continuons à porter des œillères…
Voir en ligne : Page bio de Sam Bourcier
© altersexualite.com 2013-2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Qui s’appelait Marie-Hélène Bourcier lorsque j’ai rédigé cet article, que j’ai donc modifié depuis.
[2] Je ne serais pas forcément le dernier non plus ! Et puis nous avons un fameux devancier en la personne d’Arthur Rimbaud soi-même en sa non moins fameuse lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871 : « Musset est quatorze fois exécrable pour nous, générations douloureuses et prises de visions […] tout est français, c’est-à-dire haïssable au suprême degré ; français, pas parisien ! »
 altersexualite.com
altersexualite.com