Accueil > Classiques > XIXe siècle > La Maison Tellier, de Guy de Maupassant
De la campagne, de la banlieue, de la sexualité, pour les 3e et le lycée
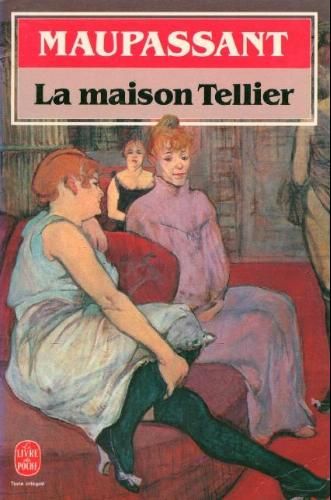 La Maison Tellier, de Guy de Maupassant
La Maison Tellier, de Guy de Maupassant
Plusieurs éditions de Poche, 1881, moins de 200 p.
jeudi 1er mars 2012
Ce court recueil se prête à une lecture cursive en 3e ou en seconde, dans le cadre de l’étude de la nouvelle ou du roman du XIXe, ou des courants littéraires, puisque nous sommes à l’époque où l’ami Maupassant tâte des Soirées de Médan, et louvoie entre réalisme et naturalisme. L’excellent manuel de 2de « Passeurs de textes » Le Robert (programmes de 2011) inclut une séquence sur l’intégralité d’« Une partie de campagne », ce qui m’a inspiré l’envie de proposer ce recueil à mes élèves, au lieu de Miss Harriet, que j’avais pratiqué naguère. De quelques années antérieur, ce recueil plus léger est obsédé par la prostitution, le canotage et la débauche des bords de Seine, ce qui ne manque pas de choquer – au bon sens du terme – nos élèves pudibonds du XXIe siècle. Il est clos par la fameuse nouvelle « La femme de Paul », à propos de laquelle Dominique Fernandez évoquait un « saphique accouplement » dans sa préface à Miss Harriet. Pour lire le recueil en ligne : Wikisource. L’étude en classe sera agréablement complétée par des adaptations cinématographiques mémorables.
« La Maison Tellier », la nouvelle éponyme, constitue une sorte de programme, le recueil étant considéré comme une maison de tolérance. À l’époque de cette publication, l’auteur « pissait de la copie » pour payer les traites d’une maison à Étretat, qu’il avait baptisée La Maison Tellier, nom qu’il dut retirer à la demande de ses voisines choquées, selon le préfacier de l’édition Livre de Poche, Patrick Wald Lasowski, qui nous apprend une autre anecdote croustillante sur Maupassant : « poussé à bout par l’incrédulité de Flaubert, [il] se rendit, une fois, dans une maison close, escorté d’un huissier auquel il fit constater qu’en une heure, il avait possédé six pensionnaires » [1] Il s’agit d’une nouvelle d’un naturalisme peu orthodoxe, puisque Maupassant s’amuse à une expérimentation zolienne mâtinée de gaudriole, en amenant toute la Maison Tellier, modeste claque de province à 5 pensionnaires, à une première communion.
Tout le petit village, curé compris, est édifié par ces dames dont il ignore la nature, et croit que les sanglots qui secouent les prostituées à la messe sont de piété alors qu’ils ne sont que la nostalgie de la pureté. Dans le dossier, Patrick Wald Lasowski s’amuse du contresens de Zola, bluffé par Maupassant et prenant au pied de la lettre la scène de l’église : « la foi qui persiste même dans l’abjection quotidienne ». On s‘amuse de la consternation puis de la félicité retrouvée des bourgeois de la petite ville perdant, puis retrouvant leur maison « fermée pour cause de première communion » ; on s’attendrit de la convivialité des maisons closes, conforme à ce qu’en a montré récemment l’excellent film de Bertrand Bonnello, L’Apollonide. Signalons une belle scène où la cinquième prostituée, qui se retrouve à dormir seule dans la ferme des parents de sa patronne, glisse dans son lit la jeune communiante, elle aussi effrayée de dormir seule. Cette nouvelle est magistralement adaptée au cinéma par Max Ophuls (1902-1957) dans Le Plaisir (1952). C’est l’adaptation de trois nouvelles de Guy de Maupassant : « Le Masque », « La Maison Tellier » et « Le Modèle ». « La Maison Tellier » est le morceau de roi, qui prend 1 h du film. À l’origine, la 3e séquence devait être une adaptation de « La Femme de Paul ». Elle fut abandonnée en faveur de « Le Modèle » pour des raisons de budget, mais sans changer les deux acteurs principaux. Madeleine Renaud joue Mme Tellier ; Danielle Darrieux est Mme Rosa, et Jean Gabin est Joseph Rivet. L’article de Wikipédia cite un « Hommage à Danielle Darrieux » de Paul Vecchiali : « Si l’on devait ne retenir qu’un plan dans toute la cinématographie française, si riche en cadeaux de toutes sortes, ce serait celui où, dans un pré orné de fleurs artificielles, après le chant des pensionnaires de la Maison Tellier (« Combien je regrette... »), Darrieux répond à Gabin, s’excusant d’avoir été « un peu chaud », ce « merci » qui exprime par la voix, le retour à la dignité ; par l’attitude, l’aveu d’un amour impossible. Au risque d’être partial, je dirai que ce moment de cinéma pur justifie à lui seul que les frères Lumière aient un jour découvert le mouvement des images. » D’accord ou pas avec ce jugement, on pourra estimer l’utilisation de la chanson de Pierre-Jean de Béranger « Ma grand-mère » et de son orchestration par Joe Hajos (je crois) comme un des plus beaux moments du cinéma français, auquel il est d’ailleurs rendu hommage par une citation musicale dès le générique du film de Jacques Demy Lola (1961), dédié à Max Ophuls. La chanson est citée dans le texte de Maupassant : Rosa la chante pendant le trajet de retour. En tout cas un film troublant à notre époque de retour à l’ordre moral, à proposer à nos élèves de lycée comme une plongée hors du temps. Un des parti pris du cinéaste est facile à identifier par les élèves : la maison close est toujours filmée de l’extérieur, souvent à travers des jalousies, tandis que la maison du charpentier à la campagne, véritable labyrinthe, est filmée de l’intérieur, et ces dames la parcourent dans tous les sens comme des souris dans un terrier !

Si l’on a encore du temps, voici une autre idée de film en parallèle. La Rue de la Honte (1956) est le dernier film de Kenji Mizoguchi. Il traite dans une optique néoréaliste de la prostitution de bas étage au Japon dans l’après-guerre. Il ne s’agit pas de geishas, mais de racoleuses sordides. Une loi d’interdiction des maisons closes est en discussion, et ces prostituées doivent se défendre, entre une société terrible pour les prolétaires et le gouvernement. Le couple de patrons les traite sans ménagement, mais elles ne sont pas plus mal traitées que les autres prolétaires travaillant en usine ; elles gagnent plutôt un chouia plus, mais sont criblées de dettes à cause des besoins engendrés par leur mode de vie. Elles pillent sans vergogne les naïfs qui tombent amoureux d’elles, mais sont rejetées plus ou moins hypocritement par leur père ou leur fils, très exigeants pour elles, moins exigeants pour eux-mêmes. La maison de prostitution est filmée sans enjolivement, de l’intérieur comme de l’extérieur, d’une façon différente de celle d’Ophuls dans Le Plaisir, d’où l’intérêt de comparer les deux films. Et puis le point de vue naturaliste de l’œuvre est intéressant, comme dans L’Amour de l’actrice Sumako (1947) du même réalisateur.
« Les tombales » est une évocation fort osée d’une femme qui semble draguer dans un cimetière parisien, en jouant les veuves éplorées. Elle se poste auprès d’un bel homme, non loin d’une tombe d’un défunt dont elle prétend être la veuve… Y aurait-il un jeu de mots entre « verticales » et « tombales » ?
« Sur l’eau » ouvre le thème du canotage, dans le registre symbolique plus que réaliste : une barque se trouve immobilisée, jusqu’à ce qu’on relève un cadavre de femme, qui bloquait l’ancre.
« Histoire d’une fille de ferme » préfigure « L’Héritage », dans Miss Harriet, mais en version populo : une fille de ferme, force de la nature, se fait abuser par un garçon qui promet de l’épouser, l’engrosse et se casse. Elle accouche en douce, se prend d’amour pour le petit qu’elle confie à son village d’origine en secret, et se met à rivaliser de zèle, pour mériter une augmentation, qui ne vient pas. Mieux, elle attire l’attention du patron, qui lui propose de l’épouser. Elle n’ose avouer ce qu’elle croit un crime, mais le patron la force, et l’épouse. Las, le couple est stérile. La fille sait bien que cela ne vient point d’elle… comment cela finira cette expérimentation naturaliste ? Extrait : « De ce moment commença entre eux l’éternelle histoire de l’amour. Ils se lutinaient dans les coins ; ils se donnaient des rendez-vous au clair de la lune, à l’abri d’une meule de foin, et ils se faisaient des bleus aux jambes, sous la table, avec leurs gros souliers ferrés. Puis, peu à peu, Jacques parut s’ennuyer d’elle ; il l’évitait, ne lui parlait plus guère, ne cherchait plus à la rencontrer seule. Alors elle fut envahie par des doutes et une grande tristesse ; et, au bout de quelque temps, elle s’aperçut qu’elle était enceinte. » Mais le plus intéressant est peut-être l’évocation rare de la force physique de la donzelle, qui ne l’empêche pas d’ailleurs de se faire rouler : « Lui, tout à coup, la saisit par le cou et l’embrassa de nouveau ; mais, de son poing fermé, elle le frappa en pleine figure si violemment qu’il se mit à saigner du nez ; et il se leva pour aller appuyer sa tête contre un tronc d’arbre. Alors elle fut attendrie et, se rapprochant de lui, elle demanda : « — Ça te fait mal ? » Mais il se mit à rire. Non, ce n’était rien ; seulement elle avait tapé juste sur le milieu. Il murmurait : « Cré coquin ! » et il la regardait avec admiration, pris d’un respect, d’une affection tout autre, d’un commencement d’amour vrai pour cette grande gaillarde si solide. » On peut visionner deux adaptations de cette nouvelle : un téléfilm français de 1973, adapté et réalisé par Claude Santelli, et une version récente de Denis Malleval dans la série « Chez Maupassant » (2007). Dans la rubrique liens inattendus, je vous propose l’étude de Xala, d’Ousmane Sembène (Présence Africaine, 1973), dans lequel on retrouve des scènes cocasses de consultation de divers sorciers pour guérir non pas la stérilité mais l’impuissance. Au chapitre IV de la première partie de La Débâcle d’Émile Zola on retrouve le motif de départ de cette nouvelle dans l’attitude de Goliath, espion qui passe de ferme en ferme.
« En famille » est une variante banlieusarde du vieux conte sur le thème « la défunte n’est pas morte ». Occasion pour l’auteur de se livrer à une évocation pour le moins déprimante de la banlieue parisienne : « Leurs faces inquiètes et tristes disaient encore les soucis domestiques, les incessants besoins d’argent, les anciennes espérances définitivement déçues ; car tous appartenaient à cette armée de pauvres diables râpés qui végètent économiquement dans une chétive maison de plâtre, avec une plate-bande pour jardin, au milieu de cette campagne à dépotoirs qui borde Paris. » La nouvelle n’est pas, faut-il le préciser ? une apologie du mariage…
« Le papa de Simon » montre de meilleurs sentiments, avec ce petit garçon, bouc émissaire de ses congénères parce qu’il n’a pas de papa, et qui fait tout pour s’en trouver un. Cette nouvelle pathétique plaît beaucoup aux élèves.
« Une partie de campagne » est le chef-d’œuvre, que tout le monde connaît, souvent par l’adaptation de Jean Renoir (1936). Pas une pub pour le mariage non plus, mais l’inoubliable scène de dépucelage au chant du rossignol, que je me suis fait le plaisir de proposer en « lecture analytique », dans ce découpage :
« Le rossignol se tut soudain. Une voix éloignée cria : — « Henriette ! »
— Ne répondez point, dit-il tout bas, vous feriez envoler l’oiseau.
Elle ne songeait guère non plus à répondre.
Ils restèrent quelque temps ainsi. Mme Dufour était assise quelque part, car on entendait vaguement, de temps en temps, les petits cris de la grosse dame que lutinait sans doute l’autre canotier.
La jeune fille pleurait toujours, pénétrée de sensations très douces, la peau chaude et piquée partout de chatouillements inconnus. La tête de Henri était sur son épaule ; et, brusquement, il la baisa sur les lèvres. Elle eut une révolte furieuse et, pour l’éviter, se rejeta sur le dos. Mais il s’abattit sur elle, la couvrant de tout son corps. Il poursuivit longtemps cette bouche qui le fuyait, puis, la joignant, y attacha la sienne. Alors, affolée par un désir formidable, elle lui rendit son baiser en l’étreignant sur sa poitrine, et toute sa résistance tomba comme écrasée par un poids trop lourd.
Tout était calme aux environs. L’oiseau se mit à chanter. Il jeta d’abord trois notes pénétrantes qui semblaient un appel d’amour, puis, après un silence d’un moment, il commença d’une voix affaiblie des modulations très lentes.
Une brise molle glissa, soulevant un murmure de feuilles, et dans la profondeur des branches passaient deux soupirs ardents qui se mêlaient au chant du rossignol et au souffle léger du bois.
Une ivresse envahissait l’oiseau, et sa voix s’accélérant peu à peu comme un incendie qui s’allume ou une passion qui grandit, semblait accompagner sous l’arbre un crépitement de baisers. Puis le délire de son gosier se déchaînait éperdument. Il avait des pâmoisons prolongées sur un trait, de grands spasmes mélodieux.
Quelquefois il se reposait un peu, filant seulement deux ou trois sons légers qu’il terminait soudain par une note suraiguë. Ou bien il partait d’une course affolée, avec des jaillissements de gammes, des frémissements, des saccades, comme un chant d’amour furieux, suivi par des cris de triomphe.
Mais il se tut, écoutant sous lui un gémissement tellement profond qu’on l’eût pris pour l’adieu d’une âme. Le bruit s’en prolongea quelque temps et s’acheva dans un sanglot.
Ils étaient bien pâles, tous les deux, en quittant leur lit de verdure. Le ciel bleu leur paraissait obscurci ; l’ardent soleil était éteint pour leurs yeux ; ils s’apercevaient de la solitude et du silence. Ils marchaient rapidement l’un près de l’autre, sans se parler, sans se toucher, car ils semblaient devenus ennemis irréconciliables, comme si un dégoût se fût élevé entre leurs corps, une haine entre leurs esprits.
De temps à autre, Henriette criait : — « Maman ! » »
Vous ne manquerez pas de visionner avec vos élèves le chef-d’œuvre de Renoir sublimé par la première musique de film de Joseph Kosma (1905-1969). Les larmes de Sylvia Bataille dans la scène finale sont un des moments les plus bouleversants du cinéma mondial.
À propos de Jean Renoir, ne ratez pas cette entrevue avec Jacques Rivette, qui date de 1975, où Renoir expose ses théories paradoxales sur le progrès en art.
– À compléter par « Le rossignol aveugle » de Marceline Desbordes-Valmore, dans une séquence sur le romantisme. Si l’on propose une séance sur le film de Renoir (qui a l’avantage de ne durer que 38 minutes), on peut prolonger par la belle scène de balançoire du chapitre IV de la première partie d’Une Page d’amour d’ Émile Zola (1878). Voir aussi la scène de séduction de Nana par le petit Georges, avec un… rouge-gorge ! Or Nana est paru en 1880, et a bien pu inspirer Maupassant. Les dernières répliques sont sans doute imitées dans le chapitre IX de La Joie de vivre, d’Émile Zola (1884) : « ils y pensaient continuellement, ils craignaient de s’abattre ensemble, n’importe où, comme frappés de la foudre », mais plus encore au chapitre VI de L’Œuvre, d’Émile Zola (1886).
« Au printemps » n’est pas non plus une pub pour le mariage. Un type rencontré dans un bateau à vapeur empêche le narrateur de lever une grisette, en lui racontant sa triste expérience d’« amours de banlieue » : « En amour, monsieur, nous sommes toujours des naïfs, et les femmes des commerçantes. » Maupassant misogyne ? Cette nouvelle a peut-être inspiré la structure de La Femme et le pantin, de Pierre Louÿs (1898).
« La femme de Paul » est une tragédie de couple hétéro sur fond de bisexualité lesbienne. Paul est un « fils de », amoureux d’une fille qu’il promène en barque dans les bords de Seine vers Bezons, soit le même décor « interlope » que « Une partie de campagne ». Survient une barque supportant quatre lesbiennes, qui suscitent des réactions enthousiastes de la foule :
« Un cri partit de la Grenouillère : « V’là Lesbos ! » et, tout à coup, ce fut une clameur furieuse ; une bousculade effrayante eut lieu ; les verres tombaient ; on montait sur les tables ; tous, dans un délire de bruit, vociféraient : « Lesbos ! Lesbos ! Lesbos ! » Le cri roulait, devenait indistinct, ne formait plus qu’une sorte de hurlement effroyable, puis, soudain, il semblait s’élancer de nouveau, monter par l’espace, couvrir la plaine, emplir le feuillage épais des grands arbres, s’étendre aux lointains coteaux, aller jusqu’au soleil […] Les hommes levaient leurs chapeaux, les femmes agitaient leurs mouchoirs, et toutes les voix, aiguës, ou graves, criaient ensemble : « Lesbos ! » On eût dit que ce peuple, ce ramassis de corrompus, saluait un chef, comme ces escadres qui tirent le canon quand un amiral passe sur leur front. »
Paul est scandalisé, et réagit de la façon la plus homophobe possible : « — C’est honteux ! on devrait les noyer comme des chiennes avec une pierre au cou. », mais sa compagne, Madeleine, ne l’entend pas de cette oreille et le rembarre sans ménagement. Elle est copine avec ces dames, à qui elle a promis de les retrouver au bal ce soir. Elle prend leur défense :
« Sont-elles pas libres de faire ce qu’elles veulent, puisqu’elles ne doivent rien à personne ? Fiche-nous la paix avec tes manières et mêle-toi de tes affaires… »
Ces dames vivent dans une communauté soixante-huitarde avant la lettre : « Elles avaient loué toutes les quatre un petit chalet au bord de l’eau, et elles vivaient là, comme auraient vécu deux ménages. Leur vice était public, officiel, patent. On en parlait comme d’une chose naturelle, qui les rendait presque sympathiques, et l’on chuchotait tout bas des histoires étranges, des drames nés de furieuses jalousies féminines, et des visites secrètes de femmes connues, d’actrices, à la petite maison du bord de l’eau. »
Maupassant est plein d’indulgence pour le pauvre garçon : « C’est qu’il aimait éperdument, sans savoir pourquoi, malgré ses instincts délicats, malgré sa raison, malgré sa volonté même. Il était tombé dans cet amour comme on tombe dans un trou bourbeux. »
L’incompréhension, ici, semble la faute de la femme : « Elle ne comprenait rien de lui ; ils étaient plus séparés que s’ils ne vivaient pas ensemble. Ses baisers n’allaient donc jamais plus loin que les lèvres ? » La femme impose ses volontés sans transiger : « Tu sais ce que je t’ai dit. Si tu n’es pas content, la porte est ouverte. On ne te retient pas. Quant à moi, j’ai promis ; j’irai. »
Enfin, c’est le drame, motivé par une jalousie homophobe : « On parlait de nouveau ; et il s’approcha, courbé en deux. Puis un léger cri courut sous les branches tout près de lui ! Un cri ! Un de ces cris d’amour qu’il avait appris à connaître aux heures éperdues de leur tendresse. Il avançait encore, toujours, comme malgré lui, attiré invinciblement, sans avoir conscience de rien… et il les vit.
Oh ! si c’eût été un homme, l’autre ! mais cela ! cela ! Il se sentait enchaîné par leur infamie même. Et il restait là, anéanti, bouleversé comme s’il eût découvert tout à coup un cadavre cher et mutilé, un crime contre nature, monstrueux, une immonde profanation. » Le pauvre Paul se jette à la Seine, et cette nouvelle semble compléter la nouvelle « Sur l’eau » : on se demande quel drame a poussé cette femme, avec cette « pierre » au cou.
– Un aspect moins réjouissant de notre Guy national est son racisme, mais qu’il faut peut-être éviter de juger à l’aune des avancées de notre siècle. Voir La Comédie indigène, de Lotfi Achour et le recueil Au soleil. Voir aussi Miss Harriet.
– Dix ans auparavant, le maître Zola avait proposé, bien timidement, un couple lesbien en littérature naturaliste, dans La Curée, et l’année précédente, le motif lesbien était très présent dans Nana, avec les amours de Nana et Satin.
– Ce livre fait partie des nombreux ouvrages que j’ai lus pour écrire mon essai Le Contrat universel : au-delà du « mariage gay ». Et si vous l’achetiez ?
Voir en ligne : Site de l’association des amis de Guy de Maupassant
© altersexualite.com 2011-2018
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Anecdote tirée de Ma vie et mes amours, de Frank Harris.
 altersexualite.com
altersexualite.com
