Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Madame Bovary, de Gustave Flaubert
Lire, écrire, publier en TL, pour lycéens et adultes
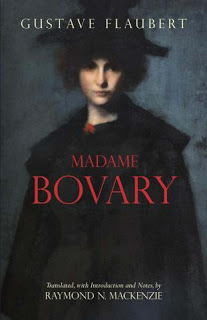 Madame Bovary, de Gustave Flaubert
Madame Bovary, de Gustave Flaubert
Édition de la Pléiade, Gallimard, 2013 (1856).
samedi 23 mai 2015
Cet article vous est proposé à l’occasion du choix de Madame Bovary pour le programme de terminale littéraire des lycées en 2014-2015 et sans doute en 2015-2016. Autant en ce qui concerne les œuvres précédemment programmées, il y avait plus ou moins de neuf à trouver (oui, même pour Lorenzaccio !), autant pour la Bovary, on ne se targuera pas de la moindre idée nouvelle, et nous nous reposerons, nous contentant de réciter le bréviaire flaubertien. Point de surprises, les clés de la Rolls sont dans la boîte à gants. Comme nous sommes sur un site appelé altersexualite.com, l’on se penchera religieusement, le cas échéant (ou le cas surgissant si vous préférez) sur la sexualité de Flaubert, et son rapport avec l’œuvre. Mais commençons par ces quelques notes sur l’apparat critique, puis sur le texte de l’œuvre dans l’édition de la Pléiade, qui est d’ailleurs pour une fois, s’agissant d’une édition récente d’une œuvre de premier plan (remplaçant l’antique édition de 1936), étonnamment sobre. Références : Œuvres complètes, III, 1851-1862, édition publiée sous la direction de Claudine Gothot-Mersch, avec, pour ce volume, la collaboration de Jeanne Bem, Yvan Leclerc, Guy Sagnes et Gisèle Séginger, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2013, 1 vol. (XVIII-1334 p.), 67 €.
Plan de l’article :
Un jeune auteur inconnu
Un livre sur rien
Journal de Madame Bovary
La Publication
Analyse
Madame Bovary : Première partie
Madame Bovary : Deuxième partie
Madame Bovary : Troisième partie
Le procès : le réquisitoire
Le procès : la plaidoirie
Appendices
Articles conseillés
Un jeune auteur inconnu
Bien qu’il ait déjà noirci de quoi remplir un épais volume d’Œuvres de jeunesse dans l’édition de la Pléiade, suivi d’un autre volume d’Œuvres complètes antérieures à Madame Bovary, Flaubert n’avait quasiment rien publié, et c’est un inconnu qui va causer une déflagration inouïe dans le ciel des lettres avec le succès fulgurant de ce premier roman. Madame Bovary est composé entre le 19 septembre 1851 et le printemps 56, pour une parution en revue entre octobre et décembre 56, un procès fin janvier 57 et une publication en volume en avril 57. Voir notre article sur Pierrot au sérail & La Tentation de Saint-Antoine pour savoir ce qui avait poussé Flaubert à entreprendre cette œuvre diamétralement opposée à ce qu’il écrivait jusque-là. Bouleversé par le violent rejet de sa Tentation de Saint-Antoine par ses amis Louis Bouilhet et Maxime Du Camp, après un an et demi de voyage en Orient, il s’attelle à ce nouveau projet, qui l’occupera cinq ans. Chose extraordinaire dans le monde des lettres, l’œuvre littéraire de Flaubert, publiée ou inédite, qui couvrira 4 volumes de Pléiade, soit 6000 pages, se trouve doublée par une correspondance d’un volume équivalent (5 volumes plus un index), et par un ensemble sans doute unique de manuscrits, notes et brouillons, qui, s’il était édité, occuperait 60 000 pages, et qu’on peut consulter sur le site de l’université de Rouen avec une extraordinaire transcription dite diplomatique. Voir ce que cela donne pour la première page du manuscrit, où l’on constate d’ores et déjà l’absence du « Nous » initial de l’incipit, big bang ajouté au dernier moment par Flaubert. À noter que l’œuvre publié de Flaubert a beaucoup à voir avec une date clé méconnue dans l’histoire du papier et de la littérature, le passage, au niveau industriel, du papier à base textile (lin, chanvre), au papier à base ligneuse, vers 1850 (voir l’article pâte à papier de Wikipédia). Cela fait baisser significativement les prix, et contribue à la démocratisation de la lecture.
Un livre sur rien
La fameuse lettre à Louise Colet du 16 janvier 1852 précise l’ambition de l’artiste à la tâche : « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière ; plus l’expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c’est beau. Je crois que l’Avenir de l’Art est dans ces voies. Je le vois, à mesure qu’il grandit, s’éthérisant tant qu’il peut, depuis les pylônes égyptiens jusqu’aux lancettes gothiques, et depuis les poèmes de vingt mille vers des Indiens jusqu’aux jets de Byron. La forme, en devenant habile, s’atténue ; elle quitte toute liturgie, toute règle, toute mesure ; elle abandonne l’épique pour le roman, le vers pour la prose ; elle ne se connaît plus d’orthodoxie et est libre comme chaque volonté qui l’a produit. […] C’est pour cela qu’il n’y a ni beaux ni vilains sujets et qu’on pourrait presque établir comme axiome, en se posant au point de vue de l’Art pur, qu’il n’y en a aucun, le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses ». Mais quel sujet ? Pour préciser ce que Flaubert entend par « livre sur rien », il faut citer aussi ce qui précède dans cette même lettre : « En résumé, il faudrait pour L’Éducation récrire ou du moins recaler l’ensemble, refaire deux ou trois chapitres et, ce qui me paraît le plus difficile de tout, écrire un chapitre qui manque, où l’on montrerait […] pourquoi telle action a amené ce résultat dans ce personnage plutôt que telle autre. Les causes sont montrées, les résultats aussi ; mais l’enchaînement de la cause à l’effet ne l’est point. Voilà le vice du livre, et comment il ment à son titre ». Affirmation à rapprocher de « ce livre est une biographie plutôt qu’une péripétie développée » (lettre du 25 juin 1853 ; cf. ci-dessous).
La critique génétique a isolé le noyau initial de Bovary dans le « roman flamand » que Flaubert envisagea parmi une liste de trois sujets sur lesquels il consulta Bouilhet par une lettre du 14 novembre 1850 : « À propos de sujets, j’en ai trois, qui ne sont peut-être que le même et ça m’emmerde considérablement : 1° Une nuit de Don Juan à laquelle j’ai pensé au lazaret de Rhodes ; 2° l’histoire d’Anubis, la femme qui veut se faire baiser par le Dieu. – C’est la plus haute, mais elle a des difficultés atroces ; 3° mon roman flamand de la jeune fille qui meurt vierge et mystique entre son père et sa mère, dans une petite ville de province, au fond d’un jardin planté de choux et de quenouilles, au bord d’une rivière grande comme l’Eau de Robec. – Ce qui me turlupine, c’est la parenté d’idées entre ces trois plans. Dans le premier, l’amour inassouvissable sous les deux formes de l’amour terrestre et de l’amour mystique. Dans le second, même histoire, seulement on s’y baise et l’amour terrestre est moins élevé en ce qu’il est plus précis. Dans le troisième, ils sont réunis dans la même personne, et l’un mène à l’autre ; mon héroïne seulement en crève de masturbation religieuse après avoir exercé la masturbation digitale ».
Flaubert s’inspire principalement d’un fait divers local, le suicide de Delphine Delamare à Ry, mais aussi de l’affaire Loursel (1844), qui eut lieu à Buchy, près de Ry, impliquant « un pharmacien qui avait une liaison extraconjugale avec une demoiselle de Bovery » (p. 1107), détail qui a peut-être inspiré à Posy Simmonds le titre de Gemma Bovery. Trente ans plus tard, Zola pratiquera de même pour La Bête humaine. Il retrouve l’inspiration d’un conte de jeunesse, Passion et vertu (1837). Pour sa documentation, Flaubert, qui connaît déjà intimement Rouen et la région et les mœurs de toutes les classes sociales grâce aux domestiques de la famille, interroge des érudits et dévore des livres variés. Il utilise aussi un document intitulé « Mémoires de Mme Ludovica » (on en reparlera ci-dessous), concernant « les désordres sentimentaux et financiers de Louise Pradier », qui lui sera utile pour imaginer le « lien étroit entre emballement érotique et spirale de la ruine » (p. 1110). Pour la scène de l’opération, Flaubert a utilisé un Traité pratique du pied-bot (1839) de Vincent Duval, dans lequel est relatée une opération ratée du propre père du romancier, médecin. Le manuscrit du « livre sur rien » comprend 1800 feuillets, et s’il est divisé en parties, ce n’est qu’au dernier moment qu’apparaît la division en chapitres (cf. p. 1115).
Journal de Madame Bovary
C’est pendant la rédaction de ce roman que Flaubert décide de conserver toutes les traces de son écriture, sans savoir qu’il ferait un siècle plus tard le bonheur des chantres de la critique génétique. Il s’en explique dans une lettre à Louise Colet du 15 avril 1852 : « Quand mon roman sera fini, dans un an, je t’apporterai mon manuscrit complet par curiosité. Tu verras par quelle mécanique compliquée j’arrive à faire une phrase ». Il écrit ces lettres la nuit, dans un état second, et elles permettent de suivre son œuvre. Cela commence par « J’ai commencé hier au soir mon roman. J’entrevois maintenant des difficultés de style qui m’épouvantent. Ce n’est pas une petite affaire que d’être simple. J’ai peur de tomber dans le Paul de Kock ou de faire du Balzac chateaubrianisé », le 20 septembre 1851.
L’origine du nom de Bovary est expliquée p. 1108, à partir de Bovery déjà cité, de la référence bovine que l’on retrouvera dans Bouvard et Pécuchet, et peut-être de Ry, mais plus bizarrement, d’un M. Bouvaret que Flaubert avait rencontré au Caire, ce dont il ne se souvient que dans une lettre du 20 mars 1870 ! Les lettres de 1852 font un sort à la phrase apocryphe « Mme Bovary c’est moi ». En effet, s’il peut écrire sur un ton badin : « J’ai fini ce soir de barbouiller la première idée de mes rêves de jeune fille. J’en ai pour quinze jours encore à naviguer sur ces lacs bleus, après quoi j’irai au bal et passerai ensuite un hiver pluvieux, que je clorai par une grossesse. Et le tiers de mon livre à peu près sera fait » (27 mars), il précise en juin : « J’ai repris mon travail. J’espère qu’il va aller, mais franchement Bovary m’ennuie. Cela tient au sujet et aux retranchements perpétuels que je fais. Bon ou mauvais, ce livre aura été pour moi un tour de force prodigieux, tant le style, la composition, les personnages et l’effet sensible sont loin de ma manière naturelle. Dans Saint Antoine j’étais chez moi. Ici, je suis chez le voisin ; aussi je n’y trouve aucune commodité », et le 26 juillet : « Les livres que j’ambitionne le plus de faire sont justement ceux pour lesquels j’ai le moins de moyens. Bovary, en ce sens, aura été un tour de force inouï et dont moi seul jamais aurai conscience : sujet, personnage, effet, etc. , tout est hors de moi. Cela devra me faire faire un grand pas par la suite. Je suis, en écrivant ce livre, comme un homme qui jouerait du piano avec des balles de plomb sur chaque phalange. Mais quand je saurai bien mon doigté, s’il me tombe sous la main un air de mon goût et que je puisse jouer les bras retroussés, ce sera peut-être bon. Je crois, du reste, qu’en cela je suis dans la ligne. Ce que vous faites n’est pas pour vous, mais pour les autres. L’Art n’a rien à démêler avec l’artiste ».
S’il pratique le « gueuloir », Flaubert esquisse une théorie de la prose pour Louise Colet, dont il corrige d’ailleurs les poèmes : « Quelle chienne de chose que la prose ! Ça n’est jamais fini ; il y a toujours à refaire. Je crois pourtant qu’on peut lui donner la consistance du vers. Une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers, inchangeable, aussi rythmée, aussi sonore. Voilà du moins mon ambition (il y a une chose dont je suis sûr, c’est que personne n’a jamais eu en tête un type de prose plus parfait que moi ; mais quant à l’exécution, que de faiblesses, que de faiblesses mon Dieu !). Il ne me paraît pas non plus impossible de donner à l’analyse psychologique la rapidité, la netteté, l’emportement d’une narration purement dramatique. Cela n’a jamais été tenté et serait beau. Y ai-je réussi un peu ? Je n’en sais rien. À l’heure qu’il est je n’ai aucune opinion nette sur mon travail » (22 juillet 1852). Les dialogues font l’objet de projets spécifiques. Ainsi de la première rencontre d’Emma et Léon, travaillée comme un quatuor, avec dans les Notes de régie l’expression « Dans l’entre deux du quatuor, charme d’Emma – effet qu’elle fait sur Léon – leur dialogue indirect d’abord – puis direct (en petites choses significatives, sympathiques) ». Voici ce qu’en dit notre ami Gustave : « Je suis à faire une conversation d’un jeune homme et d’une jeune dame sur la littérature, la mer, les montagnes, la musique, tous les sujets poétiques enfin. – On pourrait la prendre au sérieux et elle est d’une grande intention de grotesque. Ce sera, je crois, la première fois que l’on verra un livre qui se moque de sa jeune première et de son jeune premier. L’ironie n’enlève rien au pathétique ; elle l’outre au contraire » (9 octobre 1852). Dernière phrase importante pour éviter de se méprendre sur l’ironie de Flaubert, qui n’est pas celle de Voltaire.
La métaphore musicale est aussi utilisée pour la scène des comices agricoles, qui nous vaut une des plus belles envolées épistolaire : « J’ai la tête en feu, comme il me souvient de l’avoir eue après de longs jours passés à cheval. C’est que j’ai aujourd’hui rudement chevauché ma plume. J’écris depuis midi et demi sans désemparer (sauf de temps à autre pendant cinq minutes pour fumer une pipe, et une heure tantôt pour dîner). Mes comices m’embêtaient tellement que j’ai lâché là, pour jusqu’à ce qu’ils soient finis, grec et latin. Et je ne fais plus que ça à partir d’aujourd’hui. Ça dure trop ! Il y a de quoi crever, et puis je veux t’aller voir. Bouilhet prétend que ce sera la plus belle scène du livre. Ce dont je suis sûr, c’est qu’elle sera neuve et que l’intention en est bonne. Si jamais les effets d’une symphonie ont été reportés dans un livre, ce sera là. Il faut que ça hurle par l’ensemble, qu’on entende à la fois des beuglements de taureaux, des soupirs d’amour et des phrases d’administrateurs. Il y a du soleil sur tout cela, et des coups de vent qui font remuer les grands bonnets. Mais les passages les plus difficiles de Saint Antoine étaient jeux d’enfant en comparaison. J’arrive au dramatique rien que par l’entrelacement du dialogue et les oppositions de caractère. Je suis maintenant en plein. Avant huit jours, j’aurai passé le nœud d’où tout dépend. Ma cervelle me semble petite pour embrasser d’un seul coup d’œil cette situation complexe. J’écris dix pages à la fois, sautant d’une phrase à l’autre » (12 octobre 1853).
La Publication
Bovary est enfin publié dans la Revue de Paris en six livraisons, du 1er octobre au 15 décembre 1856, avec des passages entiers censurés, dont bien sûr la scène du fiacre. Flaubert exige une note de son ami Maxime, et une autre de lui-même : « Des considérations que je n’ai pas à apprécier ont contraint la Revue de Paris à faire une suppression dans le numéro du 1er décembre 1856. Ses scrupules s’étant renouvelés à l’occasion du présent numéro, elle a jugé convenable d’enlever encore plusieurs passages. En conséquence, je déclare dénier la responsabilité des lignes qui suivent ; le lecteur est donc prié de n’y voir que des fragments et non pas un ensemble ». Le procès entraîne un succès fulgurant, inouï au XIXe siècle, et le mot « bovaryste » est né : « Les « dames » se sont fortement mêlées de ton serviteur et frère ou plutôt de son livre, surtout la princesse de Beauvau, qui est une « Bovaryste » enragée et qui a été deux fois chez l’Impératrice pour faire arrêter les poursuites » (à Achille, le 6 janvier 1857). Le procès, fameux par la qualité des arguments des deux parties, sera annexé au roman dès 1873, sur proposition de l’éditeur Charpentier. La critique accuse parfois le roman de réalisme, de « roman démocrate » (A. de Pontmartin) ; traite Flaubert de « machine à raconter » (Barbey d’Aurevilly).
Analyse
L’héroïne est à la fois unique et représentative d’un type de femme. À commencer par la « seconde », celle qui épouse un veuf d’un milieu social plus élevé qu’elle (p. 1127). Elle est aussi représentative de la médiocrité bourgeoise typique du monde mis en place par le coup d’État du 2 décembre 1851, après quoi Flaubert écrit son livre. « La question qui traverse Madame Bovary est purement ontologique, tchékhovienne pourrait-on dire : « Est-il possible de vivre dans le monde qui nous est imparti ? » » (p. 1137). Très proche de Charles Baudelaire (1821-1867), né la même année que lui, et connaissant le même succès de scandale en 1857, Flaubert est comme le poète un chantre de la « modernité », mot inventé par Baudelaire selon la Pléiade (p. 1128, alors que Chateaubriand l’a utilisé en 1848). Son héroïne a la bougeotte, même si elle ne prend jamais le train, et « l’adultère est en soi une figure de la mobilité » (p. 1128). Emma prend l’Hirondelle, se déplace seule, fait du shopping, fume… Si Flaubert est un grand lecteur de Sade, il est allé aussi loin que possible dans l’érotisme, et dans les « lectures interdites » attribuées à son héroïne, sans faire tomber son livre dans la catégorie libertine qui l’aurait fait circuler sous le manteau. Il se pose clairement le problème dans ses lettres : « J’ai une baisade qui m’inquiète fort et qu’il ne faudra pas biaiser, quoique je veuille la faire chaste, c’est-à-dire littéraire, sans détails lestes, ni images licencieuses ; il faudra que le luxurieux soit dans l’émotion » (2 juillet 1853). Les scénarios révèlent les intentions sadiennes : « Départs de Rouen noyée de foutre, de larmes, de cheveux & de champagne » ; « avec Rodolphe elle était au second plan elle était sa maîtresse. ici elle au premier c’est Léon plutôt qui est sa maîtresse » ; « sang au doigt de Léon qu’elle suce / amour si violent qu’il tourne au sadisme / Manière féroce dont elle se déshabillait jetant tout à bas après les fouteries » (en marge du même folio, orthographe respectée). Flaubert s’est souvenu de la pièce Antony d’Alexandre Dumas pour les dialogues avec Rodolphe.
L’histoire de Charles emboîte celle de l’héroïne éponyme, détour indispensable au XIXe siècle. Jean Amery a écrit un roman intitulé Charles Bovary, médecin de campagne, mais aussi deux autres auteurs se sont penchés sur Monsieur Bovary, Laura Grimaldi, (Métailié, 1995) et Antoine Billot (Gallimard, 2006). L’étude des variantes et du manuscrit montre un Charles moins fade qu’on pourrait le trouver au premier abord, comme le laissent prévoir certains passages en focalisation interne où sa sensualité regardant Emma se fait jour (cf. p. 1136 : « Comme un héros d’opéra, il meurt d’amour »). La description d’Yonville au début de la 2e partie rappelle l’entrée dans Verrières au début du Rouge et le Noir de Stendhal. De nombreuses références à des coutumes normandes émaillent le récit, auxquelles Emma fait des entorses, avec son hybris (p. 1139). Mais ces références au sacré s’opposent aussi à l’industrialisme contre lequel vitupère Flaubert : « Gueulons donc contre les gants de bourre de soie, contre les fauteuils de bureau, contre le mackintosh, contre les caléfacteurs économiques, contre les fausses étoffes, contre le faux luxe, contre le faux orgueil ! L’industrialisme a développé le laid dans des proportions gigantesques ! Combien de braves gens qui, il y a un siècle, eussent parfaitement vécu sans Beaux-Arts, et à qui il faut maintenant de petites statuettes, de petite musique et de petite littérature ! Que l’on réfléchisse seulement quelle effroyable propagation de mauvais dessins ne doit pas faire la lithographie ! […] Nous sommes tous des farceurs et des charlatans. Pose, pose et blague partout ! La crinoline a dévoré les fesses, notre siècle est un siècle de putains, et ce qu’il y a de moins prostitué, jusqu’à présent, ce sont les prostituées » (29 janvier 1854). La nouveauté de Madame Bovary réside peut-être dans le fait que « ce livre est une biographie plutôt qu’une péripétie développée. Le drame y a peu de part et, si cet élément dramatique est bien noyé dans le ton général du livre, peut-être ne s’apercevra-t-on pas de ce manque d’harmonie entre les différentes phases, quant à leur développement. Et puis il me semble que la vie en elle-même est un peu ça. Un coup dure une minute et a été souhaité pendant des mois ! Nos passions sont comme les volcans : elles grondent toujours, mais l’éruption n’est qu’intermittente » (25 juin 1853). La filiation de ce type de récit marqué par l’effacement de l’intrigue et du personnage se fait en amont avec Par les champs et par les grèves, en aval avec « Un cœur simple » (p. 1142).
Madame Bovary : Première partie
Cette première partie contient en analepse les éducations opposées de Charles et d’Emma, le premier bref mariage de Charles, la rencontre et le mariage avec Emma, et les désillusions du mariage jusqu’à la décision de quitter Tostes pour le bien d’Emma, qui tombe enceinte.
Chapitre I. Le fameux « nous », big bang du roman inventé au dernier moment, me semble prendre sens dans l’édition Pléiade par le fait qu’il se retrouve exactement en vis-à-vis de la dédicace « À Louis Bouilhet », camarade de lycée de Flaubert et toujours son grand ami. Cela me semble relever du clin d’œil. Ce pronom « nous » est utilisé très exactement à huit reprises, et la dernière occurrence : « Il serait maintenant impossible à aucun de nous de se rien rappeler de lui » (noter au passage la construction « se rappeler de lui »), semble passer la main au narrateur omniscient. Le portrait en analepse des parents de Charles donne un aperçu édifiant du beau-père d’Emma, si différent de son fils : « Elle avait tant souffert, sans se plaindre, d’abord, quand elle le voyait courir après toutes les gotons de village et que vingt mauvais lieux le lui renvoyaient le soir, blasé et puant l’ivresse ! » Après le collège, ses parents décident de le mettre à la médecine. On l’installe dans le quartier peu salubre du Robec [1], et laissé à lui-même, le pauvre Charles délaisse les cours et se laisse tenter par les cabarets et les mauvaises fréquentations, ce qui rend par contraste étonnant qu’il se range si facilement une fois marié. Enfant de la ville, sa conception de la nature est diamétralement opposée à celle d’Emma (cf. ch. VI), comme le montre cette magistrale description du paysage vu de sa fenêtre en focalisation interne : « il ouvrait sa fenêtre et s’accoudait. La rivière, qui fait de ce quartier de Rouen comme une ignoble petite Venise, coulait en bas, sous lui, jaune, violette ou bleue entre ses ponts et ses grilles. […] En face, au-delà des toits, le grand ciel pur s’étendait, avec le soleil rouge se couchant. Qu’il devait faire bon là-bas ! Quelle fraîcheur sous la hêtrée ! [2] Et il ouvrait les narines pour aspirer les bonnes odeurs de la campagne, qui ne venaient pas jusqu’à lui ». Une phrase rend compte ironiquement de ses progrès rapides : « Alors, beaucoup de choses comprimées en lui, se dilatèrent ; il apprit par cœur des couplets qu’il chantait aux bienvenues, s’enthousiasma pour Béranger, sut faire du punch et connut enfin l’amour ». Madame Bovary mère (la première des trois femmes susceptibles de porter ce nom) veille au grain, et Charles finit par réussir son examen d’officier de santé. En un sommaire accéléré, on en vient aux deux questions essentielles : « Mais ce n’était pas tout que d’avoir élevé son fils, de lui avoir fait apprendre la médecine et découvert Tostes pour l’exercer : il lui fallait une femme. Elle lui en trouva une : la veuve d’un huissier de Dieppe, qui avait quarante-cinq ans et douze cents livres de rente. » On apprécie la vitesse narrative accouplée à l’ironie du zeugme, zeugme qui fait rebelote à la dernière phrase du chapitre, après la belle idylle avec cette seconde madame Bovary, expédiée en trois paragraphes : « elle finissait en lui demandant quelque sirop pour sa santé et un peu plus d’amour ».
Chapitre II. Flaubert n’a pas perdu de temps, et le lecteur, déjà pourvu de deux « Mme Bovary », une « Mme Bovary jeune » et une « Mme Bovary mère », va bientôt faire connaissance d’une troisième. La première occurrence du titre dans le roman est une fausse piste doublement ironique : « La nuit était noire. Mme Bovary jeune redoutait les accidents pour son mari ». En effet, d’une part, quinze ans après La Femme de trente ans de Balzac, peut-on sans rire traiter de « jeune » une femme de 45 ans ? D’autre part, son mari va effectivement être victime d’un bel accident, puisque en soignant M. Rouault, il va tomber amoureux de celle qui deviendra la Madame Bovary du titre après la mort de « Mme Bovary jeune » ! Emma fait son apparition dans le roman sous l’avatar de « demoiselle » : « Il [M. Rouault] n’avait avec lui que sa demoiselle, qui l’aidait à tenir la maison ». Une page après, c’est « Mlle Emma » qui coud des coussinets pour l’attelle de son père, et « elle se piquait les doigts, qu’elle portait ensuite à sa bouche pour les sucer » (galopin de Gustave !) Premier portrait d’Emma en focalisation interne, qui se termine par un oxymore : « son regard arrivait franchement à vous avec une hardiesse candide ». Tout est dit ! C’est le succès : « Le père Rouault disait qu’il n’aurait pas été mieux guéri par les premiers médecins d’Yvetot ou même de Rouen ». Derrière la mention d’Yvetot se cache l’ironie de Flaubert ; en effet, voilà une entrée du Dictionnaire des Idées Reçues (que nous abrégerons dorénavant DIR), oubliée dans cet excellent article de recension des rapports entre les deux œuvres : « voir Yvetot et mourir ». La veuve « sut qu’il avait une fille », devient jalouse, interdit à Charles d’y retourner, et… « cette défense de la voir était pour lui comme un droit de l’aimer ». C’est la ligue des deux « Mme Bovary », jeune et mère, « comme deux couteaux, elles étaient à le scarifier par leurs réflexions et leurs observations ». La veuve, « une haridelle semblable, dont les harnais ne valaient pas la peau » (belle anaphore doublée du jeu sur le double h aspiré), ayant perdu sa dot, nous est expédiée en deux courts paragraphes, qui laissent le bon Charles rêveur : « Elle l’avait aimé, après tout » !
Le Chapitre III est celui de la demande, ou plutôt de la non-demande en mariage, puisque Charles est trop ballot pour pouvoir formuler sa demande, que le père Rouault, beaucoup moins aisé que ne le croit Charles, a comprise d’abord : « Lorsqu’il s’aperçut donc que Charles avait les pommettes rouges près de sa fille, ce qui signifiait qu’un de ces jours on la lui demanderait en mariage, il rumina d’avance toute l’affaire ». C’est au signal convenu : « je pousserai tout grand l’auvent de la fenêtre contre le mur », que Charles saura que la réponse est oui. Parodie triviale des signaux tragiques, comme la voile noire d’Égée ou de Tristan. Emma aurait « désiré se marier à minuit, aux flambeaux », mais ce sera une noce traditionnelle.
Le Chapitre IV lance le thème de l’inversion sexuelle : « Le lendemain, en revanche, il semblait un autre homme. C’est lui plutôt que l’on eût pris pour la vierge de la veille, tandis que la mariée ne laissait rien découvrir où l’on pût deviner quelque chose ». C’est bien Emma qui porte la culotte face à ce mari falot.
Chapitre V. C’est la visite guidée de la maison, en focalisation interne : « il y avait, dans une carafe, un bouquet de fleurs d’oranger, noué par des rubans de satin blanc. C’était un bouquet de mariée, le bouquet de l’autre ! Elle le regarda. […] Emma songeait à son bouquet de mariage, qui était emballé dans un carton, et se demandait, en rêvant, ce qu’on en ferait, si par hasard elle venait à mourir ». L’idylle révèle l’abîme entre les époux. D’un côté, Charles considère sa femme comme une poupée, un jouet : « le cœur plein des félicités de la nuit, l’esprit tranquille, la chair contente, il s’en allait ruminant son bonheur, comme ceux qui mâchent encore, après dîner, le goût des truffes qu’ils digèrent » ; « à présent, il possédait pour la vie cette jolie femme qu’il adorait. L’univers, pour lui, n’excédait pas le tour soyeux de son jupon », mais c’est à nouveau elle qui le rejette comme un enfant : « Il ne pouvait se retenir de toucher continuellement à son peigne, à ses bagues, à son fichu ; quelquefois, il lui donnait sur les joues de gros baisers à pleine bouche, ou c’étaient de petits baisers à la file tout le long de son bras nu, depuis le bout des doigts jusqu’à l’épaule ; et elle le repoussait, à demi souriante et ennuyée, comme on fait à un enfant qui se pend après vous ». On ne s’étonne pas qu’elle soit déçue, un peu comme si les livres avaient été une publicité mensongère sur l’amour : « Avant qu’elle se mariât, elle avait cru avoir de l’amour ; mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n’étant pas venu, il fallait qu’elle se fût trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l’on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d’ivresse, qui lui avaient paru si beaux dans les livres ». Flaubert s’est amusé à opposer les « félicités de la nuit » au pluriel, qui comblent Charles, et la félicité au singulier, qui manque à Emma.
Le Chapitre VI évoque l’éducation d’Emma au couvent, ses lectures qui déforment sa compréhension de la religion ; extrait qui constituera au procès une pièce à charge : « Quand elle allait à confesse, elle inventait de petits péchés, afin de rester là plus longtemps, à genoux dans l’ombre, les mains jointes, le visage à la grille sous le chuchotement du prêtre. Les comparaisons de fiancé, d’époux, d’amant céleste et de mariage éternel qui reviennent dans les sermons lui soulevaient au fond de l’âme des douceurs inattendues ». Sa conception du paysage est à l’opposé de celle de Charles : « Si son enfance se fût écoulée dans l’arrière-boutique d’un quartier marchand, elle se serait peut-être ouverte alors aux envahissements lyriques de la nature, qui, d’ordinaire, ne nous arrivent que par la traduction des écrivains [notons l’ironie]. Mais elle connaissait trop la campagne ; elle savait le bêlement des troupeaux, les laitages, les charrues. Habituée aux aspects calmes, elle se tournait, au contraire, vers les accidentés. Elle n’aimait la mer qu’à cause de ses tempêtes, et la verdure seulement lorsqu’elle était clairsemée parmi les ruines ». Grâce à une « vieille fille […] protégée par l’archevêché », Emma est conditionnée aux motifs romanesques : « Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes, dames persécutées s’évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu’on tue à tous les relais, chevaux qu’on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l’est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes ». Elle est aussi frappée au couvent par les « assiettes peintes qui représentaient l’histoire de Mlle de La Vallière. Les explications légendaires, coupées çà et là par l’égratignure des couteaux, glorifiaient toutes la religion, les délicatesses du cœur et les pompes de la Cour ». Beau zeugme souligné par un groupe ternaire. Quand elle quitte le couvent, on ne la regrette pas, mais elle le regrette : « Quand son père la retira de pension, on ne fut point fâché de la voir partir ». Le mariage déçoit son espoir : « elle ne pouvait s’imaginer à présent que ce calme où elle vivait fût le bonheur qu’elle avait rêvé ».
Le Chapitre VII analyse la déception d’Emma : « La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d’émotion, de rire ou de rêverie. […] Un homme, au contraire, ne devait-il pas tout connaître, exceller en des activités multiples, vous initier aux énergies de la passion, aux raffinements de la vie, à tous les mystères ? Mais il n’enseignait rien, celui-là, ne savait rien, ne souhaitait rien. Il la croyait heureuse ; et elle lui en voulait de ce calme si bien assis, de cette pesanteur sereine, du bonheur même qu’elle lui donnait » ; « Ses expansions étaient devenues régulières ; il l’embrassait à de certaines heures. C’était une habitude parmi les autres, et comme un dessert prévu d’avance, après la monotonie du dîner ». Mme Bovary mère n’apprécie pas Emma : « elle observait le bonheur de son fils avec un silence triste comme quelqu’un de ruiné qui regarde, à travers les carreaux, des gens attablés dans son ancienne maison ». Emma gamberge vite et se fait romancière de sa propre vie : « – Pourquoi, mon Dieu ! me suis-je mariée ? Elle se demandait s’il n’y aurait pas eu moyen, par d’autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme ; et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu’elle ne connaissait pas ».
Le Chapitre VIII relate l’invitation exceptionnelle « à la Vaubyessard, chez le marquis d’Andervilliers ». Elle admire le groupe des aristocrates : « Ceux qui commençaient à vieillir avaient l’air jeune, tandis que quelque chose de mûr s’étendait sur le visage des jeunes. Dans leurs regards indifférents flottait la quiétude de passions journellement assouvies ; et, à travers leurs manières douces, perçait cette brutalité particulière que communique la domination de choses à demi faciles, dans lesquelles la force s’exerce et où la vanité s’amuse, le maniement des chevaux de race et la société des femmes perdues » (nouveau zeugme). Comme cette invitation demeurera unique, ce sera l’occasion d’une éternelle nostalgie : « Son voyage à la Vaubyessard avait fait un trou dans sa vie ».
Le Chapitre IX se moque de l’usage utilitaire des romans par Emma, et donc du réalisme balzacien avec ses Scènes de la vie parisienne : « Elle étudia, dans Eugène Sue, les descriptions d’ameublements ; elle lut Balzac et George Sand, y cherchant des assouvissements imaginaires pour ses convoitises personnelles. […] Paris, plus vague que l’Océan, miroitait donc aux yeux d’Emma dans une atmosphère vermeille. La vie nombreuse qui s’agitait en ce tumulte y était cependant divisée par parties, classée en tableaux distincts. Emma n’en apercevait que deux ou trois qui lui cachaient tous les autres, et représentaient à eux seuls l’humanité complète ». À rapprocher de l’« Avant-propos de la Comédie humaine » : « en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l’histoire oubliée par tant d’historiens, celle des mœurs ». Ce petit bout de la lorgnette lui fait haïr les trivialités du quotidien : « Elle confondait, dans son désir, les sensualités du luxe avec les joies du cœur, l’élégance des habitudes et les délicatesses du sentiment. […] Les soupirs au clair de lune, les longues étreintes, les larmes qui coulent sur les mains qu’on abandonne, toutes les fièvres de la chair et les langueurs de la tendresse ne se séparaient donc pas du balcon des grands châteaux qui sont pleins de loisirs, d’un boudoir à stores de soie avec un tapis bien épais, des jardinières remplies, un lit monté sur une estrade, ni du scintillement des pierres précieuses et des aiguillettes de la livrée ». Quand elle comprend qu’elle ne sera pas à nouveau invitée au grand bal, l’ennui la saisit, qui prend des accents baudelairiens : « L’avenir était un corridor tout noir, et qui avait au fond sa porte bien fermée. Elle abandonna la musique. Pourquoi jouer ? qui l’entendrait ? […] « J’ai tout lu », se disait-elle. […] Comme elle était triste le dimanche, quand on sonnait les vêpres ! Elle écoutait, dans un hébétement attentif, tinter un à un les coups fêlés de la cloche ». Cela arrive à un point tel que Charles décide de déménager de Tostes, alors que « Mme Bovary était enceinte ».
Madame Bovary : Deuxième partie
Chapitre I. C’est l’arrivée à Yonville-l’Abbaye, sa description ironique et prémonitoire : « Il n’y a plus ensuite rien à voir dans Yonville. La rue (la seule), longue d’une portée de fusil et bordée de quelques boutiques, s’arrête court au tournant de la route. Si on la laisse sur la droite et que l’on suive le bas de la côte Saint-Jean, bientôt on arrive au cimetière ». Cette description sera pastichée par Zola au chapitre I de La Joie de vivre : « C’était là tout Bonneville ». Habilement, Flaubert met en place tous ses personnages, que ce soit à l’auberge de « Mme veuve Lefrançois », avec la profession de foi anticléricale de M. Homais : « J’adore Dieu, au contraire ! Je crois en l’Être suprême, à un Créateur, quel qu’il soit, peu m’importe, qui nous a placés ici-bas pour y remplir nos devoirs de citoyen et de père de famille ; mais je n’ai pas besoin d’aller, dans une église, baiser des plats d’argent, et engraisser de ma poche un tas de farceurs qui se nourrissent mieux que nous ! », ou dans l’Hirondelle, qui amène les Bovary, et dans laquelle comme par hasard M. Lheureux sera déjà en place pour amadouer Emma de ses lénifiantes paroles.
Le Chapitre II nous présente malicieusement Léon d’abord par son regard sur Emma, dont il contemple les jambes malicieusement assimilées à des gigots dans un paragraphe dont le suivant, réduit à deux lignes, nous prouve que le point de vue était celui de Léon : « Mme Bovary, quand elle fut dans la cuisine, s’approcha de la cheminée. Du bout de ses deux doigts, elle prit sa robe à la hauteur du genou, et, l’ayant ainsi remontée jusqu’aux chevilles, elle tendit à la flamme, par-dessus le gigot qui tournait, son pied chaussé d’une bottine noire. Le feu l’éclairait en entier, pénétrant d’une lumière crue la trame de sa robe, les pores égaux de sa peau blanche et même les paupières de ses yeux qu’elle clignait de temps à autre. […]
De l’autre côté de la cheminée, un jeune homme à chevelure blonde la regardait silencieusement ». C’est alors le « quatuor », entre le discours pompeux de Homais, et les saillies romantiques d’Emma et Léon, qui se compose à peu de frais un éthos digne de l’icône romantique, Le Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich, où les Alpes sont remplacées par le haut d’une Pâture, avec un P majuscule, comme il se doit ! « Il y a un endroit que l’on nomme la Pâture, sur le haut de la côte, à la lisière de la forêt. Quelquefois, le dimanche, je vais là, et j’y reste avec un livre, à regarder le soleil couchant ». Suit une discussion littéraire, où Emma nous apprend opportunément qu’« [elle] déteste les héros communs et les sentiments tempérés, comme il y en a dans la nature ».
Le Chapitre III est celui de l’installation dans la nouvelle maison et de la naissance de Berthe. Emma « souhaitait un fils ; il serait fort et brun, elle l’appellerait Georges ; et cette idée d’avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ses impuissances passées. Un homme, au moins, est libre ; il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre aux bonheurs les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement. Inerte et flexible à la fois, elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cordon, palpite à tous les vents, il y a toujours quelque désir qui entraîne, quelque convenance qui retient ». Malheureusement c’est une nouvelle Mlle Bovary qui naît, et le choix du prénom occupe une page qui n’est pas fortuite. En effet, la coutume était de donner les prénoms des ascendants, sinon des parrains, ou du moins de leur demander. Or on ne demande à personne, pas même à la mère de Charles, la seule personne pieuse parmi l’ascendance de la petite, qui est la marraine. Même lors de la scène scandaleuse de la fête du baptême, Flaubert n’a pas voulu que « Mme Bovary mère » se scandalisât de l’attitude de « M. Bovary père [qui] exigea que l’on descendît l’enfant, et se mit à le baptiser avec un verre de champagne qu’il lui versait de haut sur la tête. Cette dérision du premier des sacrements indigna l’abbé Bournisien ». Homais chante Le Dieu des bonnes gens de Pierre-Jean de Béranger, cité à plusieurs reprises dans le roman, et à propos duquel Flaubert exprime une admiration réticente dans une lettre à Louise Colet du 27 septembre 1946 : « Béranger, depuis trente ans, défraye les amours d’étudiants et les rêves sensuels des commis voyageurs. Je sais bien que ce n’est [pas] pour eux qu’il écrit ; mais c’est surtout ces gens-là qui le sentent. […] Béranger, quant à moi, ne me parle ni de mes passions ni de mes rêves, ni de ma poésie. Je le lis historiquement, car c’est un homme d’un autre âge. Il était vrai dans son temps, il ne l’est plus pour le nôtre. […] on admire ça comme l’hymne d’une religion disparue, mais on ne le sent pas. J’ai vu tant d’imbéciles, tant de bourgeois étroits, chanter « ses gueux » et « son Dieu des bonnes gens », qu’il faut vraiment que ce soit un grand poète pour avoir résisté dans mon esprit à tous ces ébranlements prodigieux ». Quant à Bovary père, il « répondit par une citation de la Guerre des dieux ». Il s’agit d’une épopée parodique violemment anticléricale d’Évariste de Parny (1753-1814), ce qui contribue à dater l’œuvre avec le genre de littérature que Flaubert devait lire dans sa jeunesse. Le même chapitre fait coexister la naissance de l’enfant avec l’idylle avortée Emma-Léon, qui ne comprennent pas même qu’ils s’aiment : « tandis qu’ils s’efforçaient à trouver des phrases banales, ils sentaient une même langueur les envahir tous les deux ; c’était comme un murmure de l’âme, profond, continu, qui dominait celui des voix ». Léon médite dans sa « Pâture », et bizarrement, quand il fait l’inventaire du cheptel humain d’Yonville, à part « la femme du pharmacien » qui « ne possèd[e] de son sexe autre chose que la robe », il ne voit que des hommes. Flaubert n’est certes pas Maupassant, qui ferait au moins jeter à son jeune premier un œil intéressé sur les classes sociales inférieures !
Le Chapitre IV relate les soirées bourgeoises de ces notabilités yonvillaises. Beau portrait d’Emma du point de vue interne de Léon : « Léon, derrière elle, lui donnait des avis. Debout et les mains sur le dossier de sa chaise, il regardait les dents de son peigne qui mordait son chignon. À chaque mouvement qu’elle faisait pour jeter les cartes, sa robe du côté droit remontait. De ses cheveux retroussés, il descendait une couleur brune sur son dos, et qui, s’apâlissant graduellement, peu à peu se perdait dans l’ombre. Son vêtement, ensuite, retombait des deux côtés sur le siège, en bouffant, plein de plis, et s’étalait jusqu’à terre. Quand Léon parfois sentait la semelle de sa botte poser dessus, il s’écartait, comme s’il eût marché sur quelqu’un ». Évidemment, cette position en retrait du jeune homme est très féminine. Il ne manque à Emma que de fumer ! Faute de se taper Emma, Léon se replie sur Charles : « Son mari, n’était-ce pas quelque chose d’elle ? » Une autocensure est intéressante, l’histoire du gant. Le texte publié s’arrête à cette phrase précédente, mais le manuscrit continuait ainsi : « Chez le pharmacien, un soir Me Bovary tout en cousant, laissa tomber son gant par terre. Léon le poussa sous la table, puis quand on fut couché, il descendit à tâtons, le trouva sans peine et revint dans son lit. c’était un gant de couleur jaune, avec de petites rides sur les phalanges ; et la peau même semblait soulevée davantage au gd morceau du pouce, à cet endroit de la main, où il y a le plus de chair. Léon cligna les yeux. et il l’entrevit au poignet d’Emma, boutonné tendu, agissant coquettement en mille fonctions indéterminées. Il le huma. il le baisa. il y passa les quatre doigts de sa main droite et s’endormit la bouche dessus. Quant à Emma… » (variantes, Pléiade, p. 1153). Plus prosaïquement dans ses notes de régie (n° 63), Flaubert précisait : « Faire comprendre qu’il se branle avec ce gant » !
Le Chapitre V raconte la visite de la « filature de lin », du genre où finira Berthe (« filature de coton », dans l’excipit). C’est maintenant Emma qui voit en focalisation interne son mari de dos : « son dos même, son dos tranquille était irritant à voir, et elle y trouvait étalée sur la redingote toute la platitude du personnage. Pendant qu’elle le considérait, goûtant ainsi dans son irritation une sorte de volupté dépravée, Léon s’avança d’un pas ». Puis c’est l’intervention d’un personnage clé déjà entrevu dans l’Hirondelle, le marchand Lheureux, qui utilise un argument de poids : « nous ne sommes pas des juifs ! ». Il ne semble pas y avoir d’ironie dans ce mot, typique, selon les notes, de l’antisémitisme en vigueur dont Flaubert n’était pas exempt (cf. infra ce qu’en dira Senard dans sa plaidoirie). À propos de la petite Berthe, Flaubert fait un signe à Hugo en évoquant la « Sachette » de Notre-Dame de Paris, personnage misérable qui pleure la perte d’une petite fille. Voir le chapitre III du Livre sixième. Tandis que Léon se décourage sans avoir rien tenté, Homais tombe sous le charme et a ce mot devenu proverbial : « C’est une femme de grands moyens et qui ne serait pas déplacée dans une sous-préfecture ».
Le Chapitre VI nous place au cœur de la bovarysation. Emma a une poussée de piété, et s’en va consulter l’abbé Bournisien, belle figure réaliste d’abbé de campagne, brutal avec les « garnements » : « Mais le curé, soudain, distribua sur tous une grêle de soufflets. Les prenant par le collet de la veste, il les enlevait de terre et les reposait à deux genoux sur les pavés du chœur, fortement, comme s’il eût voulu les y planter ». Cet abbé trop terrien est sourd à la demande spirituelle d’Emma : « Vous vous trouvez gênée ? fit-il, en s’avançant d’un air inquiet ; c’est la digestion, sans doute ? » Le bovarysme contient un aspect politiquement incorrect (plutôt pour nous qu’à l’époque de Flaubert), le désintérêt pour ses enfants : « C’est une chose étrange, pensait Emma, comme cette enfant est laide ! » Flaubert en tire un contraste amusant avec l’excès de précautions des parents Homais pour leurs trois rejetons : « Tu prétends donc en faire des Caraïbes ou des Botocudos ? »
Le Chapitre VII permet de monter d’un cran dans la construction du principe bovaryque. Le départ de Léon pour Paris fait cogiter Emma : « Ah ! il était parti, le seul charme de sa vie, le seul espoir possible d’une félicité ! Comment n’avait-elle pas saisi ce bonheur-là, quand il se présentait ! Pourquoi ne l’avoir pas retenu à deux mains, à deux genoux, quand il voulait s’enfuir ? Et elle se maudit de n’avoir pas aimé Léon ; elle eut soif de ses lèvres. L’envie la prit de courir le rejoindre, de se jeter dans ses bras, de lui dire : « C’est moi, je suis à toi ! » Mais Emma s’embarrassait d’avance aux difficultés de l’entreprise, et ses désirs, s’augmentant d’un regret, n’en devenaient que plus actifs » On note cette nouvelle occurrence du mot d’ordre d’Emma : « félicité ». Le romancier ne perd pas un chapitre pour caser le second amant, qui survient à point nommé pour consulter Charles : « M. Rodolphe Boulanger avait trente-quatre ans ; il était de tempérament brutal et d’intelligence perspicace, ayant d’ailleurs beaucoup fréquenté les femmes, et s’y connaissant bien. Celle-là lui avait paru jolie ; il y rêvait donc, et à son mari.
— Je le crois très bête. Elle en est fatiguée sans doute. Il porte des ongles sales et une barbe de trois jours. Tandis qu’il trottine à ses malades, elle reste à ravauder des chaussettes. Et on s’ennuie ! on voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs ! Pauvre petite femme ! Ça bâille après l’amour, comme une carpe après l’eau sur une table de cuisine. Avec trois mots de galanterie, cela vous adorerait ; j’en suis sûr ! ce serait tendre ! charmant !… Oui, mais comment s’en débarrasser ensuite ? » Le regard de Rodolphe sur Emma sonne comme une des notes de régie de Flaubert ; il dit la vérité du personnage.
Le Chapitre VIII est la clef de voûte du roman, « ces fameux comices » comme l’annonce le texte même. Le plus long chapitre, et la reprise de l’entremêlement des discours tenté comme un « quatuor » au chapitre II, qui devient ici « symphonie ». Rodolphe manipule aisément sa proie : « — D’ailleurs, ajouta-t-il, quand on habite la campagne… — Tout est peine perdue, dit Emma. — C’est vrai ! répliqua Rodolphe. Songer que pas un seul de ces braves gens n’est capable de comprendre même la tournure d’un habit ! »
Le Chapitre IX reprend après une ellipse motivée de « six semaines » : « — N’y retournons pas de sitôt, ce serait une faute ». Rodolphe utilise un vieux truc de mélodrame en appelant Mme Bovary Emma : « — Ah ! vous voyez bien, répliqua-t-il d’une voix mélancolique, que j’avais raison de vouloir ne pas revenir ; car ce nom, ce nom qui remplit mon âme et qui m’est échappé, vous me l’interdisez ! Madame Bovary !… Eh ! tout le monde vous appelle comme cela !… Ce n’est pas votre nom, d’ailleurs ; c’est le nom d’un autre ! » Scène inspirée de la pièce d’Alexandre Dumas Antony, I, 6. Charles est assez ballot pour tomber dans le piège des leçons d’équitation, et livre lui-même sa femme : « Charles écrivit à M. Boulanger que sa femme était à sa disposition, et qu’ils comptaient sur sa complaisance ». De façon très pudique, le romancier amène l’adultère. On passe de « elle s’abandonnait à la cadence du mouvement qui la berçait sur la selle » au début de la promenade, à « elle s’abandonna », au moment de la chute, et il faut au lecteur contemporain habitué aux films pornos, s’y reprendre à deux fois pour comprendre ce mot. La description qui suit, en focalisation interne, est sans doute ironique, car toute retournée par Rodolphe, si je puis dire, elle voit dans le bocage normand des… colibris ! « Çà et là, tout autour d’elle, dans les feuilles ou par terre, des taches lumineuses tremblaient, comme si des colibris, en volant, eussent éparpillé leurs plumes ». On dirait un démarquage de Bernardin de Saint-Pierre : « Quoique la plupart des arbres fussent encore dans l’ombre, les premiers rayons de l’aurore éclairaient déjà leurs sommets ; on y voyait voltiger des colibris » (La Chaumière indienne, 1825 ; ce livre figure effectivement dans la Bibliothèque de Flaubert). Rentrée chez elle, Emma ne tombe point dans la honte, c’est le moins qu’on puisse dire : « Elle se répétait : « J’ai un amant ! un amant ! » se délectant à cette idée comme à celle d’une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin ces joies de l’amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délire ; une immensité bleuâtre l’entourait, les sommets du sentiment étincelaient sous sa pensée, et l’existence ordinaire n’apparaissait qu’au loin, tout en bas, dans l’ombre, entre les intervalles de ces hauteurs.
Alors elle se rappela les héroïnes des livres qu’elle avait lus, et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient ».
Le Chapitre X ne perd pas de temps non plus à refroidir notre Rodolphe. Ce sont les rendez-vous « sous la tonnelle », la même que pour Léon. Rodolphe se méfie des exaltations d’Emma qui lui parle de pistolets, alors que « il n’avait, lui, aucune raison de haïr ce bon Charles, n’étant pas ce qui s’appelle dévoré de jalousie », jolie litote ! Il l’apprécie quand même : « Mais elle était si jolie ! il en avait possédé si peu d’une candeur pareille ! Cet amour sans libertinage était pour lui quelque chose de nouveau […]. Alors, sûr d’être aimé, il ne se gêna pas, et insensiblement ses façons changèrent ». Bientôt Flaubert avance sa botte : « Rodolphe ayant réussi à conduire l’adultère selon sa fantaisie ; et, au bout de six mois, quand le printemps arriva, ils se trouvaient, l’un vis-à-vis de l’autre, comme deux mariés qui entretiennent tranquillement une flamme domestique ». C’est le moment du retour de flamme, une lettre du père Rouault, qui donne des remords à l’adultère.
Le Chapitre XI est le morceau de bravoure de l’opération du pied-bot, échec cuisant qui permet aux remords d’Emma de faire pschitt : « Emma, en face de lui, le regardait ; elle ne partageait pas son humiliation, elle en éprouvait une autre : c’était de s’être imaginé qu’un pareil homme pût valoir quelque chose, comme si vingt fois déjà elle n’avait pas suffisamment aperçu sa médiocrité ».
Dans le Chapitre XII Emma, par un mouvement de balancier, revient à l’amant, et rêve d’un départ romanesque. C’est le début des folles dépenses grâce aux manigances de Lheureux, qui ferre sa proie : « Mais le lendemain il se présenta chez elle avec une facture de deux cent soixante et dix francs, sans compter les centimes ». Rodolphe se lasse d’Emma dont il ne perçoit pas la sincérité : « Emma ressemblait à toutes les maîtresses ; et le charme de la nouveauté, peu à peu tombant comme un vêtement, laissait voir à nu l’éternelle monotonie de la passion, qui a toujours les mêmes formes et le même langage. […] Parce que des lèvres libertines ou vénales lui avaient murmuré des phrases pareilles, il ne croyait que faiblement à la candeur de celles-là ; on en devait rabattre, pensait-il, les discours exagérés cachant les affections médiocres ; comme si la plénitude de l’âme ne débordait pas quelquefois par les métaphores les plus vides, puisque personne, jamais, ne peut donner l’exacte mesure de ses besoins, ni de ses conceptions, ni de ses douleurs, et que la parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles » (cela rappelle les « coups fêlés de la cloche » (I, 9)). Dans cette belle métaphore qui constitue une manière subtile de prétérition, puisqu’il vient de parler de « métaphores les plus vides », le narrateur retrouve le « nous » initial du roman. Ce Rodolphe serait-il par hasard l’un des conscrits de Charles au collège ? Quoi qu’il en soit, Emma prend un genre, qui n’est pas celui de sa naissance : « Mme Bovary changea d’allures. Ses regards devinrent plus hardis, ses discours plus libres ; elle eut même l’inconvenance de se promener avec M. Rodolphe, une cigarette à la bouche, comme pour narguer le monde ; enfin, ceux qui doutaient encore ne doutèrent plus quand on la vit, un jour, descendre de l’Hirondelle, la taille serrée dans un gilet, à la façon d’un homme ». Rodolphe attend le dernier moment pour tromper sa maîtresse, en lui laissant faire les préparatifs de départ, et en disparaissant brusquement avec ce mot dédaigneux : « — Quel imbécile je suis ! fit-il en jurant épouvantablement. N’importe, c’était une jolie maîtresse ! ».
Le Chapitre XIII présente un exemple intéressant de mise en abyme avec cette scène où Rodolphe écrit la lettre de rupture et s’interroge en romancier sur l’effet de ses formules : « Et il y avait un dernier adieu, séparé en deux mots : À Dieu ! ce qu’il jugeait d’un excellent goût.
— Comment vais-je signer, maintenant ? se dit-il. Votre tout dévoué ?… Non. Votre ami ?… Oui, c’est cela. « Votre ami. » Il relut sa lettre. Elle lui parut bonne.
— Pauvre petite femme ! pensa-t-il avec attendrissement. Elle va me croire plus insensible qu’un roc ; il eût fallu quelques larmes là-dessus ; mais, moi, je ne peux pas pleurer ; ce n’est pas ma faute. Alors, s’étant versé de l’eau dans un verre, Rodolphe y trempa son doigt et il laissa tomber de haut une grosse goutte, qui fit une tache pâle sur l’encre ». Cette insensibilité contraste avec la façon dont Emma réagit avec son corps en entendant passer le tilbury qui emporte Rodolphe : « Emma poussa un cri et tomba roide par terre, à la renverse ». Charles, en bon bougre de mari, fait tout pour soigner sa femme.
Le Chapitre XIV est un répit ; Emma se soigne à l’eau bénite, avec un nouveau retour à la religion qui ravit la belle-mère : « la bonne femme se plaisait en cette maison tranquille, et même elle y demeura jusques après Pâques, afin d’éviter les sarcasmes du père Bovary, qui ne manquait pas, tous les vendredis saints, de se commander une andouille ». Emma ne remarque pas l’amour silencieux du commis du pharmacien, Justin, qui vous a des façons rousseauistes d’admirer les femmes : « Il […] restait debout près de la porte, immobile, sans parler. Souvent même, Mme Bovary, n’y prenant garde, se mettait à sa toilette. Elle commençait par retirer son peigne, en secouant sa tête d’un mouvement brusque ; et, quand il aperçut la première fois cette chevelure entière qui descendait jusqu’aux jarrets en déroulant ses anneaux noirs, ce fut pour lui, le pauvre enfant, comme l’entrée subite dans quelque chose d’extraordinaire et de nouveau dont la splendeur l’effraya.
Emma […] ne se doutait point que l’amour, disparu de sa vie, palpitait là, près d’elle, sous cette chemise de grosse toile, dans ce cœur d’adolescent ouvert aux émanations de sa beauté ». Sur une idée d’Homais, Charles emmène sa femme à Rouen au spectacle, et selon le principe bien rôdé depuis le début du roman, tire ardemment la charrue pour se forger des cornes !
Le Chapitre XV clôt la 2e partie par l’opéra, notamment le sextuor, après le quatuor (II, 2) et la symphonie (II, 8). C’est la rencontre des dupes, les retrouvailles avec Léon. Le chanteur vedette Lagardy a droit à un portrait charge : « Un bel organe, un imperturbable aplomb, plus de tempérament que d’intelligence et plus d’emphase que de lyrisme, achevaient de rehausser cette admirable nature de charlatan, où il y avait du coiffeur et du toréador ». L’héroïne de l’opéra Lucie de Lammermoor fait gamberger celle du roman : « Emma rêvait au jour de son mariage ; et elle se revoyait là-bas, au milieu des blés, sur le petit sentier, quand on marchait vers l’église. Pourquoi donc n’avait-elle pas, comme celle-là, résisté, supplié ? Elle était joyeuse, au contraire, sans s’apercevoir de l’abîme où elle se précipitait… Ah ! si, dans la fraîcheur de sa beauté, avant les souillures du mariage et la désillusion de l’adultère, elle avait pu placer sa vie sur quelque grand cœur solide, alors la vertu, la tendresse, les voluptés et le devoir se confondant, jamais elle ne serait descendue d’une félicité si haute ». « Les souillures du mariage et la désillusion de l’adultère » : voilà sans doute la formule qui choque le plus l’avocat impérial Pinard ; mais il n’a pas relevé qu’il s’agissait de discours indirect libre, et que c’est l’héroïne qui se vautre dans son erreur, et qui, alors qu’elle est sur le point de se précipiter dans un nouvel abîme avec un nouvel amant, croit s’être « précipitée dans un abîme » en épousant Charles, qui l’aime… Avec le recul, la méprise de Pinard nous étonne, mais il faut savoir que cet effacement de l’auteur devant les propos et pensées des personnages était une innovation.
Le sextuor de l’opéra donne lieu à un intérêt particulier d’Emma, qui succombe pour le chanteur. Bien entendu, on peut faire le rapprochement avec le « quatuor » qu’a voulu composer Flaubert au chapitre II, II. Le titre et la date probable, ainsi que les paroles citées en français, font penser qu’il s’agit de l’adaptation française, dont on trouvera le texte ici. Youtube propose cette version du sextuor avec Roberto Alagna ici. Charles lance à nouveau Emma dans les bras de Léon II : « Mais Charles répondit qu’ils s’en allaient dès le lendemain.
— À moins, ajouta-t-il en se tournant vers sa femme, que tu ne veuilles rester seule, mon petit chat ? »
Madame Bovary : Troisième partie
Et voilà Emma qui se lance dans l’abîme de l’adultère avec Léon.
Le Chapitre I ne perd pas de temps à mettre aux prises, et seul à seul, les deux amants, cette fois-ci expérimenté chacun en adultère et en mensonge : « Mais ils s’arrêtaient quelquefois devant l’exposition complète de leur idée, et cherchaient alors à imaginer une phrase qui pût la traduire cependant. Elle ne confessa point sa passion pour un autre ; il ne dit pas qu’il l’avait oubliée ». C’est maintenant au narrateur de reprendre les considérations amères sur le décalage entre parole et sentiments, qui était mis à la charge de Rodolphe en II, XII : « D’ailleurs, la parole est un laminoir qui allonge toujours les sentiments ». Emma se défend de jouer les « cougar » comme on dirait aujourd’hui : « Je suis trop vieille… vous êtes trop jeune… oubliez-moi ! ». Et Léon a l’idée de génie du rendez-vous à la cathédrale, scène d’anthologie, suivie de celle du fiacre, tout cela dans le même chapitre, et la « baisade » inénarrable au sens propre, avec ce passage, sans rire, « aux Trois-pipes » [3]. Le cocher est mauvais lecteur : « Il ne comprenait pas quelle fureur de la locomotion poussait ces individus à ne vouloir point s’arrêter ». On pourra faire le rapprochement avec la scène de la diligence au tome premier de l’Histoire de ma vie, de Jacques Casanova, que Flaubert a sans doute lue, dans une version expurgée de l’époque, bien qu’une recherche sur le site de l’université de Rouen ne donne pas la moindre occurrence de « Casanova » dans tous les écrits de Flaubert (peut-on imaginer qu’il l’ait lu sans en parler dans ses lettres ?). Tout au plus peut-on vérifier qu’il n’y a aucune trace de Casanova dans la Bibliothèque de Flaubert. Voir aussi comment André Gide dans Les Faux-Monnayeurs évoque de façon indirecte la baisade entre tonton Édouard et le jeune Olivier (3e partie, ch. 9).
Dans le Chapitre II, le motif de l’arsenic est amené habilement par une scène de genre chez le pharmacien, qu’on dirait sortie d’un mélo : « — À côté, s’écria Mme Homais en joignant les mains. De l’arsenic ? Tu pouvais nous empoisonner tous ! » Flaubert s’amuse, car dans sa furie, Homais secoue son commis et fait tomber un livre de ses poches : « — L’amour… conjugal ! dit-il en séparant lentement ces deux mots. Ah ! très bien ! très bien ! très joli ! Et des gravures !… ». C’est dans cette furie qu’il consent enfin à répondre à Emma qu’il avait fait appeler, que son beau-père est mort. Il y a une sorte de faiblesse du scénario, car on se demande bien pourquoi l’envoyer chez Homais apprendre cette nouvelle : « par excès de précaution pour la sensibilité d’Emma, Charles avait prié M. Homais de lui apprendre avec ménagement cette horrible nouvelle ». En fait de ménagement, Emma est servie ! Comme Charles est occupé du deuil avec sa mère, c’est le moment que choisit Lheureux pour proposer la « procuration » qui va perdre Emma ; procédure empruntée aux « Mémoires de Mme Ludovica » (cf. infra). Pour régler ces problèmes de dettes, Emma cette fois-ci manipule son mari, qui accepte avec reconnaissance qu’elle se dévoue pour consulter leur grand ami Léon : « Dès le lendemain, elle s’embarqua dans l’Hirondelle pour aller à Rouen consulter M. Léon ; et elle y resta trois jours ». « Consulter Léon » : qu’en termes élégants ces choses-là sont dites !
Le Chapitre III, un des plus courts, narre sommairement « l’assouvissance de leurs désirs » durant ces trois jours. La promenade en barque, avec la citation dérisoire du « Lac » de Lamartine (qui, pas rancunier, soutiendra Flaubert pendant le procès !) Le batelier évoque un joyeux drille qu’il a conduit naguère, et qui s’appelait « Adolphe…, Dodolphe…, je crois » ! Un collègue (que je remercie) m’a signalé l’existence d’une parodie du même « Lac » dans Le Trésor de Rackham le Rouge, album de Tintin d’Hergé, éd. Casterman, page 32, vignette n°2.

Au Chapitre IV, court itou, Léon revient à Yonville saluer ses amis, et voit Emma lors d’une entrevue avec fond romantique : « Il faisait de l’orage, et ils causaient sous un parapluie à la lueur des éclairs ». Emma manipule à nouveau ce pauvre Charles pour qu’il la supplie cette fois-ci d’aller tous les jeudis prendre des leçons de piano.
Le Chapitre V est constitué du récit itératif des « leçons de piano » du jeudi, des retrouvailles dans « cette bonne chambre pleine de gaieté, malgré sa splendeur un peu fanée ! » qu’ils louent dans un hôtel. Léon est aux anges, ce qui nous vaut un nouveau zeugme : « Il admirait l’exaltation de son âme et les dentelles de sa jupe. D’ailleurs, n’était-ce pas une femme du monde, et une femme mariée ! une vraie maîtresse enfin ? » Emma finit par avouer plus ou moins volontairement à Léon qu’« elle avait aimé quelqu’un », et sort cette saillie : « — Vous êtes tous des infâmes ! ». Comme Charles rencontre à Rouen la prétendue professeur de piano, qui s’étonne, Emma invente une autre prof de piano du même nom, et s’endurcit au mensonge : « À partir de ce moment, son existence ne fut plus qu’un assemblage de mensonges, où elle enveloppait son amour comme dans des voiles, pour le cacher. C’était un besoin, une manie, un plaisir, au point que, si elle disait avoir passé, hier, par le côté droit d’une rue, il fallait croire qu’elle avait pris par le côté gauche ». Les dettes vont bon train, et Mme Bovary mère parvient à obliger Charles à exiger la procuration d’Emma ; elle la met au feu, mais en jouant la crise de nerfs, Emma ne mettra pas une demi-page à récupérer une nouvelle procuration : « il fallut bien des prières avant qu’elle consentît à reprendre sa procuration ». Un degré est franchi quand Emma, sans justification, « ne rentra point à Yonville ». Fou d’inquiétude, Charles la recherche à Rouen, mais quand il la retrouve, elle en profite : « à l’avenir, tranquillise-toi. Je ne suis pas libre, tu comprends, si je sais que le moindre retard te bouleverse ainsi.
C’était une manière de permission qu’elle se donnait de ne point se gêner dans ses escapades. Aussi en profita-t-elle tout à son aise, largement. Lorsque l’envie la prenait de voir Léon, elle partait sous n’importe quel prétexte ». Cela incommode Léon, mais elle le possède autant que son mari, et le thème de l’inversion reparaît : « Il ne discutait pas ses idées ; il acceptait tous ses goûts ; il devenait sa maîtresse plutôt qu’elle n’était la sienne. Elle avait des paroles tendres avec des baisers qui lui emportaient l’âme. Où donc avait-elle appris cette corruption, presque immatérielle à force d’être profonde et dissimulée ? ».
Au Chapitre VI, Homais rend la politesse à Léon, et ils sortent en garçons à Rouen, ce qui donne l’occasion d’une belle discussion sur les femmes : « Il se lança même dans une digression ethnographique : l’Allemande était vaporeuse, la Française libertine, l’Italienne passionnée. — Et les négresses ? demanda le clerc ». Léon ne peut se dépêtrer de son Homais, et cela sur un de leurs jeudis, et Emma est furieuse : « Ce manque de parole au rendez-vous lui semblait un outrage, et elle cherchait encore d’autres raisons pour s’en détacher : il était incapable d’héroïsme, faible, banal, plus mou qu’une femme, avare d’ailleurs et pusillanime ». Mais elle y revient, et cela déchaîne en elle des furies érotiques, et c’est la séquence — très baudelairienne — qui scandalisera Pinard : « Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset, qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Elle allait sur la pointe de ses pieds nus regarder encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d’un seul geste tomber ensemble tous ses vêtements ; — et, pâle, sans parler, sérieuse, elle s’abattait contre sa poitrine, avec un long frisson » [4]. En passant seule devant son ancien couvent, la voilà prise de nostalgie : « Chaque sourire cachait un bâillement d’ennui, chaque joie une malédiction, tout plaisir son dégoût, et les meilleurs baisers ne vous laissaient sur la lèvre qu’une irréalisable envie d’une volupté plus haute ». Un paragraphe attendrissant montre Charles se faisant mère pour leur fille délaissée : « Après le dîner, il se promenait seul dans le jardin ; il prenait la petite Berthe sur ses genoux, et, déployant son journal de médecine, essayait de lui apprendre à lire ». Emma fait chambre à part, et se met au porno : « Pour ne pas avoir la nuit auprès d’elle, cet homme étendu qui dormait, elle finit, à force de grimaces, par le reléguer au second étage ; et elle lisait jusqu’au matin des livres extravagants où il y avait des tableaux orgiaques avec des situations sanglantes ». Ce n’est pas précisé, mais on songe aux romans de Sade. La mère de Léon reçoit « une longue lettre anonyme, pour la prévenir qu’il se perdait avec une femme mariée », et cela lui crée bien des désagréments. On ne saura pas qui a envoyé cette lettre, la focalisation est interne. Emma se dégoûte de Léon exactement comme Rodolphe s’était dégoûté d’elle, et la « félicité » prend une teinte négative : « Elle était aussi dégoûtée de lui qu’il était fatigué d’elle. Emma retrouvait dans l’adultère toutes les platitudes du mariage. Mais comment pouvoir s’en débarrasser ? Puis, elle avait beau se sentir humiliée de la bassesse d’un tel bonheur, elle y tenait par habitude ou par corruption ; et, chaque jour, elle s’y acharnait davantage, tarissant toute félicité à la vouloir trop grande. Elle accusait Léon de ses espoirs déçus, comme s’il l’avait trahie ; et même elle souhaitait une catastrophe qui amenât leur séparation, puisqu’elle n’avait pas le courage de s’y décider ». Son dernier plaisir est mâtiné de dégoût : « Le jour de la mi-carême, elle ne rentra pas à Yonville ; elle alla le soir au bal masqué. Elle mit un pantalon de velours et des bas rouges, avec une perruque à catogan et un lampion sur l’oreille ». Elle est prise d’un malaise comme un vulgaire teufeur : « Elle sentait dans sa tête le plancher du bal, rebondissant encore sous la pulsation rythmique des mille pieds qui dansaient. Puis, l’odeur du punch avec la fumée des cigares l’étourdit ». De retour à Yonville, c’est la catastrophe, elle y découvre « un papier gris » : c’est l’annonce de la saisie !
Au Chapitre VII, c’est un peu la passion du Christ. Emma se débat comme le taureau sous les banderilles, ou comme dans Salammbô, la mort de Mâtho dans les rues de Carthage, soumis aux coups de la foule. Elle court d’abord à Rouen, en vain, pour demander l’aide de Léon et qu’il vole son patron. Puis sur le conseil de Félicité (ai-je dit l’ironie de ce nom ?) elle va voir le notaire Guillaumin, qui tente de profiter de la situation en strausskahnisant la donzelle, ce à quoi elle se refuse : « Il tendit sa main, prit la sienne, la couvrit d’un baiser vorace, puis la garda sur son genou ; et il jouait avec ses doigts délicatement, tout en lui contant mille douceurs. […] et ses mains s’avançaient dans la manche d’Emma, pour lui palper le bras. […] Je suis à plaindre, mais pas à vendre ! » Elle prend conscience que le seul homme qui l’aiderait, c’est Charles ; profondeur psychologique de l’ami Flaubert : « il me pardonnera, lui qui n’aurait pas assez d’un million à m’offrir pour que je l’excuse de m’avoir connue… Jamais ! Jamais ! Cette idée de la supériorité de Bovary sur elle l’exaspérait ». Emma court ensuite chez Binet, et c’est une scène moderne, cinématographique, qu’on imagine filmée avec une grue, à travers la fenêtre. Bel et rare exemple de focalisation externe, puisque les deux voyeuses sont des personnages secondaires, qui n’ont aucun rôle dans le roman : « Bondissant dans l’escalier, elle s’échappa vivement par la place ; et la femme du maire, qui causait devant l’église avec Lestiboudois, la vit entrer chez le percepteur. Elle courut le dire à Mme Caron. Ces deux dames montèrent dans le grenier ; et, cachées par du linge étendu sur des perches, se postèrent commodément pour apercevoir tout l’intérieur de Binet ». Cela permet une restriction de champ, et l’établissement du récit par des conjectures. Emma semble proposer à Binet ce qu’elle vient de refuser à Guillaumin, et c’est lui qui s’offusque : « Et sans doute qu’elle lui proposait une abomination ; car le percepteur […] tout à coup, comme à la vue d’un serpent, se recula bien loin ». On pourrait comparer cette scène à d’autres scènes en focalisation externe, l’incipit ou la scène du fiacre. Des exercices scolaires de changement de point de vue seraient amusants.
En dernière extrémité, Emma revient au château de Rodolphe, la Huchette : « Elle partit donc vers la Huchette, sans s’apercevoir qu’elle courait s’offrir à ce qui l’avait tantôt si fort exaspérée, ni se douter le moins du monde de cette prostitution ». Le narrateur omniscient, par cette naïveté, semble faire table rase des extrapolations voyeuristes qui précèdent : non, elle n’a pas tenté de se prostituer à Binet, puisqu’il ne lui vient même pas à l’idée qu’elle puisse le faire avec Rodolphe.
Le narrateur a choisi de réunir dans le même long Chapitre VIII, l’entrevue de la dernière chance avec Rodolphe, le suicide et la mort d’Emma. Rodolphe semble prêt à se laisser séduire à nouveau, comme le montre ce portrait au point de vue interne : « Et elle était ravissante à voir, avec son regard où tremblait une larme, comme l’eau d’un orage dans un calice bleu ». Quant à la motivation de son refus, c’est le narrateur omniscient qui la prend en charge : « Il ne mentait point. Il les eût eus qu’il les aurait donnés, sans doute, bien qu’il soit généralement désagréable de faire de si belles actions : une demande pécuniaire, de toutes les bourrasques qui tombent sur l’amour, étant la plus froide et la plus déracinante ». La scène est théâtrale, avec crise clastique et monologue outragé, et se prêterait à une réécriture sous cette forme, ou sous toute forme artistique : « Et elle lança bien loin les deux boutons, dont la chaîne d’or se rompit en cognant contre la muraille.
— Mais, moi, je t’aurais tout donné, j’aurais tout vendu, j’aurais travaillé de mes mains, j’ aurais mendié sur les routes, pour un sourire, pour un regard, pour t’entendre dire : « Merci ! » Et tu restes là tranquillement dans ton fauteuil, comme si déjà tu ne m’avais pas fait assez souffrir ? Sans toi, sais-tu bien, j’aurais pu vivre heureuse ! Qui t’y forçait ? Était-ce une gageure ? Tu m’aimais cependant, tu le disais… Et tout à l’heure encore… Ah ! il eût mieux valu me chasser ! J’ai les mains chaudes de tes baisers, et voilà la place, sur le tapis, où tu jurais à mes genoux une éternité d’amour. Tu m’y as fait croire : tu m’as, pendant deux ans, traînée dans le rêve le plus magnifique et le plus suave !… Hein ! nos projets de voyage, tu te rappelles ? Oh ! ta lettre, ta lettre ! elle m’a déchiré le cœur !… Et puis, quand je reviens vers lui, vers lui, qui est riche, heureux, libre ! pour implorer un secours que le premier venu rendrait, suppliante et lui rapportant toute ma tendresse, il me repousse, parce que ça lui coûterait trois mille francs ! ».
La scène effrayante du suicide use de la préparation au chapitre 2 de la même partie, mais notons que le mot « arsenic » est soigneusement évité : « La clef tourna dans la serrure, et elle alla droit vers la troisième tablette, tant son souvenir la guidait bien, saisit le bocal bleu, en arracha le bouchon, y fourra sa main, et, la retirant pleine d’une poudre blanche, elle se mit à manger à même ». Quand au chevet du lit sont réunis les deux médecins, l’apothicaire et la mourante, c’est encore une superbe scène théâtrale relevant du plus pur mélodrame, malgré la bêtise sans rémission de Homais :
« Charles montra la lettre. C’était de l’arsenic.
— Eh bien, reprit Homais, il faudrait en faire l’analyse.
Car il savait qu’il faut, dans tous les empoisonnements, faire une analyse ; et l’autre, qui ne comprenait pas, répondit :
— Ah ! faites ! faites ! sauvez-la…
Puis, revenu près d’elle, il s’affaissa par terre sur le tapis, et il restait la tête appuyée contre le bord de sa couche, à sangloter.
— Ne pleure pas ! lui dit-elle. Bientôt je ne te tourmenterai plus !
— Pourquoi ? Qui t’a forcée ?
Elle répliqua :
— Il le fallait, mon ami.
— N’étais-tu pas heureuse ? Est-ce ma faute ? J’ai fait tout ce que j’ai pu pourtant !
— Oui…, c’est vrai…, tu es bon, toi !
Et elle lui passait la main dans les cheveux, lentement. La douceur de cette sensation surchargeait sa tristesse ; il sentait tout son être s’écrouler de désespoir à l’idée qu’il fallait la perdre, quand, au contraire, elle avouait pour lui plus d’amour que jamais ».
La scène de l’extrême-onction a fait couler beaucoup d’encre. On pourra la comparer aussi à celle que Zola inventera trente ans plus tard pour Le Rêve, appliquée non pas à une pécheresse, mais à une jeune vierge, une Bovary qui serait morte à peine sortie du couvent.
Pour une raison de symétrie, le roman ne se termine pas sur la mort d’Emma, mais par trois chapitres de conclusion. Le Chapitre IX renoue avec Charles seul. Après la « survenue du néant », formule qui choquera Pinard, Charles passe par tous les états, et nous émeut autant que sa solitude adolescente de bouc émissaire dans le 1er chapitre. Touchant, son amour pour la morte, qui me fait songer au personnage joué par François Truffaut dans La Chambre verte : « Il se rappelait des histoires de catalepsie, les miracles du magnétisme ; et il se disait qu’en le voulant extrêmement, il parviendrait peut-être à la ressusciter ». Même le père Rouault nous émeut, lui qui ne croit pas à la mort de sa fille, et s’évanouit en arrivant à Yonville.
Le Chapitre X commence par une analepse sur le père Rouault accourant vers sa fille morte, puis c’est la messe et l’inhumation. Flaubert insiste sur les trois hommes qui ont le plus aimé Emma, tout en se moquant de ses deux amants : « Rodolphe, qui, pour se distraire, avait battu le bois toute la journée, dormait tranquillement dans son château ; et Léon, là-bas, dormait aussi ». Le père Rouault a ces mots pour Charles, émouvants dans leur bonhomie : « Adieu !… vous êtes un bon garçon ! Et puis, jamais je n’oublierai ça, dit-il en se frappant la cuisse, n’ayez peur ! vous recevrez toujours votre dinde ». Enfin, l’amour de Justin s’oppose à l’esprit borné de Lestiboudois : « Il y en avait un autre qui, à cette heure-là, ne dormait pas. Sur la fosse, entre les sapins, un enfant pleurait agenouillé, et sa poitrine, brisée par les sanglots, haletait dans l’ombre, sous la pression d’un regret immense, plus doux que la lune et plus insondable que la nuit. La grille tout à coup craqua. C’était Lestiboudois ; il venait chercher sa bêche qu’il avait oubliée tantôt. Il reconnut Justin escaladant le mur, et sut alors à quoi s’en tenir sur le malfaiteur qui lui dérobait ses pommes de terre ». On songe à Flaubert qui souvent écrivait la nuit, s’identifiant à ceux qui comme lui ne dorment pas pour Emma.
Le Chapitre XI expédie le destin de Charles et de Berthe, le mariage de Léon avec une « Mlle Léocadie Lebœuf ». Charles découvre un jour le pot aux roses, la lettre de Rodolphe roulée en boule dans le grenier : « On avait dû, pensait-il, l’adorer. Tous les hommes, à coup sûr, l’avaient convoitée. Elle lui en parut plus belle ; et il en conçut un désir permanent, furieux, qui enflammait son désespoir et qui n’avait pas de limites, parce qu’il était maintenant irréalisable ». Flaubert semble vouloir racheter par ce sublime la naïveté de son personnage. La fin de Charles est précipitée par sa seconde découverte : « Toutes les lettres de Léon s’y trouvaient. Plus de doute, cette fois ! Il dévora jusqu’à la dernière, fouilla dans tous les coins, tous les meubles, tous les tiroirs, derrière les murs, sanglotant, hurlant, éperdu, fou. Il découvrit une boîte, la défonça d’un coup de pied. Le portrait de Rodolphe lui sauta en plein visage, au milieu des billets doux bouleversés ». Et quand il rencontre Rodolphe, à nouveau, son comportement inattendu est sublime : « Charles se perdait en rêveries devant cette figure qu’elle avait aimée. Il lui semblait revoir quelque chose d’elle. C’était un émerveillement. Il aurait voulu être cet homme ». C’est au contraire l’amant dont la fatuité est soulignée face au veuf : « — Non, je ne vous en veux plus ! Il ajouta même un grand mot, le seul qu’il ait jamais dit : — C’est la faute de la fatalité ! Rodolphe, qui avait conduit cette fatalité, le trouva bien débonnaire pour un homme dans sa situation, comique même, et un peu vil ». Ce passage est intéressant, car encore une fois, au nom de l’impersonnalité, le narrateur laisse à un personnage le soin d’en juger un autre, et au lecteur de décider. La mort de Charles suit cette rencontre, puis le destin de Berthe est scellé par la mort de sa grand-mère, et cela donne une connotation sociale à l’excipit : « Elle est pauvre et l’envoie, pour gagner sa vie, dans une filature de coton ».
Le procès
Le réquisitoire d’Ernest Pinard
Le procès eut lieu devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Paris, les 31 janvier et 7 février 1857. Le ministère public était représenté par l’avocat impérial Ernest Pinard, un avocat qui s’était rallié à l’Empire après avoir soutenu la Révolution française de 1848. Son brillant réquisitoire fait vingt pages, et il est imaginable de la mettre en voix en une heure de cours. Pinard commence par exposer la difficulté de juger d’un roman entier au lieu d’un article, et cette problématique lui permet d’annoncer son plan : « On pourrait nous dire : si vous n’exposez pas le procès dans toutes ses parties, si vous passez ce qui précède et ce qui suit les passages incriminés, il est évident que vous étouffez le débat en restreignant le terrain de la discussion. Pour éviter ce double inconvénient, il n’y a qu’une marche à suivre, et la voici, c’est de vous raconter d’abord tout le roman sans en lire, sans en incriminer aucun passage, et puis de lire, d’incriminer en citant le texte, et enfin de répondre aux objections qui pourraient s’élever contre le système général de la prévention ». L’excellentissime résumé occupe trois des vingt pages du discours, en conclusion duquel il propose « un autre titre […] : Histoire des adultères d’une femme de province. Puis l’avocat précise son objectif : « L’offense à la morale publique est dans les tableaux lascifs que je mettrai sous vos yeux, l’offense à la morale religieuse, dans les images voluptueuses mêlées aux choses sacrées ». Pour ce faire, l’avocat entend se borner à « quatre scènes, ou plutôt quatre tableaux. La première ce sera celle des amours et de la chute avec Rodolphe, la seconde, la transition religieuse entre les deux adultères ; la troisième, ce sera la chute avec Léon, c’est le deuxième adultère, et enfin la quatrième que je veux citer, c’est la mort de Mme Bovary ». Mais en fait de quatre scènes, l’avocat commence par citer d’autres scènes, pour qualifier « la couleur, le coup de pinceau de M. Flaubert, car […] il faut savoir à quelle école il appartient » ; « La couleur générale de l’auteur […] c’est la couleur lascive, avant, pendant et après les chutes ! ». L’avocat cherche à définir le style de l’auteur : « L’auteur a mis le plus grand soin, employé tous les prestiges de son style pour peindre cette femme. A-t-il essayé de la montrer du côté de l’intelligence ? Jamais. Du côté du cœur ? Pas davantage. Du côté de l’esprit ? Non. Du côté de la beauté physique ? Pas même. Oh ! je sais bien qu’il y a des portraits de Mme Bovary après l’adultère des plus étincelants ; mais le tableau est avant tout lascif, les poses sont voluptueuses, la beauté de Mme Bovary est une beauté de provocation ».
Pinard en vient à la première des quatre scènes incriminées, la chute avec Rodolphe, pour en conclure : « Ce que l’auteur nous montre, c’est la poésie de l’adultère, et je vous demande encore une fois si ces pages lascives ne sont pas d’une immoralité profonde ! » La transcription (faite pour et aux frais de Flaubert) met trois points d’exclamation ; je n’en mets qu’un. Dans la seconde scène, la transition religieuse, voilà ce que souligne le procureur : « Dans quelle langue prie-t-on Dieu avec les paroles adressées à l’amant dans les épanchements de l’adultère ? Sans doute on parlera de la couleur locale, et on s’excusera en disant qu’une femme vaporeuse, romanesque, ne fait, pas même en religion, les choses comme tout le monde. Il n’y a pas de couleur locale qui excuse ce mélange ! Voluptueuse un jour, religieuse le lendemain, nulle femme, même dans d’autres régions, même sous le ciel d’Espagne ou d’Italie, ne murmure à Dieu les caresses adultères qu’elle donnait à l’amant. Vous apprécierez ce langage, messieurs, et vous n’excuserez pas ces paroles de l’adultère introduites, en quelque sorte, dans le sanctuaire de la divinité ! ». Dans la troisième scène, l’adultère avec Léon, une phrase a particulièrement choqué Pinard : « On vous a parlé tout à l’heure des souillures du mariage ; on va vous montrer encore l’adultère dans toute sa poésie, dans ses ineffables séductions. J’ai dit qu’on aurait dû au moins modifier les expressions et dire : les désillusions du mariage et les souillures de l’adultère. Bien souvent quand on s’est marié, au lieu du bonheur sans nuages qu’on s’était promis, on rencontre les sacrifices, les amertumes. Le mot désillusion peut donc être justifié, celui de souillure ne saurait l’être ». Pinard n’a pas raté la scène la plus érotique avec Léon : « Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse ». Voici ce qu’il en pense : « Je signale ici deux choses, messieurs, une peinture admirable sous le rapport du talent, mais une peinture exécrable au point de vue de la morale. Oui, M. Flaubert sait embellir ses peintures avec toutes les ressources de l’art, mais sans les ménagements de l’art ». On voit que l’avocat n’est pas un sot et qu’il apprécie l’art.
La quatrième scène incriminée est la mort d’Emma. Pinard reproche la façon dont est administrée l’extrême-onction : « Ce sont des paroles saintes et sacrées pour tous. C’est avec ces paroles-là que nous avons endormi nos aïeux, nos pères ou nos proches, et c’est avec elles qu’un jour nos enfants nous endormiront. Quand on veut les reproduire, il faut le faire exactement ; il ne faut pas du moins les accompagner d’une image voluptueuse sur la vie passée ». En résumé sur cette mort, « C’est à vous de juger, et d’apprécier si c’est là le mélange du sacré au profane, ou si ce ne serait plutôt le mélange du sacré au voluptueux ». Pinard fait de lui-même un rapprochement avec les extraits de Saint-Antoine publiés par Flaubert récemment. La conclusion adopte un point de vue moral : « Qui peut condamner cette femme dans le livre ? Personne. Telle est la conclusion. Il n’y a pas dans le livre un personnage qui puisse la condamner. Si vous y trouvez un personnage sage, si vous y trouvez un seul principe en vertu duquel l’adultère soit stigmatisé, j’ai tort. Donc, si dans tout le livre il n’y a pas un personnage qui puisse lui faire courber la tête, s’il n’y a pas une idée, une ligne en vertu de laquelle l’adultère soit flétri, c’est moi qui ai raison, le livre est immoral ! » Pinard revient sur la « survenue du néant » du chapitre X : « Ce n’est pas un cri d’incrédulité, mais c’est du moins un cri de scepticisme. […] Et moi je dis que si la mort est survenue du néant, que si le mari béat sent croître son amour en apprenant les adultères de sa femme, que si l’opinion est représentée par des êtres grotesques, que si le sentiment religieux est représenté par un prêtre ridicule, une seule personne a raison, règne, domine : c’est Emma Bovary. Messaline a raison contre Juvénal ». C’est en définitive au nom de la « morale chrétienne » que le livre est condamnable : « En son nom l’adultère est stigmatisé, condamné, non pas parce que c’est une imprudence qui expose à des désillusions et à des regrets, mais parce que c’est un crime pour la famille. Vous stigmatisez et vous condamnez le suicide, non pas parce que c’est une lâcheté, il demande quelquefois un certain courage physique, mais parce qu’il est le mépris du devoir dans la vie qui s’achève, et le cri de l’incrédulité dans la vie qui commence. Cette morale stigmatise la littérature réaliste, non pas parce qu’elle peint les passions : la haine, la vengeance, l’amour ; le monde ne vit que là-dessus, et l’art doit les peindre ; mais quand elle les peint sans frein, sans mesure. L’art sans règle n’est plus l’art ; c’est comme une femme qui quitterait tout vêtement. Imposer à l’art l’unique règle de la décence publique, ce n’est pas l’asservir, mais l’honorer. On ne grandit qu’avec une règle. Voilà messieurs, les principes que nous professons, voilà une doctrine que nous défendons avec conscience. »
La plaidoirie de Me Senard
Flaubert a choisi comme défenseur Antoine Senard, dont les titres ronflants s’étaleront sur l’épître dédicatoire lors de la publication en volume : « MEMBRE DU BARREAU DE PARIS, EX-PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET ANCIEN MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ». Il s’agit d’un anti-bonapartiste, ce qui donne une coloration politique à sa plaidoirie contre un ancien républicain rallié à l’Empire. Dès l’exorde, la thèse est annoncée : ce roman promeut « une pensée éminemment morale et religieuse pouvant se traduire par ces mots : l’excitation à la vertu par l’horreur du vice ». Puis il impressionne le public par les références familiales du prévenu : « Son père, de l’amitié duquel je me suis longtemps honoré, […] son illustre père, a été pendant plus de trente années chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu de Rouen. […] il y a laissé de grands souvenirs, pour d’immenses services rendus à l’humanité. […] son fils, qui est traduit en police correctionnelle pour outrage à la morale et à la religion, son fils est l’ami de mes enfants, comme j’étais l’ami de son père. Je sais sa pensée, je sais ses intentions, et l’avocat a ici le droit de se poser comme la caution personnelle de son client ». L’argument relève de ce qu’Aristote appelle éthos discursif, voire éthos pré-discursif, non seulement sur la réputation de l’orateur, mais aussi sur celle du prévenu. Puis l’avocat reformule sa thèse sous la forme d’une question rhétorique : « Ce livre mis dans les mains d’une jeune femme, pourrait-il avoir pour effet de l’entraîner vers des plaisirs faciles, vers l’adultère, ou de lui montrer au contraire le danger, dès les premiers pas, et de la faire frissonner d’horreur ? » Senard défend à sa façon qui est morale, la posture flaubertienne de l’impersonnalité : « J’aime mieux celui qui ne crie pas fort, qui ne prononce pas le mot de souillure, mais qui avertit la femme de la déception, de la désillusion, qui lui dit : Là où vous croyez trouver l’amour, vous ne trouverez que le libertinage ; là où vous croyez trouver le bonheur, vous ne trouverez que des amertumes. Un mari qui va tranquillement à ses affaires, qui vous embrasse, qui met son bonnet de coton et mange la soupe avec vous, est un mari prosaïque qui vous révolte ; vous aspirez à un homme qui vous aime, qui vous idolâtre, pauvre enfant ! cet homme sera un libertin, qui vous aura prise une minute pour jouer avec vous ».
Senard invoque une autorité, celle de Lamartine, lequel « ne connaissait pas mon client, il ne savait pas qu’il existât ». Il se livre à une formidable prosopopée [5], en faisant vibrer dans le tribunal un discours qu’aurait pu tenir l’illustre poète : « Vous m’avez donné la meilleure œuvre que j’aie lue depuis vingt ans. […] En même temps que je vous ai lu sans restriction jusqu’à la dernière page, j’ai blâmé les dernières. Vous m’avez fait mal, vous m’avez fait littéralement souffrir ! l’expiation est hors de proportion avec le crime ; vous avez créé une mort affreuse, effroyable ! Assurément la femme qui souille le lit conjugal doit s’attendre à une expiation, mais celle-ci est horrible, c’est un supplice comme on n’en a jamais vu. […] Il est déjà très regrettable qu’on se soit ainsi mépris sur le caractère de votre œuvre et qu’on ait ordonné de la poursuivre, mais il n’est pas possible, pour l’honneur de notre pays et de notre époque, qu’il se trouve un tribunal pour vous condamner ». Cet argument d’autorité ne peut manquer d’impressionner le tribunal, alors même que le pauvre Lamartine voyait son « Lac » tourné en dérision au chapitre 3 de la troisième partie ! De sa propre autorité, Senard proclame que « Madame Bovary est un bon livre, une bonne action ».
Pour justifier les passages incriminés, Senard dénonce les plus grands auteurs ! À propos de la scène du fiacre, il invoque Mérimée : « Mon Dieu, savez-vous ce qu’on a supposé ? Qu’il y avait probablement dans le passage supprimé quelque chose d’analogue à ce que vous aurez la bonté de lire dans un des plus merveilleux romans sortis de la plume d’un honorable membre de l’Académie Française, M. Mérimée. M. Mérimée, dans un roman intitulé La double méprise, raconte une scène qui se passe dans une chaise de poste ». Les curieux liront le chapitre XI de la nouvelle, où un interminable dialogue se termine effectivement par ce paragraphe, guère plus explicite que celui de Bovary : « — Oh ! oui, je vous aime, murmura-t-elle en sanglotant ; et elle laissa tomber sa tête sur l’épaule de Darcy. Darcy la serra dans ses bras avec transport, cherchant à arrêter ses larmes par des baisers. Elle essaya encore de se débarrasser de son étreinte, mais cet effort fut le dernier qu’elle tenta ». De même, sur la chute avec Rodolphe, Senard évoque le célèbre roman de Samuel Richardson, Clarisse Harlowe : « Je n’ai qu’un mot à vous dire sur cette scène, il n’y a pas de détails, pas de description, aucune image qui nous peigne le trouble des sens ; un seul mot nous indique la chute ; « elle s’abandonna ». Je vous prierai, encore, d’avoir la bonté de relire les détails de la chute de Clarisse Harlowe, que je ne sache pas avoir été décrite dans un mauvais livre. M. Flaubert a substitué Rodolphe à Lovelace, et Emma à Clarisse ». Pour s’en rendre compte, on lira la lettre 91 de ce roman épistolaire, l’enlèvement de Clarisse.
L’avocat fait ressortir les aspects moraux du livre, tel le fait que « M. Flaubert n’est pas seulement un grand artiste, mais un homme de cœur, pour avoir dans les six premières pages déversé toute l’horreur et le mépris sur la femme, et tout l’intérêt sur le mari. […] Sa mort est aussi belle, aussi touchante, que la mort de sa femme est hideuse. […] il y a un homme qui est sublime, c’est le mari, sur le bord de cette fosse » Il rétorque avec justesse à l’argument du danger pour les jeunes filles : « Et vous craignez, monsieur l’Avocat impérial, que les jeunes femmes lisent cela ! […] Pour mon compte personnel, je comprends à merveille que le père de famille dise à sa fille : Jeune femme, si ton cœur, si ta conscience, si le sentiment religieux, si la voix du devoir ne suffisaient pas pour te faire marcher dans la droite voie, regarde, mon enfant, regarde combien d’ennuis, de souffrances, de douleurs et de désolations attendent la femme qui va chercher le bonheur ailleurs que chez elle ! […] Flaubert ne dit pas autre chose ; c’est la peinture la plus vraie, la plus saisissante de ce que la femme qui a rêvé le bonheur en dehors de sa maison trouve immédiatement ».
Le discours est improvisé à partir de notes, et une interruption de Pinard montre que Senard l’a piqué ; il peut donc lui répondre : « Monsieur l’Avocat impérial, j’ai cité tous les passages à l’aide desquels vous vouliez constituer un délit qui maintenant est brisé. Vous avez développé à l’audience ce que bon vous semblait, et vous avez eu beau jeu. Heureusement nous avions le livre, le défenseur savait le livre ; s’il ne l’avait pas su, sa position eût été bien étrange, permettez-moi de vous le dire. Je suis appelé à m’expliquer sur tels et tels passages. Si je n’avais possédé le livre comme je le possède, la défense eût été difficile. Maintenant, je vous montre, par une analyse fidèle que le roman, loin de devoir être présenté comme lascif, doit être au contraire considéré comme une œuvre éminemment morale. Après avoir fait cela, je prends les passages qui ont motivé la citation en police correctionnelle ; et après avoir fait suivre vos découpures de ce qui précède et de ce qui suit, l’accusation est si faible, qu’elle vous révolte elle-même, au moment où je les lis ! Ces mêmes passages que vous signaliez comme incriminables, il y a un instant, j’ai cependant bien le droit de les citer moi-même, pour vous faire voir le néant de votre accusation ».
Senard cite Bossuet, d’abord sans le nommer histoire de jouer aux devinettes avec le tribunal : « Aussi qu’est-ce autre chose que la vie des sens, qu’un mouvement alternatif de l’appétit au dégoût, et du dégoût à l’appétit, l’âme flottant toujours incertaine entre l’ardeur qui se ralentit et l’ardeur qui se renouvelle ? » ; « Qui a dit cela ? qui a écrit les paroles que vous venez d’entendre, sur ces excitations et ces ardeurs incessantes ? Quel est le livre que M. Flaubert feuillette jour et nuit, et dont il s’est inspiré dans les passages qu’incrimine M. l’Avocat impérial ? ». Toujours dans ce jeu de devinettes, il passe à « M. le président de Montesquieu », un extrait pris dans « un exemplaire qui a été donné en prix à un élève de collège », extrait d’Arsace et Isménie : « Déjà j’avais porté mes mains sur son sein ; elles couraient rapidement partout ; l’amour ne se montrait que par sa fureur ; il se précipitait à la victoire ; un moment de plus, et Ardasire ne pouvait pas se défendre ». L’édition de la Pléiade n’est pas ici à la hauteur de sa réputation, car elle ne précise pas les références de ces citations, pas plus que la lettre à laquelle fait allusion Senard : « Montesquieu décrit dans les Lettres persanes une scène, qui ne peut pas même être lue ». Je n’ai pas le courage de relire ce livre. Si un lecteur a une idée de cette lettre, merci de nous faire signe !
C’est sur la justification de la scène de l’extrême-onction, précédée de la phrase « collant ses lèvres sur le corps de l’Homme-Dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d’amour qu’elle eût jamais donné », que Senard est le meilleur : « L’extrême-onction n’est pas encore commencée ; mais on me reproche ce baiser. Je n’irai pas chercher dans sainte Thérèse, que vous connaissez peut-être, mais dont le souvenir est trop éloigné, je n’irai pas même chercher dans Fénelon le mysticisme de Mme Guyon, ni des mysticismes plus modernes dans lesquels je trouve bien d’autres raisons. Je ne veux pas demander à ces écoles, que vous qualifiez de christianisme sensuel, l’explication de ce baiser ; c’est à Bossuet, à Bossuet lui-même que je veux la demander : « Obéissez et tâchez au reste d’entrer dans les dispositions de Jésus en communiant, qui sont des dispositions d’union, de jouissance et d’amour : tout l’Évangile le crie. Jésus veut qu’on soit avec lui ; il veut jouir, il veut qu’on jouisse de lui. Sa sainte chair est le milieu de cette union et de cette chaste jouissance : il se donne. » Etc. » Senard invente quasiment la critique génétique, car il retrouve la même paraphrase sensuelle de l’extrême-onction chez un confrère de Flaubert : « M. Sainte-Beuve, dans un livre que vous connaissez, met aussi une scène d’extrême-onction, et voici comment il s’exprime : « Oh ! oui donc, à ces yeux d’abord, comme au plus noble et au plus vif des sens ; à ces yeux, pour ce qu’ils ont vu, regardé de tendre, de trop perfide en d’autres yeux, de trop mortel ; pour ce qu’ils ont lu et relu d’attachant et de trop chéri ; pour ce qu’ils ont versé de vaines larmes sur les biens fragiles et sur les créatures infidèles ; pour le sommeil qu’ils ont tant de fois oublié, le soir, en y songeant ! ». On note d’ailleurs une légère différence avec la version de cette lettre XXIV de Volupté sur Wikisource (mais on retrouve la même version sur Google livres). Senard donne le coup de grâce en citant la source commune à Sainte-Beuve et Flaubert, le catéchisme de « M. l’abbé Amboise Guillois » : « Aux reins (ad Iumbos) : Par cette sainte onction, et par sa grande miséricorde, que le Seigneur vous pardonne tous les péchés que vous avez commis par les mouvements déréglés de la chair ». En ce qui concerne la mort d’Emma avec la chanson de l’aveugle, on relèvera cet aveu étonnant : « Et vous voyez si quelque chose manque au tableau, l’huissier est là, là aussi est le juif qui a vendu pour satisfaire les caprices de cette femme, les meubles sont saisis, la vente va avoir lieu ; et le mari ignore tout encore. Il ne reste plus à la malheureuse qu’à mourir ! ». C’est donc Senard qui nous apprend ce que le texte ne dit pas, que Lheureux serait juif ! Bel exemple de « paralipse » au sens de Gérard Genette. Pourtant, au chapitre V de la seconde partie, Lheureux ne dit-il pas : « — Une misère, répondit-il, une, misère ; mais rien ne presse ; quand vous voudrez ; nous ne sommes pas des juifs ! » Serait-ce un signe de l’antisémitisme forcené de l’époque, selon lequel un usurier ne pouvait être que juif ?
Il est également facile de démonter l’accusation d’avoir montré un prêtre ridicule, et Senard, à la fin de sa plaidoirie, s’identifie à son client : « Qu’est-ce que j’ai montré, moi ? Un curé de campagne qui est dans ses fonctions de curé de campagne ce qu’est M. Bovary, un homme ordinaire. L’ai-je représenté libertin, gourmand, ivrogne ? Je n’ai pas dit un mot de cela. […] J’ai mis en contact avec lui et en état de discussions presque perpétuelles un type qui vivra — comme a vécu la création de M. Prud’homme — comme vivront quelques autres créations de notre temps, tellement étudiées et prises sur le vrai, qu’il n’y a pas possibilité qu’on les oublie : c’est le pharmacien de campagne, le voltairien, le sceptique, l’incrédule, l’homme qui est en querelle perpétuelle avec le curé. Mais dans ces querelles avec le curé, qui est-ce qui est continuellement battu, bafoué, ridiculisé ? C’est Homais, c’est lui à qui on a donné le rôle le plus comique parce qu’il est le plus vrai, celui qui peint le mieux notre époque sceptique, un enragé, ce qu’on appelle le prêtrophobe ».
Senard conclut très académiquement par le bilan de sa plaidoirie : « cette question par laquelle j’ai commencé ma plaidoirie, et par laquelle je la finis : La lecture d’un tel livre donne-t-elle l’amour du vice, inspire-t-elle l’horreur du vice ? l’expiation si terrible de la faute ne pousse-t-elle pas, n’excite-t-elle pas à la vertu ? La lecture de ce livre ne peut pas produire sur vous une impression autre que celle qu’elle a produite sur nous, à savoir : que ce livre est excellent dans son ensemble, et que les détails en sont irréprochables. Toute la littérature classique nous autorisait à des peintures et à des scènes bien autres que celles que nous nous sommes permises. Nous aurions pu, sous ce rapport, la prendre pour modèle, nous ne l’avons pas fait ; nous nous sommes imposé une sobriété dont vous nous tiendrez compte ».
Le jugement
Si l’acquittement est obtenu, certains attendus sont édifiants sur la conception officielle de la littérature. En voici trois : « Attendu qu’à ces divers titres l’ouvrage déféré au tribunal mérite un blâme sévère, car la mission de la littérature doit être d’orner et de récréer l’esprit en élevant l’intelligence et en épurant les mœurs plus encore que d’imprimer le dégoût du vice en offrant le tableau des désordres qui peuvent exister dans la société ».
« Attendu qu’il n’est pas permis, sous prétexte de peinture de caractère ou de couleur locale, de reproduire dans leurs écarts, les faits, dits et gestes des personnages qu’un écrivain s’est donné mission de peindre ; qu’un pareil système, appliqué aux œuvres de l’esprit aussi bien qu’aux productions des beaux-arts, conduirait à un réalisme qui serait la négation du beau et du bon et qui, enfantant des œuvres également offensantes pour les regards et pour l’esprit, commettrait de continuels outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs ».
« Mais attendu que l’ouvrage dont Flaubert est l’auteur est une œuvre qui paraît avoir été longuement et sérieusement travaillée, au point de vue littéraire et de l’étude des caractères ; que les passages relevés par l’ordonnance de renvoi, quelque répréhensibles qu’ils soient, sont peu nombreux si on les compare à l’étendue de l’ouvrage ; que ces passages, soit dans les idées qu’ils exposent, soit dans les situations qu’ils représentent, rentrent dans l’ensemble des caractères que l’auteur a voulu peindre, tout en les exagérant et en les imprégnant d’un réalisme vulgaire et souvent choquant ».
Appendices
Le volume de la Pléiade a sélectionné quelques extraits du dossier Bovary. Cela commence par les différentes étapes du brouillon de la première page, dont on peut vérifier sur le site de l’université de Rouen que le manuscrit définitif ne contient toujours pas le « Nous » initial, qui n’est ajouté que sur le manuscrit des copistes. On lira sur ce point précis deux études, celle de Françoise Ménand Doumazane et celle de Pierre-Marc de Biasi : « Nouer et dénouer le Nous : le cas Flaubert ». Ce dernier nous propose une brillante analyse, qui relie ce « nous » au sort de la petite Berthe, mise en usine à l’âge de 12 ans, qui poursuit à la génération suivante, l’exclusion subie par Charles au collège : « Au fond que cherche à nous dire Flaubert ? Que les illusions romantiques ont fabriqué une société sans pitié qui envoie les enfants à l’usine. Que ce petit « monde intellectuel », ce « nous » littéraire dont les jeunes fils de la bourgeoisie étaient si fiers dans les années 1830, a servi d’écran de fumée et de machine à stéréotypes pour masquer une autre histoire : la marche vers une dictature politique et la construction d’un univers social glacé où c’est l’intérêt personnel le plus immédiat, la bassesse et la bêtise qui peuvent maintenant, en toute impunité, dire « nous » et qui triomphent ».
L’épisode des « verres de couleurs », auquel Flaubert a renoncé après l’avoir beaucoup travaillé, donne lieu à une étude intéressante, qui en retrace paradoxalement la genèse et l’importance pour l’auteur (notes p. 1192). Les « conversations pendant le bal » sont un autre passage supprimé ; on relève par exemple ce paragraphe, peut-être trop politique, qui révèle l’arrière-pensée de l’auteur : « Oui, l’esprit de nos campagnes est généralement assez bon, dit le Marquis. Quoique les mœurs de la population agricole s’y corrompent un peu au voisinage des fabriques. L’exemple de fortunes rapidement acquises descend en effet, du capitaliste au petit bourgeois, frappe l’artisan, gagne l’ouvrier lui-même et établit ainsi à poste fixe, dans la basse classe, une cause de perturbation morale déplorable ! Monsieur le conseiller ! le colportage de la librairie nous fait aussi bien du mal et les fillettes de paysan, au lieu d’aller aux vêpres, passent maintenant leur dimanche à lire un tas de mauvais petits livres qui les gâtent et sur lesquels le gouvernement devrait avoir les yeux ! »
Les « Mémoires de Mme Ludovica » sont un document de premier plan, qu’on peut trouver en ligne sur ce site consacré à James Pradier. En effet, ce pseudonyme cache une amie de Flaubert, Louise Darcet, qu’il connaissait par sa famille avant qu’elle devienne Mme Louise Pradier. Ces faux mémoires sont en fait l’œuvre d’une femme de l’entourage de Louise, à laquelle Flaubert aurait passé commande de ce texte vers 1847 : « Ce serait un cas intéressant de documentation anticipée, assez en accord avec les habitudes de Flaubert ». Lire une lettre du 2 avril 1845 à son ami Alfred le Poittevin, dûment censurée dans l’édition Conard : « J’ai eu pitié de la bassesse de tous ces gens déchaînés contre cette pauvre femme, parce qu’elle a ouvert ses cuisses à un autre vi qu’à celui désigné par M. le Maire. On lui a retiré ses enfants, on lui a retiré tout. Elle vit avec 6 mille francs de rente, en garni, sans femme de chambre ; dans la misère » (où l’on se rend compte que la « misère » ne saurait concerner une femme de chambre !). Certains paragraphes de ces mémoires sont dignes d’un roman beaucoup plus réaliste — et invraisemblable ! — que celui de Flaubert : « cet homme avait pris de l’ascendant sur Ludovica. Son esprit enjoué sa légèrté habituele pliait sous le regard froid et sévère du peintre. malgré cette différence de caractère cette liaison dura l’espace d’un an. au bout de quelques temps ludovica devint enceinte, et finit par craindre tellement le père de son troisième enfant que cette crainte seule l’enchainait à lui. j’ai vu ludovica devenir pâle comme une morte rien qu’aux coup de sonnette que donnait cet homme, et ne paraître devant lui qu’après avoir pris dix minutes pour se remettre. si bien caché que fut cette liaison le mari de ludovica l’aprit et un jour qu’il était bien renseigné il se rendit à l’atelier du peintre, heurta a la porte avec sa canne. pas un souffle n’échapa. mais le cœur de ludovica bondit, et à travers sa poitrine on eut peut le voir battre. le mari de ludovica attendit longtemps car il était bien instruit. mais ils eurent de la patience et au bout de six heures d’atentes et de craintes le peintre sorti et fit visiter toutes les portes adjassente et sur qu’il n’y avait plus personne fit sortire ludovica travesti avec les vettements de la portière et par ce moyen méconnaissable. je la vois encore cette pauvre ludovica, elle si fière de sa beauté de son nom, monter dans une voiture habiller en portière, et redescendre de cette même voiture dans sa toilette habituele ».
Un autre extrait utile est celui de l’aide apportée par cette femme de confiance qui rédige les mémoires, et des refus de prêts par des hommes sollicités par Mme Pradier : « les affiche de vente roulait a proportion à la maison comme chez elle, il me falait cacher tout cela a mon mari qui eut desuite refuser son nom ce qui achevait de la perdre, car lui croyait rendre service à mr. Pradier. oh comme j’ai souffert mondieu… tout était au mont de piété que faire plus de ressources… plus rien… il vint à l’idée de louise d’emprunter a plusieurs individus de qui elle avait satisfait le caprice, triste moyen. Enfin, elle écrivait les lettre et moi j’alais les porter et le cœur me battait arriver a la porte, il me prenait l’envie de lui dire que je n’avais trouver perssonne, mais c’était son éspoir pouvaije lui mentire, etaije sur d’allieur que j’aurais un refus… si j’avais écouter mes préssentiment, certe ? je n’eu pas sonné, mais elle attendait elle… et je sonnais… pas un de ces homme ne mit même de politesse dans le refus qu’ils fesaient ». Ce document est fourni, l’aurez-vous remarqué, en transcription diplomatique brute de décoffrage !
Articles conseillés
– De manière générale, consulter L’atelier Bovary sur le site de l’université de Rouen, où l’on retrouve de nombreux liens épars dans cet article et ci-dessous. Une page est dédiée au travail en lycée sur les manuscrits.
– Chronologie de la rédaction de Madame Bovary d’après la Correspondance.
– Notes de régie : une page extraordinaire où sont regroupées les indications que Flaubert se donne sur son manuscrit, avec la possibilité de vérifier ce que cela donne.
– Un article d’Yvan Leclerc à propos de la citation apocryphe « Madame Bovary, c’est moi ».
– « Sacralisation et désacralisation du sexe chez Flaubert ».
– Recensement des réécritures bovaryennes.
– Le Dictionnaire des Idées Reçues et Madame Bovary.
– Site de Pierre-Marc de Biasi, spécialiste de Flaubert et de la critique génétique.
– Sur la bisexualité de Flaubert, lire l’article de Michel Larivière et celui de Jean-Yves Alt. On peut lire dans une version non-censurée la longue lettre à Louis Bouilhet du 15 janvier 1850 sur Gallica.
– Lire aussi nos articles sur Par les champs et par les grèves, sur Pierrot au sérail & La Tentation de Saint-Antoine, sur Salammbô, sur la Correspondance de Gustave Flaubert, et sur Gemma Bovery, roman graphique de Posy Simmonds inspiré de Madame Bovary.
– La Conquête de Plassans (1874) d’Émile Zola provoque l’admiration de Flaubert. Il en fait dans une lettre du 3 juin 1874 une critique qu’il faut lire, car Flaubert semble parler de sa Bovary ! On comprend pourquoi c’est un de ses Rougon-Macquart préféré. Une bonne lecture en parallèle… Le même Zola provoque à nouveau l’admiration du maître vieillissant, avec Une Page d’amour, dans lequel Flaubert reconnaît sans doute le « livre sur rien » qu’il ambitionnait. En effet, Zola surclasse Flaubert avec cet ovni des Rougon-Macquart ! Juste après la mort du maître, Pot-Bouille, le premier Zola que Flaubert n’aura pas lu, propose un personnage secondaire, Marie Pichon qui constitue une sorte d’hommage à Bovary (voir le chapitre IV).
– Les Liaisons coupables (1962), film de George Cukor contient une double citation (textuelle et thématique) de Madame Bovary. Dans La Ronde (1950), Max Ophüls s’amuse à donner au couple marié qui est au centre de l’histoire, les noms de Charles et Emma.
Voir en ligne : Le site de l’université de Rouen consacré à Madame Bovary
© altersexualite.com 2014
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Sur ce quartier lire Le Voile noir d’Anny Duperey.
[2] Archaïsme orthographique pour « hêtraie ».
[3] Le mot « baisade » est utilisé par Flaubert dans sa correspondance et ses scénarios (voir ici) ; il sera également utilisé lors de la rédaction de Salammbô.
[4] Cela me fait penser à telle des pièces condamnées de Baudelaire, comme « Les bijoux ». On retrouvera le même motif au chapitre XI de Salammbô : « Mâtho lui saisit les talons, la chaînette d’or éclata, et les deux bouts, en s’envolant, frappèrent la toile comme deux vipères rebondissantes. »
[5] La prosopopée consiste à rendre présent, souvent par le discours, les morts, les abstractions, mais aussi, comme c’est le cas ici, les absents.
 altersexualite.com
altersexualite.com