Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Pierrot au sérail & La Tentation de Saint-Antoine, de Gustave (...)
Flaubert romantique, pour lycéens et adultes
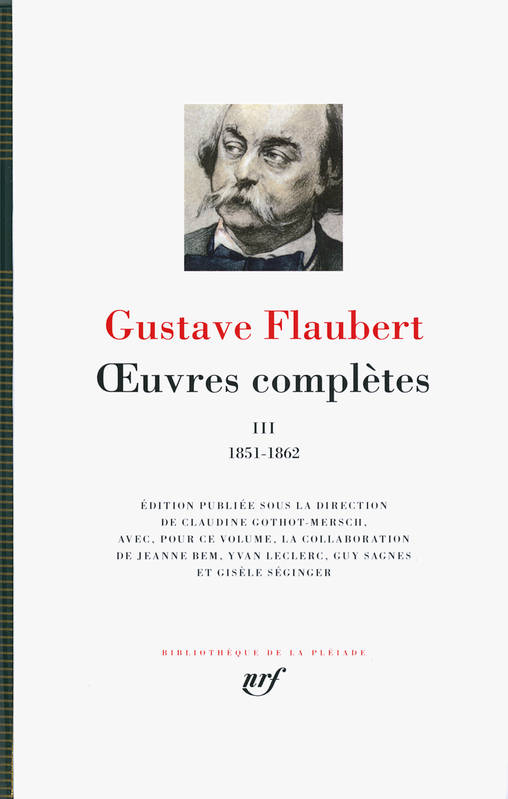 Pierrot au sérail & La Tentation de Saint-Antoine, de Gustave Flaubert
Pierrot au sérail & La Tentation de Saint-Antoine, de Gustave Flaubert
Édition de la Pléiade, Gallimard, 2013
samedi 16 mai 2015
La publication en 2013 de ce 3e volume d’une nouvelle édition des œuvres complètes de Gustave Flaubert est l’occasion de se plonger dans la tête de ce bon vieux Gustave au moment où il composait Madame Bovary (entre le 19 septembre 1851 et le printemps 56, pour une parution en revue entre octobre et décembre 56, un procès fin janvier 57 et une publication en volume en avril 57). Pierrot au sérail et la seconde version de La Tentation de Saint-Antoine n’ont pas grand rapport avec le fond ni la forme de Madame Bovary, mais c’est ce contraste justement qui nous intéresse, et nous permettra de préciser les intentions de Flaubert. Références : Œuvres complètes, III, 1851-1862, édition publiée sous la direction de Claudine Gothot-Mersch, avec, pour ce volume, la collaboration de Jeanne Bem, Yvan Leclerc, Guy Sagnes et Gisèle Séginger, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2013, 1 vol. (XVIII-1334 p.), 67 €.
Pierrot au sérail
Cette courte pantomime sous-titrée « L’Apothéose de Pierrot dans le paradis de Mahomet » avait été coécrite avec son ami Louis Bouilhet vraisemblablement vers 1847, puis mise au net en 1855 par Flaubert pour être refusée par les Folies-Nouvelles (actuel théâtre Déjazet). À mille lieues du réalisme affiché de Madame Bovary, Pierrot nous replonge dans la vogue du Théâtre romantique, et les théâtres du boulevard du crime tels que Les Enfants du paradis les fait revivre. Pierrot part en voyage en Orient avant son mariage, et il fourre discrètement Colombine, sa promise, dans sa malle. Les voilà au désert, et patatras ! Colombine, puis Pierrot sont enlevés par de farouches Arabes. Pierrot se rebiffe, et le voilà condamné, à l’instar de Georges Clemenceau, à choisir son supplice, entre corde et pal : « Deux nègres l’enlèvent et le suspendent sur le pal. Il fait des mouvements tortueux de la croupe pour se l’enfoncer dans le cul. Son effroi à la première sensation ; enfin il déclare qu’il aime mieux le sabre. Il va donc vers le sabre, en essaie le tranchant sur son pouce, et après une longue hésitation, fait encore signe que non » (p. 10). Heureusement, Pierrot « fait un bond en arrière », le sabre coupe la tête du Sultan, et il devient Sultan à la place du Sultan. Comme Colombine veut le rejoindre sur le trône, « Il la renverse d’un coup de pied dans le cul et se rassoit majestueusement » (p. 12). Plus tard, le père et le maître de pension de Pierrot arrivent au sérail ; ils ont recherché Pierrot dans le monde entier. Le père lui fait la morale, mais Pierrot l’envoie valser, ou plutôt l’oblige à danser : « Pierrot renvoie les deux vieillards à grands coups de pied dans le cul. Ils le maudissent dans une pose solennelle. Pierrot leur fait un pied de nez » (p. 14). Le temps passe. Pierrot est « devenu considérablement gros ». On lui propose un clystère : « un Turc […] se présente, portant péniblement sur une serviette d’or, pliée en plusieurs doubles, une gigantesque seringue. – À cette vue toutes les femmes rabattent leur voile. Il faut prendre le clystère. Mais Pierrot, apercevant le calibre de la canule, et se rappelant le pal, déclare qu’il ne prendra pas un tel remède » (p. 16). Il finit par crever au sens littéral du thème : « son ventre hydropique se déchire en deux » (p. 17), et se retrouve dans un « paradis de Mahomet » où l’on trouve entre autres de la « bière de Strasbourg » et des « guirlandes de saucissons »… On ne se demande donc pas pourquoi cette pochade potache a été refusée, mais cette lecture récréative nous permet de mieux comprendre l’état d’esprit de Flaubert.
La Tentation de Saint-Antoine, 2e version
Cette version est une mise au net de l’automne 1856. La Tentation est l’œuvre de toute une vie. Flaubert en a eu l’idée en mars 1845, lors du voyage de noces de sa sœur en Italie. C’est d’ailleurs pour cette sœur Caroline que Flaubert avait inventé en 1841 à l’âge de vingt ans la notion d’âge du capitaine, dont il ignorait qu’elle aurait un succès posthume. Il a admiré La Tentation de Saint-Antoine de Pieter Brueghel le Jeune au palais Balbi [1], qui lui a donné envie d’« arranger pour le théâtre » ce thème.

Cela fait longtemps que Flaubert a dans l’idée d’« écrire une œuvre à la fois philosophique et fantastique centrée sur un personnage unique, assailli de visions » (p. 1058). Il a déjà écrit au collège des textes hybrides entre théâtre et récit, avec Voyage en enfer (1835) et Smar (1839). Il commence à rédiger la première version de l’œuvre en 1848, la finit en 49, avant son départ en Orient avec Maxime du Camp, et la reprend après chaque grande œuvre, jusqu’à la publication en 1874. La documentation pléthorique qu’il amasse lui servira aussi pour Salammbô ainsi que pour Hérodias. Flaubert ne donne pas une vision chrétienne de la légende, mais une version romantique basée sur le triomphe de l’imaginaire, une « réponse au constat de l’insuffisance du monde » selon Maurice Bardèche (Flaubert, La Table ronde, 1988, cité p. 1060). Quand il lit cette version à ses amis Bouilhet et Du Camp, leur avis est franc et sévère : « Tu procèdes par expansion ; un sujet en entraîne un autre, et tu finis par oublier ton point de départ » (p. 1062) ; « Nous pensons qu’il faut jeter cela au feu et n’en jamais reparler » (p. 1105 ; extrait des Souvenirs littéraires de Maxime Du Camp, qui datent de 1881 et sont sans doute très romancés). Cet avis négatif va être déterminant pour réorienter Flaubert « vers un sujet plus prosaïque qui devrait le protéger des élans lyriques ». Flaubert revient à Saint-Antoine quelques jours après avoir achevé Bovary, en juin 1856. Il entre dans des transes d’écriture : « La pâte du style est molle. Quant à l’ensemble, je masturbe ma pauvre cervelle pour tâcher d’en faire un » (p. 1065, Lettre à L. Bouilhet du 28 juillet 56 ; « masturbe » est remplacé par « secoue » dans les éditions expurgées de la Correspondance). « Je travaille comme un boëf (sic) à Saint Antoine. La chaleur m’excite. Et il y a longtemps que je n’ai été aussi gaillard. Je passe mes après-midi avec les volets fermés, les rideaux tirés, et sans chemise ; en costume de charpentier. – Je gueule ! je sue ! c’est superbe. Il y a des moments où « décidément, c’est plus que du délire » ! Blague à part, je crois toucher le joint, je finirai par rendre la chose potable, à moins que je n’aie complètement la berlue, ce qui est possible ? » (p. 1065, Lettre à L. Bouilhet du 11 août 56). Il publie des fragments de cette version en revue, mais le procès Bovary, même s’il a été acquitté, l’incite à renoncer à la publication en volume : « Il faut que je me prive de ce plaisir, car il m’entraînerait en cour d’assises net » (Lettre à Louise Pradier du 10 février 57). Pourtant, il pense que « Saint-Antoine a maintenant un plan ; cela me semble beaucoup plus sur ses pieds que la Bovary » (Lettre à L. Bouilhet du 5 octobre 56). Flaubert écrit à Sainte-Beuve le 5 mai 1857 : « Ne me jugez pas d’après ce roman. Je ne suis pas de la génération dont vous parlez – par le cœur du moins. – Je tiens à être de la vôtre, j’entends de la bonne, celle de 1830. Tous mes amours sont là. Je suis un vieux romantique enragé, ou encroûté, comme vous voudrez. Ce livre est pour moi une affaire d’art pur et de parti pris. Rien de plus. D’ici à longtemps je n’en referai de pareils. Il m’a été physiquement pénible à écrire. Je veux maintenant vivre (ou plutôt revivre) dans des milieux moins nauséabonds » (Les notes de la Pléiade ne citent cette lettre que jusqu’à « enragé »). Gisèle Séginger, auteure de la notice, établit ce parallèle : « on observe dans l’ensemble de l’œuvre de Flaubert une alternance entre le rêve et le réel, entre le mirage oriental ou antique et la banalité bourgeoise […] Comme les allégories tentent Antoine avec le rêve d’autres existences possibles, les livres lus par Emma lui font imaginer quelques scènes d’existences plus brillantes qu’elle aurait voulu connaître. […] Emma incarne aussi avec force une révolte contre l’enlisement dans le réel, contre la monotonie, un besoin d’ailleurs que d’une autre façon La Tentation de 1856 met encore une fois en scène » (p. 1067). Les deux tendances de Flaubert sont également exprimées dans une lettre à Louise Colet du 16 janvier 1852 : « Il y a en moi, littérairement parlant, deux bonshommes distincts : un qui est épris de gueulades, de lyrisme, de grands vols d’aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l’idée ; un autre qui fouille et creuse le vrai ».
La première partie commence bille en tête par un anachronisme, l’évocation de la « Sainte Vierge » ; Salut, Marie, pleine de grâces » (pp. 21, 22), alors que le culte marial n’est pas encore développé au IIIe siècle. Puis Antoine, flanqué de son cochon familier, a la vision des sept péchés capitaux venus le tenter, puis des sectateurs de tout poil, par exemple les « Paterniens », qui déclarent : « Dieu a formé la tête où pousse la pensée, le cœur où palpite la vie. Mais c’est le Diable qui a fait la digestion, la génération et l’envie de voyager qui circule dans les pieds » (p. 33). Puis les « Ophites » proposent une vision originale du mythe d’Ève et du Serpent : « Assise sous un térébinthe, elle le regardait monter. Son corps gluant se collait contre l’écorce, et les feuilles vertes s’enflammaient à son haleine. Quand il eut passé par toutes les branches, il reparut. Les os de son crâne s’écartèrent ; le fruit tomba. Il le retint sur ses dents, et, suspendu par la queue au tronc du grand arbre, il balançait devant le visage d’Ève sa tête sifflante aux paupières enivrées. Elle le suivait attentive ; il s’arrêta. La poitrine d’Ève battait, la queue du serpent se tordait, un lotus s’ouvrit, les dattes des palmiers mûrirent. Elle tendit la main. Il était bon, le fruit superbe. Elle en ramassa l’écorce pour s’en parfumer la poitrine. S’ils en avaient goûté davantage, ils seraient dieux maintenant, selon la promesse du tentateur. » (p. 35). Plus loin, voilà Hélène en fuite : « J’étais dans une forêt, des hommes ont passé. Ils m’ont prise et, m’attachant avec des cordes, m’ont emportée sur leurs chameaux. D’autres accoururent, la caravane devint une armée. Ils se glissaient sur moi dans mon sommeil. Ce fut le Prince d’abord, puis les capitaines, puis les soldais, puis les valets de pied qui soignent les ânes. » (p. 40).
La deuxième partie aboutit à cette proclamation d’Antoine : « J’ai besoin d’aboyer, de beugler, de hurler ! je voudrais vivre dans un antre, souffrir de la fumée, porter une trompe, tordre mon corps, — et me diviser partout, être en tout, m’émaner avec les odeurs, me développer comme les plantes, vibrer comme le son, briller comme la lumière, me blottir sous les formes, pénétrer chaque atome, circuler dans la matière, être matière moi-même pour savoir ce qu’elle pense. » (p. 99).
La troisième partie embraye sur une diatribe du Diable sur les deux infinis, qui nous rappelle Blaise Pascal (qui avait lui-même emprunté à Savinien Cyrano de Bergerac, qui l’avait emprunté à Charles Sorel, l’argument des deux infinis ; cf. cet article) : « quand tu remuais ton bras, savais-tu comment ? et quand s’avançait ton pied, savais-tu pourquoi ? La fiente de ton cochon poudroyant au soleil, avec les scarabées verts qui bourdonnaient à l’entour, suffisait tout comme Dieu à torturer ta pensée, l’infiniment petit n’étant pas plus facile à comprendre que l’infiniment grand. Mais par-delà l’intelligence humaine, il n’y a plus ni ce qui est grand ni ce qui est petit, car l’illimité n’a pas de mesure, l’éternité n’a point de durée. Dieu ne se classe pas en parties. Si le plus imperceptible des brins de la matière te découvre un aussi vaste horizon que l’ensemble des choses, c’est qu’il y a, dans l’un comme dans l’autre, un insaisissable abîme qui les fait pareils. Or, il n’y a pas deux infinis, deux dieux, deux unités. Il y a Lui, et c’est tout ! » (p. 101). Puis le Diable allégorise la Création : « La mélodie d’une lyre, ce n’est pas l’air mis en mouvement, ni la vibration des cordes, ni le son des notes ; elle résulte de tout cela et elle le cause. Tu ne sépareras pas plus la mélodie de la lyre, de ses cordes ni de ses notes, que tu ne disjoindras le créateur de la créature, le fini de l’infini, l’attribut de la substance. La mélodie se fait en vertu d’un ordre qui est en elle – d’où elle n’est pas libre. Dieu existe en vertu de lui-même, en dehors de quoi il ne peut être, et alors il n’est pas libre » (p. 103). Le Diable présente ensuite des créatures et des dieux innombrables, parmi lesquels : « Celle qui porte des croûtes blanchâtres sur la figure, c’est Rubigo la déesse de la Rogne ; non loin Angeronia qui délivre des inquiétudes et l’immonde Perfica, inventrice des olisbus » (p. 132). Les notes, innombrables, de cette édition, oublient de préciser le sens de ce dernier mot…
– Quittons ce livre fuligineux sur le rire du Diable et les prières de Saint-Antoine, et découvrons Madame Bovary. Lire aussi nos articles sur Par les champs et par les grèves, Salammbô, sur la Correspondance de Gustave Flaubert et sur Gemma Bovery, roman graphique de Posy Simmonds inspirée de Madame Bovary.
Voir en ligne : Voir le manuscrit de Pierrot au sérail sur le site Gallica
© altersexualite.com 2014
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Lire sa description de ce tableau reprise dans un article de Paul Valéry. Jusqu’à la rédaction de cet article, il était impossible de trouver sur Internet une autre image que celle figurant dans le lien qui précède de cette version de la Tentation, qui semble-t-il a été désattribuée depuis le passage de Flaubert. Or ce tableau vient d’être à nouveau exposé à Gênes, de façon exceptionnelle, pour la première fois depuis 1946. Dépêchez-vous ! Voir cet article. Je remercie ma collègue Sophie Jeddi d’avoir fait cette trouvaille, depuis publiée sur le site de l’université de Rouen.
 altersexualite.com
altersexualite.com