Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Les Faux-Monnayeurs, d’André Gide, au programme de terminale littéraire
De la socratisation mal tempérée, pour lycéens et adultes
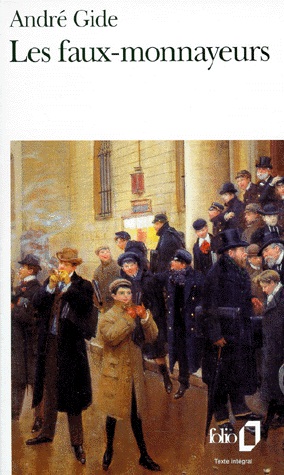 Les Faux-Monnayeurs, d’André Gide, au programme de terminale littéraire
Les Faux-Monnayeurs, d’André Gide, au programme de terminale littéraire
Folio classiques, 1925, 512 p., 8,7 €
jeudi 1er septembre 2016
L’inscription de ce roman au programme de terminale L en 2016-17 (et donc en 2017-18) nous fournit l’occasion de nous replonger dans ce texte. Je n’enseigne pas en TL cette année, mais ce livre, dont je ne parviens pas à me souvenir si je l’avais lu dans mon adolescence ou si j’en ai tellement entendu parler que j’ai l’impression de l’avoir lu, est tellement dans la cible originale du présent site, que l’occasion ne pouvait se rater. Publié un an après Corydon, Les Faux-Monnayeurs s’adresse à un large public, et l’on est amené à rechercher les liens entre les deux livres, d’autant que la pédérastie sera à nouveau présente dans le récit autobiographique Si le grain ne meurt, paru en 1926. Ce triptyque, qui ne peut se comprendre en cloisonnant ces trois livres, fait suite à un événement phare dans la vie de Gide, la séparation d’avec son épouse et cousine Madeleine, après que celle-ci eut découvert et brûlé ses lettres le 21 novembre 1918, dont certaines faisaient état de relations avec des garçons (Lire cet article : « Ces femmes qui ont épousé des homosexuels sans le savoir »). Ce n’est pas la première fois qu’André Gide aborde la question de la pédérastie (le mot est plus adapté que « homosexualité ») [1] ; il l’avait déjà fait en 1902 dans L’Immoraliste, mais c’est la première fois qu’il se mouille à ce point. Et cessons de nous voiler la face : les Boloss des belles lettres ne s’y sont pas trompés : Les Faux-Monnayeurs, c’est l’histoire de deux littérateurs pédérastes et salonnards qui se disputent les faveurs de lycéens, et papillonnent de l’un à l’autre tout en causant littérature pour donner le change. On peut se disputer pour savoir s’ils draguent les lycéens en causant littérature ou s’ils causent littérature en draguant les lycéens… [2] Depuis l’abolition des lois homophobes par François Mitterrand et Robert Badinter en 1982, la communauté gaie travaille à faire la distinction entre homosexualité et pédophilie, et à traiter d’homophobes (à juste titre !) ceux qui font l’amalgame. Or le problème avec Gide c’est qu’il nous renvoie brutalement dans les cordes de cette époque antédiluvienne où les deux étaient à peu près aussi répréhensibles moralement. Il serait bien sûr facile d’adopter une posture morale et de condamner l’ouvrage d’un homme dont on sait qu’il eut des goûts pédophiles (c’est-à-dire qu’il s’intéressait à des garçons pubères, mais qui n’avaient pas encore atteint la barre aujourd’hui légale de 15 ans), et blabla… Tel n’est pas notre point de vue. Puisque ce texte se trouve au programme, il s’agit de le prendre phénoménologiquement [3] comme phénomène culturel, et de l’étudier sous tous les angles, en le replaçant dans son contexte de publication (dans le cadre de l’objet d’étude « Lire, écrire, publier », dont ce triptyque aurait constitué sans doute l’un des plus beaux cas cliniques). Une règle absolue dans le domaine judiciaire est la non-rétroactivité des lois. Alors ne jugeons pas André Gide à l’aune des lois ni des mœurs actuelles. Cela serait aussi bête que d’interdire la Bible parce qu’il y est écrit que « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils seront punis de mort : leur sang retombera sur eux » (Lévitique 20, 13). Soyons plutôt admiratifs pour cet intellectuel qui a osé aborder de front (ou presque) un sujet tabou. Mais si vous me permettez une réflexion personnelle, je suis estomaqué que le Bulletin Officiel qui propose ces deux textes à l’étude ne mentionne ni la question pédérastique (ou même homosexuelle, ce qui serait un euphémisme), ni l’écriture parallèle de Si le grain ne meurt et Corydon. Comment comprendre Les Faux-Monnayeurs avec comme unique lampe-torche Les Caves du Vatican et le Journal des Faux-Monnayeurs, comme semble le suggérer ce pusillanime programme ? Aussi proposerai-je dans cet article une série de liens avec les passages correspondants de Si le grain ne meurt, pour défricher la composante autobiographique, et une réflexion sur la question pédérastique qui manque cruellement à la fois au programme de TL, mais aussi aux deux éditions disponibles consultées pour cet article (Folio classique et Pléiade, Romans et récits II, sous la direction de Pierre Masson, 2009). Me rejoignant dans cette interrogation, le site Lettres volées publie en octobre 2016 une série d’articles sur la pédérastie, contribuant à recentrer l’étude de ce roman sur la vraie problématique que l’on aurait dû mettre au programme dans le cadre de l’objet d’étude « Lire, écrire, publier », laquelle sera bien plus intéressante pour nos lecteurs que les interrogations savantes sur la critique génétique, la mise en abyme, etc. (qui ont bien sûr aussi leur intérêt). J’en appelle à Frank Lestringant, qui dans une entrevue de Joseph Vebret pour lintern@ute, rappelle l’importance de la pédérastie dans l’œuvre de Gide (cf. les propos du même A. Goulet dans son édition Folio de Corydon). Considérer ces trois ouvrages publiés en 3 ans comme un triptyque n’est donc pas une élucubration personnelle, et on s’étonne que les inspecteurs généraux n’en aient pas fait mention dans ce choix courageux. En pleine hystérie antipédophile et alors que des homophobes honteux nous inventent une prétendue « théorie du genre », aborder de front la vraie problématique de Gide eût-il été si futile ? Rappelons ses propos après qu’il eut obtenu le prix Nobel : « j’aurais certainement renoncé au prix Nobel plutôt que de désavouer n’importe lequel de mes écrits. Aucun titre pourtant n’avait été prononcé ; mais lorsque l’interviewer me demanda, sitôt ensuite, quel était celui de mes livres que je considérais comme le plus important, c’est sans hésitation aucune que je nommai Corydon. » […] « l’on m’avait accordé le prix Nobel malgré ce livre ; sans l’ignorer, ce qui devait déjà me suffire ». Ce présent article nous fera sans doute (mais nous y sommes habitué à altersexualite.com) attribuer par le Vaticancan de la fachosphère, le titre envié de docteur honoris diabolici causa en « théorie du genre ». Cette querelle actuelle de la prétendue « théorie du genre » me fait penser à l’affaire de l’Augustinus, qui opposa jansénistes et molinistes au XVIIe siècle. En 1653, le pape Innocent XI avait condamné cinq propositions tirées de ce livre de Jansénius, mais sans citations précises. Arnauld avait riposté en contestant que ces propositions, qu’il désavouait en droit, se trouvassent en fait dans l’Augustinus. Blaise Pascal l’appuya en publiant ses célèbres Provinciales, mais rien n’empêcha qu’on n’aboutît en 1713 à la bulle Unigenitus, condamnant le jansénisme sur la base de ces improbables citations, après l’épisode de la persécution de Port-Royal. La bulle Unigenitus n’est pas loin de ces articles mêlant fachosphère, Vatican et Sarkosphère, condamnant une prétendue « théorie du genre » qui n’est qu’un rideau de fumée destiné à permettre à l’homophobie judéo-islamo-chrétienne de s’exprimer. En effet, comme d’une part il n’est plus politiquement correct de proférer des propos homophobes, et que d’autre part, les différentes Églises et notamment la catho, n’osent pas trop s’agréger au troupeau de l’hystérie anti-pédophile, vu la proportion de pédophiles parmi leurs rangs, ces obédiences ont trouvé comme échappatoire ce nouveau tour de passe-passe consistant à s’attaquer à une « théorie du genre » qui a l’avantage de n’avoir jamais existé, mais qui fait baver les Don Quichotte des moulins à vent de l’ordre moral. Mais voilà que je m’énerve. Passons à Gide !
Plan de l’article
Genèse
Première partie : Paris
Deuxième partie : Saas-Fée
Troisième partie : Paris
Dossier Folio Classique : la pédérastie, ce douloureux problème
Journal des Faux-Monnayeurs
Genèse
Ce livre est présenté comme le « premier roman » de l’auteur dans sa dédicace à Roger Martin du Gard, bien que Gide ait déjà publié des livres que par afféterie il se refusera à qualifier de « roman », préférant « récit » ou « sotie ». Il faut dire qu’entre-temps en 1912 il avait commis la bourde de sa vie, en refusant la publication à la NRF qu’il dirigeait de Du côté de chez Swann, de Marcel Proust, ce qui relativise l’étalage de théories sur le roman dont son « premier roman » est truffé. Dès 1914, un roman intitulé Le Faux-Monnayeur est annoncé « en préparation » (dossier Pléiade p. 1202), mais la rédaction proprement dite ne commence que le 3 octobre 1921 (bien que le Journal des Faux-Monnayeurs commence à la date du 17 juin 1919). Alain Goulet, l’auteur de la notice du roman dans l’édition de la Pléiade, souligne le lien entre les trois livres : « En fait, c’est le drame des lettres brûlées par Madeleine qui détermine Gide à se lancer dans ce roman où il projette d’évoquer une relation homosexuelle comme celle qu’il est en train de vivre avec Marc Allégret, qui conférerait donc un éclairage supplémentaire à cette question centrale dont Corydon présente l’apologie et Si le grain ne meurt l’histoire personnelle. Et alors qu’il avait composé toute son œuvre précédente pour sa femme, pour se dire à elle et la convaincre, c’est pour Marc qu’il écrira ses Faux-Monnayeurs, pour l’éclairer et l’instruire ». Est-il utile de signaler que s’agissant d’une relation pédérastique, la suite de la vie de Marc Allégret ne semble pas révéler qu’il ait eu à souffrir de cet amour de jeunesse ? Roger Martin du Gard n’est pas que le dédicataire, c’est une sorte de conseiller éditorial, qui accompagna et aida Gide du début à la fin de son projet. La fin est d’ailleurs précipitée par le départ de Gide avec Marc Allégret pour l’Afrique, départ reporté d’un an, mais qui oblige quand même Martin du Gard à relire les épreuves pour Gide. (« Je devais partir le 6 novembre pour le Congo ; toutes dispositions étaient prises, cabines retenues, etc. Je remets le départ en juillet. Espoir de finir mon livre (ce n’est d’ailleurs pas là la raison majeure qui me retient) », Journal des Faux-Monnayeurs, 01/11/1924) C’est grâce ou à cause de Martin du Gard, notamment, que Gide tempéra sa propension au scandale. Martin du Gard, qui l’avait encouragé à aller plus loin dans ses mémoires, au contraire le met en garde pour le roman : « je voudrais éloigner de cette œuvre […] tout sujet inutile de scandale personnel. Je soupçonne que vous avez par instants trop de courage, une inutile témérité. […] je ne vois pas ce que le caractère d’Édouard gagne à une exposition trop claire de ses goûts privés ? (Je me demande même […] s’il est plus profitable que nuisible d’en faire un romancier) » […] « le lecteur ayant à hésiter entre l’hypothèse de l’homosexualité ou de l’impuissance, sans pouvoir préciser ». (C’est en passant la preuve que le mot « homosexualité » était connu de Gide). Et Alain Goulet conclut très justement : « Il s’émeut donc de la propension de son ami, encore tout rempli de sa passion pour Marc Allégret, à se confesser à travers son roman et à y exposer ouvertement des émois et un amour de nature homosexuelle. En même temps, cette rédaction montrait la détermination de Gide, parallèlement à Corydon et Si le grain ne meurt, à établir le droit à l’existence et à la parole de ce penchant sexuel. Aux deux points de vue précédents, il ajoutait le récit d’un vécu, dans son intensité et son tourment. » Sauf que ce n’est pas vraiment d’homosexualité qu’il s’agit, mais de pédérastie, et que j’ai bien l’impression que tous les éditeurs modernes du texte, ainsi que les inspecteurs qui nous l’ont mis au programme, ont traité ce détail à la façon d’une patate chaude, lancée sans précaution entre les mains de nos élèves… Au risque de me répéter, je souhaite bonne chance dans l’état d’esprit actuel, aux enseignants qui auront à expliquer face à une classe à majorité musulmane comme c’est le cas dans le type d’établissements où j’enseigne, le goût personnel de tonton Gide pour les garçons arabes qui est la source de ce goût d’Édouard et de Robert pour Olivier ! Heureusement en général les élèves de L, et de terminale L, sont plus ouverts que la moyenne des lycéens. L’une des scènes supprimées sur le conseil de Martin du Gard est publiée parmi les « Fragments retranchés et ébauches » qui suivent le roman dans l’édition de la Pléiade. Édouard discute avec le narrateur, son ami d’études. Il évoque longuement son amour pour Olivier, dans un chapitre dont on peut se réjouir, effectivement, qu’il ait terminé à la poubelle. Le narrateur décrit ainsi son ami Édouard : « Sa mère même jusqu’à son dernier jour ignorait l’emploi quotidien de ses soirées. Il n’eût pu, me disait-il, la persuader que cette femme n’était pas sa maîtresse, supposition qui l’eût désolée, sans lui révéler qu’il était uraniste, ce qui l’eût désolée bien davantage. Au demeurant, la bonne vieille n’était point sotte, me disait-il encore ; « mais je n’ai jamais pu comprendre si elle me croit un ermite, un onaniaque ou un impuissant » » (p. 486). Dans la suite de cette conversation, que le narrateur écoute complaisamment, Édouard lui fait cet aveu : « Je t’ai laissé croire que je voyageais pour me distraire de mon chagrin ; mais c’était de mon amour, qui me paraissait monstrueux, abominable. » Mais c’est pour se reprendre : « Au bout d’une année de voyage, j’avais pu me ressaisir. Je me sentais guéri… comment dirai-je ? non pas de mon amour précisément ; non mais guéri de le trouver abominable. Je l’acceptais à présent comme une chose naturelle ; je dirai plus : comme une chose heureuse, comme un bienfait ; et non pas seulement pour moi ; pour lui tout aussi bien, ou plus encore » […] « Et ne va pas croire surtout à des tas de choses ; t’imaginer que je désire cet enfant. Je le respecte ; entends-tu, je le respecte. Mais ce que je peux dire, c’est que, depuis que je le connais, c’est bizarre, je n’ai plus de désirs pour personne ». Il faut également tenir compte de la naissance de la fille naturelle de Gide, Catherine Gide, en 1923, en pleine rédaction du roman ; fille qui restera cachée jusqu’à la mort de Madeleine. Gide pense sans doute également à elle quand il écrit certaines phrases sur la bâtardise de Bernard. Gide veille à ce que l’argent gagné par ce roman soit versé au bénéfice de sa fille, et verse 5000 F. à Élisabeth van Rysselberghe, mère de Catherine (Pléiade, p. 1208). À noter : Martin du Gard détestait la lutte avec l’ange, mais Gide l’a maintenue.
Le texte est divisé en trois parties, « Paris », puis « Saas-Fée », puis à nouveau « Paris », constituées de 18, 7, et à nouveau 18 chapitres, sans titre dans le livre, mais l’édition Folio classiques propose une table des chapitres en p. 421, qui attribue un titre à chaque chapitre, sans indiquer si ces titres sont de Gide ou de l’éditeur. Vérification faite, la liste est absente de l’édition Pléiade ; il s’agit donc a priori d’une initiative de l’édition Folio, ce qui est fort utile, mais encore faudrait-il avoir l’idée d’en informer le lecteur étudiant !
La réception de l’œuvre est pour le moins mitigée, car la question pédérastique n’échappe pas aux critiques. Citons par exemple Marcel Arland : « que Gide, dans L’Immoraliste, signale le goût de Michel pour les jeunes garçons, cela ne manque pas d’audace ; que ce goût soit plus ou moins exprimé dans ses œuvres suivantes, tant pis, c’est une habitude ; et Corydon, livre didactique et en quelque sens scolaire, abandonne toute prétention littéraire. Mais Les Faux-Monnayeurs, qui veulent être un grand livre, sont construits presque uniquement autour de ce goût ; j’avoue que cela me paraît un peu lassant. » Un autre critique que je n’ai pas pu identifier juge : « Il y a trop d’histoires de petits garçons »
Première partie : Paris
L’incipit répond à l’énigme proposée par le titre en fournissant trois indices : premièrement, un personnage commettant une effraction, ce qui correspond au sème délictueux. Si l’on prend « Faux-Monnayeurs » au sens figuré de produire un faux, alors d’une part le « V, qui peut aussi bien être un N… », d’autre part la découverte d’une filiation factice, constituent des échos au titre [4]. Enfin, l’aphorisme de Bernard « Ça joue la larme, pensa-t-il. Mais mieux vaut suer que de pleurer » prend le titre au sens symbolique de la fausseté des sentiments, et constitue un premier cas de mise en abyme, thème central dans le roman, puisque « jouer la larme » peut se prendre comme un symbole de ce que le roman ou la comédie proposent : susciter par la sueur de l’écrivain ou du comédien des sentiments factices. Mais rappelons le factuel de l’incipit : un adolescent, Bernard, découvre par hasard en démontant une pendule, un paquet de lettres d’amour vieilles de 17 ans, d’où il résulte qu’il n’est pas l’enfant de celui qu’il croyait son père. Le motif de la découverte des lettres provient d’une anecdote du chapitre 5 de Si le grain ne meurt, tandis que le démontage de la pendule est également issu d’une anecdote du chapitre 2. Il prend immédiatement la décision de quitter ce domicile, alors qu’il est censé « potasser son bachot ». Le style compassé, même dans le discours du personnage adolescent (« Ne pas savoir qui est son père, c’est ça qui guérit de la peur de lui ressembler. Toute recherche oblige. Ne retenons de ceci que la délivrance. N’approfondissons pas. Aussi bien j’en ai mon suffisant pour aujourd’hui. »), ainsi que la localisation de l’action « rue de T… […] proche du jardin du Luxembourg », nous mettent sur la voie d’un texte autobiographique, puisque la famille Gide habitait rue de Tournon, proche du Luxembourg, dans un milieu de bourgeoisie intellectuelle et aisée. Ce n’est pas le style naturel de Gide ; il semble composé pour convenir aux personnages. Bernard recherche son ami Olivier, au sein d’un groupe homosexuel d’amis (je veux dire d’amis uniformément masculins, comme cela se pratiquait en ce temps d’écoles non-mixtes et se pratique encore dans certains milieux). « Bernard était son ami le plus intime, aussi Olivier prenait-il grand soin de ne paraître point le rechercher ; il feignait même parfois de ne pas le voir ». Le narrateur fait intrusion par un « je » qui le situe parmi, ou proche de ce groupe de garçons : « Que Lucien fasse des vers, chacun s’en doute ; pourtant Olivier est, je crois bien, le seul à qui Lucien découvre ses projets. » Comme de nombreux personnages, ce jeune Lucien est passionné d’écriture et entend renouveler l’art du roman : « Ce que je voudrais, disait Lucien, c’est raconter l’histoire, non point d’un personnage, mais d’un endroit ». Ces amitiés masculines exacerbées et littéraires semblent prendre racine dans les amitiés d’enfance de Gide, lors de sa scolarité erratique, par exemple son amitié avec Pierre Louÿs, condisciple de l’école alsacienne, évoquée au chapitre 8 de Si le grain ne meurt.
Le chapitre 2 nous présente le père, d’abord en discussion de magistrat avec « son collègue Molinier » à propos d’une affaire de jeunes débauchés, que son collègue lui suggère de traiter avec doigté : « Je ferais fermer l’appartement, le théâtre de ces orgies, et je m’arrangerais de manière à prévenir les parents de ces jeunes effrontés […]. Ah ! par exemple, faites coffrer les femmes ! ça, je vous l’accorde volontiers ; il me paraît que nous avons affaire ici à quelques créatures d’une insondable perversité et dont il importe de nettoyer la société. Mais, encore une fois, ne vous saisissez pas des enfants […]. Songez que trois d’entre eux n’ont pas quatorze ans et que les parents sûrement les considèrent comme des anges de pureté et d’innocence. » Après cette discussion, Albéric Profitendieu découvre la lettre laissée par son « fils » : « dites-lui que je ne lui en veux pas de m’avoir fait bâtard ; qu’au contraire, je préfère ça à savoir que je suis né de vous ». La brève réunion de famille qui suit la découverte de la lettre met à jour les non-dits du couple : « ce n’était pas tant sa faute qu’elle regrettait à présent, que de s’en être repentie ». Le narrateur fait à nouveau intrusion, d’une façon qui maintenant nous paraîtrait artificielle, mais dont la fonction était sans doute de dénoncer les artifices de la narration : « J’aurais été curieux de savoir ce qu’Antoine a pu raconter à son amie la cuisinière ; mais on ne peut tout écouter. »
Le ch. 3 est une scène très homoérotique. Bernard partage le lit de son ami Olivier, en présence du petit frère, et ils se font des confidences sur le récent dépucelage d’Olivier : « je ne pourrai pas si je ne te sens pas tout près de moi. Viens dans mon lit. Et après que Bernard, qui s’est en un instant dévêtu, l’a rejoint : – Tu sais, ce que je t’avais dit l’autre fois… Ça y est… J’y ai été. Bernard comprend à demi-mot. Il presse contre lui son ami. » Et cette première fois a été des plus décevante : « c’est une gonzesse que Dhurmer connaît bien ; à qui il m’avait présenté. C’est surtout sa conversation qui m’écœurait. Elle n’arrêtait pas de parler. Et ce qu’elle est bête ! Je ne comprends pas qu’on ne se taise pas à ces moments-là. J’aurais voulu la bâillonner, l’étrangler… ». Bref, faut-il vous faire un dessin ? Évidemment, pour des lycéens de l’ère du mariage gay, ce langage de faux-monnayeurs de l’amour n’est pas forcément compréhensible. L’autre confidence d’Olivier concerne son admiration bien plus forte que son goût pour les femmes, pour son oncle écrivain Édouard. Si le grain ne meurt ne révèle aucune passion de ce genre, mais deux membres de sa famille auxquels Gide enfant s’est particulièrement attaché, son oncle paternel Charles évoqué au chapitre 2, et son cousin Albert Démarest évoqué à partir du chapitre 3, et surtout au chapitre 9, où l’on trouve des phrases proches du roman. Il faut lire une lettre de l’oncle Charles citée dans La Jeunesse d’André Gide de Jean Delay pour comprendre que l’oncle Édouard du roman est à la fois le calque et l’inversion du rôle moral qu’eut Charles Gide pour André. Édouard incarne un puritanisme pédérastique, si l’on permet l’oxymore ! Quant à Albert, Jean Delay cite un « tardif commentaire de Gide », dont malheureusement il ne précise pas la référence : « Si mon cousin m’avait initié, au lieu de me laisser m’épuiser tout seul, j’aurais été un excellent père de famille » (p. 538). C’est évidemment une phrase clé pour comprendre notre roman.
Au ch. 4 nous découvrons Vincent, le fils du Molinier collègue d’Albéric et le grand-frère d’Olivier et de Georges, qui se rend chez son ami Robert de Passavant. Le modèle de Robert serait Jean Cocteau, d’après une note qui ne vient qu’en p. 148 de cette édition, mais on pourrait également songer à Oscar Wilde. Le personnage jeune et provocateur de Cob-Lafleur qui interviendra plus tard serait une émanation de Raymond Radiguet, en tout cas Radiguet est la preuve qu’un adolescent lettré, provocateur et génial est plausible à l’époque ; ce qui l’est moins, c’est que tous les adolescents le soient ! L’édition de la Pléiade précise que « l’antagonisme avec Cocteau s’accroît d’une jalousie à cause de Marc Allégret qui le fréquente et qui est introduit par lui dans le cercle artistique et mondain du comte Étienne de Beaumont » (p. 1211). Vincent a fait un enfant à Laura, qui a quitté son mari Félix Douvier, or Vincent a besoin d’argent pour Laura, et Robert l’a introduit dans un cercle de jeu, mais Vincent a perdu, et Robert, qui se sent responsable, lui offre une somme équivalente, pour qu’il tente à nouveau sa chance. Robert est un écrivain mondain, mécène d’une revue révélatrice d’un milieu littéraire corrompu qui devra intéresser les élèves dans le cadre de l’objet d’étude « Lire, écrire, publier » : « Naturellement, je ne le signe pas… d’autant plus que j’y fais mon éloge… ». Robert propose à Vincent de publier les textes de son frère Olivier. Gide, qui pratique lui-même une littérature élitiste de réseau (voir le chapitre 10 de Si le grain ne meurt), dénonce donc cette littérature en cercle fermé. Incidemment, Robert apprend à Vincent que son père vient de mourir, ce qui provoque en lui cet aveu cynique : « J’avais confectionné dans mon cœur pour mon père, un amour filial sur mesure, mais qui, dans les premiers temps, flottait un peu et que j’avais été amené à rétrécir ». On songe à la relation quelque peu désinvolte de la mort du père de Gide au chapitre 3 de Si le grain ne meurt.
Le ch. 5 nous permet de faire connaissance de Lilian, l’amante en titre de Robert, qui courtise ouvertement Vincent. Quand Robert lui propose de l’épouser, elle rétorque cyniquement : « Mais, mon cher…, c’est que je crois bien me souvenir que j’ai oublié un mari en Angleterre. Quoi ! je ne vous l’avais pas déjà dit ? ». Robert comprend que Lilian a invité Vincent à la rejoindre après leur départ, mais il laisse faire sans jalousie, et l’on a bien compris qu’il s’agit d’un liaison pour donner le change. L’édition Pléiade nous apprend que le nom de ce personnage vient du goût de Gide pour le film Les Deux orphelines (1921), de D. W. Griffith, avec Lillian Gish, dont il mélange les deux noms pour faire celui de son personnage !
Au ch. 6, nous retournons dans le lit d’Olivier, avec à nouveau des allusions uranistes (pour utiliser le langage de l’époque) : « Son ami, pendant leur sommeil, ou du moins pendant le sommeil de Bernard, s’était rapproché, et du reste l’étroitesse du lit ne permet pas beaucoup de distance ; il s’était retourné ; à présent, il dort sur le flanc et Bernard sent son souffle chaud chatouiller son cou. Bernard n’a qu’une courte chemise de jour ; en travers de son corps, un bras d’Olivier opprime indiscrètement sa chair. Bernard doute un instant si son ami dort vraiment. » Bernard sort en pleine nuit, et se retrouve libre, sans un sou en poche.
Au ch. 7, le réveil de Lilian (alias Lady Griffith) et Vincent est l’occasion d’une jolie coquille de cette édition (p. 71) : « Elle sortie d’un coffre oriental deux larges écharpes aubergine ». Le summum de la coquille sera atteint p. 169 (Livre I, ch. 17), avec « à la tueur de la cigarette » ! On trouve encore, p. 306 : « ma table de toilette » au lieu de « la table… ». On dirait qu’un stagiaire s’est amusé à introduire des coquilles dans un fichier nickel depuis des générations ! Gallimard a dû supprimer quelques postes, et le créateur de la NRF a dû se retourner dans sa tombe… Vincent ne se sent guère plus avancé d’avoir couché avec Lilian, sauf que ce faux pas se produit alors que la chance lui a souri au jeu, et qu’il a désormais largement de quoi subvenir aux besoins de Laura… Cet argent gagné et qui ne sert pas à monnayer son amour, fait écho au titre.
Au ch. 8, nous faisons connaissance d’Édouard, l’oncle d’Olivier, qui vient à Paris depuis Londres après avoir reçu une lettre de Laura, son amie, dont il avoue dans son journal qu’il l’aime plus qu’elle ne le pense. Avec l’entrée du romancier, c’est la double entrée de la mise en abyme. Ce chapitre contient une lettre, et un extrait de journal, deux moyens de suppléer à la narration traditionnelle. Celle-ci nous apprend cependant l’intention d’Édouard « d’aller dans un mauvais lieu ». Dans son journal, Édouard se révèle un écrivain au style encore plus précieux que celui du narrateur : « Il me paraît même que si elle n’était pas là pour me préciser, ma propre personnalité s’éperdrait en contours trop vagues ; je ne me rassemble et ne me définis qu’autour d’elle. » Comme Lucien, il s’interroge sur l’art du roman : « L’analyse psychologique a perdu pour moi tout intérêt du jour où je me suis avisé que l’homme éprouve ce qu’il s’imagine éprouver. […] Dans le domaine des sentiments, le réel ne se distingue pas de l’imaginaire ». Voici le fameux thème de la décristallisation, glose de Stendhal : « On parle sans cesse de la brusque cristallisation de l’amour. La lente décristallisation, dont je n’entends jamais parler, est un phénomène psychologique qui m’intéresse bien davantage. J’estime qu’on le peut observer, au bout d’un temps plus ou moins long, dans tous les mariages d’amour. ». Ce mot du domaine chimique évoque pour moi le phénomène du kaléidoscope, évoqué au chapitre 1 de Si le grain ne meurt ; est-ce par hasard si ce thème kaléidoscopique cristallisation / décristallisation intervient dès le début de cette cristallisation / décristallisation de la trame romanesque en quoi consiste la mise en abyme ? Celle-ci survient au sens propre du terme : « Il songe au roman qu’il prépare, qui ne doit ressembler à rien de ce qu’il a écrit jusqu’alors. Il n’est pas assuré que Les Faux-Monnayeurs soit un bon titre. » La fin du chapitre, en dépit du journal, concentre l’attention d’Édouard sur son neveu Olivier, la véritable cause de sa venue à Paris. Le narrateur semble se moquer du personnage par cette exclamation vieillotte digne d’un personnage de « tante » de caricature : « Ah ! juste ciel ! serait-ce lui ? »
Au chapitre 9, à rebrousse-poil des affirmations d’Édouard contre l’analyse psychologique, le narrateur se livre à une double et minutieuse introspection des faux-semblants d’Olivier et de son oncle, réciproquement amoureux mais incapables de supposer que l’autre ne soit venu à sa rencontre que par hasard.
Le chapitre 10 nous ramène à Bernard, qui espionne son ami et l’oncle d’icelui, qu’il traite de couple : « N’était-il pas l’être que Bernard préférait sur terre ?… Quand il le vit au bras d’Édouard, un sentiment bizarre tout à la fois lui fit suivre le couple, et le retint de se montrer. Péniblement il se sentait de trop, et pourtant eût voulu se glisser entre eux. » Bernard ramasse le ticket de consigne que Bernard, dans son émotion, a laissé choir, et alors qu’il avait l’intention de rendre le bagage, finit par piquer le fric et par lire le journal d’Édouard qu’il contient, lequel nous fournit trois longs chapitres (11 à 13). Et c’est là qu’il découvre par indiscrétion ce qu’en principe on ne confie qu’à soi-même, ce qui se cache derrière l’hétérosexualité de façade d’Édouard, son amour pour Olivier et son attirance pour les adolescents.
Au ch. 11 est retracé le début de l’amour d’Édouard pour Olivier : « La figure d’Olivier aimante aujourd’hui mes pensées » avoue-t-il, avant de raconter par le menu comment, alors qu’il faisait connaissance avec « un jeune lycéen, de treize ans environ », cela l’a conduit à un coup de foudre pour Olivier. Ce garçon est en train de voler des livres à l’étalage quand Édouard le fixe : « Il n’était peut-être pas beau, mais quel joli regard il avait ! » Édouard l’aborde selon la technique pédérastique rodée, et le garçon lui répond en faux-monnayeur : « Je ne cherche pas à transcrire ses propres paroles, car elles perdraient leur caractère, dépouillées de l’extraordinaire accent faubourien qu’il y mettait et qui m’amusait d’autant plus que ses phrases n’étaient pas sans élégance. » Où l’on constate qu’en tant que romancier, Édouard se situerait plutôt dans un style réactionnaire, en tout cas anti-réaliste, anti-Zola, ce qui est justifié par la situation car le jeune Georges semble lui-même le symbole d’un écrivain bourgeois contrefaisant l’accent faubourien (un faux faux bourgeois, donc, faux à la puissance 2). En fait de faubourien, rappelons que Gide ne dédaignait pas le jeune Arabe (je prends « Arabe » ici dans un sens générique désignant les garçons que les riches pédérastes de l’époque allaient cueillir tout autour de la méditerranée ; voir Flaubert et ses bardaches en sa Correspondance) ; mais sans doute dans un roman était-il plus présentable de dissimuler la pédérastie sous le manteau de la socratisation bien tempérée envers des lycéens de bonne famille… Georges ne semble pas né de la dernière pluie : « Dites donc… ça vous arrive souvent de reluquer les lycéens ? ». Queneau s’en souviendra pour sa Zazie : « Vous êtes un vieux salaud, oui » (ch. 4). Il s’avère que ce lycéen faux-faubourien n’est autre que le plus jeune neveu du pédéraste avunculaire, le petit frère d’Olivier. Édouard file dare-dare chez sa sœur, pensant profiter de la situation, mais le petit bougre pervers lui met un mot en main : « Si vous racontez à mes parents l’histoire du livre, je (il avait barré : vous détesterai) dirai que vous m’avez fait des propositions. Et plus bas : Je sors quotidie du lycée à dix h. » Édouard fait d’abord une confidence, que l’on peut prendre pour celle de l’auteur : « Ce qui m’inquiète, c’est de sentir la vie (ma vie) se séparer ici de mon œuvre, mon œuvre s’écarter de ma vie. », puis il lâche le morceau, l’un des plus beaux coups de foudre – coup de foudre pédérastique – de la littérature : « Dès que je le vis, ce premier jour, dès qu’il se fut assis à la table de famille, dès mon premier regard, ou plus exactement dès son premier regard, j’ai senti que ce regard s’emparait de moi et que je ne disposais plus de ma vie ». Commence un épisode de « je t’aime, moi non plus » pédérastique. Édouard se met brusquement à trouver sa sœur Pauline plus intéressante à fréquenter, même si ce n’est guère fructueux concernant Olivier : « le rencontré-je par hasard, je suis si gauche et si confus que je ne trouve rien à lui dire, et cela me rend si malheureux que je préfère aller voir sa mère aux heures où je sais qu’il n’est pas à la maison ».
Au chapitre 12, récit du mariage de Laura, prétexte à quelque aphorisme désabusé (« Admirable propension au dévouement, chez la femme. L’homme qu’elle aime n’est, le plus souvent, pour elle, qu’une sorte de patère à quoi suspendre son amour »), aphorisme qu’on modifiera pour l’appliquer à ce que constitue pour l’homosexuel honteux de ces époques, l’épouse de substitution, la Madeleine de Gide. Lors de la cérémonie de mariage protestant (la famille étant divisée entre catholiques et protestants suite au remariage du grand-père d’Olivier), Olivier fait signe à Édouard de s’asseoir à côté de lui, et bien qu’il le vouvoie, « m’a pris la main et l’a longuement retenue dans la sienne. […] Il a gardé les yeux fermés pendant presque toute l’interminable allocution du pasteur, ce qui m’a permis de le contempler longuement ; il ressemble à ce pâtre endormi d’un bas-relief du musée de Naples, dont j’ai la photographie sur mon bureau. J’aurais cru qu’il dormait lui-même, sans le frémissement de ses doigts ; sa main palpitait comme un oiseau dans la mienne. » Nous voilà clairement dans le registre pédérastique des Idylles de Théocrite et de Corydon. Notons au passage une première remarque teintée d’antisémitisme, digression que la forme journal autorise : « L’exhalaison est aussi forte, et peut-être plus asphyxiante encore, dans les meetings catholiques ou juifs, dès qu’entre eux ils se laissent aller ; mais on trouve plus souvent parmi les catholiques une appréciation, parmi les juifs une dépréciation de soi-même, dont les protestants ne me semblent capables que bien rarement. Si les juifs ont le nez trop long, les protestants, eux, ont le nez bouché ; c’est un fait. » La relation du mariage, après la cérémonie, permet d’introduire à la fois la pension Vedel-Azaïs, et Armand, jeune frère de Laura et autre jeune ami fasciné par la beauté d’Olivier : « Et puis qu’est-ce que deviendrait la repopulation, s’il fallait condamner au célibat tous ceux qui ne sont pas des Adonis… ou des Oliviers, dirons-nous pour nous reporter à une époque plus récente ». Cette hyperbole permet de contourner la remarque d’Édouard au ch. 8 : « Il se dit que les romanciers, par la description trop exacte de leurs personnages, gênent plutôt l’imagination qu’ils ne la servent et qu’ils devraient laisser chaque lecteur se représenter chacun de ceux-ci comme il lui plaît ». Tout ça pour en revenir à la description hyperbolique à la Mme de La Fayette ! Toujours dans ce registre de coq-à-l’âne, Édouard connaît le grand frisson en fréquentant « le train de ceinture », où le discours d’une mère à sa fille l’indigne, ce qui nous vaut cette réflexion édifiante : « Oh ! je sais bien que c’étaient des gens du peuple ; mais le peuple aussi a droit à notre indignation ». Cela nous rappelle certaines préventions de classe du jeune Gide telle celle évoquée au chapitre 6 de Si le grain ne meurt, où il ne peut se résoudre à fréquenter le balcon du théâtre « environné de gens qui me paraissaient du commun ». La pension Vedel-Azaïs et Armand ont une triple généalogie autobiographique, que l’on peut retrouver dans Si le grain ne meurt. PremiL’inscription de ce romanèrement, Vedel est le véritable nom du professeur de l’École alsacienne qui renverra le petit André pour « mauvaises habitudes », au chapitre 3. Deuxièmement, Armand est calqué sur Armand Bavretel, pseudonyme pour Émile Ambresin, au chapitre 6, dont le père pasteur fournit l’un des modèles du vieil Azaïs ; l’autre étant le fondateur de la pension Keller évoqué au chapitre 8. Ce qui est passionnant, c’est que le modèle se suicida à l’âge de 22 ans, et que Gide, sans doute par remords du rôle qu’il joua dans ce suicide, l’affecta dans son roman, à la fois à Olivier (suicide raté) et à Boris (suicide accompli), et le remords à Bernard. Voir à ce propos la genèse de Corydon. Troisièmement, la pension Keller, au cœur du chapitre 7, que Gide fréquenta un an et demi aux alentours de sa seizième année, et où il eut pour répétiteurs des maîtres tels que ceux qu’il évoquera au chapitre 2 de la IIIe partie des Faux-Monnayeurs.
Bernard ne semble pas décontenancé par la découverte des liens pédérastiques d’Édouard et Olivier (car lui seul connaît désormais les sentiments des deux protagonistes) : « Son amitié pour Olivier était évidemment des plus vives […] mais Olivier et lui ne comprenaient pas tout à fait de même l’amitié ». Et Gide a sans doute introduit sciemment l’expression « en être » dans cette phrase amusante : « Un peu de ce dépit qu’il avait ressenti tout à l’heure à voir Olivier au bras d’Édouard : un dépit de ne pas en être ». En effet, le Vocabulaire de l’homosexualité masculine, de Claude Courouve nous apprend que l’expression « en être » est fort ancienne, utilisée par Rousseau mais aussi fréquemment par Proust. On relèvera dans ce chapitre 12 l’importante profession de foi d’Édouard : « Je n’ai jamais rien pu inventer. Mais je suis devant la réalité comme le peintre avec son modèle, qui lui dit : donnez-moi tel geste, prenez telle expression qui me convient. Les modèles que la société me fournit, si je connais bien leurs ressorts, je peux les faire agir à mon gré ; ou du moins je peux proposer à leur indécision tels problèmes qu’ils résoudront à leur manière, de sorte que leur réaction m’instruira. C’est en romancier que me tourmente le besoin d’intervenir, d’opérer sur leur destinée. Si j’avais plus d’imagination, j’affabulerais des intrigues ; je les provoque, observe les acteurs, puis travaille sous leur dictée. » Il est difficile de comprendre ce que Gide sous-entend. Est-ce une critique du « roman expérimental » à la Zola ? Une condamnation de l’immoralisme du personnage qui n’ose pas assumer ses désirs et préfère les observer chez les autres ? En tout cas, Gide a commenté cette phrase dans son Journal, dont on peut consulter les pages consacrées aux Faux-Monnayeurs sur le site-magister de Philippe Lavergne. En date du 29 octobre 1929 : « « Je n’ai jamais rien pu inventer. » C’est par une telle phrase du Journal d’Édouard que je pensais le mieux me séparer d’Édouard, le distinguer… et c’est de cette phrase au contraire que l’on se sert pour prouver que, « incapable d’invention », c’est moi que j’ai peint dans Édouard et que je ne suis pas romancier. »
Au ch. 13, Édouard relate en son journal sa visite à un vieillard, La Pérouse, qui philosophe par aphorismes comme tous les personnages : « Dieu m’a roulé. Il m’a fait prendre pour de la vertu mon orgueil ». Ce personnage a pour modèle principal Marc de la Nux (chapitre 9 de Si le grain ne meurt), le professeur de piano vénéré de Gide, qui utilisera pour son roman nombre de conversations notées dans son journal. Sa seule raison de vivre est l’existence d’un petit-fils qu’il n’a jamais rencontré, Boris, mais dont il a subtilisé la photo. Le romancier a encore choisi que ce soit un enfant mâle qui suscite de tels sentiments… Dans les « Fragments retranchés et ébauches », Gide avait d’ailleurs laissé filtré un autre indice de la personnalité de Marc de la Nux, le fait qu’il jouait aussi du violon (p. 505). Or dans le roman définitif, au lieu de jeter un violon par terre, l’épouse de La Pérouse ne jette plus qu’un « cahier de musique ». Un autre modèle de La Pérouse est mentionné dans les « éléments manuscrits non retenus par Gide » qui se trouvent en marge du Journal des Faux-Monnayeurs dans l’édition de La Pléiade : « Le pauvre père Espinas, à la mort de sa vieille femme n’a pu parvenir à se persuader que, la défunte, c’était elle » […] « le peu de logique que conservait encore son esprit exigeait que le mort qu’on devait enterrer, ce soit lui ». Suivent des propos que l’on pourra trouver prétentieux, toujours prêtés à Édouard : « Une sorte de tragique a jusqu’à présent, me semble-t-il, échappé presque à la littérature. Le roman s’est occupé des traverses du sort, de la fortune bonne ou mauvaise, des rapports sociaux, du conflit des passions, des caractères, mais point de l’essence même de l’être ». Il est tellement évident que Diderot, Hugo, Balzac, Stendhal, Zola… ne se sont préoccupés que de babioles dans leurs œuvres romanesques ! Ironiquement, juste après cette mention du « tragique moral », ce grand penseur en vient à ronchonner façon courrier des lecteurs de Gala sur le fait qu’un éphèbe ne daigne pas l’aimer : « Mais il ne se soucie pas de moi, ne s’aperçoit même pas de l’intérêt que je lui porte ». On aimerait conseiller à tonton Gide dans sa tombe de rouvrir par exemple Pot-Bouille, d’Émile Zola, et de relire au dernier chapitre, l’épisode de l’accouchement de Louison, pour voir si les naturalistes manquaient la profondeur de l’être humain !
Le chapitre 14 reprend la trame narrative, avec la démarche de Bernard auprès de Laura, où il retrouve Édouard auquel il avoue le vol de sa valise. Celui-ci lui demande « vous avez lu mes papiers ? », et Bernard (qui confirme donc connaître les goûts pédérastiques d’Édouard), lui fait cette proposition : « Je suis ici pour vous servir ». On n’est certes pas dans le cadre du roman réaliste ! À la fin de ce chapitre on relève un solécisme volontaire : « Il ne vit que Pauline, malgré qu’il prolongeât désespérément sa visite » (« malgré que » est considéré comme incorrect par les puristes).
Au ch. 15, entretien entre Robert et Olivier où le dandy recrute le lycéen pour sa revue littéraire (« Il faut que cette revue devienne une plate-forme de ralliement pour la jeunesse »). L’antisémitisme se fait jour : « Vous connaissez, je crois, un certain youpin du nom de Dhurmer ? » […] « j’ai infiniment plus de confiance dans votre goût qu’en celui de Sidi Dhurmer ». Il semble en réalité que Robert trouve ce prétexte pour s’assurer de la compagnie d’un éphèbe pour l’été, puisque au ch. 17, il demande à son ami Vincent de lui arranger le coup avec leurs parents : « Rédacteur en chef d’une revue, à son âge !… Avouez que ça n’est pas ordinaire. – C’est si peu ordinaire que je crains que ça n’effraie un peu mes parents, dit Vincent, tournant enfin vers lui les yeux et le regardant fixement ». Gide peut s’appuyer son son expérience de la fondation de La Nouvelle Revue française entre 1908 et 1910, parmi les fondateurs de laquelle on trouve Jean Schlumberger, grand frère de Maurice, qu’il aima (donc on retrouve la situation des fratries du roman), Marcel Drouin, et Henri Ghéon, tous deux confidents de Gide en matière d’uranisme.
Au ch. 16, nous retrouvons Olivier avec Lilian, laquelle utilise à deux reprises le terme « triche » / « tricheur » pour lui faire des reproches, ce qui nous renvoie au titre. L’arrivée de Robert est l’occasion d’aphorismes, que Lilian reproche d’ailleurs à son ami : « Non ; moi, je mets ma coquetterie à ne pas rougir, fût-ce de la boutonnière. » Puis, se tournant vers Lilian : « Savez-vous qu’ils sont rares, de nos jours, ceux qui atteignent la quarantaine sans vérole et sans décorations ! »
Au ch. 18, La Pérouse n’a pas même besoin de le demander à Édouard : il suffit qu’il évoque son petit-fils Boris qu’il n’a jamais vu, pour qu’alléché par l’odeur de garçon, celui-ci décide de se rendre en Suisse pour le voir. Dans un échange sur l’art, une belle métaphore fait un parallèle entre le progrès des arts et celui des mœurs : « Avez-vous remarqué, que tout l’effort de la musique moderne est de rendre supportables, agréables même, certains accords que nous tenions d’abord pour discordants ? »
Deuxième partie : Saas-Fée
Ce titre étrange est le nom d’un village isolé du Valais, qui s’écrit désormais Saas-Fee, villégiature idéale pour la bourgeoisie élitiste. Cette partie constitue une sorte de Jules et Jim pédérastique, où la femme n’est que le faire-valoir de la réunion d’un pédéraste et d’un éphèbe, sans doute inspirée du voyage de Gide en Suisse avec le jeune Marc Allégret, en 1917. Cela commence par une lettre de Bernard à Olivier où l’on ne sait si celui-là est idiot ou menteur quand, alors qu’il connaît pour avoir lu son journal, les tendances d’Édouard, apprend à Olivier sans rire qu’« il m’a proposé de les accompagner, parce que ça le gênait de voyager en tête à tête avec elle, vu qu’il n’a pour elle que des sentiments d’amitié », puis que « pour cacher son identité, Laura passe pour la femme d’Édouard ; mais chaque nuit c’est elle qui occupe la petite chambre et je vais retrouver Édouard dans la sienne. Chaque matin c’est tout un trimbalement pour donner le change aux domestiques ». Le lecteur avisé doit comprendre, je suppose, que ce qui est à cacher aux domestiques est tout autre, et que Gide devait en avoir une certaine habitude. D’ailleurs Olivier ne s’y trompe pas, et guide le lecteur naïf : « l’abominable serpent de la jalousie se déroulait et se tordait en son cœur. « Ils couchent dans la même chambre !… » Que n’imaginait-il pas aussitôt ? Son cerveau s’emplissait de visions impures qu’il n’essayait même pas de chasser. Il n’était jaloux particulièrement ni d’Édouard, ni de Bernard ; mais des deux. » Le ch. 2 est un nouvel extrait du journal d’Édouard. Il fait la connaissance de Mme Sophroniska, qui est médecin, et comme par hasard, justement en train de lire le dernier ouvrage d’Édouard. Le dossier nous apprend que c’est le double du Dr Eugénie Sokolnicka (encore le name dropping !), introductrice de la psychanalyse en France. Elle se charge de soigner le petit Boris, en compagnie de sa propre fille Bronja. Le garçon souffre d’un traumatisme infantile, qu’elle tâche de traiter, ce qui nous vaut une discussion dont je relève un extrait en avance sur son temps : « J’ai vu des juges d’instruction maladroits souffler sans le vouloir à un enfant un témoignage inventé de toutes pièces et l’enfant, sous la pression d’un interrogatoire, mentir avec une parfaite bonne foi, donner créance à des méfaits imaginaires. » Cette évidence, qui a échappé aux juges des affaires Outreau et Cie, était donc déjà connue en 1925 ; c’était ce que la psychanalyse appelle « suggestion » ! (cf. L’École du soupçon, les dérives de la lutte contre la pédophilie , de Marie-Monique Robin).
Au ch. 3, Laura se rend compte à moitié de ce à quoi elle a servi : « Édouard l’avait trompée en éveillant en elle un amour qu’elle sentait encore vivace, puis en se dérobant à cet amour et en le laissant sans emploi. » Puis on a droit à des pages et des pages de dissertation littéraire où chaque personnage, quel que soit son âge, son sexe ou son métier, semble agrégé de lettres. Édouard confond théorie littéraire et bons mots quand il ironise sur Balzac : « Concurrence à l’état civil ! Comme s’il n’y avait pas déjà suffisamment de magots et de paltoquets sur la terre ! », ou tente de faire passer pour de l’art son incapacité à s’intéresser à autre chose qu’à son égo : « Mon roman n’a pas de sujet. Oui, je sais bien ; ça a l’air stupide ce que je dis là. Mettons si vous préférez qu’il n’y aura pas un sujet… “Une tranche de vie”, disait l’école naturaliste. Le grand défaut de cette école, c’est de couper sa tranche toujours dans le même sens ; dans le sens du temps, en longueur. Pourquoi pas en largeur ? ou en profondeur ? Pour moi, je voudrais ne pas couper du tout. Comprenez-moi : je voudrais tout y faire entrer, dans ce roman. » Édouard explique sa façon d’écrire son roman sans l’écrire : « sur un carnet, je note au jour le jour l’état de ce roman dans mon esprit ». Suit une phrase-clé pour l’étude de ce roman en terminale L : « Songez à l’intérêt qu’aurait pour nous un semblable carnet tenu par Dickens, ou Balzac ; si nous avions le journal de L’Éducation sentimentale, ou des Frères Karamazov ! l’histoire de l’œuvre, de sa gestation ! Mais ce serait passionnant… plus intéressant que l’œuvre elle-même… » Édouard est amené à justifier le titre de son roman : « À vrai dire, c’est à certains de ses confrères qu’Édouard pensait d’abord, en pensant aux faux-monnayeurs ; et singulièrement au vicomte de Passavant ». Gide songeait-il aussi aux homosexuels forcés à trafiquer leurs sentiments pour donner le change ? Une phrase extraite des « Fragments retranchés et ébauches » nous met sur cette piste : « Et je me demande si précisément ce n’est pas l’empêchement qu’il éprouve de laisser son œuvre pénétrer ses nouvelles amours, si ce n’est pas le caractère inavouable de celles-ci, qui d’autre part le précipite dans l’artificiel » (p. 495).
Au ch. 4, on revient à l’action : Laura obtient le pardon de Félix : « Au nom de ce petit enfant qui va naître, et que je fais serment d’aimer autant que si j’étais son père », ce qui amène Bernard à réfléchir sur sa propre attitude et à comprendre : « que celui qui m’a tenu lieu de père n’a jamais rien dit ni rien fait qui laissât soupçonner que je n’étais pas son vrai fils » ; il prend conscience de son ingratitude. Il mentionne en exemple des lectures sur « certaines peuplades des îles de l’Océanie [dont] c’est la coutume d’adopter les enfants d’autrui ». Dans les « Fragments retranchés et ébauches », ce thème était abordé en entrée du roman, dans une scène fastidieuse de repas chez les Profitendieu, le soir du départ de Bernard. L’une des invitées faisait état de son expérience de vie en Polynésie (p. 483). Édouard joue les psy, mais les psys du XIXe siècle, et nous ressert le préjugé sur la masturbation qu’on avait déjà relevé dans Corydon : « De même qu’à l’onanisme avaient succédé les mouvements nerveux, ceux-ci cèdent à présent à je ne sais quelle transe invisible. » [5]
Le ch. 6 commence par une lettre d’Olivier à Bernard, réplique à celle du ch. 1, où il se vante d’être lui aussi devenu le secrétaire (lisez : Giton) d’un littérateur pédéraste & fortuné. La lettre est écrite de Vizzavone (orthographe actuelle Vizzavona) en Corse, où Gide fit un court séjour en août 1923. Cette tendance à faire feu romanesque de tout bois glané dans sa propre vie est à mettre au crédit de son art du roman, même si ça peut surprendre ou passer pour manque d’imagination. Olivier croit à la fable de son poste de « rédacteur en chef », et se laisse prendre à la tentation de la corruption : « Passavant voudrait que, dans le premier numéro, paraisse quelque chose de très libre et d’épicé, parce qu’il estime que le plus mortel reproche que puisse encourir une jeune revue, c’est d’être pudibonde ; je suis assez de son avis. » Le portrait crypté du séducteur pédéraste laisse lire entre les lignes la rivalité des Gitons Olivier et Bernard, qui se vantent d’avoir levé le meilleur micheton : « Il fait tout pour me faire oublier son âge et je t’assure qu’il y parvient. […] Passavant est si généreux qu’il voulait toujours tout m’offrir et que je devais sans cesse l’arrêter ». Gide était-il conscient d’écrire un Satyricon édulcoré ? De même que le roman latin nous informe sur les mœurs de Rome, Les Faux-Monnayeurs délivre quelques informations sur les mœurs sexuelles de l’époque. Cela étonnera sans doute nos élèves que la prostitution opère dans les salles de spectacle : « Un autre jour, nous étions à l’Olympia. Pendant l’entracte, nous nous promenions dans le hall où circulait grande abondance de putains. » […] « Je crois qu’il a horreur des putains. Il m’a confié qu’il n’était jamais entré dans un bordel et m’a laissé entendre qu’il serait très fâché contre moi si j’y allais ». Gide nous fournit le mode d’emploi de son livre à la suite de la lettre : « Il fit de vains efforts pour déchiffrer, sous une épaisse rature, les trois lignes, écrites en post-scriptum, et que voici : « Dis à l’oncle É… que je pense à lui constamment ; que je ne puis pas lui pardonner de m’avoir plaqué et que j’en garde au cœur une blessure mortelle. » Ces lignes étaient les seules sincères de cette lettre de parade, toute dictée par le dépit. Olivier les avait barrées. » Soyons un lecteur plus habile que les personnages, et sachons lire sous les ratures de Gide (par exemple les ratures inspirées par Martin du Gard sur la question pédérastique ; Alain Goulet signale qu’elles sont nombreuses, notamment dans les ch. 10, 12 et 16 de la 3e partie). La fin du chapitre nous invite d’ailleurs à restituer ce que Gide a raturé entre les lignes : « Si vous ne dormez pas, je voudrais vous demander encore… Qu’est-ce que vous pensez du comte de Passavant ? – Parbleu [6], vous le supposez bien, dit Édouard. Puis, au bout d’un instant : – Et vous ? – Moi, dit Bernard sauvagement… je le tuerais. » Question : pourquoi Bernard veut-il tuer Robert ?
Le dernier chapitre de cette 2e partie est entièrement constitué de commentaires du narrateur sur ses personnages, que l’on pourra ne pas trouver ridicules si l’on est de bonne volonté et si l’on a oublié Diderot : « Édouard m’a plus d’une fois irrité (lorsqu’il parle de Douviers, par exemple), indigné même ; j’espère ne l’avoir pas trop laissé voir ; mais je puis bien le dire à présent. Sa façon de se comporter avec Laura, si généreuse parfois, m’a paru parfois révoltante. » Pourquoi révoltante ? c’est au lecteur perspicace de trouver !
Troisième partie : Paris
La 3e partie commence par un chapitre de journal d’Édouard. Il fait part à Molinier, de ses « craintes sur l’influence que Passavant pourrait avoir sur Olivier », et utilise l’expression « enlèvement d’Olivier », allusion claire, pour les happy few, aux enlèvements évoqués dans L’Homosexualité initiatique dans l’Europe ancienne, de Bernard Sergent, et avec l’enlèvement d’un caouadji par Alfred Douglas au chapitre 2 de la 2de partie de Si le grain ne meurt, enfin et surtout au projet d’« enlèvement » d’Athman évoqué par un long échange de lettres avec la mère de Gide, en février et mars 1895, que l’on peut lire dans La Jeunesse d’André Gide de Jean Delay. Je vous propose de vous pencher en histoire de l’art sur cette version parmi les plus belles de Le Viol de Ganymède de Pierre Paul Rubens (1636-1638), visible au musée du Prado à Madrid.

Molinier profite de l’occasion, aidé par l’absorption de Pommard, pour s’épancher sur ses malheurs conjugaux depuis que sa femme lui a découvert une maîtresse. Édouard le juge « ridicule ». Molinier revient aussi sur l’affaire des « orgies » évoquées par Profitendieu au ch. 2 de la 1re partie. Il se vante d’avoir modéré les ardeurs du magistrat, qui selon lui, « risquait d’embrocher son fils », et ajoute : « Profitendieu a été pris de quelques soupçons, car son zèle s’est brusquement ralenti ; que dis-je, il a paru faire machine arrière, et la dernière fois que je lui ai demandé où cette affaire en était, il s’est montré gêné ». Molinier est loin de s’imaginer qu’il s’agit en fait de son propre fils, qu’à ce stade le lecteur croit être Olivier, qui s’est vanté à Bernard d’avoir franchi le pas avec « une gonzesse ». Au contraire, Édouard le laisse se mettre le doigt dans l’œil : « j’attache une particulièrement grande importance aux fréquentations de mes enfants. J’estime qu’on ne saurait trop y prendre garde. Les miens ont heureusement une tendance naturelle à ne se lier qu’avec ce qu’il y a de mieux ». Ces propos proviennent en droite ligne des préjugés des parents de Gide, mentionnés au chapitre 3 de Si le grain ne meurt. Ces longs chapitres de journal contiennent de moins en moins de réflexions, et de plus en plus de relations de discussions et d’actions, qui relèvent de la narration romanesque, comme si ce personnage de romancier était incapable de faire roman d’autre chose que de la réalité qu’il observe et dans laquelle il intervient tant soit peu, application de son affirmation du ch. 12 de la 1re partie : « Je n’ai jamais rien pu inventer ». La mise en abyme, ici, prend un autre sens que l’évocation de la fabrique du roman dans le roman, c’est l’inscription du roman à l’intérieur d’un journal lui-même inclus dans un roman ; et il faut remarquer l’artifice avec lequel le ch. 3, qui est prétendument extrait du journal d’Édouard, enchaîne avec la narration prise en charge par le narrateur externe, de la suite de ce que relate Édouard, ce qui amène le lecteur à s’interroger sur l’identité ou plutôt la nature de ce narrateur extradiégétique qui finit par enchaîner si naturellement sur le narrateur intradiégétique qu’est Édouard.
Nous en sommes à la rentrée des classes à la pension Vedel-Azaïs. Boris « avait l’air d’une fille, le sentait et s’en désolait », ce qui ne présage rien de bon, d’autant qu’un nouveau personnage fait son entrée : « Un certain Léon Ghéridanisol faisait centre et déjà s’imposait. Un peu plus âgé que les autres, et du reste plus avancé dans ses études, brun de peau, aux cheveux noirs, aux yeux noirs, il n’était ni très grand ni particulièrement fort, mais il avait ce qu’on appelle « du culot ». » Cette description précise de Léon permet au narrateur de se démarquer de la profession de foi anti-description d’Édouard, comme s’il disait : « assez rigolé, laisse faire le pro ! ». Le jeune Georges Molinier, séduit par ce Léon, se fait fort de raconter devant lui à son copain Phiphi (Philippe Adamanti) ce qui a failli leur arriver pendant les vacances : « une descente de police avait été opérée au commencement des vacances. Ce que ces femmes et ces enfants ignoraient, c’est que Profitendieu avait eu grand soin d’attendre, pour cette opération, une date où les délinquants mineurs seraient dispersés, désireux de ne les englober point dans la rafle et d’épargner ce scandale à leurs parents ». Voilà l’information du lecteur complétée sur les trois fils Molinier : entre celui qui encloque une fille et l’abandonne, celui qui s’ignore homosexuel, et celui qui fréquente les bordels à 13 ans, voilà de quoi rabaisser les prétentions de leur père au chapitre précédent ! Quand la narration revient à Édouard, le narrateur continue le récit, alors qu’on aurait pu revenir au journal d’Édouard. Celui-ci se plaint du mutisme de Bernard, comme dans un vieux couple : « vous m’avez offert vos services et que je suis en droit d’espérer de vous quelques récits… » ; et voilà encore une autre forme de mise en abyme puisque les faits sont rapportés par le prisme du rapport de Bernard à Édouard, ce qui permet d’en donner une relation sommaire.
Le ch. 5, également du ressort du narrateur, relate les retrouvailles d’Olivier et Bernard. Le fossé se creuse entre les deux amis. Cela s’exprime par exemple avec le double juron de cette phrase particulièrement élégante : « Parbleu ! s’écria-t-il, je sais parbleu bien que ce n’est pas toi qui penses ainsi » [7]. Le chapitre fait un écart sur le petit Georges, pour introduire le fait romanesque qui correspond au sens propre au titre, et qui est introduit par une nouvelle occurrence du juron : « – Tu l’as passée ? – Parbleu ! – On ne t’a rien dit ? » Georges hausse les épaules : « Qu’est-ce que tu voulais qu’on me dise ? – Et on t’a rendu la monnaie ? » […] Georges avait payé un franc la fausse pièce. Il avait été convenu qu’on partagerait la monnaie. ». C’est Léon qui manigance cet écoulement de fausse monnaie, guidé par « son grand cousin » Strouvilhou, déjà évoqué plus haut comme un pensionnaire indiscipliné de la pension Vedel dix ans auparavant. Laissant cette piste de côté, on revient à Bernard et Olivier. Ce dernier est désespéré du refroidissement de Bernard : « S’il n’y sent plus son ami près de lui, cette revue cesse de l’intéresser. C’était si beau, ce rêve de débuter ensemble ». De plus, ayant convié Bernard et Édouard, les deux êtres qu’il chérit le plus, à une soirée de lancement de sa revue, il pressent ce qui risque de se produire : « il lui faudrait parader ; Édouard allait le méjuger davantage ; le méjuger sans doute à jamais… ». Bernard évoque son amour idéalisé pour Laura : « je n’ai plus de désirs du tout. Moi qui, dans le temps, tu t’en souviens, m’enflammais à la fois pour vingt femmes que je rencontrais dans la rue (et c’est même ce qui me retenait d’en choisir aucune), à présent je crois que je ne puis plus être sensible, jamais plus, à une autre forme de beauté que la sienne ; que je ne pourrai jamais aimer d’autre front que le sien, que ses lèvres, que son regard. » Entre les deux excès, le lecteur malin comprend ce qui arrive à Bernard.
Au ch. 6 on en revient au journal d’Édouard, pour une rencontre avec sa demi-sœur Pauline. Cela nous permet au passage de vérifier qu’ils se vouvoient ou s’appellent réciproquement « mon (ma) pauvre ami(e) », ce qui confirme mon impression de style compassé ou vieille France. À côté de cela, Édouard est capable d’utiliser à 3 reprises « jobard » ou « jobarderie ». À force de persifler sur Robert, Édouard s’entend dire par Pauline « C’est avec vous que j’aurais souhaité qu’il partît », mais peut-être parle-t-elle trop vite ! C’est sans doute la forme du journal intime qui permet à Édouard de commenter : « Gêné de la voir ainsi se méprendre, et ne pouvant la détromper ». Pauline a des doutes sur Georges, qu’elle soupçonne d’avoir dérobé les lettres adultères de son mari, ce que le lecteur sait déjà, de même qu’il sait déjà que ledit mari soupçonne sa femme, dont il ignore qu’elle sait déjà tout de son adultère.
Aux ch. 7 et 8, on revient à la narration. Armand expose à Olivier, qui lui demande un article, sa théorie de « la limite de résistance », qui n’est autre que le paradoxe sorite. L’un de ses exemples est le suivant : « la corde est tendue jusqu’à se rompre, sur laquelle le démon tire… Un tout petit peu plus, la corde claque : on est damné. Comprends-tu maintenant ? Un tout petit peu moins : le non-être ». On pourrait appliquer le même principe à la majorité sexuelle, et se demander si Gide n’y aurait pas songé : un jour de plus ou un jour de moins, et une relation amoureuse passe du crime à la légalité. Prenons l’exemple de Zahia Dehar et poussons-le à l’absurde : un jour de plus, il y avait une affaire de mœurs pouvant mener plusieurs célébrités à la déchéance ; un jour de moins, il n’y avait rien… Armand refuse la proposition d’Olivier de se rendre à la soirée de son journal, mais propose que sa sœur Sarah soit invitée. Bernard doit l’accompagner. Sarah tient des propos féministes : « ne consentait à voir dans le mariage de Laura qu’un lugubre marché, aboutissant à l’esclavage. L’instruction qu’elle avait reçue, celle qu’elle s’était donnée, qu’elle avait prise, la disposait fort mal, estimait-elle, à ce qu’elle appelait : la dévotion conjugale. Elle ne voyait point en quoi celui qu’elle pourrait épouser lui serait supérieur. N’avait-elle point passé des examens, tout comme un homme ? N’avait-elle point, et sur n’importe quel sujet, ses opinions à elle, ses idées ? Sur l’égalité des sexes, en particulier ; et même, il lui semblait que dans la conduite de la vie et, partant, des affaires, de la politique même au besoin, la femme fait souvent preuve de plus de bon sens que bien des hommes… ». Lors de la soirée assez alcoolisée, Gide inaugure (à ma connaissance) le name dropping, en introduisant Alfred Jarry comme personnage de son roman, et pas qu’un peu : « Vêtu en traditionnel Gugusse d’hippodrome, tout, en Jarry, sentait l’apprêt ; sa façon de parler surtout, qu’imitaient à l’envi plusieurs Argonautes, martelant les syllabes, inventant de bizarres mots, en estropiant bizarrement certains autres ; mais il n’y avait vraiment que Jarry lui-même pour obtenir cette voix sans timbre, sans chaleur, sans intonation, sans relief. » Cette scène engendre un problème, celui de la datation de la diégèse. En effet, Jarry étant mort en 1907, l’action ne peut se situer qu’avant cette date. Cela permet de justifier les théories littéraires étalées au fil des pages, ignorant le surréalisme qui fait fureur au moment de la publication, mais cela demande, rétrospectivement, d’évaluer les possibles anachronismes depuis le début du roman. On se contentera des indices relevés par la suite. Il est plusieurs fois fait mention d’automobiles voire de taxis. Cela est possible avec des véhicules comme Renault Type AG. Par contre au ch. 16, lorsqu’il est question d’une rubrique Fer à repasser dans la revue de Passavant, ainsi que de la « Joconde à moustache », les notes de bas de page y voient des allusions au célèbre Cadeau de Man Ray, qui date de 1921, et au non moins fameux L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp (1919). Les lycéens pourront s’amuser à dater la diégèse en relevant ce genre d’indices, problématique tout à fait absente des deux principales éditions disponibles. Les notions de psychanalyse évoquées au travers du personnage de Mme Sophroniska iraient dans le sens de 1921. Le nom de Freud, absent de la rédaction définitive, est présent dans les « Fragments retranchés et ébauches » : « elle me demanda brusquement si j’avais entendu parler des travaux et des découvertes d’un célèbre psychiatre autrichien, du nom de Freud » (p. 509). Le mot « commutateur » au sens d’interrupteur électrique est utilisé dans ce chapitre. Il est facile de savoir grâce à Internet de quand date la 1re lampe électrique de tel ou tel type ; mais pour savoir de quand date raisonnablement un éclairage électrique fonctionnel, et non un prototype, dans un restaurant parisien, je vous souhaite bon courage. Quant au name dropping, un certain Paul-Ambroise est nommé à deux reprises dans le roman, allusion discrète à Paul Valéry, dont ce sont les vrais prénoms inversés. Cette question de la datation laisse totalement indifférents les éditeurs de la Pléiade ou de Folio. Seul Gide s’en préoccupe un peu dans son Journal des Faux-Monnayeurs, quand il écrit : « Il n’est sans doute pas adroit de situer l’action de ce livre avant la guerre ». Passavant se donne en spectacle : « Averti des bruits désobligeants qui couraient sur ses rapports avec Olivier, il cherchait à donner le change. Et pour s’afficher plus encore, il s’était promis d’amener Sarah à s’asseoir sur ses genoux. » Tout cela va amener Olivier à un tournant radical : « L’ivresse exaspérait en lui ce sentiment affreux, qu’il connaissait si bien, de demeurer en marge ». Ivre, Olivier tente de gifler Dhurmer qui l’a insulté ; Édouard le prend en charge, et voilà le résultat : « Quand il avait senti la main d’Édouard se poser sur son bras, il avait cru défaillir et s’était laissé emmener sans résistance. De ce que lui avait dit Édouard, il n’avait rien compris que le tutoiement. Comme un nuage gros d’orage crève en pluie, il lui semblait que son cœur soudain fondait en larmes. […] Alors, tout frémissant de détresse et de tendresse, il se jeta vers Édouard et, pressé contre lui, sanglota : « Emmène-moi. » ». De son côté, Bernard sauve Sarah des griffes de Robert, et la ramène à sa chambre. L’action s’emballe !
Armand, qui a accompagné Bernard dans la chambre de sa sœur Sarah, les surprend au matin : « Armand s’avance vers le lit où sa sœur et Bernard reposent. Un drap couvre à demi leurs membres enlacés. Qu’ils sont beaux ! Armand longuement les contemple. Il voudrait être leur sommeil, leur baiser. Il sourit d’abord, puis, au pied du lit, parmi les couvertures rejetées, soudain s’agenouille. Quel dieu peut-il prier ainsi, les mains jointes ? Une indicible émotion l’étreint. Ses lèvres tremblent… Il aperçoit sous l’oreiller un mouchoir tâché de sang ; il se lève, s’en empare, l’emporte et, sur la petite tache ambrée, pose ses lèvres en sanglotant. » Je vous renvoie aux analyses psychanalytiques… d’autant que, à peine dépucelé, Bernard n’a qu’une idée en tête, foncer retrouver son ami Olivier chez Édouard, et là, c’est un festival. Gide nous donne 3 indices successifs : Premier indice : « Édouard habitait à Passy, au dernier étage d’un immeuble. Sa chambre ouvrait sur un vaste atelier. Quand, au petit matin, Olivier s’était levé, Édouard ne s’était pas d’abord inquiété. « Je vais me reposer un peu sur le divan », avait dit Olivier. Et comme Édouard craignait qu’il ne prît froid, il avait dit à Olivier d’emporter des couvertures. Un peu plus tard, Édouard s’était levé à son tour ». Ils ont donc couché ensemble ; et si ce n’est pas clair, 2e indice : Apprenant la tentative de suicide de son ami, Bernard repense à leur discussion d’ivresse de la veille sur le suicide, à laquelle il n’avait pas accordé d’intérêt. Il rapporte à Édouard les propos d’Olivier : « il comprenait qu’on se tuât, mais seulement après avoir atteint un tel sommet de joie, que l’on ne puisse, après, que redescendre. Tous deux, sans plus ajouter rien, se regardèrent. Le jour se faisait dans leur esprit ». Enfin, pour les lecteurs vraiment lents à la comprenette, 3e indice : « Après que les trois visiteurs l’eurent quitté, Édouard appela la femme de ménage. À côté de sa chambre était une chambre d’ami, qu’il lui demanda de préparer, afin d’y pouvoir installer Olivier ». Faut-il vous faire un dessin ? Cette réticence du texte (il s’agit quand même d’une sorte d’inceste avunculaire & pédérastique, et je souhaite bonne chance à mes chers collègues enseignants de lettres qui auront la charge d’expliciter tout cela à la génération de pervers pudibonds que nous avons comme élèves) renvoie aux affirmations de Gide dans son journal, en date du 3 octobre 1929 : « Qu’il m’eût été facile de rallier les suffrages du grand nombre en écrivant Les Faux-Monnayeurs à la manière des romans connus, décrivant les lieux et les êtres, analysant les sentiments, expliquant les situations, étalant en surface tout ce que je cache entre les phrases, et protégeant la paresse du lecteur », et le 23 juin 1930 : « J’ai eu soin de n’indiquer que le significatif, le décisif, l’indispensable ; d’éluder tout ce qui « allait de soi » et où le lecteur intelligent pouvait suppléer de lui-même (c’est ce que j’appelle la collaboration du lecteur). » Aura-t-il assez sollicité notre lecteur, ce brave Dédé ? Rien de nouveau cependant : la scène de baise subliminale est un grand classique du roman du XIXe siècle ; témoin la « baisade » du chapitre IX de la seconde partie de Madame Bovary de Gustave Flaubert, ou bien la scène du fiacre qui ouvre la 3e partie. Mais pour quelqu’un qui prétendait faire du neuf…
Le ch. 10 commence par de la narration, et se poursuit en journal. Édouard y relate la visite de Pauline, et se comporte en lecteur-décrypteur des paroles de sa demi-sœur : « Je ne le soignerais pas mieux que vous, car je sens bien que vous l’aimez autant que moi. » […] « En ne me scandalisant pas tout à l’heure, je crains de vous avoir scandalisé. Il est certaines libertés de pensée dont les hommes voudraient garder le monopole. Je ne puis pourtant pas feindre avec vous plus de réprobation que je n’en éprouve. La vie m’a instruite. J’ai compris combien la pureté des garçons restait précaire, alors même qu’elle paraissait le mieux préservée. De plus, je ne crois pas que les plus chastes adolescents fassent plus tard les maris les meilleurs ; ni même, hélas, les plus fidèles, ajouta-t-elle en souriant tristement. » Il s’agit pourtant d’une femme qui semble avoir compris que son demi-frère a socratisé son fils. Il est vrai qu’elle sait déjà que son aîné a abandonné une fille qu’il a engrossée, et que son plus jeune a fréquenté un bordel pour lycéens et écoule de la fausse monnaie… Coucher avec un oncle, à côté !… Bref, Pauline Molinier a moins de chance que la Jeanne Lalochère de Zazie dans le métro, qui sait qu’elle peut confier sa fille à son frère Gabriel. Avec un oncle « hormosessuel », mieux vaut avoir des filles ! L’idylle nonobstant se poursuit : « Près de toi, je suis trop heureux pour dormir », proclame Olivier à la fin du chapitre. Une rature signalée dans l’édition de la Pléiade (note a p. 412) dit : « Il me fit place et quand je fus entré dans son lit, se blottit tendrement et comme frileusement contre moi, puis murmura : Il faut… »
Si le ch. 10 n’avait pas été assez clair, on enfonce le clou au 11. Édouard va rechercher les affaires de son amant ; pardon, de son neveu, chez Robert : « Ce rival, qu’il détestait hier encore, il venait de le supplanter, et trop complètement pour pouvoir plus longtemps le haïr ». Celui-là ne fait pas d’histoires : « Celui-ci n’eut donc pas trop de mal à se persuader que précisément il en avait assez d’Olivier ; qu’en ces deux mois d’été, il avait épuisé tout l’attrait d’une aventure qui risquait d’encombrer sa vie ; qu’au demeurant il s’était surfait la beauté de cet enfant, sa grâce et les ressources de son esprit ; que même il était temps que ses yeux s’ouvrissent sur les inconvénients de confier la direction d’une revue à quelqu’un d’aussi jeune et d’aussi inexpérimenté ». Robert ne peut s’empêcher quelques sarcasmes : « Chez moi, vous comprenez, sa présence était plus scabreuse » (sous-entendu que chez son oncle, même si, comme dirait Queneau, tout Paris sait que le tonton est une tata !). Dans le même chapitre, Passavant reçoit Strouvilhou à qui il veut refiler la direction de son journal. Celui-ci affecte une posture pseudo-révolutionnaire et carrément fasciste : « Il ne m’arrive pas de monter dans un tram ou dans un train sans souhaiter un bel accident qui réduise en bouillie toute cette ordure vivante ; oh ! moi compris, parbleu » […] « Une férocité dévouée, voilà qui produirait de grandes choses. En protégeant les malheureux, les faibles, les rachitiques, les blessés, nous faisons fausse route ; et c’est pourquoi je hais la religion qui nous l’enseigne. La grande paix que les philanthropes eux-mêmes prétendent puiser dans la contemplation de la nature, faune et flore, vient de ce qu’à l’état sauvage, seuls les êtres robustes prospèrent ; tout le reste, déchet, sert d’engrais. Mais on ne sait pas voir cela ; on ne veut pas le reconnaître. » […] « C’est l’amélioration de la race, à laquelle il faut travailler. Mais toute sélection implique la suppression des malvenus, et c’est à quoi notre chrétienne de société ne saurait se résoudre. Elle ne sait même pas prendre sur elle de châtrer les dégénérés ; et ce sont les plus prolifiques. Ce qu’il faudrait, ce ne sont pas des hôpitaux, c’est des haras. » […] « de toutes les nauséabondes émanations humaines, la littérature est une de celles qui me dégoûtent le plus. Je n’y vois que complaisances et flatteries. Et j’en viens à douter qu’elle puisse devenir autre chose, du moins tant qu’elle n’aura pas balayé le passé. » Suit une allusion au titre, toujours du même Strouvilhou, et là, le ton change, on dirait que Gide se livre à une autocritique : « Ces sentiments sonnent faux comme des jetons, mais ils ont cours. Et, comme l’on sait que “la mauvaise monnaie chasse la bonne”, celui qui offrirait au public de vraies pièces semblerait nous payer de mots. » […] « Les jeunes gens les plus dégourdis sont prévenus de reste aujourd’hui contre l’inflation poétique. Ils savent ce qui se cache de vent derrière les rythmes savants et les sonores rengaines lyriques. Qu’on propose de démolir, et l’on trouvera toujours des bras. Voulez-vous que nous fondions une école qui n’aura d’autre but que de tout jeter bas ?… » On en revient vite au sarcasme : « J’en connais qui n’attendent qu’un signe de ralliement ; des tout jeunes… Oui, cela vous plaît, je sais », puis : « Parmi vos acolytes, reprit-il après un silence, est-ce que vous comptez votre jeune neveu ? – Le petit Léon, c’est un pur […] – Vous me l’amèneriez ? – Monsieur le comte plaisante, je crois… »
Le ch. 12 n’est constitué que du journal d’Édouard, qui a « Écrit trente pages des Faux-Monnayeurs, sans hésitation, sans ratures. », et qui éprouve encore le besoin d’écrire dans son journal qu’il a écrit ! (cela fait écho à Gide, qui en faisait autant !) Il utilise une métaphore précieuse pour dire comment il conçoit désormais son roman, à l’opposé de ses œuvres précédentes : « laisser couler selon sa pente, tantôt rapide et tantôt lente, en des lacis que je me refuse à prévoir. » Comment un tel érudit que tonton Dédé ne nous cite-t-il pas à propos le « par sauts et gambades » de tonton Montaigne ? Il nous sert un leurre sur l’excipit : « "Pourrait être continué…” c’est sur ces mots que je voudrais terminer mes Faux-Monnayeurs ». Édouard relate ensuite la visite de M. Profitendieu, qui lorsqu’il lui parle de son « fils » Bernard, laisse poindre la première vraie émotion du roman, tout en poursuivant sa mission de juge pour le motif mineur du roman, celui des vraies fausses pièces de monnaie.
Le ch. 13 est le fameux morceau de la lutte avec l’ange, un épisode surnaturel inspiré du thème biblique de la Lutte de Jacob avec l’ange, taillé sur mesure pour échapper au réalisme, et propre à permettre toutes les élucubrations possibles et imaginables, tout en dissimulant l’interprétation homosexuelle, pourtant la plus simple. Reçu au bac, Bernard n’ose le dire à personne, de crainte de passer pour vantard. Il rencontre cet ange, qui le mène ici ou là ; il manque s’enrôler dans une sorte de parti de l’ordre, mais y renonce ; traverse « de pauvres quartiers dont Bernard ne soupçonnait pas auparavant la misère. Le soir tombait. Ils errèrent longtemps entre de hautes maisons sordides qu’habitaient la maladie, la prostitution, la honte, le crime et la faim. » Et voilà pour le réalisme ! Bernard renonce à rejoindre Sarah, et entraîne l’ange dans son lit malgré la présence de Boris, scène jumelle de la scène du ch. 3 de la 1re partie, où il couche dans le lit de son ami Olivier. « Et toute cette nuit, jusqu’au matin, ils luttèrent. Boris voyait confusément Bernard s’agiter. Il crut que c’était sa façon de prier et prit garde de ne point l’interrompre. » On peut voir là l’allégorie de la masturbation aussi bien que la lutte de l’homosexuel tourmenté par la religion contre sa propre nature, ou bien des trucs intellos suggérés par le paratexte un peu comme des leurres, comme la lutte du romancier avec la réalité ou autres balivernes. Le résultat est pourtant clair : exactement comme Olivier au ch. 3 avec sa « gonzesse » dont la « conversation [l]’écœurait », Bernard « prit Sarah en haine et le plaisir qu’il goûtait avec elle en horreur ». Tout homosexuel qui s’est forcé à tenter l’expérience avec une fille pour voir s’il est vraiment homo, a connu ce genre de sentiment. Pour revenir au thème biblique, voici le texte de Charles Baudelaire sur la peinture de Delacroix (d’ailleurs visible dans l’église Saint-Sulpice de Paris, située dans l’épicentre de l’action). Le thème de la lutte renvoie à cette affirmation fumeuse d’Édouard au ch. 3 de la 2e partie : « le sujet du livre, si vous voulez, c’est précisément la lutte entre ce que lui offre la réalité et ce que, lui, prétend en faire ». Pour éclairer notre lanterne, le thème de la lutte est présent parmi les « Fragments retranchés et ébauches », lors de la discussion d’Édouard avec le narrateur : « il n’y avait pas, chez moi, combat, comme il advient souvent entre la chair et l’esprit, ou si tu veux : les sens et l’âme. Chacun allait de son côté ; ils s’ignoraient » (p. 489). Gide n’a pas pu la connaître, bien sûr, mais je préfère en ce qui me concerne la version de ce thème par Jacob Epstein, dont il est question dans cet article. Jacob Epstein fut d’ailleurs l’auteur de la tombe d’Oscar Wilde au Père Lachaise.
Au début du ch. 14, le narrateur se la joue voyou : « Vers six heures, Bernard s’amena chez Édouard » et s’affranchit du style compassé d’Édouard, exactement comme Bernard semble s’être affranchi d’une certaine convention sociale. Édouard lui sert encore un aphorisme devenu proverbial : « Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant ». En lisant Si le grain ne meurt, je constate que je me suis emballé : « s’amener » au sens de venir semble courant sous la plume de Gide : « ils étaient trois, qui s’amenèrent bientôt, avec boîtes à couleurs et chevalets » (chapitre 9) ; « Je les vis s’amener tous deux à l’hôtel des Bains » (chapitre 1 de la 2e partie), etc.
Le ch. 15 commence brièvement par le narrateur, qui passe aussitôt le relais au journal d’Édouard. Celui-ci va voir le vieux La Pérouse, bordélisé par les potaches, et convoque Georges, mais au lieu de lui parler franchement, il lui fait lire un extrait de son roman qu’il vient de rédiger, où il a utilisé à chaud les craintes de Pauline à son sujet. Georges ne comprend pas, aussi Édouard doit-il préciser la menace du juge, ce qui semble impressionner Georges. Édouard crie victoire : « Laissons aux romanciers réalistes l’histoire des laisser-aller » (le mot vient d’être employé dans l’extrait de journal, c’est le fait de suivre sa pente en descendant). L’édition Pléiade nous apprend que Gide s’est inspiré d’une expérience personnelle, où la mère et le frère aîné du petit Yves Allégret lui avaient demandé de le raisonner sur de « graves indélicatesses ». Gide aurait donc rédigé cet épisode pour Yves : « À sa lecture, Yves se décompose mais refuse de se livrer » (Pléiade, p. 1210).
Le ch. 16 est une relation par le narrateur de la visite d’Armand à Olivier. Entre autres provocations, il lui lit une lettre de son grand frère Alexandre, qui fait fortune « sur les bords de la Casamance ». Ce frère raconte qu’il héberge une sorte de fou de bonne famille, qui semble avoir assassiné une femme. Or le narrateur insinue négligemment que ce fou n’est autre que le frère d’Olivier, Vincent. C’est une façon désinvolte de se débarrasser d’un des éléments de l’intrigue en tuant une femme. Décidément, Gide a travaillé pour la psychanalyse. Je ne peux m’empêcher de penser à cette scène du film de Louis Malle Zazie dans le métro où en arrière-plan de la scène principale, rencontre de Pédro-surplus et de Zazie au métro Bastille, un homme poignarde une femme.
Le ch. 17 est entièrement pris en charge par le narrateur et développe de façon très romanesque le piège ourdi par Ghéridanisol contre Boris, dans la droite ligne de Les Désarrois de l’élève Törless, de Robert Musil (1906). L’appendice du Journal des Faux-Monnayeurs livre une coupure de presse du 5 juin 1909 à propos d’un suicide de lycéen à Clermont-Ferrand, dont Gide a fait plus que s’inspirer pour ce chapitre et le suivant. Jean Delay fait ce commentaire dans La Jeunesse d’André Gide : « Pas davantage [que le crime de Lafcadio] le suicide du petit Boris ne sera gratuit, mais motivé par le désir d’obtenir la « considération » de la confrérie des « Hommes forts » qu’anime le nietzschéisant Strouvilhou : c’est en quelque sorte, à l’échelle enfantine, une protestation de la volonté de puissance, un besoin de se revaloriser à ses propres yeux » (p. 631).
Le ch. 18 commence par la narration du suicide de Boris, puis enchaîne et clôt le roman sur le journal d’Édouard. Le narrateur expose l’erreur des enquêteurs : « On préfère tout supposer, plutôt que l’inhumanité d’un être si jeune ; et lorsque Ghéridanisol protesta de son innocence, on le crut. » Édouard conclut sur une phrase qui le renvoie à son statut de prédateur pédéraste : « Je suis bien curieux de connaître Caloub. » Une piste d’interprétation de cette dernière phrase pourrait se trouver dans une phrase cynique attribuée à Alfred Douglas au dernier chapitre de Si le Grain ne meurt.
Dossier Folio Classique : la pédérastie, ce douloureux problème [8]
Le dossier de Frédéric Maget, accompagné d’une lecture d’image d’Agnès Verlet, dans l’édition Folio classiques, est à la fois riche et frustrant. Les analyses sur le thème de Jacob avec l’ange, et sur la mise en abyme sont érudites, certes (sauf quand on nous dit que « la palette [de Delacroix] a déjà quelque chose d’impressionniste », aussi vrai que si ma tante en avait…), et les citations d’engueulades épistolaires de son cadet des lettres Roger Martin du Gard, déterminantes pour forcer Gide à rédiger son « premier roman », sont indispensables ; mais franchement, quand on constate que la mention de l’homosexualité de Gide et de sa pédérastie se limitent à apprendre que « en 1917 Gide est amoureux de Marc Allégret, avec qui il voyage en Suisse » (p. 481), et que « Lors d’un voyage avec Paul Laurens en Algérie, en Tunisie et en Italie en 1893-1894, Gide découvre l’homosexualité et est initié à l’amour physique par la jeune Mériem », on se demande s’il s’agit de malaise ou de manque de perspicacité, d’autant plus que Gide n’a jamais de sa vie découvert l’homosexualité. Il a tout au plus pratiqué la pédérastie et la pédophilie homosexuelles, mais jamais ce qu’on appelle couramment de nos jours « homosexualité » qui suppose dans l’acception courante que les partenaires soient adultes, ou éventuellement adolescents, mais tous les deux. On apprend également que Juliette Gide, la mère, a la bonne idée de décéder en 1895 (« cette disparition est à la fois une souffrance et une libération », p. 495 ; cf. Si le grain ne meurt, deuxième partie, chapitre 2). En octobre de la même année, au lieu de retourner en Algérie, Gide épouse Madeleine, ce qui lui vaut une nouvelle enfance de 22 ans, jusqu’à la rencontre avec Marc Allégret en 1917 (Gide a 48 ans, Marc 16 ans). Madeleine découvre et brûle les lettres d’amour de Gide avec Marc, et « C’est une libération et un nouveau tournant dans la carrière littéraire de Gide ». Une fois qu’on a osé dire ça, pourquoi s’arrêter en si bon chemin, et faire les mijaurées devant le sujet qui fâche ? La pédérastie, et même, disons le mot, la pédophilie homosexuelle, sont LE sujet des Faux-Monnayeurs. Tout le reste n’est que littérature…
Bon, nous y voilà. Ne nous dérobons pas, car ce serait malhonnête vis-à-vis des élèves de TL qui n’ont rien demandé et à qui les inspecteurs ont envoyé cette patate chaude. C’est un secret de polichinelle que notre Prix Nobel André Gide était plutôt pédéraste qu’homosexuel, et même pédophile. Plutôt que de pousser des cris d’orfraie (et il m’étonne que les professionnels de l’indignation médiatique ne se soient pas encore manifestés depuis que ce choix d’œuvre est paru au BO le 22 avril 2016 ; cela ne devrait pas tarder), il convient de s’intéresser – et avec les élèves car cela fait partie de la problématique Lire, écrire, publier – à la question de la tolérance vis-à-vis de la pédophilie. Lire d’abord l’article de Wikipédia « apologie de la pédophilie », où l’on apprend que « Le statut particulier des intellectuels en France, qui avait permis, à une époque où la majorité sexuelle était fixée à 13 ans (soit avant août 1942 pour l’homosexualité, et avant juillet 1945 pour l’hétérosexualité), à certains écrivains comme Henry de Montherlant ou André Gide d’assumer leurs goûts sexuels pour les jeunes garçons sans être inquiétés ou, comme Roger Peyrefitte, d’en retirer un succès de scandale, permet aussi à plusieurs écrivains, à partir de la fin des années 1960, de tenir des discours présentant la pédophilie de manière positive. » Il convient donc de replacer les choses dans leur contexte. Eh oui, paradoxalement, à l’époque, c’était l’homosexualité qui était le tabou absolu, et qui faisait les biens pensants vociférer (aïe ! J’écris comme Gide !). À côté de cela, on peut imaginer, en faisant l’effort de se replacer dans la mentalité de l’époque, que des attouchements d’adolescents pouvaient passer pour véniels, provisoires, etc. Rappelons-nous les propos que Françoise Dolto tenait impunément sur France Inter, avec la plupart des psychologues, jusque dans les années 1990 : la découverte de l’homosexualité à l’adolescence, par peur du sexe opposé, était une étape provisoire. On peut citer comme preuve les propos de Voltaire dans l’article « AMOUR SOCRATIQUE » de son Dictionnaire philosophique : « Les jeunes mâles de notre espèce, élevés ensemble, sentant cette force que la nature commence à déployer en eux, et ne trouvant point l’objet naturel de leur instinct, se rejettent sur ce qui lui ressemble. Souvent un jeune garçon, par la fraîcheur de son teint, par l’éclat de ses couleurs, et par la douceur de ses yeux, ressemble pendant deux ou trois ans à une belle fille ; si on l’aime, c’est parce que la nature se méprend ; on rend hommage au sexe, en s’attachant à ce qui en a les beautés ; et quand l’âge a fait évanouir cette ressemblance, la méprise cesse ». J’émets donc l’hypothèse que la pédophilie – et je précise la pédophilie avec des enfants pubères de 12, 13 ans, pas le viol et l’assassinat d’enfants de 8 ans à la Marc Dutroux ! – pouvait passer pour condamnable, mais pas le crime ultime qu’elle est aujourd’hui. On a bien vu en cette année 2016, que les mêmes médias qui traitent sans la moindre indulgence l’affaire d’un évêque qui ne s’est pas empressé de dénoncer à la police un prêtre présumé pédophile, sans même chercher à savoir son degré de pédophilie, l’âge des enfants et la gravité des atteintes sexuelles, ces mêmes médias sont unanimement prêts, devant un terroriste responsables de la mort d’une dizaine de personnes, à se demander si par hasard il n’aurait pas eu une enfance malheureuse, été victime de racisme à l’école et autres excuses à ses meurtres. À cette époque pas si lointaine où l’aveu d’une simple homosexualité faisait de vous un paria infréquentable, la pédérastie pouvait paradoxalement passer pour un moindre mal, car considérée comme passagère chez la « victime », ou du moins l’objet d’amour. D’autre part, quand la majorité sexuelle était fixée à 21 ans, alors il était indifférent de préférer des ados de 16, 17, 18 ou 20 ans, puisque la loi était la même (enfin ce n’est pas si simple ; voir notre article sur l’affaire Gabrielle Russier, ou sur Bianca Lamblin et Simone de Beauvoir). Enfin, dans ce roman, les proies des pédérastes sont des lycéens ; or à l’époque, un lycéen qui passait son bac, c’était un jeune bourgeois membre de l’élite intellectuelle, un segment minime de la population, et l’on voit bien avec la réaction de Georges quand Édouard le reluque, que cette élite savait se défendre des prédateurs pédérastes, et que si au contraire elle s’adonnait à la socratisation, c’était en connaissance de cause. Si le grain ne meurt montre qu’il en va à peu près de même chez les jeunes garçons arabes, prostitution en sus. Bref, pour ne pas passer à côté de ce sujet, il faudrait à mon sens, creuser les informations données par l’édition Folio classiques, sur l’amour quasi-incestueux de Gide à 48 ans pour Marc, âgé de 16 ans, le fils d’un de ses précepteurs Élie Allégret, et leur voyage en Suisse, qui ressemble quand même fortement au séjour d’Édouard à Saas-Fée avec Bernard. Quant au fait que le même Édouard « reluque » les lycéens de 13 ans, et s’intéresse au jeune Caloub à la dernière phrase du roman, il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas le traiter. Biaiser sur le sujet et se contenter en 5 minutes de présenter Gide comme un auteur « homosexuel », puis partir bille en tête sur les leurres que sont à mon humble avis les tartes à la crème sur l’anti-roman, la mise en abyme, etc., relèverait de la malhonnêteté intellectuelle, et faciliterait incidemment l’amalgame homosexualité-pédophilie. Si j’enseignais en Terminale L cette année, je commencerais sans doute par prendre ce taureau – ou cet ange – par les cornes, et à lutter avec ce bout de sparadrap que les inspecteurs nous ont innocemment collé aux doigts. Partir par exemple des définitions problématiques et contradictoires de l’homosexualité, de la pédérastie, de l’inversion dans Corydon ; étudier des extraits du Satyricon et du Banquet de Platon pour connaître les aspects socratiques de l’amour des jeunes gens ; s’intéresser à l’histoire de la perception de l’onanisme, qui fournit un cas d’évolution de la tolérance intéressant à comparer à la tolérance vis-à-vis de l’homosexualité ou de la pédophilie, en choisissant des extraits dans Les Origines de la sexologie 1850-1900, de Sylvie Chaperon. Ne pas faire l’impasse sur les aspects incestueux de la vie de Gide (il épouse sa cousine ; il a une aventure avec le jeune fils de son précepteur) et du roman (Édouard drague ou est amoureux de ses neveux).
Journal des Faux-Monnayeurs (1926)
Et voici maintenant ce fastidieux journal, qui ajoute un nouvel étage à cette pièce montée déjà peu digeste. Et le dossier de la Pléiade nous précise encore qu’il s’agit du premier livre publié par Gide sous le titre « Journal », dont il ne reprit donc point le contenu dans les éditions de son Journal. Et ce Journal des Faux-Monnayeurs est lui-même pourvu d’un « appendice », et cet appendice suivi d’un « en marge du « Journal des Faux-Monnayeurs » » ! Ce petit livre est rien moins que spontané, puisque la notice de David H. Walker nous apprend que le texte est raturé, couvert de placards, etc. Bref, c’est une couche supplémentaire de mise en abyme, et franchement, je n’ai éprouvé aucun plaisir à le lire. Quel nombrilisme pouvait avoir cet écrivain à croire que la moindre hésitation sur la rédaction de ce roman pouvait passionner les foules ! (« Le problème, pour moi, n’est pas : comment réussir ? — mais bien : comment DURER ? Depuis longtemps, je ne prétends gagner mon procès qu’en appel. Je n’écris que pour être relu. », 07/12/1921). On se doute que le directeur-fondateur de La Nouvelle Revue française n’éprouve aucune difficulté à imprimer en masse tout ce qui coule de sa plume, et que tout cela est maintenu dans un tabernacle par les héritiers de la NRF. Mais est-ce que cela va passionner les élèves de terminale littéraire de 2016 ? Zola nous a bien laissé des dossiers, mais au moins les a-t-il laissés au hasard de la postérité, sans obliger ses contemporains à s’esbaudir sur chacune de ses gouttes de sueur, et il s’est autrement fait suer le burnous que tonton Gide ! D’autre part, comme le texte a été publié par Gide, il a forcément été censuré comme le reste, et l’essentiel reste à lire entre les lignes. David H. Walker en critique généticien, nous fait remarquer : « La ligne assez tourmentée que tracent les ratures et les retouches témoigne en effet clairement, nous semble-t-il, de l’intensité avec laquelle Gide s’applique à échapper à l’emprise du personnage : il bouleverse ses phrases pour mieux asseoir sa conclusion et pourchasse la formule qu’il lui faut jusque dans le coin inférieur de la page. » Dans le Journal lui-même on trouve quelques indications de régie : « grouper dans un seul roman tout ce que me présente et m’enseigne la vie » (17/06/1919). On peut relever telle belle phrase sur l’inspiration : « J’attends trop de l’inspiration ; elle doit être le résultat de la recherche ; et je consens que la solution d’un problème apparaisse dans une illumination subite ; mais ce n’est qu’après qu’on l’a longuement étudié » (11/07/1919), mais cela noyé sous un flot de considérations métaphorisées et d’affirmations gratuites. Une parmi d’autres : « le mieux serait de faire une description « poétique » du Luxembourg — qui doit rester un lieu aussi mythique que la forêt des Ardennes dans les féeries de Shakespeare » (27/12/1923). La rédaction parallèle des livres est confirmée : « mon souci le plus immédiat fût pour la rédaction de « Si le grain ne meurt », dont j’ai écrit cet été l’un des plus importants chapitres (Voyage en Algérie avec Paul). Je fus amené, tout en l’écrivant, à penser que l’intimité, la pénétration, l’investigation psychologique peut, à certains égards, être poussée plus avant dans le « roman » que même dans les « confessions ». » (cf. le paragraphe final du dernier chapitre de la première partie de Si le Grain ne meurt). Alors pourquoi n’avoir pas publié le journal de ces trois livres rédigés parallèlement ? Autre métaphore souvent citée : « Je préfère l’image de la baratte. Oui ; plusieurs soirs de suite j’ai baratté (to churn) le sujet dans ma tète, sans obtenir le moindre caillot, mais sans perdre l’assurance que les grumeaux finiraient bien par se former. Étrange matière liquide qui, d’abord et longtemps, refuse de prendre consistance, mais où les particules solides, à force d’être remuées, agitées en tous sens, s’agglomèrent enfin et se séparent du petit-lait » (25/11/1921). On trouve, comme dans un journal, quelques anecdotes, dont certaines seront utilisées, comme celle sur la rencontre du lycéen volant un livre, reprise presque identiquement, malgré cette note : « L’anecdote, si je voulais m’en servir, serait, il me semble, beaucoup plus intéressante racontée par l’enfant lui-même, ce qui permettrait sans doute plus de détours et de dessous. » (03/05/1921). Il exprime l’ennui censé ressenti par Édouard : « d’avoir à conditionner les personnages » […] « Je vois chacun de mes héros, vous l’avouerai-je, orphelin, fils unique, célibataire, et sans enfants » (août 1921). Une remarque sur les portraits permet de comprendre pourquoi il en a fait certains et pas d’autres : « Ne pas amener trop au premier plan — ou du moins pas trop vite — les personnages les plus importants, mais les reculer, au contraire, les faire attendre. Ne pas les décrire, mais faire en sorte de forcer le lecteur à les imaginer comme il sied. Au contraire, décrire avec précision et accuser fortement les comparses épisodiques ; les amener au premier plan pour distancer d’autant les autres. » (28/10/1922). On s’étonne que le 23 février 1922, il en soit encore à hésiter sur un point important : « Il y a eu maldonne : c’est Olivier qu’Édouard aurait dû adopter ; et c’est Olivier qu’il aimait. » Ce qui me semble à retenir c’est l’emploi du mot « adopter » en lieu et place de « enlever » qu’on trouve dans le roman. L’adoption étant la forme moderne que prend l’enlèvement mythologique. Gide exhibe son improvisation jusqu’au bout (qui n’étonnera d’ailleurs personne) : « Pourtant, ce matin, j’en viens à considérer l’avantage qu’il y aurait à diviser le livre en trois parties. La première (Paris) s’arrêtant au chapitre XVI. La seconde comprenant les huit chapitres de Saas-Fée. Ce qui ferait remporter en importance la troisième ». Suit cette note laconique : « Hier, 8 juin, achevé Les Faux-Monnayeurs ». Dans l’appendice du Journal, se trouvent des « pages du journal de Lafcadio », puisque Gide se plaît à maintenir ce nom issu des Caves du Vatican, auquel il substitua Bernard. On y trouve cette protestation polyamoureuse : « ce qui m’ennuie dans l’amour, c’est la romance, le long diffèrement du plaisir, les petits soins, les minauderies, les protestations, les serments… Car, amoureux, je le suis sans cesse, et de tout, et de tous. Ce qui me déplairait, ce serait de ne l’être plus que de quelqu’un ».
– Édouard aura pour postériorité le personnage de Daniel dans Les Chemins de la Liberté de Jean-Paul Sartre, mais aussi peut-être l’Hadrien des Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar, qui d’ailleurs est censé être dédié à un autre Marc de 17 ans.
– Rien à voir sans doute, mais pourquoi ne pas écouter la chanson de Georges Brassens « Histoire de faussaire » ?
– Voir l’hommage de Jean-Yves Alt au tableau de Delacroix.
– Lire l’article « La psychanalyse en question dans Les Faux-Monnayeurs », de Jean-Yves Debreuille.
– Il existe un téléfilm de Benoît Jacquot adapté du roman de Gide, réalisé en 2011. Je ne l’ai pas vu.
– Si ce n’est fait, lire maintenant les articles sur Corydon, sur Si le grain ne meurt et sur Le Ramier.
– La Femme et le pantin (1898), de Pierre Louÿs, l’ami de jeunesse de Gide, est une bonne lecture en parallèle, car cette histoire d’amour hétérosexuelle dont les adaptations filmiques ont fait oublier qu’il s’agissait d’amours qu’on qualifierait maintenant de pédophiles, nous rappelle que cet aspect pédophile aussi bien homo qu’hétéro, n’était pas perçu comme un problème à cette époque, du moment qu’il s’agissait de jeunes filles ou garçons pubères. Pour nous plonger dans l’ambiance littéraire fin de siècle qui a forcément influencé Gide, voir aussi notre article sur Monsieur Vénus, de Rachilde (1977).
– Le hasard a mis entre mes mains peu après cette lecture de Gide, Le Tournant, un très intéressant livre autobiographique de Klaus Mann, le dernier avant son suicide. J’en ai extrait un fort beau portrait de Gide, dont Klaus Mann a fait connaissance à l’époque de la publication de cette trilogie, que vous trouverez sur Lettres volées.
– Lire les excellents articles de Marie-Françoise Leudet sur la pédérastie à propos de Gide.
– Lire un article sur une piste pédagogique que je propose en marge des Faux-Monnayeurs : « La relation avunculaire en littérature et au cinéma ».
Voir en ligne : Les Faux-Monnayeurs sur les Lettres volées
© altersexualite.com 2016
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Il conviendra de distinguer « homosexualité » de « pédérastie » (attirance pour les jeunes gens pubères, synonyme de « éphébophilie »), et de « pédophilie » (attirance pour des enfants non pubères). En précisant que la puberté physique ne correspond pas à la puberté légale fixée par la majorité sexuelle, qui diffère selon les pays. Pour se replacer dans le contexte de l’époque, lire un article sur les Recherches sur la sexualité (1928-1932). Archives du surréalisme n°4, où l’on constatera que le mot « pédérast(i)e » était préféré au mot « homosexuel(le) », quelques années après Les Faux-Monnayeurs. Écouter l’épisode 5 de l’entrevue de Yann Moix et Franck Lestringant, sur le site La Règle du jeu, qui fait le point sur la question de l’homosexualité / pédérastie de Gide.
[2] « L’ordre des mots ». « Une histoire japonaise présente deux moines qui vivaient dans le même monastère et qui tous les deux désiraient fumer. Ce penchant, auquel ils succombaient assez souvent, leur attirait des remarques et des blâmes. Ils furent un jour convoqués chez le maître, l’un après l’autre, séparément. Le premier dit au maître : « Est-ce que je peux méditer, pendant que je fume ? » Le maître éclata de colère, répondit non et renvoya rudement le disciple. Le moine, un peu plus tard, rencontra l’autre moine en train de fumer paisiblement. Étonné, il lui demanda : « Tu n’as pas vu le maître ? – Si, je l’ai vu. – Et il ne t’a pas interdit de fumer ? – Non. – Mais comment se fait-il ? Que lui as-tu demandé ? – Je lui ai simplement demandé : est-ce que je peux fumer pendant que je médite ? » (Jean-Claude Carrière, Le Cercle des menteurs, Pocket, p. 314).
[3] Ça ne veut pas dire grand-chose mais ça en jette !
[4] Cet écho sera confirmé par une citation de Cymbeline de Shakespeare en tête du ch. 6, citation sur le thème de la bâtardise, dont l’éditeur de Folio classiques a retrouvé la suite : « c’est quelque faussaire qui m’a frappé de son coin ».
[5] Le dossier nous apprend (p. 493) un traumatisme de l’enfance de Gide, renvoyé de l’École alsacienne dans la classe de M. Vedel, dont il n’a pas changé le nom, pour « mauvaises habitudes », c’est-à-dire masturbation. Son insistance sur ce point mériterait un éclairage.
[6] On relève 32 occurrences de ce juron vieille France dans le roman. S’agissant d’un faux juron (déformation de « par Dieu »), on peut y trouver un écho au titre.
[7] Au lecteur en quête de phrases sublimes de notre Prix Nobel, je signale le joli pléonasme de tonton Édouard : « J’ai mes idées ; mais qui répugnent à la toise et que je ne cherche pas trop à mesurer », ainsi que les deux occurrences de « sursaturé », dont l’une sur-superfétatoirisée d’un « jusqu’à la nausée », comme si « saturé » n’aurait pas suffi : « il a été sursaturé de morale, et jusqu’à la nausée » (3e partie, ch. 15). Il est vrai que c’est Édouard qui écrit, censé être un mauvais romancier. On trouve en marge du Journal des Faux-Monnayeurs dans l’édition de La Pléiade, un hapax étonnant : « Il a été sursaliné de morale ; jusqu’au vomissement ». L’absence de note explicative nous laisse incertain s’il s’agit d’une coquille de l’éditeur, ou d’une afféterie de langage de Gide.
[8] Allusion au titre d’une émission historique de Ménie Grégoire.
 altersexualite.com
altersexualite.com
