Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Si le grain ne meurt, d’André Gide
« La non-conformité sexuelle est, pour mon œuvre, la clé première », pour lycéens et adultes
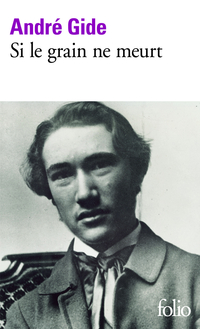 Si le grain ne meurt, d’André Gide
Si le grain ne meurt, d’André Gide
Folio, 1926, 371 p., 8,2 €
samedi 1er octobre 2016
Dernier opus de la trilogie entamée par la publication de l’essai Corydon (1924), puis celle du roman Les Faux-Monnayeurs assorti de son « journal des Faux-Monnayeurs » (1925), le récit autobiographique Si le grain ne meurt achève de mettre les points sur les i. Oui, ce littérateur de premier ordre est homosexuel, ou plus précisément pédéraste ; il n’avait pas disserté ou romancé la pédérastie par pur plaisir intellectuel ! Ces livres courageux n’empêchèrent pas leur auteur d’obtenir le prix Nobel en 1947, dix ans cependant après son cadet et ami Roger Martin du Gard. J’ai utilisé le tome Souvenirs et voyages de l’édition de la Pléiade qui date de 2001, édition de Pierre Masson, enrichie d’un abondant apparat critique. La genèse de ces aveux remonte trente ans auparavant, mais comme Gide le dit lui-même, « pour qu’il vaille la peine de « se perdre de réputation », il faut d’abord se payer une réputation bien établie » (correspondance Gide-Blei, 28 décembre 1908)… Le titre Si le grain ne meurt fait allusion à un vers de l’Évangile de Jean : « si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul : mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. ». Cet article a été rédigé spécifiquement à l’occasion de la mise au programme de Terminale L des Faux-Monnayeurs, en 2016, et consiste surtout à éclairer la lecture de celui-ci par celui-là.
Plan de l’article
Genèse de l’œuvre
Première partie
chapitre 1
chapitre 2
chapitre 3
chapitre 4
chapitre 5
chapitre 6
chapitre 7
chapitre 8
chapitre 9
chapitre 10
Deuxième partie
chapitre 1
chapitre 2
Feuillets inédits de 1910
La Jeunesse d’André Gide, de Jean Delay
Genèse de l’œuvre
Cette genèse est expliquée par Pierre Masson dans la notice de la Pléiade, et il se base notamment sur les travaux de Claude Martin (correspondances de Gide ; La Maturité d’André Gide, etc.). En décembre 1894, âgé de 25 ans, Gide obtient de sa mère Juliette un « tableau chronologique » retraçant les événements de son enfance, lieux d’habitation, écoles, professeurs, voyages, etc. Juliette, mère castratrice, meurt le 31 mai 1895, et Gide s’empresse d’épouser sa cousine Madeleine, histoire de continuer à faire passer sa libération sexuelle sous les fourches caudines de la morale protestante. À l’automne 1897, Gide projette précisément d’écrire ses mémoires, constitue des dossiers, et rédige quelques pages, qui seront reprises dans le chapitre VI. Gide se donne deux destinataires : d’une part le public qu’il prend à témoin de sa différence homosexuelle, à qui il s’adresse directement de façon hautaine à la Rousseau, en utilisant un « vous » dont l’étude des manuscrits montre qu’il en a biffé plusieurs occurrences ; d’autre part, Madeleine, dont il doit prévenir la réprobation. Une lettre à Franz Blei du 28 décembre 1908 donne une information capitale sur le sens de l’écriture de soi chez Gide : « Mon récit scandaleux n’est pas près d’être achevé ; et peut-être attendrai-je des années avant de le publier. Pour qu’il vaille la peine de « se perdre de réputation », il faut d’abord se payer une réputation bien établie ». Le 21 juin 1910, Gide note dans son Journal qu’il a « écrit presque sans arrêt toute l’après-midi (souvenirs sur Em-Barka, Mohamed d’Alger et le petit de Sousse) ». Cela coïncide avec les débuts de la rédaction de Corydon, dont ce récit constitue une illustration. Ces pages qui seront à peine édulcorées dans la seconde partie du livre, sont publiées pour la première fois en annexe de la notice de cette édition de la Pléiade. En 1916, en pleine guerre, il reprend sérieusement la rédaction, avec une sorte de dégoût, qu’il note dans son journal : « je me refuse à me relire, et même à mettre au net, de peur d’être dégoûté de ce que j’écris et de n’avoir plus de courage pour continuer. Ce n’est pas tant le doute et l’inconfiance en moi qui m’arrêtent, qu’une sorte de dégoût, de haine et de mépris sans nom pour tout ce que j’écris, pour tout ce que j’étais, pour tout ce que je suis. Vraiment, en poursuivant la rédaction de ces mémoires, je fais œuvre de macération. » Gide est impatient d’en venir à ce qui fait selon lui le cœur de son sujet : « Et je n’y ai même pas abordé mon sujet, et l’on ne peut même encore entrevoir l’annonce, ni pressentir l’approche, de ce qui devait occuper tout le livre, de ce pourquoi je l’écris. J’en suis à ne plus savoir si je dois continuer ». En janvier 1917, il hésite entre plusieurs titres, avec une préférence pour celui qui sera choisi. Le 19 janvier, affirmation importante dans le Journal : « Je n’écris pas ces mémoires pour me défendre. Je n’ai point à me défendre, puisque je ne suis pas accusé. Je les écris avant d’être accusé. Je les écris pour qu’on m’accuse ». L’année 1917, entre deux voyages d’amour avec Marc Allégret âgé de 16 ans, dans le Midi au mois de mai, et en Suisse au mois d’août, est un moment d’intense écriture des chapitres VII et VIII, suivi d’une nouvelle période de sécheresse. L’autre influence de cette passion pédérastique est que Gide cesse de considérer Si le grain ne meurt et Corydon comme des « œuvres posthumes », et entame des démarches pour des tirages partiels de moins de 10 exemplaires réservés à des amis, ce qui en dit long sur son inquiétude de mourir avant d’avoir lâché le morceau. En novembre 1918, de retour d’Angleterre avec Marc, Gide apprend que Madeleine a détruit ses lettres, ce qui le confirme dans son désir de publier de son vivant. En 1920, les premières versions de Corydon et Si le grain ne meurt sont publiées en Belgique, tandis que Gide entame la partie problématique de ses mémoires, de front avec la mise en chantier des Faux-Monnayeurs. Roger Martin du Gard, à qui il lit la relation du voyage à Biskra, note ceci dans son journal (6 octobre 1920) : « Visiblement bouleversé par sa lecture : ses lèvres, ses mains tremblent » […] « lui fais remarquer, dans le ton du récit, la permanence d’une sorte de réprobation sous-entendue, assez conventionnelle, sans doute d’origine protestante. – « Parbleu », me dit-il, d’une voix troublée, « l’éternel drame de ma vie… Vous comprenez bien, cher, que tout ça, c’est pour ma femme, c’est en pensant à elle, sans trêve, que je l’écris ! » En réalité, cette confession qu’il voulait totale et sans réserve, m’apparaît assez timide encore, pleine de réticences, de camouflage, de refus ; devant certains aveux, il semble se dérober malgré lui. Je le lui dis. Aussitôt il en convient, avec un émouvant empressement, une espèce de jubilation, d’exaltation à s’accuser : « Oui, oui… je vois bien… Ce que vous me dites va tout à fait dans mon sens !… En somme, j’ai un peu triché, sans le vouloir… J’ai escamoté le fond… » Le 1er novembre 1920, Gide, âgé de 50 ans, note : « Je voudrais surtout obtenir de moi une façon de m’exprimer plus nerveuse, plus incisive, plus sèche ; ne céder plus à ce besoin de rythmer mes phrases dont je prends en horreur le bercement. En horreur le revêtement poétique mielleux, poisseux. » Justement, le style de cet opus me semble beaucoup plus naturel, coulant, que celui, compassé, des Faux-Monnayeurs, qui semble taillé tout exprès pour convenir au propos [1]. Fin 1921, une seconde partie est imprimée en tirage limité ; les trois volumes sont imprimés fin 1923, avec un copyright de 1924, mais ne seront mis en vente qu’en octobre 1926 (Pléiade p. 1113). Information capitale, qui prouve la volonté de Gide de présenter ses mémoires comme une suite logique et un aboutissement de Corydon (1924) et des Faux-Monnayeurs (1925), alors que les trois livres ont été conçus de conserve.
Première partie
Chapitre I
Il est inhabituel qu’entamant une autobiographie qui remonte à l’enfance, l’auteur évoque dès la toute première page « de mauvaises habitudes » qu’il avait avec « le fils de la concierge, un bambin de mon âge qui venait parfois me retrouver ». Certes cela permet une introduction dramatique à la Rousseau, mais un cran au-dessous : « Qui de nous deux en avait instruit l’autre ? et de qui le premier les tenait-il ? Je ne sais. Il faut bien admettre qu’un enfant parfois à nouveau les invente. Pour moi je ne puis dire si quelqu’un m’enseigna ou comment je découvris le plaisir ; mais, aussi loin que ma mémoire remonte en arrière, il est là.
Je sais de reste le tort que je me fais en racontant ceci et ce qui va suivre ; je pressens le parti qu’on en pourra tirer contre moi. Mais mon récit n’a raison d’être que véridique. Mettons que c’est par pénitence que je l’écris.
À cet âge innocent où l’on voudrait que toute l’âme ne soit que transparence, tendresse et pureté, je ne revois en moi qu’ombre, laideur, sournoiserie. »
En effet, le critique Paul Souday parlera de « crotte sur un paillasson » ! (note p. 1118). Du coq-à-l’âne, on passe à une série de notations nostalgiques plus conformes à l’idée qu’on se fait de souvenirs d’enfance, comme quoi il y avait bien un désir de choquer d’entrée. Voici l’expérience du « kaléidoscope » : « J’étais autant intrigué qu’ébloui, et bientôt voulus forcer l’appareil à me livrer son secret. Je débouchai le fond, dénombrai les morceaux de verre, et sortis du fourreau de carton trois miroirs ; puis les remis ; mais, avec eux, plus que trois ou quatre verroteries. L’accord était pauvret ; les changements ne causaient plus de surprise ; mais comme on suivait bien les parties ! comme on comprenait bien le pourquoi du plaisir ! » Le mot kaléidoscope évoque pour nous la métaphore de la multiplicité des points de vue en œuvre dans Les Faux-Monnayeurs ; mais Gide y a-t-il songé en plaçant d’entrée ce souvenir anodin ? C’est bien le mot « plaisir » qui donne la clé de la transition. Les souvenirs défilent par associations d’idées, les lectures et promenades avec Papa, lectures sérieuses mais aussi « plaisir assez vif, mais stupide » auprès des livres de Mme de Ségur ; c’était le début de la littérature jeunesse, déjà aimée & méprisée. Contemplation des vélocipèdes, grand-bi, ancêtre de la bicyclette. Gide est sans doute un des rares à pouvoir témoigner de cette mode brève et circonscrite à un périmètre réduit. Suit une réflexion sur les errements du souvenir, introduisant le célèbre passage des Prussiens : « J’écrirai mes souvenirs comme ils viennent, sans chercher à les ordonner. Tout au plus les puis-je grouper autour des lieux et des êtres ; ma mémoire ne se trompe pas souvent de place ; mais elle brouille les dates ; je suis perdu si je m’astreins à de la chronologie. À reparcourir le passé, je suis comme quelqu’un dont le regard n’apprécierait pas bien les distances et parfois reculerait extrêmement ce que l’examen reconnaîtra beaucoup plus proche. C’est ainsi que je suis resté longtemps convaincu d’avoir gardé le souvenir de l’entrée des Prussiens à Rouen ». En fait il s’agissait d’une retraite aux flambeaux. Nous égrenons quelques visions du passé côté maternel, en Normandie. La gouvernante écossaise Anna Shackleton a droit à de fort belles pages, au cours desquelles sont évoqués d’étonnants « essais des premières chaudières solaires » qui auraient eu lieu en face de l’appartement parisien de celle-ci.
Chapitre II
Nous voici côté paternel, à Uzès, avec d’abord le chemin pour s’y rendre, en train puis en guimbarde, et cette phrase clé : « Ici je quitte un instant la guimbarde ; il est des souvenirs qu’il faut que j’accroche au passage, que je ne saurais sinon où placer », phrase étonnante, car depuis le début du chapitre I, le récit n’est pas le moins du monde chronologique, mais va, comme dirait Montaigne, « par sauts et guimbardes ». L’oncle Charles, seul frère survivant de son père, est brossé en quelques lignes, mais les notes de l’édition Pléiade nous apprennent que cet oncle joua un rôle remarquable pour Gide, et d’évoquer les « oncles » de Lafcadio des Caves du Vatican, mais point l’Édouard des Faux-Monnayeurs. Une lettre de cet oncle citée dans La Jeunesse d’André Gide de Jean Delay nous apprend quel fut son rôle moral. Les « mégathériums » du culte protestant sont dessinés avec soin : « j’ai pu voir encore les derniers représentants de cette génération de tutoyeurs de Dieu assister au culte avec leur grand chapeau de feutre sur la tête, qu’ils gardaient durant toute la pieuse cérémonie, qu’ils soulevaient au nom de Dieu, lorsque l’invoquait le pasteur, et n’enlevaient qu’à la récitation de « Notre Père… ». Un étranger s’en fût scandalisé comme d’un irrespect, qui n’eût pas su que ces vieux huguenots gardaient ainsi la tête couverte en souvenir des cultes en plein air et sous un ciel torride, dans les replis secrets des garrigues, du temps que le service de Dieu selon leur foi présentait, s’il était surpris, un inconvénient capital. » Puis c’est la grand-mère qui est bellement croquée, comme un pomme ridée, à grand renfort d’hyperboles : « Jamais je ne saurai dire combien ma grand-mère était vieille. Du plus loin que je la revois, il ne restait rien plus en elle qui permît de reconnaître ou d’imaginer ce qu’elle avait pu être autrefois. Il semblait qu’elle n’eût jamais été jeune, qu’elle ne pouvait pas l’avoir été. » Le goût du jeune Gide pour l’anatomie des pendules est sans doute à l’origine de celui de Bernard Profitendieu à l’incipit des Faux-Monnayeurs : « Les jours de pluie, confiné dans l’appartement, je faisais la chasse aux moustiques, ou démontais complètement les pendules de grand-mère, qui toutes s’étaient détraquées depuis notre dernier séjour ; rien ne m’absorbait plus que ce minutieux travail ». Le jeune Gide croit surprendre une passion ancillaire entre Marie et Delphine, mais les indices en sont fort maigres, pour celui qui se déclare « parfaitement ignorant, incurieux même, des œuvres de la chair » : « Dans ma famille on a toujours tenu très serré les domestiques. Ma mère, qui se croyait volontiers une responsabilité morale sur ceux à qui elle s’intéressait, n’aurait souffert aucune intrigue qu’un hymen ne vînt consacrer. C’est sans doute pourquoi je n’ai jamais connu à Marie d’autre passion que celle que je surpris pour Delphine, notre cuisinière, et que ma mère, certes, n’eût jamais osé soupçonner. Il va sans dire que moi-même je ne m’en rendis point nettement compte au moment même, et que je ne m’expliquai que longtemps ensuite les transports de certaine nuit ». On est à la même époque, et l’on dirait un chapitre de Pot-Bouille, d’Émile Zola. Au musée du Luxembourg, le petit André est attiré par « l’image des nudités, au grand scandale de Marie, et qui s’en ouvrit à ma mère ; et plus encore par les statues ». Il évoque notamment le Mercure inventant le caducée (1878), de Jean Antoine Idrac, mais montre que la sexualité était en jeu plutôt là où l’on ne l’attendait pas : « Mais ni ces images n’invitaient au plaisir, ni le plaisir n’évoquait ces images. Entre ceci et cela, nul lien. Les thèmes d’excitation sexuelle étaient tout autres : le plus souvent une profusion de couleurs ou de sons extraordinairement aigus et suaves ; parfois aussi l’idée de l’urgence de quelque acte important, que je devrais faire, sur lequel on compte, qu’on attend de moi, que je ne fais pas, qu’au lieu d’accomplir, j’imagine ; et, c’était aussi, toute voisine, l’idée de saccage, sous forme d’un jouet aimé que je détériorais : au demeurant nul désir réel, nulle recherche de contact. » Gide s’en veut étonnamment d’avoir apprécié les chansons idiotes d’une bonne : « Quelles chansons, Seigneur ! Constance aurait pu protester qu’elles n’avaient rien d’immoral. Non, ce qui me souillait le cerveau, c’est leur bêtise. Que n’ai-je pu les oublier ! Hélas ! tandis qu’échappent à ma mémoire les trésors les plus gracieux, ces rengaines misérables, je les entends aussi net que le premier jour. […] – Parbleu ! ce n’est pas à la chanson que j’en ai ; c’est à l’amusement que j’y pris ; où je vois déjà s’éveiller un goût honteux pour l’indécence, la bêtise et la pire vulgarité. » On retrouvera ce thème au chapitre VII : « je m’étais contraint d’entrer, et avec quel raidissement, quel air de mauvaise assurance, dans l’immonde boutique d’un herboriste de la rue Saint-Placide, qui vendait de tout et aussi des chansons – pour acheter la plus niaise et la plus vulgaire : Ah ! qu’el’ sent bon, Alexandrine ! – Pourquoi ? Oh ! je vous dis : uniquement par défi ; car, en vérité, je n’en avais aucun désir. Oui, par besoin de me violenter et parce que, la veille, en passant devant la boutique, je m’étais dit : ça, tu n’oserais tout de même pas le faire. Je l’avais fait. » Il est intéressant de noter le contraste chez Gide, entre cette haine du peuple et son goût pour les Arabes exprimé dans la 2e partie.
Chapitre III
Le thème des « mauvaises habitudes » prend ici sa place naturelle, et l’on se demande donc quelle mouche a piqué Gide d’en avoir fait l’annonce à la première page du chapitre I ! « Mon renvoi de l’École n’était que provisoire. M. Brunig, le directeur des basses classes, me donnait trois mois pour me guérir de ces « mauvaises habitudes », que M. Vedel avait surprises d’autant plus facilement que je ne prenais pas grand soin de m’en cacher, n’ayant pas bien compris qu’elles fussent à ce point répréhensibles ; car je vivais toujours (si l’on peut appeler cela : vivre) dans l’état de demi-sommeil et d’imbécillité que j’ai peint. Mes parents avaient donné la veille un dîner ; j’avais bourré mes poches des friandises du dessert ; et, ce matin-là, sur mon banc, tandis que s’évertuait M. Vedel, je faisais alterner le plaisir avec les pralines. » Le nom de M. Vedel sera repris tel quel dans Les Faux-Monnayeurs ! Le petit est amené voir un ponte en médecine, qui use d’intimidation dans une scène fort amusante autant que révélatrice de la mentalité de l’époque : « « Je sais ce dont il s’agit, dit-il en grossissant la voix, et n’ai besoin, mon petit, ni de t’examiner ni de t’interroger aujourd’hui. Mais si ta mère, d’ici quelque temps, voyait qu’il est nécessaire de te ramener, c’est-à-dire si tu ne t’étais pas corrigé, eh bien, (et ici sa voix se faisait terrible) voici les instruments auxquels il nous faudrait recourir, ceux avec lesquels on opère les petits garçons dans ton cas ! » – et sans me quitter des yeux, qu’il roulait sous ses sourcils froncés, il indiquait, à bout de bras, derrière son fauteuil, une panoplie de fers de lances touareg. » Le médecin ne se doutait pas de l’ironie fatale de son allusion ! Le petit Gide sera forcé de redoubler suite à ce renvoi et à une rougeole, et il passe un long temps dans la propriété maternelle normande de La Roque, autour de laquelle il situera l’action de L’Immoraliste, et où il s’adonne à la pêche, considérée comme un sport autant qu’un loisir (belle page). Gide apprend aussi la musique sous la direction d’un talentueux M. Gueroult, auquel il consacre un beau portrait. Il est sensible à l’intérêt d’un cousin : « Mon cousin Albert Démarest – pour qui je ressentais déjà une sympathie des plus vives, malgré qu’il eût vingt ans de plus que moi […]. C’est peut-être au retour de ces vacances qui suivirent mon renvoi de l’École, qu’Albert Démarest commença à faire attention à moi. Que pouvait-il bien discerner en moi qui attirât sa sympathie ? Je ne sais ; mais sans doute lui fus-je reconnaissant de cette attention, d’autant plus que, précisément, je sentais que je la méritais moins. Et tout aussitôt je m’efforçai d’en être un petit peu moins indigne. La sympathie peut faire éclore bien des qualités somnolentes ; je me suis souvent persuadé que les pires gredins sont ceux auxquels d’abord les sourires affectueux ont manqué. Sans doute est-il étrange que ceux de mes parents n’eussent pas suffi ; mais il est de fait que je devins aussitôt beaucoup plus sensible à approbation ou à la désapprobation d’Albert qu’à la leur. » Le retour à Paris est l’occasion d’une amitié forcée avec les enfants Jardinier, qui inspirera les propos d’Oscar Molinier au ch. 1 de la 3e partie des Faux-Monnayeurs : « Je n’avais de véritable amitié pour aucun des deux Jardinier. Jules était trop âgé ; Julien d’une rare épaisseur. Mais nos parents qui, pour l’amitié, semblaient avoir les idées de certaines familles sur les mariages de convenance, ne manquaient pas une occasion de nous réunir. Je voyais Julien déjà chaque jour en classe ; je le retrouvais en promenade, au patinage. Mêmes études, mêmes ennuis, mêmes plaisirs ; là se bornait la ressemblance ; pour l’instant, elle nous suffisait. Certes, il était, sur les bancs de la neuvième, quelques élèves vers qui plus d’affinité m’eût porté ; mais leur père, hélas ! n’était pas professeur à la Faculté. » Pourtant le niveau social n’est pas le même, et maman Gide, par scrupule, aligne ses largesses sur ce que la maman Jardinier peut donner à ses enfants, d’où certaines mortifications ressenties par le petit Gide. Cela ne l’empêche pas de pratiquer tous les sports en « champion de la classe », y compris le ballon : « Ce n’était pas encore, hélas ! le football ». Le bal annuel donne lieu à une belle scène, puisque le petit Gide se retrouve, avec les Jardinier parmi les vingt petits pâtissiers, panoplie la moins chère. Cela n’empêche pas que « tout à coup, je tombai amoureux, oui, positivement amoureux, d’un garçonnet un peu plus âgé que moi, qui devait me laisser un souvenir ébloui de sa sveltesse, de sa grâce et de sa volubilité », et pourtant il ne reverra jamais ledit garçonnet ! La mort du père est expédiée presque avec la même désinvolture que celle de Robert de Passavant dans Les Faux-Monnayeurs, et sert de transition.
Chapitre IV
Nous voici auprès des cousines (côté mère, à Rouen). Trois filles et deux garçons, dont Emmanuèle qui « avait deux ans de plus que moi » : « quand, à la fin de chaque journée, nos parents nous séparaient pour nous emmener dormir, je pensais enfantinement : cela va bien parce que nous sommes petits encore, hélas ! mais un temps viendra où la nuit même ne nous séparera plus ». Parmi leurs jeux, « un appareil à copier ; je ne sais plus le nom de cette machine rudimentaire, qui n’était, en somme, qu’un plateau de métal couvert d’une substance gélatineuse, sur laquelle on appliquait d’abord la feuille qu’on venait de couvrir d’écriture, puis la série des feuilles à impressionner. L’idée d’un journal naquit-elle de ce cadeau ? ou au contraire le cadeau vint-il pour répondre à un projet de journal ? Peu importe. Toujours est-il qu’une petite gazette, à l’usage des proches, fut fondée ». André se contente d’y recopier les « grands auteurs », et n’y reviendra pas. C’est une période où le petit Gide est trimballé par sa mère aux quatre coins de l’hexagone comme dit l’autre, et de précepteur en école : « J’admire qu’une instruction si brisée ait malgré tout pu réussir en moi quelque chose ». Au lycée de Montpellier, le petit déraciné est le bouc émissaire des potaches : « T’es catholique, toi ? ou protescul ? » lui demande-t-on. Comme un camarade se vante que son père soit « athée », Juliette refuse d’expliquer ce mot à André (qui ne précise pas s’il avait un dictionnaire à disposition). Voici l’épisode de la récitation qui figure dans toutes les anthologies : Gide met le ton, ce qui entraîne l’hilarité de la classe et les félicitations du prof : « Ce compliment, en m’opposant à mes camarades, eut pour résultat le plus clair de me les mettre tous à dos ». La persécution potache n’y va pas avec le dos de la cuiller : « ce ne fut plus de l’affût, ce devint de la chasse à courre ; pour un peu ç’aurait pu devenir amusant ; mais je sentais chez eux moins l’amour du jeu que la haine du misérable gibier que j’étais. […] J’essuyais à nouveau contre ma joue l’abominable contact du chat crevé qu’un jour il avait ramassé dans le ruisseau pour m’en frictionner le visage, tandis que d’autres me tenaient les bras ». L’école de toute façon n’est pas la tasse de thé de notre futur prix Nobel : « ce que je ressentais alors c’était un dégoût sans nom pour tout ce que nous faisions en classe, pour la classe elle-même, le régime des cours, des examens, les concours, les récréations même ; et l’immobilité sur les bancs, les lenteurs, les insipidités, les stagnances ». Gide n’hésite pas à s’adresser au lecteur pour l’informer de son travail : « Je renonce à copier ici les pages où je racontais d’abord Gérardmer, ses forêts, ses vallons, ses chaumes, la vie oisive que j’y menai. Elles n’apporteraient rien de neuf et j’ai hâte de sortir enfin des ténèbres de mon enfance. » Il ne termine cependant pas son chapitre sans un réjouissant portrait charge, pour une fois, d’un obscur médecin que sa mère croira nécessaire de consulter : « Avec M. Lizart […] rien de pareil n’était à craindre ; on pouvait être bien assuré que la célébrité jamais ne se saisirait de lui, car il n’offrait aucune prise : un être débonnaire, blond et niais, à la voix caressante, au regard tendre, au geste mou ; inoffensif en apparence ; mais rien n’est plus redoutable qu’un sot. Comment lui pardonner ses ordonnances et le traitement qu’il prescrivit ? Dès que je me sentais, ou prétendais, nerveux : du bromure ; dès que je ne dormais pas : du chloral. Pour un cerveau qui se formait à peine ! Toutes mes défaillances de mémoire ou de volonté, plus tard, c’est lui que j’en fais responsable. Si l’on plaidait contre les morts, je lui intenterais procès. »
Chapitre V
Le lecteur ne comprend guère le « drame » annoncé à son de trompe à la fin du chapitre précédent. Il s’agit de la cousine Emmanuèle (qui est en fait Madeleine) : « rien ne pouvait être plus cruel, pour une enfant qui n’était que pureté, qu’amour et que tendresse, que d’avoir à juger sa mère et à réprouver sa conduite ; et ce qui renforçait le tourment, c’était de devoir garder pour elle seule, et cacher à son père qu’elle vénérait, ce secret qu’elle avait surpris je ne sais comment et qui l’avait meurtrie – ce secret dont on jasait en ville, dont riaient les bonnes et qui se jouait de l’innocence et de l’insouciance de ses deux sœurs. Non, de tout cela je ne devais rien comprendre que plus tard ; mais je sentais que, dans ce petit être que déjà je chérissais, habitait une grande, une intolérable détresse, un chagrin tel que je n’aurais pas trop de tout mon amour, toute ma vie, pour l’en guérir. » Mais rien ne perce du contenu du secret, c’est le défaut sans doute de mémoires écrits et publiés trop tôt, du vivant des personnages (Gide est âgé de 54 ans quand les volumes sont imprimés). L’éducation erratique du petit André a ses lacunes : « ma mère aurait pu profiter de ce temps pour me faire apprendre l’anglais par exemple ; mais c’était là une langue dont mes parents se réservaient l’usage pour dire devant moi ce que je ne devais pas comprendre ». À comparer avec Vipère au poing, d’Hervé Bazin où au contraire les parents imposent l’usage de l’anglais durant les repas. Les professeurs de piano successifs ne sont pas tous aussi performants qu’il l’eût souhaité : « J’enrage, comme M. Jourdain, à rêver au virtuose qu’aujourd’hui je pourrais être, si seulement en ce temps j’eusse été quelque peu poussé ». Après la mort du père, Juliette déménage, rue de Commaille dans un plus bel appartement donnant sur le jardin des missions étrangères de Paris. La tante Claire impose que l’appartement ait une « porte cochère » : « Il pouvait paraître à l’esprit d’un enfant que, ne recevant guère et ne roulant point carrosse nous-mêmes, la porte cochère fût chose dont on aurait pu se passer. » […] « Ce n’est pas une question de commodité, mais de décence. » […] « Tu te le dois ; tu le dois à ton fils. » […] « D’ailleurs, c’est très simple, si tu n’as pas de porte cochère, je peux te nommer d’avance ceux qui renonceront à te voir. » Suivant les méandres de sa mémoire, Gide place dans ce chapitre le récit d’événements antérieurs qui ont eu lieu dans l’appartement de la rue de Tournon. Comme il avait prépublié ses mémoires en édition limitée au fur et à mesure de leur rédaction, cela a entraîné ce vice de composition. Quoi qu’il en soit, voici les fameux « schaudern », mot allemand signifiant « tremblement ». Le premier schaudern eut lieu à l’annonce de la mort d’un cousin âgé de quatre ans, pour lequel pourtant André n’éprouvait pas « de sympathie bien particulière ». […] « Le second tressaillement est plus bizarre encore : c’était quelques années plus tard, peu après la mort de mon père ; c’est-à-dire que je devais avoir onze ans. La scène de nouveau se passa à table, pendant un repas du matin ; mais, cette fois, ma mère et moi nous étions seuls. J’avais été en classe ce matin-là. Que s’était-il passé ? Rien, peut-être… Alors pourquoi tout à coup me décomposai-je et, tombant entre les bras de maman, sanglotant, convulsé, sentis-je à nouveau cette angoisse inexprimable, la même exactement que lors de la mort de mon petit cousin ? On eût dit que brusquement s’ouvrait l’écluse particulière de je ne sais quelle commune mer intérieure inconnue dont le flot s’engouffrait démesurément dans mon cœur ; j’étais moins triste qu’épouvanté ; mais comment expliquer cela à ma mère qui ne distinguait, à travers mes sanglots, que ces confuses paroles que je répétais avec désespoir : « Je ne suis pas pareil aux autres ! Je ne suis pas pareil aux autres ! » ». Et l’auteur n’en profite pas pour entamer le chapitre de sa différence homosexuelle, qu’il reporte aux chapitres postérieurs. Le petit André élève successivement toutes sortes d’animaux, et découvre la chimie tout seul avec un livre de classe qu’il se fait offrir, au risque de faire sauter la baraque : « Au bruit de l’explosion les cochons de Barbarie firent en hauteur un bond absolument extraordinaire et le verre de lampe m’échappa des mains. Je compris en tremblant que, pour peu que le récipient eût été plus solidement bouché, il m’eût éclaté au visage, et ceci me rendit plus réservé dans mes rapports avec les gaz. » Le cousin Albert a droit à un bel éloge : « J’avais pour Albert, à cette époque déjà, une espèce d’adoration ; j’ai dit de quelle âme je pouvais boire ses paroles, surtout lorsqu’elles allaient à l’encontre de mon penchant naturel ; c’est aussi qu’il ne s’y opposait que rarement et que je le trouvais d’ordinaire extraordinairement attentif à comprendre de moi précisément ce qui risquait d’être le moins bien compris par ma mère et par le reste de la famille. Albert était grand ; à la fois très fort et très doux ; ses moindres propos m’amusaient inexprimablement, soit qu’il dît précisément ce que je n’osais point dire, soit même ce que je n’osais pas penser ; le seul son de sa voix me ravissait. Je le savais vainqueur à tous les sports, à la nage et au canotage surtout ; et, après avoir connu l’ivresse du grand air, du bel épanouissement physique, la peinture, la musique et la poésie l’occupaient à présent tout entier. » Quelques pages sont consacrées à un précepteur, dont j’extrais ce détail à propos d’Abel, le petit frère dudit précepteur, qui veut partager son secret avec André : « Abel, sans un mot, se dirigea vers une armoire de poupée, qui se trouvait sur une table, l’ouvrit avec une clef qu’il portait pendue à sa chaîne de montre ; il sortit de là une douzaine de lettres ceinturées d’une faveur rose, dont il défit le nœud ; puis, me tendant le paquet : « Tenez ! Vous pouvez toutes les lire », fit-il avec un grand élan. » Or au lieu de lettres d’amour, ce ne sont que des plaintes de la sœur d’Abel et du précepteur à propos de ses dettes ! Mais André s’en vengera en introduisant au début des Faux-Monnayeurs la découverte d’un semblable paquet au contenu bien plus alléchant.
Chapitre VI
C’est la vie tranquille avec maman. Beaux souvenirs des soirées avec le cousin : « Albert et moi nous nous plongions dans les trios, les quatuors et les symphonies de Mozart, de Beethoven et de Schumann, déchiffrant avec frénésie tout ce que les éditions allemandes ou françaises nous offraient d’arrangements à quatre mains. J’étais devenu à peu près de sa force, ce qui n’était du reste pas beaucoup dire, mais ce qui nous permettait de goûter ensemble des joies musicales qui sont restées parmi les plus vives et les plus profondes que j’aie connues. » En Normandie, il y a aussi l’amitié passionnelle pour « Lionel de R… », en réalité François de Witt-Guizot, amitié qui donne à Gide l’occasion de préciser les étapes de sa vocation homosexuelle : « nous nous donnions de vrais rendez-vous d’amoureux, auxquels nous courions furtivement, le cœur battant et la pensée frémissante » […] « Si passionnée que fût notre liaison, il ne s’y glissait de sensualité pas la moindre. Lionel, d’abord, était richement laid ; puis sans doute éprouvais-je déjà cette inhabileté foncière à mêler l’esprit et les sens, qui je crois m’est assez particulière, et qui devait bientôt devenir une des répugnances cardinales de ma vie. De son côté, Lionel, en digne petit fils de Guizot, affichait des sentiments à la Corneille. Certain jour de départ, comme je m’approchais pour une accolade fraternelle, il me repoussa à bras tendus et, solennel : « Non ; entre eux, les hommes ne s’embrassent pas ! » […] « durant la prière, alors que nous étions agenouillés, il me prenait la main, qu’il gardait serrée dans la sienne, comme pour offrir à Dieu notre amitié ». Quant à Armand Bavretel, pseudonyme pour Émile Ambresin, c’est le modèle de l’Armand des Faux-Monnayeurs, et ce qui est passionnant, c’est que le modèle se suicida, et que Gide, sans doute par remords du rôle qu’il joua dans ce suicide, l’affecta dans son roman, à la fois à Olivier (suicide raté) et à Boris (suicide accompli), et le remords à Bernard. Voir à ce propos la note 44 de la p. 1143 de la Pléiade, et la genèse de Corydon. En tout cas, la maison des Ambresin est l’un des deux modèles de la pension Vedel : « Je ne le vis que ces deux fois, mais mon impression fut si vive qu’il ne cessa depuis lors de hanter mon imagination ; même il commença d’habiter un livre que je projetais d’écrire, et qu’il n’est pas encore dit que je n’écrirai pas, au travers duquel je pusse répandre un peu de la fuligineuse atmosphère que j’avais respirée chez les Bavretel. Ici la pauvreté cessait d’être seulement privative, comme la croient trop souvent les riches ; on la sentait réelle, agressive, attentionnée ; elle régnait affreusement sur les esprits et sur les cœurs, s’insinuait partout, touchait aux endroits les plus secrets et les plus tendres, et faussait les ressorts délicats de la vie. Tout ce qui s’éclaire à mes yeux aujourd’hui, j’étais mal éduqué pour le comprendre d’abord ; bien des anomalies, chez les Bavretel, ne me paraissaient étranges sans doute que parce que j’en discernais mal l’origine, et ne savais pas faire intervenir toujours et partout cette gêne que, par pudeur, la famille prenait tant de soin de cacher. » Juliette prend toujours soin de ne pas humilier les amis de son fils par l’étalage de leur richesse, d’où certaine attitude : « Quelles réactions une telle éducation me préparait, il est prématuré d’en parler ; j’en suis encore au temps où, emmenant Armand à une matinée de l’Opéra-Comique, pour laquelle ma mère avait retenu deux places de seconde galerie – car, nous laissant, pour la première fois, aller seuls, elle avait jugé ces places suffisantes pour deux galopins de notre âge – je fus éperdu de me trouver sensiblement plus haut que de coutume, environné de gens qui me paraissaient du commun ; me précipitant au contrôle je versai tout l’argent que j’avais en poche, pour des suppléments qui nous permissent de regagner mon niveau. » Je vois dans ce genre de notation le même type de prévention relevé au chapitre 12 de la première partie des Faux-Monnayeurs sur les « gens du peuple ». Armand va se suicider, et Gide tente d’analyser rétrospectivement son comportement, mais ne se servira pas de cette analyse pour son roman. En revanche, le portrait psychologique d’Armand est le brouillon de celui du roman : « Certainement Armand souffrait déjà du mal bizarre qui le porta quelques années plus tard à se tuer. Je ne puis m’expliquer autrement l’acharnement qu’il y mettait ; il n’avait de cesse que sa sœur ne fût en larmes, et, si les mots n’y suffisaient pas, il s’approchait pour la brutaliser, la pincer. Quoi ! la détestait-il ? Je crois qu’il l’adorait au contraire, et qu’il souffrait pour elle de tout, et aussi de ces mortifications qu’il lui faisait subir, car il était de tendre nature et nullement cruel ; mais son obscur démon se plaisait à détériorer son amour. »
Chapitre VII
L’année de ses quinze ans commence par une anecdote dont Gide fait sur un ton mi-figue, mi-raisin, l’annonce d’une vocation : un canari échappé d’une cage se réfugie sur lui : « Je revins en courant près de ma mère, ravi de rapporter le canari ; mais surtout ce qui me gonflait, ce qui me soulevait de terre, c’était l’enthousiasmante assurance d’avoir été célestement désigné par l’oiseau. Déjà j’étais enclin à me croire une vocation ; je veux dire une vocation d’ordre mystique ; il me sembla qu’une sorte de pacte secret me liait désormais ». L’idée de débauche est au centre du chapitre. Dans une sorte d’exposé de cas clinique, Gide étudie comment l’idée de débauche s’impose progressivement à lui précisément par l’interdit dont elle fait l’objet, alors que par nature, il semble imperméable à cette notion. C’est d’abord une série de visites d’appartements à louer avec son précepteur qui lui donne l’occasion de contempler des débauches dont le spectacle lui est dérobé par le précepteur ; puis c’est un mystérieux avertissement de sa mère sur le « Passage du Havre » si mal fréquenté dont il faudrait protéger son ami qui fréquente le lycée Condorcet : « Malgré mes explorations à travers les appartements des cocottes, j’étais demeuré, à quinze ans, incroyablement ignorant des alentours de la débauche ; tout ce que j’en imaginais n’avait aucun fondement dans le réel ; je brodais et chargeais aussi bien dans l’indécent, dans le charmant et dans l’horrible – dans l’horrible surtout, à cause de cette instinctive réprobation dont je parlais plus haut : je voyais, par exemple, mon pauvre Tissaudier orgiastiquement lacéré par les hétaïres. » C’est un nouveau « shaudern », qui couvre de ridicule le petit Gide aux yeux de son camarade : « quelque chose d’énorme, de religieux, de panique, envahit mon cœur, comme à la mort du petit Raoul, ou comme le jour où je m’étais senti séparé, forclos ; tout secoué de sanglots, me précipitant aux genoux de mon camarade : « Bernard ! Oh ! je t’en supplie : n’y va pas. » » La tante Claire « Démarest habitait boulevard Saint-Germain, à peu près en face du théâtre Cluny, ou, plus exactement, de cette rue montante qui mène au Collège de France, dont on voyait la façade, du balcon de son appartement, lequel était au quatrième. La maison avait porte cochère, il est vrai ; mais comment ma tante, avec ses goûts et ses principes, avait-elle été choisir ce quartier ? Entre le boul’Mich et la place Maub’, à la tombée du jour, le trottoir commençait de s’achalander » [2]. Une rencontre fortuite avec une de ces créatures qu’il n’ose pas éviter par un sentiment subtil : « quelque chose en moi presque toujours l’emporte sur la peur : c’est la peur de la lâcheté », lui fit faire un bond de côté et engendre cette intéressante confession : « Mon incuriosité à l’égard de l’autre sexe était totale ; tout le mystère féminin, si j’eusse pu le découvrir d’un geste, ce geste je ne l’eusse point fait ; je m’abandonnais à cette flatterie d’appeler réprobation mes répugnances et de prendre mon aversion pour vertu ; je vivais replié, contraint, et m’étais fait un idéal de résistance ; si je cédais, c’était au vice, j’étais sans attention pour les provocations du dehors. Au surplus, à cet âge, et sur ces questions, avec quelle générosité l’on se dupe ! Certains jours qu’il m’arrive de croire au diable, quand je pense à mes saintes révoltes, à mes nobles hérissements, il me semble entendre l’autre rire et se frotter les mains dans l’ombre. Mais pouvais-je pressentir quels lacs… ? Ce n’est pas le lieu d’en parler ». On est décidément dans le chapitre des confidences, car la bibliothèque du feu père, que Juliette lui interdit longtemps d’explorer, inspire à Gide cette pensée fort rousseauiste : « Je ne suis pas de ces tempéraments qui d’abord s’insurgent ; au contraire il m’a toujours plu d’obéir, de me plier aux règles, de céder, et, de plus, j’avais une particulière horreur pour ce que l’on fait en cachette ; s’il m’est arrivé par la suite et trop souvent, hélas ! de devoir dissimuler, je n’ai jamais accepté cette feinte que comme une protection provisoire comportant le constant espoir et même la résolution d’amener bientôt tout au grand jour. Et n’est-ce pas pourquoi j’écris aujourd’hui ces mémoires ?… » Cette citation prend un sel particulier lorsque au cours de la genèse de Corydon, Gide s’appuie sur une citation homophobe extraite d’un livre de son père pour argumenter. La « pension Keller » (vrai nom) est l’autre modèle de la pension Vedel. Gide y passe 18 mois entre 1886 et 1887. Il y relate une confidence d’un répétiteur de bas étage, semblable à ceux que Rachel est contrainte de recruter dans le roman, et qui nous rappelle Pot-Bouille, d’Émile Zola, qui date de 1882 : « Les déboires de M. de Bouvy étaient de l’ordre conjugal. « Quoi ! » m’écriais-je, plus amusé je le crains qu’apitoyé : « vous avez de nouveau couché dans l’escalier ? – Ouih ! Vous trouvez aussi que cela n’est pas tolérable. » Il regardait dans le vague. Je crois qu’il cessait de me voir et oubliait que c’était à un enfant qu’il parlait. « D’autant plus, continuait-il, que je deviens la risée des autres locataires, qui ne se rendent pas compte de la situation. – Vous n’auriez pas pu forcer la porte ? – Quand je fais cela, elle me bat. Mettez-vous seulement à ma place. – À votre place, je la battrais. » Il soupirait profondément, levait vers le plafond un œil de vache, et sentencieusement : « On ne doit pas battre une femme. » Et il ajoutait dans sa barbe : « D’autant plus qu’elle n’est pas seule !… » »
Chapitre VIII
Gide évoque le souvenir du patriarche fondateur de la pension Keller, qu’il compare « au Wemmick des Grandes Espérances » (de Charles Dickens) […] « M. Jacob avait […] pour son vieux père, une vénération quasi religieuse et paralysante. Si mûr qu’il fût déjà lui-même, il subordonnait sa pensée, ses desseins, sa vie, à cet « Aged » que les élèves connaissaient à peine, car il ne se montrait que dans les occasions solennelles, mais dont l’autorité pesait sur la maison entière ; et M. Jacob en revenait tout chargé lorsqu’on le voyait redescendre (comme, de la montagne, Moïse porteur des tables saintes) de la chambre du second où le Vieux restait enfermé. Lieu très saint où il ne me fut permis de pénétrer (et je puis témoigner que l’Aged existait vraiment) que de rares fois, accompagnant ma mère, car seul, je n’aurais jamais osé. » C’est bien sûr l’une des deux sources du personnage du vieil Azaïs des Faux-Monnayeurs. Gide devient inséparable d’Emmanuèle (Madeleine), et évoque avec circonspection ce que recelait l’excès de sentimentalité de ses lettres par exemple : « Une correspondance suivie avait commencé de s’établir entre nous… J’ai voulu récemment relire mes lettres ; mais leur ton m’est insupportable et je m’y parais odieux. […] Pour moi j’avais à démêler ma ligne d’entre une multitude de courbes ; encore n’étais-je point conscient de l’enchevêtrement à travers quoi je m’avançais ». Il traverse une crise mystique : « Je portais un Nouveau Testament dans ma poche ; il ne me quittait point ; je l’en sortais à tout instant, et non point seulement quand je me trouvais seul, mais bien aussi en présence de gens précisément qui m’eussent pu tourner en ridicule et dont j’eusse à redouter la moquerie : en tramway, par exemple, tout comme un prêtre, et pendant les récréations, à la pension Keller, ou, plus tard, à l’École Alsacienne, offrant à Dieu ma confusion et mes rougeurs sous les quolibets de mes camarades. » […] « Par macération je dormais sur une planche ; au milieu de la nuit je me relevais, m’agenouillais encore, mais non point tant par macération que par impatience de joie. Il me semblait alors atteindre à l’extrême sommet du bonheur. […] Voici la duperie des récits de ce genre : les événements les plus futiles et les plus vains usurpent sans cesse la place, et tout ce qui se peut raconter. Hélas ! ici, quel récit faire ? Ce qui gonflait ainsi mon cœur tient dans trois mots qu’en vain je souffle et j’allonge. Ô cœur encombré de rayons ! Ô cœur insoucieux des ombres qu’ils allaient projetant, ces rayons, de l’autre côté de ma chair. Peut-être, à l’imitation du divin, mon amour pour ma cousine s’accommodait-il par trop facilement de l’absence. Les traits les plus marquants d’un caractère se forment et s’accusent avant qu’on en ait pris conscience. Mais pouvais-je déjà comprendre le sens de ce qui se dessinait en moi ?… » Belle analyse de ce que pouvait ressentir un homosexuel à cette époque où l’homosexualité avait à peine un nom (le premier emploi du mot « homosexuel » en français daterait de 1891 d’après le TLF). On saute justement à une de ces amitiés exacerbées, celle avec celui qui deviendra le poète Pierre Louÿs (Gide écrit « Louis ») qui seront la source des amitiés passionnelles des jeunes gens au chapitre 1 de la partie I des Faux-Monnayeurs : « Mais les jours suivants il y eut un retombement. Que s’était-il passé ? Louis ne m’adressait plus la parole ; il semblait qu’il m’eût oublié. C’est, je crois, que par une craintive pudeur, pareille à celle des amoureux, il voulait dérober aux autres le secret de notre naissante amitié. Mais je ne le comprenais pas ainsi ; je jalousais Glatron, Gouvy, Brocchi, ceux avec qui je le voyais parler ; j’hésitais à m’approcher de leur groupe ; ce qui me retenait n’était point tant la timidité que l’orgueil ; je répugnais à me mêler aux autres, et n’admettais point que Louis m’assimilât à eux. J’épiais l’occasion de le rencontrer seul ; elle s’offrit bientôt. » Cette rencontre constitue la première étape de la carrière de l’écrivain Gide, qui songe à sa première œuvre publiée, Les Cahiers d’André Walter, qui fournit d’entrée le moule dans lequel sera fondu Les Faux-Monnayeurs : « j’avais pris l’habitude de tenir un journal, par besoin d’informer une confuse agitation intérieure ; et maintes pages de ce journal ont été transcrites telles quelles dans ces Cahiers ».
Chapitre IX
Gide revient sur son cousin, qui nous rappelle toujours la passion d’Olivier pour son oncle Édouard : « Albert Démarest proposa de faire mon portrait. J’avais pour mon cousin, je l’ai dit, une sorte d’admiration tendre et passionnée ; il personnifiait à mes yeux l’art, le courage, la liberté ; mais, bien qu’il me témoignât une affection des plus vives, je restais inquiet près de lui, arpentant impatiemment le peu d’espace que j’occupais dans son cœur et dans sa pensée, soucieux sans cesse des moyens de l’intéresser à moi davantage. » Albert réalise le portrait de Gide en violoniste, mais l’édition ne précise pas ce qu’il en est advenu, et l’on ne trouve pas d’images de ce tableau sur Internet… Albert lui fait « confidence du secret de sa double vie » […] « Albert, malgré son aspect herculéen, était le plus timide des êtres. Il reculait devant le chagrin que pourrait causer à sa mère ce que celle-ci considérerait sûrement comme une mésalliance. » Gide n’est pas tendre pour lui-même : « Depuis que j’avais posé pour Albert (il venait d’achever mon portrait), je m’occupais beaucoup de mon personnage ; le souci de paraître précisément ce que je sentais que j’étais, ce que je voulais être : un artiste, allait jusqu’à m’empêcher d’être, et faisait de moi ce que l’on appelle : un poseur. […] Comme Narcisse, je me penchais sur mon image ; toutes les phrases que j’écrivais alors en restent quelque peu courbées. » C’est alors l’éloge de Marc de la Nux, son professeur de musique, le modèle principal de La Pérouse dans Les Faux-Monnayeurs : « J’avais pour lui une sorte de vénération, d’affection respectueuse et craintive, semblable à celle que je ressentis un peu plus tard auprès de Mallarmé, et que je n’éprouvai jamais que pour eux deux ». Marc de la Nux étant né à La Réunion, cela peut expliquer ce surnom que Gide lui accorda dans son journal, bien avant son roman. Non que l’illustre navigateur ait visité cette île, mais une origine ultramarine peut faire songer à un navigateur au hasard. Gide atteint lui-même un tel niveau qu’il donne des cours avec succès : « Si j’avais à gagner ma vie, je me ferais professeur ; professeur de piano, de préférence ; j’ai la passion de l’enseignement et, pour peu que l’élève en vaille la peine, une patience à toute épreuve ». On trouve une explication des longues conversations notées dans le journal d’Édouard, qui me semblaient un procédé artificiel : « J’ai noté de ses propos, nombre de conversations que j’eus avec lui, surtout dans les derniers temps de sa vie ; celles-ci me paraissent encore, à les relire, d’un intérêt extrême ; mais elles chargeraient trop mon récit. » Une note de la Pléiade nous apprend d’ailleurs que certaines de ces conversations ont été conservées inédites pour être insérées dans le roman. Gide obtient de sa mère de voyage à moitié seul en Bretagne (ils se rejoignent par étapes), et le hasard l’amène à croiser des peintres : je « les contemplai avec une stupéfaction grandissante ; il me parut qu’il n’y avait là que d’enfantins bariolages, mais aux tons si vifs, si particuliers, si joyeux que je ne songeai plus à repartir. Je souhaitai connaître les artistes capables de ces amusantes folies » […] « Je retrouvai l’un d’eux, plus tard, chez Mallarmé : c’était Gauguin. L’autre était Sérusier. » Une note nous apprend que la première relation de cette scène était « beaucoup plus critique », mais que Gide la réécrit, conscient de l’« insupportable suffisance de ces pages ». Un réflexion sur Les Cahiers d’André Walter, nous donne une clé pour comprendre aussi Les Faux-Monnayeurs : « Mon éducation puritaine avait fait un monstre des revendications de la chair ; comment eussé-je compris, en ce temps, que ma nature se dérobait à la solution la plus généralement admise, autant que mon puritanisme la réprouvait. Cependant l’état de chasteté, force était de m’en persuader, restait insidieux et précaire ; tout autre échappement m’étant refusé, je retombais dans le vice de ma première enfance et me désespérais à neuf chaque fois que j’y retombais. Avec beaucoup d’amour, de musique, de métaphysique et de poésie, c’était le sujet de mon livre. » Je suis persuadé que la pédérastie est également le sujet des Faux-Monnayeurs, avec beaucoup d’enrobage. Gide s’isole pendant deux mois aux environs d’Annecy pour terminer son livre. Il nous donne en passant une première allusion à son amour des jeunes gens (allégrement confondu avec une amitié exacerbée) qui adviendra plus tard dans sa vie : « j’appelais instamment ce camarade dont l’exaltation fraternelle eût gémellé la mienne, et je me racontais à lui, et lui parlais à haute voix, et sanglotais de ne le point sentir à mon côté. Je décidai que ce serait Paul Laurens (qu’en ce temps je connaissais à peine, car ce que j’ai dit de lui et de mon introduction dans l’atelier de son père, il faut le reporter à plus tard) et pressentis extraordinairement qu’un jour nous partirions ainsi, tous deux ensemble, seuls, au hasard des routes » Une note (p. 1158) nous rappelle qu’au moment où il écrit cela, Gide a rencontré le jeune Marc Allégret, dont le père Élie Allégret fut son précepteur vers 1884, mais son nom ne figure pas dans le texte, et je n’ai pas noté qu’il ait été désigné par un pseudonyme. Gide évoque ensuite les aléas de la publication de ses premières œuvres, et explique que son état de rentier lui permet de se contenter de faibles tirages : « J’avais, Dieu merci, de quoi vivre et pouvais me permettre de faire fi du profit ».
Chapitre X
Ce chapitre, le dernier de la première partie, rompt avec l’ordre chronologique (« j’ai dit que j’écrasais ici les souvenirs de plus de dix ans »). Il est d’abord question de Madeleine (Emmanuèle) qui le fera languir cinq ans avant d’accepter le mariage, puis de son culte de l’amitié, avec quelques exemples de ses amis les plus chers, pour la plupart littérateurs symbolistes infatués d’eux-mêmes. Si nous prenons exemple d’un des rares que la postérité ait retenu, Pierre Louÿs, la note 18 p. 1167 confirme les propos de Gide (« Certes je m’indignais d’entendre Pierre nommer Guez de Balzac « Balzac le Grand », par mépris pour l’auteur de La Comédie humaine ; mais pourtant il était dans le vrai lorsqu’il m’invitait à mettre les questions de forme au premier rang de mes préoccupations et je lui suis reconnaissant de ce conseil. ») en citant une des lettres de Louÿs : « sans la forme, l’idée n’est comprise que des contemporains, c’est la forme qui la fait vivre, et si Musset est déjà fini, c’est qu’il n’en avait pas ». On voit combien Pierre Louÿs a éclipsé la gloire de Musset de de Balzac le Petit ! De ridicules querelles de clans sont rapportées à titre d’exemple, entrecoupées de notations plus anecdotiques et révélatrices : « à quelque heure que l’on sortît de chez Mallarmé, d’une réunion ou d’un spectacle, André-Ferdinand Hérold vous raccompagnait toujours, et à pied. Ma mère l’aimait bien pour cela car elle craignait de me savoir seul dans les rues, passé minuit, et comptait que Hérold ne m’abandonnerait qu’à ma porte. » Gide partage l’antimilitarisme en vigueur dans ces cercles : « On comprend que dans ces conditions je considérasse le service militaire comme une calamité insupportable, à laquelle il était séant de chercher à se soustraire, s’il se pouvait sans désertion. » Il se satisfait de participer à une école : « Comme le goût de chacun, dans une école (et nous en formions une assurément) par frottement, se tempère et s’affine, il était rare que l’un de nous commît une erreur de jugement ; ou du moins cette erreur était-elle alors, le plus souvent, celle du groupe entier ». C’est par ce chapitre mondain que s’achève la première partie, sur un paragraphe placé sous l’égide de Roger Martin du Gard : « Roger Martin du Gard, à qui je donne à lire ces Mémoires, leur reproche de ne jamais dire assez, et de laisser le lecteur sur sa soif. Mon intention pourtant a toujours été de tout dire. Mais il est un degré dans la confidence que l’on ne peut dépasser sans artifice, sans se forcer ; et je cherche surtout le naturel. […] le plus gênant c’est de devoir présenter comme successifs des états de simultanéité confuse. Je suis un être de dialogue ; tout en moi combat et se contredit. Les Mémoires ne sont jamais qu’à demi sincères, si grand que soit le souci de vérité : tout est toujours plus compliqué qu’on ne le dit. Peut-être même approche-t-on de plus près la vérité dans le roman. » Idée que l’on retrouve dans le Journal des Faux-Monnayeurs.
Deuxième partie
Chapitre I
Cette 2e partie constituée de deux chapitres est articulée de façon fuligineuse sur une rupture que l’on connaît uniquement grâce aux notes : « je conservai jusqu’à ces derniers mois cette confiance, et je tiens pour un des plus importants de ma vie l’événement qui m’en fit douter brusquement ». Il s’agit de la destruction par Madeleine des lettres de Gide le 21 novembre 1918, suite à un séjour de celui-ci en Angleterre avec Marc Allégret. Commence une émouvante profession de foi contre la morale religieuse admise : « Au nom de quel Dieu, de quel idéal me défendez-vous de vivre selon ma nature ? Et cette nature, où entraînerait-elle, si simplement je la suivais ? Jusqu’à présent j’avais accepté la morale du Christ, ou du moins certain puritanisme que l’on m’avait enseigné comme étant la morale du Christ. Pour m’efforcer de m’y soumettre, je n’avais obtenu qu’un profond désarroi de tout mon être. Je n’acceptais point de vivre sans règles, et les revendications de ma chair ne savaient se passer de l’assentiment de mon esprit » […] « J’entrevis enfin que ce dualisme discordant pourrait peut-être bien se résoudre en une harmonie. Tout aussitôt il m’apparut que cette harmonie devait être mon but souverain, et de chercher à l’obtenir la sensible raison de ma vie. Quand en octobre 93, je m’embarquai pour l’Algérie, ce n’est point tant vers une terre nouvelle, mais bien vers cela, vers cette toison d’or, que me précipitait mon élan ». Le refus de sa cousine laisse son amour « quasi mystique », de sorte que « j’avais pris mon parti de dissocier le plaisir de l’amour ; et même il me paraissait que ce divorce était souhaitable, que le plaisir était ainsi plus pur, l’amour plus parfait, si le cœur et la chair ne s’entr’engageaient point ». Il précise d’ailleurs que son camarade Paul « avait pu, passé vingt-trois ans, rester puceau […] et qu’un tel cas est du reste beaucoup plus fréquent qu’on ne croit ; car le plus souvent il répugne à se laisser connaître ». Grâce à certaines recommandations, André et Paul se font accueillir et héberger par des militaires de bonne famille, et il semble que l’antimilitarisme de bon ton soit tout envolé chez un Gide admirant « le plus beau des cuirassiers » (cf. note 20 p. 1177). Le premier contact avec le sol africain est avenant : « Dès le premier jour, dès notre apparition dans les souks, un petit guide de quatorze ans se saisit de nos personnes, nous escorta dans les boutiques […] et comme il parlait le français passablement, que de plus il était charmant, nous prîmes rendez-vous à notre hôtel pour le lendemain. Il s’appelait Céci et était originaire de l’île de Djerba […]. Je me souviens de mon trouble, quelques jours plus tard, lorsqu’il vint dans ma chambre […] chargé de nos récentes emplettes et commença de se dévêtir à demi pour me montrer comment on se drapait dans un haïk ». En route pour Biskra, le 2e contact est non moins charmant, et l’on dirait la rubrique voyages de Têtu : « Guide et cocher étaient maltais ; jeunes, superbement râblés, avec des airs de brigands qui nous enchantaient. » C’est à l’occasion d’un arrêt à Sousse, Gide étant assez malade, qu’a lieu ce qu’il faut bien appeler son dépucelage avec un garçon, qui reprend d’une façon plus présentable le récit brut qui figure dans les feuillets inédits de 1910. Il faut préciser ici que ce fait serait aujourd’hui classé dans la rubrique « pédophilie », quoique l’âge du garçon ne soit pas explicite ; cependant, compte tenu de la situation de Gide, de l’époque et de nombre de facteurs, nous ne pouvons considérer comme vérité des faits qui ne sont que des phrases ; et nous savons qu’en matière de sexualité, encore plus quand la moralité s’en mêle, nous mentons tous plus ou moins comme nous respirons… (Voir cependant, pour être fixé sur le sujet, La Jeunesse d’André Gide de Jean Delay). Voici donc l’extrait : « Je ne sortais jamais sans emporter manteau et châle : sitôt dehors, quelque enfant se proposait à me les porter. Celui qui m’accompagna ce jour-là était un tout jeune Arabe à peau brune, que déjà les jours précédents j’avais remarqué parmi la bande de vauriens qui fainéantisait aux abords de l’hôtel. Il était coiffé de la chéchia, comme les autres, et portait directement sur la peau une veste de grosse toile et de bouffantes culottes tunisiennes qui faisaient paraître plus fines encore ses jambes nues. […] je me laissai entraîner dans la dune par Ali – c’était le nom de mon jeune porteur ; nous atteignîmes bientôt une sorte d’entonnoir ou de cratère, dont les bords dominaient un peu la contrée, et d’où l’on pouvait voir venir. Sitôt arrivé là, sur le sable en pente, Ali jette châle et manteau ; il s’y jette lui-même et, tout étendu sur le dos, les bras en croix, commence à me regarder en riant. Je n’étais pas niais au point de ne comprendre pas son invite ; toutefois je n’y répondis pas aussitôt. Je m’assis, non loin de lui, mais pas trop près pourtant, et, le regardant fixement à mon tour, j’attendis, fort curieux de ce qu’il allait faire.
J’attendis ! J’admire aujourd’hui ma constance… Mais était-ce bien la curiosité qui me retenait ? […] Non ; j’eusse été trop déçu si l’aventure eût dû se terminer par le triomphe de ma vertu – que déjà j’avais prise en dédain, en horreur. Non ; c’est bien la curiosité qui me faisait attendre… Et je vis son rire lentement se faner, ses lèvres se refermer sur ses dents blanches ; une expression de déconvenue, de tristesse assombrit son visage charmant. Enfin il se leva : « Alors, adieu », dit-il. Mais, saisissant la main qu’il me tendait, je le fis rouler à terre. Son rire aussitôt reparut. Il ne s’impatienta pas longtemps aux nœuds compliqués des lacets qui lui tenaient lieu de ceinture ; sortant de sa poche un petit poignard, il en trancha d’un coup l’embrouillement. Le vêtement tomba ; il rejeta au loin sa veste, et se dressa nu comme un dieu. Un instant il tendit vers le ciel ses bras grêles, puis, en riant, se laissa tomber contre moi. Son corps était peut-être brûlant, mais parut à mes mains aussi rafraîchissant que l’ombre. »
Arrivés à Biskra, les deux camarades s’installent confortablement. Ils recrutent « un jeune Arabe du nom d’Athman, que nous avions pris à notre service. Il n’avait guère que quatorze ans ; mais très grand, très important sinon très fort parmi les autres enfants qui venaient sur nos terrasses, à la sortie de l’école, jouer aux billes et à la toupie, Athman les dépassait tous de la tête, ce qui rendait presque naturel l’air protecteur qu’il prenait avec eux ». Gide prend plaisir au spectacle des enfants : « je traînais misérablement le long du jour, ne trouvant distraction ou joie qu’à contempler les jeux des enfants sur nos terrasses ou dans le jardin public, si le temps me permettait d’y descendre ; car nous étions dans la saison des pluies. Et je n’étais épris d’aucun d’entre eux, mais bien, indistinctement, de leur jeunesse. Le spectacle de leur santé me soutenait et je ne souhaitais pas d’autre société que la leur. » Gide ne se livre pas sans résistance à sa pente : « Mon penchant naturel, que j’étais enfin bien forcé de reconnaître, mais auquel je ne croyais encore pouvoir donner assentiment, s’affirmait dans ma résistance ; je l’enforçais à lutter contre, et, désespérant de le pouvoir vaincre, je pensais pouvoir le tourner. Par sympathie pour Paul, j’allais jusqu’à m’imaginer des désirs ; c’est-à-dire que j’épousais les siens ; tous deux nous nous encouragions. Une station d’hiver, comme Biskra, offrait à notre propos des facilités particulières : un troupeau de femmes y habite, qui font commerce de leur corps […] Une antique tradition veut que la tribu des Oulad Naïl exporte, à peine nubiles, ses filles, qui, quelques années plus tard, reviennent au pays avec la dot qui leur permette d’acheter un époux. Celui-ci ne tient point pour déshonorant ce qui couvrirait un mari de chez nous ou de honte, ou de ridicule. Les Oulad Naïl authentiques ont une grande réputation de beauté ; de sorte que se font appeler communément Oulad Naïl toutes les filles qui pratiquent là-bas ce métier » (cf. Ouled Naïl). Paul leur amène la fameuse Mériem, qu’ils vont se partager quelques nuits durant : « Un double haïk l’enveloppait, qu’elle laissa tomber devant la porte. Je ne me souviens pas de sa robe, qu’elle dépouilla bientôt, mais elle garda les bracelets de ses poignets et de ses chevilles. Je ne me souviens pas non plus si Paul ne l’emmena pas d’abord dans sa chambre qui formait pavillon à l’autre extrémité de la terrasse ; oui, je crois qu’elle ne vint me retrouver qu’à l’aube ; mais je me souviens des regards baissés d’Athman, au matin, en passant devant le lit du cardinal, et de son : « Bonjour Mériem », si amusé, si pudibond, si comique. Mériem était de peau ambrée, de chair ferme, de formes pleines mais presque enfantines encore, car elle avait à peine un peu plus de seize ans ». En fait, Paul et André avaient découvert Mériem lors d’un concert, où leurs regards avaient été attirés par « le petit Mohammed, éperdu de lyrisme et de joie, [qui] tempêtait sur son tambour de basque. Qu’il était beau ! à demi nu sous ses guenilles, noir et svelte comme un démon, la bouche ouverte, le regard fou… Paul s’était penché vers moi ce soir-là (s’en souvient-il ?) et m’avait dit tout bas : « Si tu crois qu’il ne m’excite pas plus que Mériem ? » Il m’avait dit cela par boutade, sans songer à mal, lui qui n’était attiré que par les femmes ; mais était-ce à moi qu’il était besoin de le dire ? Je ne répondis rien ; mais cet aveu m’avait habité depuis lors ; je l’avais aussitôt fait mien ; ou plutôt, il était déjà mien, dès avant que Paul n’eût parlé ; et si, dans cette nuit auprès de Mériem, je fus vaillant, c’est que, fermant les yeux, j’imaginais serrer dans mes bras Mohammed ». L’alexandrin qui termine cet aveu n’est sans doute pas accidentel. Gide recommande cette pinothérapie : « il est certain que Mériem m’avait, d’emblée, fait plus de bien que tous les révulsifs du docteur. Je n’oserais guère recommander ce traitement ; mais il entrait dans mon cas tant de nervosité cachée qu’il n’est pas étonnant que, par cette profonde diversion, mes poumons se décongestionnassent, et qu’un certain équilibre fût rétabli. » Maman Gide arrive sur ces entrefaites, alertée par les lettres de Gide, ignorant quelle médication il avait prise entre-temps, et Gide de théoriser l’altersexualité, ou du moins le polyamour en trouple : « notre vie commune commençait de si bien s’arranger ; cette rééducation de nos instincts, à peine entreprise, allait-il falloir l’interrompre ? Je protestai qu’il n’en serait rien, que la présence de ma mère ne devrait rien changer à nos us, et que, pour commencer, nous ne décommanderions pas Mériem. Quand, par la suite, je racontai notre oaristys à Albert, je fus naïvement surpris de le voir, lui que je croyais d’esprit très libre, s’indigner d’un partage qui nous paraissait, à Paul et à moi, naturel. Même, notre amitié s’y complaisait, s’y fortifiait comme d’une couture nouvelle. Et nous n’étions non plus jaloux de tous les inconnus auxquels Mériem accordait ou vendait ses faveurs. C’est que nous considérions tous deux alors l’acte charnel cyniquement, et qu’aucun sentiment ici du moins, ne s’y mêlait. » Maman surprend le jeu, et André met les points sur les i, d’où pluie de larmes et « une tristesse inconsolable, infinie ». Cela calme son hétérosexualité peu vaillante : « la seule autre expérience que je tentai à Biskra, ce fut loin de l’hôtel, avec En Barka, dans la chambre de celle-ci. Paul était avec moi, et, pour lui comme pour moi, cette nouvelle tentative échoua misérablement. En Barka était beaucoup trop belle (et, je dois ajouter : sensiblement plus âgée que Mériem) ; sa beauté même me glaçait ; je ressentais pour elle une sorte d’admiration, mais pas le moindre soupçon de désir. J’arrivais à elle comme un adorateur sans offrande. À l’inverse de Pygmalion, il me semblait que dans mes bras la femme devenait statue ; ou bien plutôt c’est moi qui me sentais de marbre ». Ce qui reste à prouver pour le lecteur actuel, c’est l’hétérosexualité de Paul ! La petite troupe rentre en Europe ; Paul & André à Rome, où « c’est dans ma chambre qu’il recevait celle que nous appelions « la dame », une putain de style, qu’un des élèves de la villa Médicis nous avait présentée. Je crois bien que j’essayai d’en tâter moi-même, mais je n’ai gardé souvenir que du dégoût qu’elle me causait avec la distinction de son allure, son élégance et son afféterie. Je commençais à comprendre que je n’avais supporté Mériem que grâce à son cynisme et à sa sauvagerie ; avec elle du moins on savait à quoi s’en tenir ; dans ses propos, dans ses manières, rien ne singeait l’amour ; avec l’autre je profanais ce que j’avais de plus sacré dans le cœur. » Florence est expédiée en un paragraphe ; puis ce sont les retrouvailles avec Pierre Louÿs à Genève, lequel sur son éloge de Mériem, « se persuada qu’il devait à notre amitié de faire de Mériem sa maîtresse », et de partir aussitôt à Biskra, où Louÿs achève Les Chansons de Bilitis, son œuvre la plus connue (avec La Femme et le pantin) dont la première édition (avant la rupture de leur amitié) est dédiée à Gide « en souvenir de Mériem ben Atala ; et c’est là ce que signifient les trois lettres mystérieuses qui font suite à mon nom, en première page du volume ». De son côté, Gide a « pris la Suisse en horreur ; non point celle des hauts plateaux peut-être, mais cette zone forestière où les sapins semblaient introduire dans la nature entière une sorte de morosité et de rigidité calviniste ». Il évoque « la nostalgie de ce grand pays sans profil, du peuple en burnous blancs, nous avait poursuivis à travers l’Italie, Paul et moi ; le souvenir des chants, des danses, des parfums, et, avec les enfants de là-bas, de ce commerce charmant où déjà tant de volupté se glissait captieusement sous l’idylle ». Il faut lire La Femme et le pantin de Louÿs, pour comprendre que l’âge de consentement n’était pas un problème à cette époque : Louÿs s’intéressait aux très jeunes filles exactement comme Gide aux très jeunes garçons, mais pubères, point barre !
Chapitre II
On passe quasiment sans transition au séjour en Algérie de janvier 1895, notamment à une longue et courageuse relation de la rencontre avec Oscar Wilde, que Gide connaissait déjà depuis 1891, qu’il avait rencontré en 1894 à Florence, et qu’il retrouve à « Blidah ». C’est par fidélité à Wilde et à lui-même que Gide témoigne : « Le livre infâme de Lord Alfred Douglas, Oscar Wilde et moi [paru en 1914 en anglais], travestit trop effrontément la vérité pour que je me fasse scrupule aujourd’hui de la dire, et puisque mon destin a voulu que ma route en ce point croisât la sienne, je tiens de mon devoir d’apporter ici ma déposition de témoin. » Une note de la Pléiade évoque la réputation tôt connue de Wilde, et même de Gide avant qu’il ne se connût lui-même, dans un extrait du journal de Jules Renard de décembre 1891 : « André Gide […] c’est un imberbe […] Il est amoureux d’Oscar Wilde, dont je vois la photographie sur la cheminée : un monsieur à la chair grasse, très distingué, imberbe aussi, qu’on a récemment découvert. » J’avais rarement lu l’épithète « imberbe » employée en ce sens ! C’est sans doute cette photographie émouvante que l’on retrouve sur le site de la Fondation Catherine Gide avec la dédicace de 1891. Il s’agit en fait d’une photographie du prestigieux studio de William & Daniel Downey datée de 1889. Voir notre article sur l’exposition « Oscar Wilde, l’impertinent absolu » sur Lettres volées.

Jean Delay nous apprend que lors de sa première rencontre avec Wilde en 1891, Gide fut bouleversé, et que les pages de novembre et décembre 1891 de son journal en ont été arrachées (p. 134). Il n’en témoigna pas dans Si le grain ne meurt, sans doute parce qu’il avait déjà publié en 1903 un texte sur Wilde intitulé In memoriam ; mais Jean Delay s’étonne fortement que Gide puisse prétendre n’avoir rien soupçonné de l’homosexualité de Wilde à cette époque. Gide fait état de propos de Pierre Louÿs, qui avait rencontré Wilde à Londres entouré de ses amis, et avait trouvé leurs manières exquises, tout en faisant croire qu’il ne croyait pas qu’il s’agît d’homosexualité : « X. à qui je venais d’être présenté, m’a offert une cigarette ; mais, au lieu de me l’offrir simplement comme nous aurions fait, il a commencé par l’allumer lui-même et ne me l’a tendue qu’après en avoir tiré une première bouffée. N’est-ce pas exquis ? Et tout est comme cela. Ils savent tout envelopper de poésie. Ils m’ont raconté que quelques jours auparavant, ils avaient décidé un mariage, un vrai mariage entre deux d’entre eux, avec échange d’anneaux. » On imagine les gloussements très hétérosexuels qui devaient accompagner cette saillie de l’auteur de Bilitis ! En tout cas, Pierre Louÿs rompt avec Wilde quand la rumeur devient trop grosse pour continuer à jouer les hypocrites. Bref, voilà Gide flanqué de Wilde et Douglas. Celui-ci l’intéresse vivement, plus qu’il ne l’aime : « À l’ignoble procureur qui nous pilota ce même soir à travers la ville, Wilde ne se contentait pas d’exprimer le souhait de rencontrer de jeunes Arabes ; il ajoutait : « beaux comme des statues de bronze ». […] « nous ne fûmes pas plus tôt dans la rue, que Lord Alfred me prit affectueusement par le bras et déclara : « Ces guides sont stupides : on a beau leur expliquer, ils vous mènent toujours dans des cafés pleins de femmes. J’espère que vous êtes comme moi : j’ai horreur des femmes. Je n’aime que les garçons. » Gide achève le costard qu’il taille à Douglas : « Ceci donnera la mesure de son cynisme : comme je l’interrogeais un jour au sujet des deux fils de Wilde, il insista sur la beauté de Cyril (? je crois) tout jeune encore en ce temps, puis chuchota, avec un complaisant sourire : « Il est pour moi. » » Étonnante accusation de la part d’un homme qui avoue son penchant pour les enfants arabes, et fit tout pour épouser sa cousine ! On pourrait se demander s’il n’y aurait pas là la source de la dernière phrase des Faux-Monnayeurs ? Puis il revient à l’époque de leur complicité : « Douglas repartit le lendemain ou le surlendemain pour Blidah, où il allait travailler à l’enlèvement d’un jeune caouadji qu’il se proposait d’emmener à Biskra, car les descriptions qu’il m’avait entendu faire de l’oasis, où je me proposais de retourner moi-même, l’avaient séduit. Mais l’enlèvement d’un Arabe n’est pas chose aussi facile qu’il avait pu croire d’abord ; il fallait obtenir le consentement des parents, signer des papiers au bureau arabe, au commissariat ». Le mot « caouadji » étant inconnu des dictionnaires, croyez-vous que la Pléiade daigne expliquer cet hapax ? Macache ! En fait c’est un cafetier ; je dirais que Gide arabise l’échanson du mythe de Ganymède, puisqu’il s’agit d’enlèvement ; en tout cas il faut faire le rapprochement avec l’« enlèvement » d’Olivier par Robert, mot utilisé dans le ch. 1 de la 3e partie des Faux-Monnayeurs. Gide et Wilde sortent sans Douglas, et voici le 2e extrait pour lequel a été écrit tout le livre, à comparer avec la version primitive des Feuillets inédits de 1910 : « bientôt je distinguai, près du foyer plein de cendres, dans l’ombre, un caouadji, assez jeune encore, qui prépara pour nous deux tasses de thé de menthe, que Wilde préférait au café. […] dans l’entrebâillement de la porte, apparut un adolescent merveilleux. Il demeura quelque temps, le coude haut levé, appuyé contre le chambranle, se détachant sur un fond de nuit. Il […] sourit au signe que lui fit Wilde, et […] sortit de son gilet tunisien une flûte de roseau, dont il commença de jouer exquisement. Wilde m’apprit un peu plus tard qu’il s’appelait Mohammed et que c’était « celui de Bosy » […]. Ses grands yeux noirs avaient ce regard langoureux que donne le haschisch ; il était de teint olivâtre ; j’admirais l’allongement de ses doigts sur la flûte, la sveltesse de son corps enfantin, la gracilité de ses jambes nues qui sortaient de la blanche culotte bouffante, l’une repliée sur le genou de l’autre. Le caouadji était venu s’asseoir près de lui et l’accompagna sur une sorte de darbouka. Comme une eau limpide et constante le chant de la flûte coula à travers un extraordinaire silence, et l’on oubliait l’heure, le lieu, qui l’on était et tous les soucis de ce monde. Nous restâmes ainsi, sans bouger, un temps qui me parut infini ; mais je serais resté bien plus longtemps encore, si Wilde, tout à coup, ne m’avait pris le bras, rompant l’enchantement. « Venez », me dit-il. Nous sortîmes. Nous fîmes quelques pas dans la ruelle, suivis du hideux guide, et je pensais déjà que là s’achevait la soirée, mais, au premier détour, Wilde s’arrêta, fit tomber sa main énorme sur mon épaule et, penché vers moi, – car il était beaucoup plus grand – à voix basse : « Dear, vous voulez le petit musicien ? » Oh ! que la ruelle était obscure ! Je crus que le cœur me manquait ; et quel raidissement de courage il fallut pour répondre : « Oui », et de quelle voix étranglée ! » Wilde prend toutes ses précautions et son temps, et c’est dans une maison close sous la protection de la police, que le rendez-vous a lieu : « le guide ignoble vint nous rejoindre. Les deux adolescents le suivaient, chacun enveloppé d’un burnous qui lui cachait le visage. Le guide nous laissa. Wilde me fit passer dans la chambre du fond avec le petit Mohammed et s’enferma avec le joueur de darbouka dans la première. » Suit une longue introspection, qui vaut autant pour Madeleine que pour Marc, ses deux lecteurs privilégiés : « Depuis, chaque fois que j’ai cherché le plaisir, ce fut courir après le souvenir de cette nuit. Après mon aventure de Sousse, j’étais retombé misérablement dans le vice. La volupté, si parfois j’avais pu la cueillir en passant, c’était comme furtivement ; délicieusement pourtant, un soir, en barque avec un jeune batelier du lac de Côme » (la note 26 p. 1188 cite une lettre à maman Gide du 14 septembre 1894 qui précise « l’enfant qui me guidait »). « La tentative auprès de Mériem, cet effort de « normalisation » était resté sans lendemain, car il n’allait point dans mon sens ; à présent je trouvais enfin ma normale. Plus rien ici de contraint, de précipité, de douteux ; rien de cendreux dans le souvenir que j’en garde. Ma joie fut immense et telle que je ne la puisse imaginer plus pleine si de l’amour s’y fût mêlé. Comment eût-il été question d’amour ? Comment eussé-je laissé le désir disposer de mon cœur ? Mon plaisir était sans arrière-pensée et ne devait être suivi d’aucun remords. Mais comment nommerai-je alors mes transports à serrer dans mes bras nus ce parfait petit corps sauvage, ardent, lascif et ténébreux ?… » Loin de renoncer aux précisions de son ébauche de 1910, Gide estompe à peine la forme de la précision casanovienne : « Je demeurai longtemps ensuite, après que Mohammed m’eut quitté, dans un état de jubilation frémissante, et bien qu’ayant déjà, près de lui, cinq fois atteint la volupté, je ravivai nombre de fois encore mon extase et, rentré dans ma chambre d’hôtel, en prolongeai jusqu’au matin les échos. » Et ne croyez point qu’il s’arrête là, mais si je puis dire, enfonce le clou : « Comme je donnais ici simplement ma mesure, et qu’au surplus je venais de lire le Rossignol de Boccace [3], je ne me doutais pas qu’il y eût de quoi surprendre, et ce fut l’étonnement de Mohammed qui d’abord m’avertit. Où je la dépassai, cette mesure, c’est dans ce qui suivit, et c’est là que pour moi commence l’étrange : si soûlé que je fusse et si épuisé, je n’eus de cesse et de répit que lorsque j’eus poussé l’épuisement plus loin encore. J’ai souvent éprouvé par la suite combien il m’était vain de chercher à me modérer, malgré que me le conseillât la raison, la prudence ; car chaque fois que je le tentai, il me fallut ensuite, et solitairement, travailler à cet épuisement total hors lequel je n’éprouvais aucun répit, et que je n’obtenais pas à moins de frais ». La note 29 de la p. 1189 livre sobrement la traduction de Roger Martin du Gard en son journal : « Gide a besoin d’arriver à un total épuisement de sperme, et il n’y arrive qu’après cinq, six ou même huit coups consécutifs. […] Il n’a qu’une idée : rentrer chez lui et se masturber autant de fois qu’il faudra pour atteindre le point final d’épuisement ». Le lecteur passionné constatera que sur ce point du record éjaculatoire, Gide est en concurrence serrée avec notre ami Paul Éluard, en se reportant aux Archives du surréalisme. Quand on remarque que Flaubert et Queneau n’étaient pas en reste, et que Musset n’a pas mauvaise réputation en la matière, on se demande sur quel critère sont choisis les auteurs au programme de TL ! Suit une nouvelle rencontre de « Mohammed deux ans plus tard » […] « Il était attrayant encore ; que dis-je ? plus attrayant que jamais ; mais paraissait non plus tant lascif qu’effronté. » […] « Mohammed nous conduisit au quatrième étage d’un hôtel borgne […]. Relevant le haïk qui remplaçait à présent son costume tunisien, il étendit vers nous ses jambes nues. « Une pour chacun », nous dit-il en riant. […] Daniel saisit Mohammed dans ses bras et le porta sur le lit qui occupait le fond de la pièce. Il le coucha sur le dos, tout au bord du lit, en travers ; et je ne vis bientôt plus que, de chaque côté de Daniel ahanant, deux fines jambes pendantes. […] Daniel paraissait gigantesque, et penché sur ce petit corps qu’il couvrait, on eût dit un immense vampire se repaître sur un cadavre. J’aurais crié d’horreur… » […] « Pour moi, qui ne comprends le plaisir que face à face, réciproque et sans violence, et que souvent, pareil à Whitman, le plus furtif contact satisfait, j’étais horrifié tout à la fois par le jeu de Daniel, et de voir s’y prêter aussi complaisamment Mohammed. » À noter que soucieux de chiffres, tonton André oublie de préciser le tarif à l’attention de ses lecteurs qui prendraient le Grain pour un Baedecker… « Daniel » est en réalité Eugène Rouart, l’ami fidèle avec qui voyagent Gide et Madeleine. Gide rejoint Douglas à Biskra où celui-ci réside avec son Ganymède-Ali enlevé de Blida : « Je m’attendais à quelque caouadji bien modeste, mis comme Mohammed à peu près ; c’est un jeune seigneur que je vis descendre du train, en vêtements brillants, ceinturé d’une écharpe de soie, enturbanné d’or. Il n’avait pas seize ans, mais quelle dignité dans la démarche ! Quelle fierté dans le regard ! Quels sourires dominateurs il laissa tomber sur les domestiques de l’hôtel inclinés devant lui ! […] Tout Arabe, et si pauvre soit-il, contient un Aladin près d’éclore et qu’il suffit que le sort touche : le voici roi. » Ali n’est pourtant pas la cup of tea de Gide : « rien ne me distançait plus que l’apparence efféminée de tout son être, par quoi précisément d’autres sans doute eussent été séduits. » Gide recrute cependant Athman, qu’il retrouve, pour Douglas, mais se distancie de Douglas et des garçons : « j’étais loin d’avoir alors pour Athman la grande amitié qui m’occupa tant, par la suite, et qu’il commença bientôt de mériter. » […] « Douglas en revenait toujours, et avec une obstination dégoûtante, à ce dont je ne parlais qu’avec une gêne extrême, que sa totale absence de gêne augmentait. » Il s’amuse à raconter la déconvenue de Douglas : « Cette idylle prit fin brusquement. Bosy, qui voyait avec un amusement assez vif une douteuse intrigue s’ébaucher entre Ali et un jeune berger […], entra dans une grande fureur lorsqu’il vint à comprendre qu’Ali pouvait bien être sensible également aux charmes […] de Mériem. L’idée qu’Ali pût coucher avec elle lui était insupportable » […] « Des garçons, protestait-il ; oui des garçons tant qu’il voudra ; je le laisse libre ; mais je ne puis supporter qu’il aille avec des femmes. » […] « Certain jour, soupçonneux, il s’avisa de fouiller dans la valise d’Ali, découvrit […] une photographie de Mériem, qu’il lacéra… […] Ali, cravaché d’importance, poussa des hurlements à ameuter tous les gens de l’hôtel. […] Douglas apparut le soir à dîner, blême, le regard dur ; il m’annonça qu’Ali regagnerait Blidah par le premier train ». De ces deux pédérastes, on comprend bien que Gide est le modèle d’Édouard, et Douglas celui de Robert.
La suite du chapitre est consacrée plutôt aux relations avec la mère de Gide, d’abord son refus que Gide fasse venir Athman en France : « En vain, ici, m’efforçai-je de la persuader, comme j’avais fini par m’en persuader moi-même, qu’il s’agissait d’un sauvetage moral et que le salut d’Athman dépendait de sa transplantation à Paris, que je l’avais comme adopté… » Le dossier précise (note 50 p. 1101) qu’Athman viendra à Paris en mai 1900. Un tableau de Jacques-Émile Blanche : André Gide et ses amis en témoigne (à voir au musée des Beaux-Arts de Rouen). Ce tableau réunit de gauche à droite Charles Chanvin, Henri Ghéon, Athman, André Gide et Eugène Rouart, dont on sait par la lecture du dossier de la genèse de Corydon, qu’au moins deux d’entre eux étaient des amis uranistes ; quant à Athman, rien n’en est dit, mais si Gide le fait venir en France…

Avant de quitter l’Algérie, Gide se laisse entraîner par Pierre Louÿs au bordel : « Puis, comme Pierre Louis commençait de déclarer que ce qui lui plaisait surtout, c’était cette vulgarité même, mon dégoût l’engloba pour le vomir avec le reste. […] à mon écœurement s’ajouta bientôt la crainte de m’être fait poivrer – crainte sur laquelle Louis s’amusa de souffler » Bref, c’est la rupture avec Louÿs. La mère meurt en une scène bien pittoresque, même si Gide ne s’apitoie guère : « ce n’était pas tant le sentiment de mon deuil qui bouleversait mon âme à ce point (et, pour être sincère, je suis bien forcé d’avouer que ce deuil ne m’attristait guère ; ou si l’on veut : je m’attristais de voir souffrir ma mère, mais pas beaucoup de la quitter). Non, ce n’était pas surtout de tristesse que je pleurais, mais d’admiration pour ce cœur qui ne livrait accès jamais à rien de vil, qui ne battait que pour autrui, qui s’offrait incessamment au devoir, non point tant par dévotion que par une inclination naturelle » […] « lorsqu’enfin son cœur cessa de battre, je sentis s’abîmer tout mon être dans un gouffre d’amour, de détresse et de liberté. » Gide se morigène à qui mieux mieux : « Les chagrins personnels ne sont pas ce qui peut m’arracher des larmes ; mon visage alors reste sec, si douloureux que soit mon cœur. C’est que toujours une partie de moi tire en arrière, qui regarde l’autre et se moque, et qui lui dit : « Va donc ! tu n’es pas si malheureux que ça ! » » Cela nous rappelle Les Faux-Monnayeurs, chapitre 16 de la 3e partie : « Quoi que je dise ou fasse, toujours une partie de moi reste en arrière, qui regarde l’autre se compromettre, qui l’observe, qui se fiche d’elle et la siffle, ou qui l’applaudit. Quand on est ainsi divisé, comment veux-tu qu’on soit sincère ? » Gide est sous le choc : « Cette liberté même après laquelle, du vivant de ma mère, je bramais, m’étourdissait comme le vent du large, me suffoquait, peut-être bien me faisait peur. Je me sentais, pareil au prisonnier brusquement élargi, pris de vertige, pareil au cerf-volant dont on aurait soudain coupé la corde, à la barque en rupture d’amarre, à l’épave dont le vent et le flot vont jouer. » Le volume s’achève sur les improbables fiançailles avec Madeleine. Jean Delay souligne « la coïncidence chronologique troublante » entre la condamnation d’Oscar Wilde et la mort de la mère de Gide (p. 554).
Le « Projet de préface » publié dans l’édition Pléiade en appendice, est un indice supplémentaire que l’aveu pédérastique est la raison principale de l’écriture : « Pourquoi j’écrivis ces Mémoires : Par grand-peur des Berrichons et des Bazalgettes [auteur d’une biographie sur Whitman, niant son homosexualité, déjà mentionné dans Corydon]. Pourquoi je les publie de mon vivant : Parce que je n’ai pas confiance dans les publications posthumes. La dévotion des parents, des amis, s’entend à camoufler les morts. » Il dénonce « le zèle qui retouche et dissimule », et ajoute : « J’estime que mieux vaut encore être haï pour ce que l’on est, qu’aimé pour ce que l’on n’est pas. Ce dont j’ai le plus souffert durant ma vie, je crois bien que c’est le mensonge. » Enfin, « C’est parce qu’il se croyait unique que Rousseau dit avoir écrit ses Confessions. J’écris les miennes pour des raisons exactement contraires, et parce que je sais que grand est le nombre de ceux qui s’y reconnaîtront. »
Feuillets inédits de 1910
L’édition de la Pléiade fournit deux « feuillets inédits » fort intéressants, relatant ses expériences homosexuelles en Tunisie et à Biskra (Algérie) en 1893, puis en Algérie en 1895 et deux ans après. Ces textes sont la plus ancienne strate rédigée du livre, datés par le journal du 21 juin 1910, bien avant la rédaction de l’ensemble à partir de mars 1916. Nous avons vu comment ils seraient à peine édulcorés pour figurer dans la deuxième partie. En Tunisie, il était malade, mais « Un jour que je me sentis assez gaillard pour tâcher d’aller le rejoindre, ce fut avec un enfant brun qui, le plus souvent, m’accompagnait à travers la ville » […] « il commença de me parler comme savent faire les enfants arabes. Il se faisait très doux, caressant. Pour moi je soupçonnais, mais ne savais pas précisément à quel point ces enfants de Mohammed sont loisibles, et jusqu’alors n’en avais jamais essayé. (Je pourrais presque dire qu’encore je n’avais expérimenté rien) ». Bref, le petit finit par comprendre ce qu’attend Gide ; « il trancha précipitamment les attaches de sa culotte turque ». Gide fait remarquer « le rôle du poignard dans les amours arabes », puis raconte la suite : il demande au garçon « Tu veux que je t’enc… », et celui-ci « se mit en posture », mais Gide n’en avait pas envie, et « n’en profita point » : « mon désir n’avait rien de féroce ; cet enfant était délicieux, gracieux ; sans rien de vicieux, de corrompu dans sa mise ou dans son allure » (p. 1110). Le deuxième extrait inédit est consacré à « Mohammed d’Alger », le jeune musicien que Wilde lui avait présenté en 1895. « Je l’ai décrit dans Amyntas ». Gide était novice en la matière, et Wilde s’amusa fort à le débaucher en lui proposant ce jeune musicien, qui était « celui de Lord Alfred ». Ils ont chacun leur garçon dans deux chambres séparées. L’expérience est une épiphanie ; voici l’extrait, à peine différent du texte définitif, comme quoi la publication de cette expérience semble bien le nœud du projet : « Depuis, chaque fois que j’ai cherché le plaisir, c’était courir après le souvenir de cette première nuit-là. Je trouvais enfin ma normale. Plus rien ici de contraint, de précipité, d’inachevé, de douteux, d’illicite ; dans le souvenir que j’en garde, rien de cendreux. Ma joie fut pleine, intense, immense. Mais je demeurai longtemps ensuite dans une telle jubilation de la chair, que rentré dans ma chambre d’hôtel, je me br. encore éperdument – et bien qu’ayant déjà b. cinq fois avec Mohammed, jusqu’au matin j’entretins en moi pour ainsi dire sans effort une volupté frémissante. » Il retrouve Mohammed deux ans après, « déjà plus effronté que lascif », et font une partie à trois avec un ami de Gide (Eugène Rouart), dans une maison de passe. De la même époque, il brosse également un souvenir de prostituées à Biskra, Meryem et En Barka : « L’allure franchement putassière de Meryem m’excitait bien davantage. C’est auprès d’En Barka que volontiers j’eusse passé la nuit de Flaubert auprès des Kuchuk Hanem (du moins telle qu’il la raconte à Bouilhet) ». Témoignage intéressant sur le « tuilage » des expériences érotiques orientales chez les voyageurs européens du XIXe au XXe siècle. Combien encore de nos jours vont sur les traces de Flaubert et de Gide ? Mais attention, désormais, le terrain est sacrément miné ! (cf. par exemple de Patrick Cardon : Le Grand Écart ou tous les garçons s’appellent Ali, Orizons, 2009.
La Jeunesse d’André Gide, de Jean Delay
J’ai parcouru le second tome de ce gros livre écrit en 1956-57, par un psychiatre qui allait être élu à l’Académie française. Il est truffé de lettres inédites à l’époque, et de brouillons qui souvent ont été repris dans l’édition Pléiade. L’auteur y va plutôt franco sur les goûts de Gide, et utilise alternativement les mots « pédéraste » et « pédophile », tout en les amalgamant de façon fâcheuse à « homosexualité ». Exemple : « C’est donc à Sousse, quelques jours avant d’avoir vingt-quatre ans, qu’Andre Gide eut sa première expérience homosexuelle, ou du moins, si l’on suppose qu’il a pu avoir auparavant avec tel ou tel de ses amis des relations équivoques, ce qu’il a formellement nié, sa première expérience de pédéraste, c’est-à-dire d’homme épris de jeunes garçons » (p. 293). L’âge d’Athman est une question épineuse : quand Paul & André le recrutent en nov. 1893, Athman est « un jeune Arabe de quinze ans » (p. 294) ; mais si l’on regarde la photo reproduite en hors-texte et pleine page, Athman fait plutôt garçon de 12 ou 13 ans. On peut voir cette photo en petit sur le site andregide.org. Malheureusement il n’y a aucun crédit ni date dans le livre, et l’on ne peut savoir s’il s’agit de photos prises par les deux voyageurs ou antérieures (il y a aussi une mauvaise photo de Mériem). Sur le site de la Fondation Catherine Gide, on trouve mention sous la cote « PH-32 » de « photos de voyage en Algérie et Tunisie (1893), clichés de Athman Ben Salah, Ali, Mériem, En Barka, Paul-Albert Laurens, etc. », ce qui laisse supposer que les photos seraient de Gide, ou alors de photographes locaux, mais aucune de ces photos-là n’est visible sur le site… En 1893, Gide écrit à Jeanne Rondeaux : « C’est un charmant petit garçon décidément, qui a pour nous une estime, une affection démesurée ». Une lettre de recommandation adressée à Athman pour Louis & Hérold est entièrement citée p. 346 : « Je leur ai beaucoup parlé de toi ; ils te chercheront ; j’espère que tu seras libre et que tu pourras être avec eux comme tu étais avec Monsieur Paul et avec moi. »
Gide se confie naïvement à sa mère, par exemple sur le recrutement de « modèles » pour Paul : « Ces modèles sont des petits qui d’ordinaire ne demandent qu’à revenir… Nous leur offrons le café ; avec eux nous jouons aux billes […] nous avons des protégés ; leurs photographies attendent vos regards ». On se demande pourquoi ces photos ne sont pas envoyées ; peut-être sont-elles sur plaques de verre ? Gide demande à sa mère d’expédier des jouets : « Le 8 janvier [1894] arriva un volumineux paquet de jouets qu’André Gide avait demandé à sa mère pour ses petits compagnons ». Jean Delay commente l’expression « formes pleines mais presque enfantines encore » utilisée à propos de Mériem : « étant donné les goûts pédophiles de Gide, le fait que Mériem était une femme-enfant, ou mieux encore, une enfant-femme, n’est pas sans intérêt » (p. 299). Ce qu’il faudrait préciser, c’est que ces goûts sont partagés avec tous les Européens qui consomment des Ouled Naïl, puisque c’est Paul qui recrute Mériem, et que Gide la refilera à Pierre Louis, etc. À Biskra, c’est une églogue de Virgile que vit André, et il précise qu’il connaît tous les petits bergers par leur nom, dont il cite un grand nombre dans des notes inédites pour Si le grain ne meurt (pp. 308-309). À propos de la rencontre furtive de Wilde à Florence en mai 1894, on apprend que Wilde laisse à Gide son appartement loué pour un mois dont il reste 15 jours, et un extrait d’une lettre à Paul Valéry de juin 1894 en dit long sur la peur qu’inspirait la réputation de Wilde : « il y a de cela quatre semaines. Je ne te l’ai pas dit parce que tu étais à Paris et que tu l’aurais répété ! Mais à présent que le silence est plus facile, je ne te demande pas moins le silence ». Voilà sans doute l’origine de la relation entre Corydon et son interlocuteur qui n’ose le rencontrer que seul à seul au mois d’août. En tant que médecin, Delay pense que le spécialiste des bronches (Dr Andreæ) que Gide rencontra à Genève et qui lui prescrivit une cure d’hydrothérapie, doit s’être rendu compte de son état de nerf : « Que Gide ait tu un penchant pédophile qu’il tenait encore pour honteux, cela est très vraisemblable, mais il est peu probable qu’il ait gardé le silence sur tout son long passé de troubles nerveux et d’habitudes solitaires » (p. 335). Au début de son second voyage en Afrique du Nord, Gide, qui s’est naïvement confié à son oncle Charles Gide sur ses frasques avec Mériem, reçoit une lettre intégralement citée où le puritain tonton lui remet les pendules à l’heure : « On ne peut nier que cette histoire ne soit la marque d’un détraquement absolu du sens moral. Faire l’amour par besoin physique, ce n’est certes pas beau » […] « Mais aller chercher une femme sans avoir pour excuse l’instinct et pour faire une sorte d’expérimentation physiologique et psychologique [...] – ceci est le dernier degré de la démence morale » […] « Avec ce raisonnement-là d’ailleurs, ce n’est pas seulement l’acte sexuel, mais les vices contre nature qui pourraient aussi bien être recherchés et expérimentés dans un esprit de curiosité scientifique ou d’éducation morale. » On voit que l’oncle était clairvoyant ! Cette lettre n’empêche absolument pas André de replonger dans la débauche sous l’influence de Wilde, rencontré si opportunément à Blida. Il se confie toujours aussi naïvement à sa mère : « Impossible de comprendre ce que vaut ce jeune Lord, que Wilde semble avoir dépravé jusqu’aux moelles — à la façon d’un Vautrin bien plus terrible (je trouve) que celui du Père Goriot ». Sur la question de l’« enlèvement », ce mot si important pour l’intrigue des Faux-Monnayeurs, là encore Gide dit tout à maman. C’est déjà de Lord Douglas qu’il est question dans une lettre du 2 février 1895 : « Lord Douglas voyage avec un petit Arabe de 12 ou 13 ans qu’il a été cueillir à Blidah – un véritable enlèvement ». C’est sans doute l’exemple éhonté de Douglas qui donne l’idée à Gide d’enlever à son tour son Ganymède, en la personne d’Athman. Et Delay cite alors un étourdissant échange de lettres avec maman Gide — notamment une fort longue lettre du 25 février 1895 — dans laquelle Gide emploie à chaque fois le mot « enlèvement » : « Pour l’enlèvement d’Athman, rien ne serait plus simple que je le retrouve à Marseille, ou même à Paris. L’excellent garçon m’a annoncé de lui-même que s’il y avait des quatrièmes classes il les prendrait pour me coûter moins cher et que pour le service qu’il fera soit à Paris, soit à La Roque il ne demandait que 25 fr. par mois. Évidemment, il me faudra laisser un joli cadeau à sa mère au départ… ». Le 6 mars : « l’enlèvement d’Athman présente des tas de difficultés : des vraies, tu en parles à peine ; — ce n’est qu’après avoir tourné et retourné le projet une dizaine de jours dans ma tête sans lui en parler, qu’après avoir éprouvé dans ma tête la valeur du pour et du contre — qu’après lui en avoir parlé comme d’une chose en l’air et improbable que maintenant je l’habitue à regarder comme une probabilité sérieuse — lorsque c’est déjà pour moi une résolution très bien ancrée ». Le mot est à nouveau employé dans une lettre du 14 mars : « [Madeleine] m’a jugé depuis longtemps, et me reconnaîtra mieux que tu ne sais le faire dans cet enlèvement — et n’y verra pas de sottise — à moins que tu ne t’ingénies à lui démontrer l’absurdité d’une chose qui n’est pas absurde du tout étant donné ce qu’est ton fils ». Enfin le 14 mars, nouvelle longue missive : « J’ai dit qu’il aiderait Marie (cirage de souliers — et presque rien à Paris — mais, à La Roque montage de l’eau dans les chambres, port des plats de la cuisine à la salle à manger — tas de petits services divers), d’ailleurs je n’ai jamais prétendu qu’il pourrait remplacer complètement un domestique. Songe qu’il n’a tout juste que 15 ans et fait son apprentissage somme toute. Tu me parles de cruauté, « expériences littéraires » et des tas de machines à vous faire sauter sur les dents — mais si ce n’est pas moi qui l’emmène, ce sera quelqu’un d’autre — Athman certains jours, gagne ici jusqu’à 14 francs (c’est le plus fort) — mais il est très couru, si j’ose m’exprimer ainsi, et c’est par gentillesse qu’il reste attaché à moi, qui ne lui donne rien du tout à présent. […] Cet apprentissage, tu comprends que j’aime mieux qu’il le fasse chez nous qu’avec des gens de rencontre qui pourront, comme c’est l’usage s’amuser à le dépraver. C’est une pâte molle à présent : je perdrais, en l’abandonnant une occasion que je crois unique de former un serviteur d’une fidélité parfaite, qui n’a jamais servi que vous, et qui est presque comme un ami. Enfin, si je retourne à Biskra, j’aime former Athman et lui apprendre à m’aimer. Plus je vois les petits qui l’entourent, plus je comprends qu’il est absolument le seul — et plus j’apprends à l’apprécier ». Si Athman a quinze ans le 14 mars 95, cela confirme qu’en nov. 93, quand Gide le recrute pour la première fois, il n’aurait eu que 13 ans, âge plus conforme à la photo publiée dans l’ouvrage de Jean Delay. Cet escrime épistolaire se poursuit par un silence de Gide, que Delay interprète comme le résultat du procès perdu de Wilde. Gide prend peur, et prend prétexte du refus de Marie pour renoncer à son projet et le reporter à plus tard. Une dernière passion l’attache à un petit infirme surnommé Karoppo (crapaud) : « Il était assis tout tordu, sur la natte de la niche extérieure, au plein vent du soir parfumé. Je m’assis près de lui, troublé d’une angoisse indicible. Je pensais que ce pauvre enfant n’avait jamais eu de caresses, et qu’il vivait pourtant parmi ces prostitutions ». Gide médite ses Nourritures terrestres : « Il leur apprend à n’aimer plus seulement leur famille, et, lentement, à la quitter ; il rend leur cœur malade d’un désir d’aigres fruits sauvages et soucieux d’étrange amour. » Dans le Journal, Gide précise sa pensée : « La levée de chaque disciple est un enlèvement à sa famille ; par respect filial, l’un d’eux veut, avant de suivre Jésus, ensevelir son père ». Gide choisit entre Saint-Paul et Saint-Jean, et choisit Jean contre Paul, le prénom de son père.
Dans le chapitre « La consultation », Jean Delay va plus loin dans l’analyse du cas Gide, et parle plus clairement de pédophilie (mot qui n’avait pas les mêmes implications en 1957 que de nos jours). « Ses mœurs homosexuelles se réduisaient à des jeux voluptueux qui n’étaient autres que ceux de son enfance, à ceci près que l’onanisme solitaire était devenu un onanisme réciproque avec des partenaires puérils. » (p. 523). Il est bien évident qu’on n’emploierait absolument plus le mot « homosexuel » aujourd’hui pour de pareils faits, de peur de l’amalgame. Jean Delay expose ensuite quelques idées reçues de l’époque (« le stade homosexuel existe chez beaucoup d’adolescents qui n’en parviennent pas moins à l’étape hétérosexuelle. », p. 527 ; « Par rapport à l’onanisme solitaire, en tant qu’expression du narcissisme intégral et de la totale introversion du désir, il y a, du point de vue de la philosophie de l’instinct, progression, puisque la libido se fixe sur un objet extérieur à soi, mais cette progression est incomplète et n’atteint pas le stade ultime : la fixation sur un objet sexuellement différent de soi. », p. 528). Puis il cherche des causes au comportement sexuel de Gide dans le puritanisme protestant de sa famille : « On a souvent incriminé l’éducation puritaine dans les névroses sexuelles d’un Rousseau, d’un Amiel, d’un Nietzsche, d’un Loti, d’un Gide » (p. 529), avant de relativiser en montrant que le judaïsme et le catholicisme présentent aussi des aspects puritains, et que c’est plutôt dans la rigidité de celui, en l’occurrence celle (la mère) qui transmet ce puritanisme, qu’il faut chercher un lien causal. Puis on passe par le café du commerce : « Il est rare qu’un homosexuel soit le fils d’un couple heureux », p. 534 (l’auteur de cette phrase est quand même médecin et futur académicien !) Après tout ce bavardage, Jean Delay finit quand même par reconnaître sa limite : « des enfants placés dans des situations affectives exactement superposables à celles de Proust ou de Gide ne deviennent nullement des homosexuels » (et il oublie à ce moment-là de sa réflexion, que Gide, selon son propre classement, n’est pas un homosexuel, mais un pédophile / pédéraste homosexuel). Quelques réflexions, pourtant, traitent cette spécificité : « Mais il semble aussi que la virilité accomplie, de même que la féminité, inspiraient à Gide une sorte de peur, et qu’il n’était libéré de ses inhibitions que devant un enfant du même sexe que lui et vis-à-vis duquel il avait la supériorité d’un aîné » (p. 540). D’où l’avantage des garçons arabes : « Ses initiations eurent lieu dans un pays où la pédérastie n’est guère réprouvée. Les jeunes garçons qu’il y connut pendant ses deux premiers séjours étaient habitués à ces pratiques et n’y attachaient aucun sentiment de culpabilité » (p. 541). Le journal de Gide est même cité en note : « L’amour est très difficile chez nous, disait Athman, parce que les femmes sont gardées par les chiens et par toute la famille ». Un point important est que la dissociation amour / plaisir « a régi aussi les mœurs homosexuelles » : « Cependant, si son plus vif désir allait aux mauvais petits garçons, sa tendresse allait aux autres ; lorsqu’il s’attachait a l’un d’eux, par exemple Athman, réapparaissaient aussitôt des préoccupations moralisatrices, un désir d’éduquer, au sens d’élever, qui contrariait précisément, il l’a maintes fois souligné, ses penchants sexuels, comme si le pédagogue inhibait le pédéraste ». Une citation d’une lettre à Ramon Fernandez de 1934 nous semble révélatrice : « Je crois fort juste de dire (ainsi que vous l’avez fort bien fait) que la non-conformité sexuelle est, pour mon œuvre, la clé première ; mais je vous sais gré tout particulièrement d’indiquer déjà, par quel glissement, par quelle invitation, après ce monstre de la chair, premier sphinx sur ma route, et des mieux dévorants, mon esprit, mis en appétit de lutte, passa outre pour s’en prendre à tous les autres sphynx du conformisme, qu’il soupçonna dès lors d’être les frères et cousins du premier » (cité p. 549). Un grand nombre d’homosexuels actuels se prennent encore ainsi pour des Che Gayvaras même quand ils militent pour le mariage gay !
Dans le chapitre consacré à ce que Jean Delay appelle le « mariage blanc » avec Madeleine, il montre que celle-ci n’était sans doute pas dupe, et qu’elle avait remarqué, durant le voyage de noces déjà, selon des Notes sur André Gide de Roger Martin du Gard, que « Quand Gide était possédé par son « démon », quand il était en proie à son obsession pédophile, il perdait tout contrôle, tout sentiment des convenances, du respect d’autrui et de soi-même, même celui de la plus élémentaire prudence. Ses traits et son regard s’altéraient, il semblait devenir un autre. » (p. 570). Pour la petite histoire, on remarquera grâce aux moteurs de recherche, que les éditions actuelles de ces notes de Martin du Gard sont amputées de la partie de la phrase « quand il était en proie à son obsession pédophile »… Gide reconnaîtra dans Et nunc manet in te, texte postérieur à Si le grain ne meurt, avoir succombé lors de ce voyage à ses pratiques homosexuelles avec « de jeunes modèles de Saraginesco » qu’il emmenait sous prétexte de les photographier dans tel « petit appartement » loué avec sa femme à Rome (p. 574).
– Lire les excellents articles de Marie-Françoise Leudet sur la pédérastie à propos de Gide, ainsi que notre article sur l’exposition « Oscar Wilde, l’impertinent absolu ».
– Lire notre article sur Le Ramier, qui permet d’en savoir plus sur la question problématique de l’érotique gidienne.
– Lire à propos d’Amyntas, l’article de Jean-Yves sur le blog Culture et débats. Lire Le Pain nu, de Mohamed Choukri, pour avoir un aperçu de la situation des jeunes Arabes par rapport à la prostitution deux générations plus tard.
– Lire notre article sur « La relation avunculaire en littérature et au cinéma », où il est question des oncles & tantes de Gide, et d’autres relations du même tonneau.
Voir en ligne : Si le grain ne meurt, sur ebooksgratuits.com
© altersexualite.com 2016
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Jean Delay nous propose une justification du style de Gide : « Tout s’est passé comme si Gide avait voulu rédimer la peccabilité du fond par l’impeccabilité de la forme, remplaçant en quelque sorte le puritanisme du protestant par le purisme de l’écrivain, la moralité des mœurs par la moralité d’un style » (p. 673, sic : comprendre « l’immoralité des mœurs »).
[2] Hasard amusant, alors que je lisais ce livre à mon habitude à 90 % dans les transports, quelques minutes après avoir lu ce passage, je me trouve, pour faire des courses au « Vieux campeur », dans un quartier que je ne fréquente désormais qu’une ou deux fois par an, passer juste devant cet immeuble (au 78 du boulevard selon la note 4 p. 1155) qui existe toujours, en face de la rue Thénard ! D’où une idée pour les lycéens résidant en région parisienne, en Normandie ou dans le Gard, de randonner sur les traces de notre cher André…
 altersexualite.com
altersexualite.com