Accueil > Zola pour les nuls > Thérèse Raquin, d’Émile Zola
Naissance du roman expérimental, niveau seconde
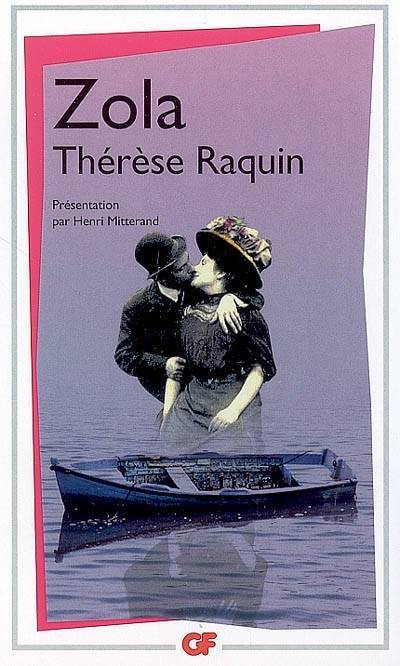 Thérèse Raquin, d’Émile Zola
Thérèse Raquin, d’Émile Zola
Garnier-Flammarion, 1867 (édition de 1970-2008).
mercredi 13 septembre 2017
Pour ce roman, j’ai utilisé l’édition Garnier-Flammarion d’Henri Mitterand (1970, revue en 2008). Après avoir achevé ma lecture critique du cycle des Rougon-Macquart, voici un retour à l’œuvre qui l’a précédé, et par laquelle Zola étrenna son idée de « roman expérimental ». Thérèse Raquin est souvent choisi en classe de Seconde, parce qu’il est moins volumineux et plus simple qu’un des Rougon-Macquart. Une lecture rétrospective permettra de souligner ce qui préfigure dans ce roman, les Rougon-Macquart, dont plusieurs tomes sont préfigurés, à la manière d’une ouverture d’opéra, sans doute parce que ce sont des thèmes chers au jeune auteur. Le roman a été publié en trois livraisons dans la revue L’Artiste entre août et septembre 1867, puis en volume le 7 décembre 1867.
– Genèse
– Réception de l’œuvre
– Chapitres I à XI : de l’enfance au meurtre de Camille
– Chapitres XII à XXI : du meurtre au mariage
– Chapitres XXII à XXXII : du mariage au suicide
– Adaptations et idées de films et d’œuvres sur les thèmes du roman
Genèse de l’œuvre
Selon Henri Mitterand, Zola s’est servi pour ses premières œuvres de son expérience de la vie, notamment de la misère qu’il a connue lors de son séjour à Paris, surtout la première année (1861) : « Il a habité les rues les plus pauvres de la montagne Sainte-Geneviève et du quartier Maubert. Il a fréquenté les humbles, le menu peuple des petits commerçants de quartier, des employés, des étudiants sans fortune, des rapins sans talent. Il a fait l’expérience des amours de galetas. » Si ses premières œuvres étaient autobiographiques, Zola s’en détache avec ce premier roman : « Zola est désormais moins préoccupé d’exprimer ses propres amours, ses souffrances, ses découragements ou ses déceptions, que de connaître, de comprendre et d’expliquer les lois et les contraintes qui font se mouvoir les êtres ». Il s’engage dans le roman d’analyse, sous la double influence de Flaubert et des Goncourt. La source immédiate de Thérèse Raquin serait, de l’aveu de Zola soi-même, La Vénus de Gordes d’Adolphe Belot et Ernest Daudet. Zola en a d’abord tiré une courte nouvelle intitulée « Un mariage d’amour » (1866), véritable synopsis de Thérèse Raquin, qui présente une structure serrée autour de la succession adultère / meurtre / remords. D’autres lectures ont pu lui inspirer un motif, d’autant que Zola publiait des critiques littéraires, ce qui l’amenait à formuler ses réflexions sur ces œuvres. Je ne les mentionne pas toutes, mais par exemple Atar-Gull d’Eugène Sue, qui traite de la vengeance d’un esclave contre le colon à qui il a été vendu, et aurait fourni à Zola le motif secondaire du « paralytique impuissant à dénoncer son tortionnaire » selon Mitterand.
Mais il faut voir large et compter avec l’influence grandissante des progrès de la médecine sur les littérateurs, ainsi de Flaubert, fils et frère de médecin qui utilise des données médicales pour Madame Bovary ou Sainte-Beuve qui a fait des études médicales. Claude Bernard publie son Introduction à l’étude de la médecine expérimentale en 1865. Dans les Essais de critique et d’histoire (1858) d’Hippolyte Taine, Zola avait pu lire un parallèle entre sciences et littérature : « De pureté, de grâce, le naturaliste ne s’inquiète guère ; à ses yeux, un crapaud vaut un papillon ; la chauve-souris l’intéresse plus que le rossignol. […] L’idéal manque au naturaliste ; il manque encore plus au naturaliste Balzac. » (etc. ; cf. « Zola critique littéraire, entre Sainte-Beuve et Taine », de François-Marie Mourad. Dans sa critique des Victimes d’amour d’Hector Malot (1866), Zola utilise pour la 1re fois l’expression « la bête humaine », et expose l’embryon de son idée du Roman expérimental : « M. Malot, un fils indépendant de Balzac, passe le tablier blanc de l’anatomiste et dissèque fibre par fibre la bête humaine étendue toute nue sur la dalle de l’amphithéâtre. » […] « On a dès lors une méthode d’observation basée sur l’expérience même. »
Structure. Mitterand analyse ainsi la structure du roman : « D’un amour de « brutes » au crime, du crime à l’effroi, de l’effroi à la souffrance, puis à la haine, puis au suicide, ce sont les six temps d’un drame dont les personnages sont poussés avec une parfaite régularité vers la déchéance et vers la mort, dans un mouvement déclenché quasi mécaniquement par le heurt des tempéraments entre eux et des tempéraments avec les milieux. Autant dire une tragédie, dans laquelle le déterminisme des instincts irrépressibles tient lieu de fatalité. » Le roman est divisé en 32 courts chapitres, beaucoup plus que dans les Rougon-Macquart, où Zola optera pour des chapitres plus longs réunissant un faisceau de faits. Mitterand dresse un tableau (p. 33) des tempéraments de Thérèse (nerveux), Laurent (sanguin) et Camille (lymphatique), en relevant les caractéristiques physiques associées à ces tempéraments en opposition. Mais le portrait physique de Thérèse renvoie aussi à deux tableaux de Manet, dont Zola était proche : Lola de Valence (1862) et Olympia (1863) ; cf. ci-dessous.
Réception. La réception est assez positive, en ce sens que Zola obtient un succès de scandale et d’estime. Un certain « Ferragus » (Louis Ulbach) publie un bel article (lecture analytique possible) intitulé « La littérature putride », qui met bien dans l’ambiance, en attaquant de front le roman de Zola et ceux des Goncourt et de Feydeau. Extraits choisis :
« Il s’est établi depuis quelques années une école monstrueuse de romanciers, qui prétend substituer l’éloquence du charnier à l’éloquence de la chair, qui fait appel aux curiosités les plus chirurgicales, qui groupe les pestiférés pour nous en faire admirer les marbrures, qui s’inspire directement du choléra, son maître, et qui fait jaillir le pus de la conscience. »
« Remarquez bien que c’est la pierre de touche. Balzac, le sublime fumier sur lequel poussent tous ces champignons-là, a amassé dans madame Marneffe toutes les corruptions, toutes les infamies […] »
« Les foules qui courent à la guillotine, ou qui se pressent à la morgue, sont-elles le public qu’il faille séduire, encourager, maintenir dans le culte des épouvantes et des purulences ? »
« Je ne prétends pas restreindre le domaine de l’écrivain. Tout, jusqu’à l’épiderme, lui appartient : arracher la peau, ce n’est plus de l’observation, c’est de la chirurgie ; et si une fois par hasard un écorché peut être indispensable à la démonstration psychologique, l’écorché mis en système n’est plus que de la folie et de la dépravation. »
« Ma curiosité a glissé ces jours-ci dans une flaque de boue et de sang qui s’appelle Thérèse Raquin, et dont l’auteur, M. Zola, passe pour un jeune homme de talent. Je sais, du moins, qu’il vise avec ardeur à la renommée. Enthousiaste des crudités, il a publié déjà La Confession de Claude qui était l’idylle d’un étudiant et d’une prostituée ; il voit la femme comme M. Manet la peint, couleur de boue avec des maquillages rosés. Intolérant pour la critique il l’exerce lui-même avec intolérance, et à l’âge où l’on ne sait encore que suivre son désir, il intitule ses prétendues études littéraires : Mes haines ! »
« Si je disais à l’auteur que son idée est immorale, il bondirait, car la description du remords passe généralement pour un spectacle moralisateur ; mais si le remords se bornait toujours à des impressions physiques, à des répugnances charnelles, il ne serait plus qu’une révolte du tempérament, et il ne serait pas le remords. »
« Comment ne pas assassiner ce pauvre Camille, cet être maladif et gluant, dont le nom rime avec camomille, après une telle excitation ? »
« Je ne blâme pas systématiquement les notes criardes, les coups de pinceau violents et violets ; je me plains qu’ils soient seuls et sans mélange ce qui fait le tort de ce livre pouvait en être le mérite. »
« Ce livre résume trop fidèlement toutes les putridités de la littérature contemporaine pour ne pas soulever un peu de colère. »
« À la vente […], M. Courbet représentait le dernier mot de la volupté dans les arts par un tableau qu’on laissait voir, et par un autre suspendu dans un cabinet de toilette qu’on montrait seulement aux dames indiscrètes et aux amateurs. Toute la honte de l’école est là dans ces deux toiles, comme elle est d’ailleurs dans les romans : la débauche lassée et l’anatomie crue. C’est bien peint, c’est d’une réalité incontestable, mais c’est horriblement bête. » La réponse de Zola (à lire dans le même lien ci-dessus) est amusante ; il y pratique l’insulte avec ironie. Notons quand même son dégoût du public du théâtre (qu’il exprimera dans Nana) : « Nos foules demandent de beaux mensonges, des sentiments tout faits, des situations clichées ; elles descendent souvent jusqu’aux indécences, mais elles ne montent jamais jusqu’aux réalités. » Un paragraphe fait le lien avec cet autre réaliste qu’est Baudelaire (« Une Charogne ») : « S’il est possible, ayez un instant la curiosité du mécanisme de la vie, oubliez l’épiderme satiné de telle ou telle dame, demandez-vous quel tas de boue est caché au fond de cette peau rose dont le spectacle contente vos faciles désirs. »
Zola peut se féliciter d’avoir obtenu deux lettres globalement positives de Sainte-Beuve et d’Hippolyte Taine. Celle de Sainte-Beuve reprend une des critiques de « Ferragus », sur le juste milieu, et prédit le succès à l’auteur : « Votre œuvre est remarquable, consciencieuse, et, à certains égards même, elle peut faire époque dans l’histoire du roman contemporain.
Selon moi, cependant, elle dépasse les limites, elle sort des conditions de l’art à quelque point de vue qu’on l’envisage ; et, en réduisant l’art à n’être que la seule et simple vérité, elle me paraît hors de cette vérité. » […]
« Vous avez fait un acte hardi : vous avez bravé dans cette œuvre et le public et aussi la critique. Ne vous étonnez pas de certaines colères ; le combat est engagé ; votre nom y est signalé : de tels conflits se terminent, quand un auteur de talent le veut bien, par un autre ouvrage, également hardi, mais un peu détendu, où le public et la critique croient voir une concession à leur gré, et tout finit par un de ces traités de paix qui consacrent une réputation de plus. »
Zola répond en se justifiant avec tact et précisant ses intentions : « Vous me dites que j’ai menti à la vérité en ne jetant pas Laurent et Thérèse dans les bras l’un de l’autre, le lendemain du meurtre. Si j’ai cru devoir les séparer, leur donner des répugnances et des lassitudes, c’est que je n’ai pas voulu peindre une passion tragique, âpre, insatiable. Lorsqu’ils tuent, ils sont déjà presque dégoûtés l’un de l’autre. Leur crime est une fatalité à laquelle ils ne peuvent échapper. Ils éprouvent comme un affaissement après l’assassinat, comme une paix d’être débarrassés d’un effort trop violent pour leur nature. » Cette justification ne nous convainc pas vraiment.
Quant à Taine, lui aussi plaide pour le juste milieu : « Probablement, il faut garder une mesure, et si j’en cherche la raison, c’est qu’il y a une mesure dans la vie. Certainement Germinie Lacerteux et Thérèse Raquin sont des histoires vraies ; mais un livre doit être toujours, plus ou moins, un portrait de l’ensemble, un miroir de la société entière ; il faut à droite, à gauche des biographies, des personnages, des indices qui montrent le grand complément, les antithèses de toute sorte, les compensations, bref, l’au-delà de notre sujet. »
Dans la préface de la 2e édition, publiée en général dans les éditions de poche, Zola répond aux critiques, et explique son art : « Dans Thérèse Raquin, j’ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là est le livre entier. J’ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, rien de plus. J’ai cherché à suivre pas à pas dans ces brutes le travail sourd des passions, les poussées de l’instinct, les détraquements cérébraux survenus à la suite d’une crise nerveuse. » Le terme « bête humaine » est presque là : « En un mot, je n’ai eu qu’un désir : étant donné un homme puissant et une femme inassouvie, chercher en eux la bête, ne voir même que la bête, les jeter dans un drame violent, et noter scrupuleusement les sensations et les actes de ces êtres. » Sûr de lui, Zola dédaigne la critique : « je sens le tort que je me fais auprès de la critique en l’accusant d’inintelligence, et je ne puis pourtant m’empêcher de témoigner le dédain que j’éprouve pour son horizon borné et pour les jugements qu’elle rend à l’aveuglette, sans aucun esprit de méthode. Je parle, bien entendu, de la critique courante, de celle qui juge avec tous les préjugés littéraires des sots, ne pouvant se mettre au point de vue largement humain que demande une œuvre humaine pour être comprise. Jamais je n’ai vu pareille maladresse. Les quelques coups de poing que la petite critique m’a adressés à l’occasion de Thérèse Raquin se sont perdus, comme toujours, dans le vide. Elle frappe essentiellement à faux, applaudissant les entrechats d’une actrice enfarinée et criant ensuite à l’immoralité à propos d’une étude physiologique, ne comprenant rien, ne voulant rien comprendre et tapant toujours devant elle, si sa sottise prise de panique lui dit de taper. » Dès cette préface (1868), Zola se réclame d’un « groupe » : « Le groupe d’écrivains naturalistes auquel j’ai l’honneur d’appartenir a assez de courage et d’activité pour produire des œuvres fortes, portant en elles leur défense ».
Chapitre I à XI : de l’enfance au meurtre de Camille
Chapitre I. Cela commence à la Zola, par la description du quartier où se trouve une boutique du nom éponyme : « une boutique dont les boiseries d’un vert bouteille suaient l’humidité par toutes leurs fentes. L’enseigne, faite d’une planche étroite et longue, portait, en lettres noires, le mot : Mercerie, et sur une des vitres de la porte était écrit un nom de femme : Thérèse Raquin, en caractères rouges. » Comme ce sera à nouveau le cas dans Au Bonheur des Dames, le nom du roman mis en abyme dans celui d’une boutique attire notre attention sur son contenu, représentatif de la matière même du roman naturaliste : « un entassement d’objets ternes et fanés qui dormaient sans doute en cet endroit depuis cinq ou six ans. Toutes les teintes avaient tourné au gris sale, dans cette armoire que la poussière et l’humidité pourrissaient. »
Chapitre II. Retour en arrière pour évoquer la famille Raquin, la veuve vivant retirée du commerce en province : « La bonne dame, qui avait dépassé la cinquantaine, s’enferma au fond de cette solitude, et y goûta des joies sereines, entre son fils Camille et sa nièce Thérèse ». Ce fils est maladif, au contraire de la nièce, fille de son frère et d’une « indigène », que celui-ci lui a confiée avant de repartir mourir en Afrique. Thérèse est vue comme une bête : « Quand elle était seule, dans l’herbe, au bord de l’eau, elle se couchait à plat ventre comme une bête, les yeux noirs et agrandis, le corps tordu, près de bondir. Et elle restait là, pendant des heures, ne pensant à rien, mordue par le soleil, heureuse d’enfoncer ses doigts dans la terre. » Les deux cousins grandissent sans trouble amoureux, bien qu’ils soient promis au mariage : « Quand il jouait avec elle, qu’il la tenait dans ses bras, il croyait tenir un garçon ; sa chair n’avait pas un frémissement. » Au dernier moment, Thérèse apprend son origine, impassible : « Le jour fixé pour le mariage arriva. Mme Raquin prit Thérèse à part, lui parla de son père et de sa mère, lui conta l’histoire de sa naissance. La jeune fille écouta sa tante, puis l’embrassa sans répondre un mot. »
Chapitre III. Camille impose à sa mère et sa femme de s’installer à Paris. Il trouve un emploi dans un bureau, tandis que la boutique permet un revenu modeste et régulier. Tandis que Camille tente de s’instruire par des lectures, « Thérèse repoussait les livres avec impatience. Elle préférait demeurer oisive, les yeux fixes, la pensée flottante et perdue. […] Pendant trois ans, […] Camille ne s’absenta pas une seule fois de son bureau ; sa mère et sa femme sortirent à peine de la boutique ». Ce motif sera repris dans Une Page d’amour, où Hélène Rambaud et sa fille s’installent également à Paris recluses dans leur maison.
Chapitre IV. C’est l’instauration des jeudis, où les Raquin reçoivent un petit groupe d’amis (utiles à la suite de l’intrigue), dînent et jouent aux dominos. Thérèse n’apprécie pas, et trouve souvent prétexte à s’installer « derrière le comptoir ».
Chapitre V. Camille introduit un pays, camarade d’enfance, retrouvé au bureau : « Laurent, le petit Laurent, le fils du père Laurent qui a de si beaux champs de blé du côté de Jeufosse ?… Tu ne te rappelles pas ?… J’allais à l’école avec lui ; il venait me chercher le matin, en sortant de chez son oncle qui était notre voisin » C’est décidément une vie en vase clos. Le portrait de Laurent vu par Thérèse (focalisation interne) est un modèle du genre, et préfigure Cabuche, l’assassin caricatural, dans La Bête humaine : « Elle n’avait jamais vu un homme. Laurent, grand, fort, le visage frais, l’étonnait. Elle contemplait avec une sorte d’admiration son front bas, planté d’une rude chevelure noire, ses joues pleines, ses lèvres rouges, sa face régulière, d’une beauté sanguine. Elle arrêta un instant ses regards sur son cou ; ce cou était large et court, gras et puissant. Puis elle s’oublia à considérer les grosses mains qu’il tenait étalées sur ses genoux ; les doigts en étaient carrés ; le poing fermé devait être énorme et aurait pu assommer un bœuf. Laurent était un vrai fils de paysan, d’allure un peu lourde, le dos bombé, les mouvements lents et précis, l’air tranquille et entêté. On sentait sous ses vêtements des muscles ronds et développés, tout un corps d’une chair épaisse et ferme. Et Thérèse l’examinait avec curiosité, allant de ses poings à sa face, éprouvant de petits frissons lorsque ses yeux rencontraient son cou de taureau. » Laurent s’est essayé à la peinture, mais il est velu de la paume : « Ce grand corps puissant ne demandait qu’à ne rien faire, qu’à se vautrer dans une oisiveté et un assouvissement de toutes les heures. » […] « Ses premiers essais étaient restés au-dessous de la médiocrité ; son œil de paysan voyait gauchement et salement la nature ; ses toiles, boueuses, mal bâties, grimaçantes, défiaient toute critique. » Ce préjugé de Zola à l’encontre des paysans annonce La Terre. Laurent ne regrette que les séances de pose : « Il regretta encore les femmes qui venaient poser, et dont les caprices étaient à la portée de sa bourse. Ce monde de jouissances brutales lui laissa de cuisants besoins de chair. » Camille est curieux de ce point : « Alors, lui dit-il, il y a eu, comme ça, des femmes qui ont retiré leur chemise devant toi ? » Du coup le regard que jette Laurent à Thérèse est informé par sa pratique de peintre amateur : « Laurent leva la tête et vit Thérèse devant lui, muette, immobile. La jeune femme le regardait avec une fixité ardente. Ses yeux, d’un noir mat, semblaient deux trous sans fond, et, par ses lèvres entr’ouvertes, on apercevait des clartés roses dans sa bouche. » Est-ce bien l’Olympia de Manet ?

Chapitre VI. Laurent fait poussivement le portrait de Camille, et Thérèse l’admire. Il en tire une conclusion logique : « Voilà une petite femme, se disait-il, qui sera ma maîtresse quand je le voudrai. Elle est toujours là, sur mon dos, à m’examiner, à me mesurer, à me peser… […] À coup sûr, elle a besoin d’un amant ; cela se voit dans ses yeux… Il faut dire que Camille est un pauvre sire. » Sa réflexion fort argumentée, est des plus romantiques : « Pour lui, Thérèse, il est vrai, était laide, et il ne l’aimait pas ; mais, en somme, elle ne lui coûterait rien ; les femmes qu’il achetait à bas prix n’étaient, certes, ni plus belles ni plus aimées. L’économie lui conseillait déjà de prendre la femme de son ami. D’autre part, depuis longtemps il n’avait pas contenté ses appétits ; l’argent étant rare, il sevrait sa chair, et il ne voulait point laisser échapper l’occasion de la repaître un peu. Enfin, une pareille liaison, en bien réfléchissant, ne pouvait avoir de mauvaises suites : Thérèse aurait intérêt à tout cacher, il la planterait là aisément quand il voudrait ; en admettant même que Camille découvrît tout et se fâchât, il l’assommerait d’un coup de poing, s’il faisait le méchant. La question, de tous les côtés, se présentait à Laurent facile et engageante. » Le portrait s’achève sans qu’il se crée une occasion. Celui-ci, terminé, constitue ironiquement une mise en abyme du roman naturaliste tel que les critiques l’ont lu : « Le portrait était ignoble, d’un gris sale, avec de larges plaques violacées. Laurent ne pouvait employer les couleurs les plus éclatantes sans les rendre ternes et boueuses ; il avait, malgré lui, exagéré les teintes blafardes de son modèle et le visage de Camille ressemblait à la face verdâtre d’un noyé ». Laurent finit par prendre Thérèse à la Zola, c’est-à-dire par surprise et sans un mot. Première occurrence d’un motif que l’on retrouvera maintes fois dans les Rougon-Macquart : « Puis, d’un mouvement violent, Laurent se baissa et prit la jeune femme contre sa poitrine. Il lui renversa la tête, lui écrasant les lèvres sous les siennes. Elle eut un mouvement de révolte, sauvage, emportée, et, tout d’un coup, elle s’abandonna, glissant par terre, sur le carreau. Ils n’échangèrent pas une seule parole. L’acte fut silencieux et brutal. »
Chapitre VII. Thérèse est comme enchantée par cet acte : « Au premier baiser, elle se révéla courtisane. Son corps inassouvi se jeta éperdument dans la volupté. Elle s’éveillait comme d’un songe, elle naissait à la passion. Elle passait des bras débiles de Camille dans les bras vigoureux de Laurent, et cette approche d’un homme puissant lui donnait une brusque secousse qui la tirait du sommeil de la chair. Tous ses instincts de femme nerveuse éclatèrent avec une violence inouïe ; le sang de sa mère, ce sang africain qui brûlait ses veines, se mit à couler, à battre furieusement dans son corps maigre, presque vierge encore. » Étonnamment, elle se met à raconter sa vie terne, son mariage avec un homme qu’elle déteste, avec cette justification : « Je te dis tout cela pour que tu ne sois pas jaloux… » Elle ne craint rien, à la Bovary : « Elle se jetait dans l’adultère avec une sorte de franchise énergique, bravant le péril, mettant une sorte de vanité à le braver. »
Chapitre VIII. La situation semble idéale : « Un jour même il [Camille] fit des reproches à Thérèse sur ce qu’il appelait sa froideur pour Laurent. Laurent avait deviné juste : il était devenu l’amant de la femme, l’ami du mari, l’enfant gâté de la mère. » L’usage de la focalisation externe laisse un peu à désirer : « Le soir, à table, dans les clartés pâles de la lampe, on sentait la force de leur union, à voir le visage épais et souriant de Laurent, en face du masque muet et impénétrable de Thérèse. » Qui est ce « on » ? Tant que Laurent peut rejoindre Thérèse dans la chambre conjugale en journée, tout va bien, et l’idylle dure « huit mois ».
Chapitre IX. Tout allait si bien, mais le drame s’engendre d’un détail : « Mon chef me refuse toute nouvelle permission de sortie. » Plus de coït l’après-midi ! Une simple question-réponse amène la grande idée : « Est-ce que tu ne pourrais pas nous en débarrasser, l’envoyer en voyage, quelque part, bien loin ? — Ah ! oui, l’envoyer en voyage ! reprit la jeune femme en hochant la tête. Tu crois qu’un homme comme ça consent à voyager… Il n’y a qu’un voyage dont on ne revient pas… » Et pour Zola une réflexion s’impose : Laurent est paysan, donc meurtrier en puissance : « Il risquait moins en tuant le mari ; il ne soulevait aucun scandale, il poussait seulement un homme pour se mettre à sa place. Dans sa logique brutale de paysan, il trouvait ce moyen excellent et naturel. » Thérèse est dégoûtée par son mari : « Thérèse regarda longtemps cette face blafarde qui reposait bêtement sur l’oreiller, la bouche ouverte. Elle s’écartait de lui, elle avait des envies d’enfoncer son poing fermé dans cette bouche. »
Chapitre X. Ce court chapitre relate une discussion d’un jeudi, où l’ancien commissaire Michaud et son fils Olivier, qui est toujours de la maison, évoquent les crimes impunis, ce qui intéresse fort les deux amants : « — Alors, la police est impuissante, vous l’avouez ? il y a des meurtriers qui se promènent au soleil ? — Eh ! malheureusement oui, répondit le commissaire. »
Chapitre XI. C’est le grand et long chapitre du meurtre. Zola, qui n’était guère en fonds à l’époque, parle de ce qu’il connaît, les sorties du populo à Saint-Ouen : « D’autres fois, plus rarement, les époux sortaient de Paris : ils allaient à Saint-Ouen ou à Asnières, et mangeaient une friture dans un des restaurants du bord de l’eau. C’étaient des jours de grande débauche, dont on parlait un mois à l’avance. » Un dimanche d’automne, on part donc à Saint-Ouen, dont Camille se plaint – porte-parole de Zola ! – qu’il ne soit point aménagé comme les jardins des riches : « [Camille] se fâchait contre le gouvernement, en déclarant qu’on devrait changer tous les îlots de la Seine en jardins anglais, avec des bancs, des allées sablées, des arbres taillés, comme aux Tuileries ». Pour la petite histoire, le vœu de Camille sera bientôt réalité, car l’Île Saint-Denis, autour de laquelle a lieu l’action de ce chapitre, a été choisi pour construire à la fois le village olympique et un terrain d’entraînement pour plusieurs sports, pour les JO de 2024 ou 2028. Les berges, qui sont actuellement à l’état de friches jouxtant des cités parmi les plus décrépites et criminogènes de France, deviendront donc incessamment un lieu branché. Devant le mari qui fait sa sieste, Laurent se livre au fétichisme : « Alors, Laurent se coula doucement vers la jeune femme ; il avança les lèvres et baisa sa bottine et sa cheville. Ce cuir, ce bas blanc qu’il baisait lui brûlaient la bouche. Les senteurs âpres de la terre, les parfums légers de Thérèse se mêlaient et le pénétraient, en allumant son sang, en irritant ses nerfs. » Le crime est improvisé : Laurent a l’idée de louer une barque pour une heure en attendant que le repas soit prêt, et il choisit une barque effilée, ce qui effraie Camille : « Le commis avait une peur horrible de l’eau. À Vernon, son état maladif ne lui permettait pas, lorsqu’il était enfant, d’aller barboter dans la Seine ; tandis que ses camarades d’école couraient se jeter en pleine rivière, il se couchait entre deux couvertures chaudes. Laurent était devenu un nageur intrépide, un rameur infatigable ; Camille avait gardé cette épouvante que les enfants et les femmes ont pour les eaux profondes. » Ce motif sportif est fréquent dans la littérature de l’époque, à l’instar de Maupassant, qui se souviendra peut-être de ce chapitre pour sa « Partie de campagne » en 1881. L’extrait est connu. Rappelons que lorsqu’il balance Camille à la flotte, celui-ci le mord et emporte « un morceau de chair. » La naïveté des indigènes (on dirait actuellement « banlieusards ») comme l’évanouissement de Thérèse accréditent la thèse de l’accident.
Chapitres XII à XXI : du meurtre au mariage
Ce second mouvement prend des allures de roman gothique, avec l’intrusion obsessionnelle du cadavre du mari entre les deux amants.
Chapitre XII. Laurent laisse Thérèse sur place et, craignant d’annoncer seul le drame à la mère Raquin, court chez « le vieux Michaud », qu’il trouve dînant avec son fils. Les regards des policiers l’inquiètent : « il voyait de la méfiance où il n’y avait que de la stupeur et de la pitié ». Tout marche, et l’accident est relayé par les échotiers : « Le lendemain, les journaux racontèrent l’accident avec un grand luxe de détails ; la malheureuse mère, la veuve inconsolable, l’ami noble et courageux, rien ne manquait à ce fait divers, qui fit le tour de la presse parisienne et qui alla ensuite s’enterrer dans les feuilles des départements. » Laurent revit : « devant la certitude de l’impunité, le sang se remettait à couler dans ses veines avec des lenteurs douces. »
Chapitre XIII. Le seul souci de Laurent semble anodin : cacher sa cicatrice, « se disant que la blessure serait cicatrisée au bout de quelques jours. » Mais une « inquiétude sourde » se fait jour : « retrouver son cadavre pour qu’un acte formel fût dressé ». Voici donc le chapitre de la morgue, qui est finalement, au milieu du roman, le premier chapitre justifiant le procès de « Ferragus » en « littérature putride », alors qu’aujourd’hui, ces pages nous semblent fascinantes, véritable reportage révélant certaines mœurs étranges de l’époque. Le dossier de l’œuvre a été perdu, mais on se doute que Zola journaliste avait eu l’occasion de visiter la morgue de Paris. On apprend l’existence d’un métier très spécial : « Des ravageurs fouillaient activement la Seine pour toucher la prime. » Les visites quotidiennes de Laurent fournissent des scènes étonnantes, comme cette danse macabre : « Un matin, il fut pris d’une véritable épouvante. Il regardait depuis quelques minutes un noyé, petit de taille, atrocement défiguré. Les chairs de ce noyé étaient tellement molles et dissoutes, que l’eau courante qui les lavait les emportait brin à brin. Le jet qui tombait sur la face, creusait un trou à gauche du nez. Et, brusquement, le nez s’aplatit, les lèvres se détachèrent, montrant des dents blanches. La tête du noyé éclata de rire. » En dehors de ça, le spectacle est plutôt cool, et pas seulement pour Laurent, mais pour toute une foule de curieux : « il prenait un plaisir étrange à regarder la mort violente en face, dans ses attitudes lugubrement bizarres et grotesques. Ce spectacle l’amusait, surtout lorsqu’il y avait des femmes étalant leur gorge nue. Ces nudités brutalement étendues, tachées de sang, trouées par endroits, l’attiraient et le retenaient. » […] « Lorsque les dalles sont bien garnies, lorsqu’il y a un bel étalage de chair humaine, les visiteurs se pressent, se donnent des émotions à bon marché, s’épouvantent, plaisantent, applaudissent ou sifflent, comme au théâtre, et se retirent satisfaits, en déclarant que la morgue est réussie, ce jour-là. » (on songe au Ventre de Paris) « Les femmes étaient en grand nombre ; il y avait de jeunes ouvrières toutes roses, le linge blanc, les jupes propres, qui allaient d’un bout à l’autre du vitrage, lestement, en ouvrant de grands yeux attentifs, comme devant l’étalage d’un magasin de nouveautés » (Voilà Au Bonheur des Dames !) « Par moments, arrivaient des bandes de gamins, des enfants de douze à quinze ans […] ne s’arrêtant que devant les cadavres de femmes. Ils appuyaient leurs mains aux vitres et promenaient des regards effrontés sur les poitrines nues. […] ils apprenaient le vice à l’école de la mort. C’est à la Morgue que les jeunes voyous ont leur première maîtresse. » (belle idée de sortie pédagogique !) Le chapitre scandaleux est d’ailleurs d’autant plus justifiée que Laurent a appris la peinture, et que les nudités le choquent moins que le commun des mortels, dont on constate qu’il est plutôt attiré par ce spectacle, à l’instar des amateurs d’exécutions. On sait que les peintres, à l’instar de Géricault pour Le Radeau de la Méduse, étudiaient comme les médecins les cadavres dans les morgues, voire en ramenaient des morceaux à l’atelier…
Chapitre XIV. Thérèse a besoin de trois jours pour se relever, mais la mère est plus atteinte : « Le soir, elle consentit à se lever, à essayer de manger. Thérèse put alors voir quel terrible coup avait reçu sa tante. Les jambes de la pauvre vieille s’étaient alourdies. Il lui fallut une canne pour se traîner dans la salle à manger ». Cependant, elle tient à rouvrir boutique : « Elle craignait de devenir folle en restant seule dans sa chambre. Elle descendit pesamment l’escalier de bois, en posant les deux pieds sur chaque marche, et vint s’asseoir derrière le comptoir. À partir de ce jour, elle y resta clouée dans une douleur sereine. »
Chapitre XV. Laurent reprend ses visites quotidiennes, bientôt suivi des habitués du jeudi, ennuyés par le deuil de la mère : « Ces gens se trouvèrent gênés, n’ayant plus dans le cœur le moindre souvenir vivant de Camille. » Heureusement, entre les deux amants, le fluide coule toujours : « Il fut heureux de rencontrer ses regards et de les voir s’arrêter sur les siens avec une fixité courageuse. Thérèse lui appartenait toujours, chair et cœur. » On est d’ailleurs étonné de constater que rien dans son roman ne justifie la défense de Zola dans sa lettre à Sainte-Beuve (« Lorsqu’ils tuent, ils sont déjà presque dégoûtés l’un de l’autre. Leur crime est une fatalité à laquelle ils ne peuvent échapper. ») Et l’illustre critique avait bien raison de s’étonner qu’il n’y ait aucun coït après le meurtre (mais cela aurait encore plus scandalisé les autres critiques : Ô Charybde, Ô Scylla !)
Chapitre XVI. Voici la justification étonnante de leur refroidissement : « Les deux amants ne cherchèrent plus à se voir en particulier. Jamais ils ne se demandèrent un rendez-vous, jamais ils n’échangèrent furtivement un baiser. Le meurtre avait comme apaisé pour un moment les fièvres voluptueuses de leur chair ; ils étaient parvenus à contenter, en tuant Camille, ces désirs fougueux et insatiables qu’ils n’avaient pu assouvir en se brisant dans les bras l’un de l’autre. Le crime leur semblait une jouissance aiguë qui les écœurait et les dégoûtait de leurs embrassements. » Côté Thérèse, « Elle ne pensait à Laurent que lorsqu’un cauchemar l’éveillait en sursaut ; alors, assise sur son séant, tremblante, les yeux agrandis, se serrant dans sa chemise, elle se disait qu’elle n’éprouverait pas ces peurs brusques, si elle avait un homme couché à côté d’elle. Elle songeait à son amant comme à un chien qui l’eût gardée et protégée ; sa peau fraîche et calme n’avait pas un frisson de désir. » Comme un clin d’œil à Flaubert, c’est après, et non avant l’adultère, que Thérèse se met à lire, ce qui a un drôle d’effet : « Elle s’abonna à un cabinet littéraire et se passionna pour tous les héros des contes qui lui passèrent sous les yeux. Ce subit amour de la lecture eut une grande influence sur son tempérament. […] Les romans, en lui parlant de chasteté et d’honneur, mirent comme un obstacle entre ses instincts et sa volonté. Elle resta la bête indomptable qui voulait lutter avec la Seine et qui s’était jetée violemment dans l’adultère ; mais elle eut conscience de la bonté et de la douceur, elle comprit le visage mou et l’attitude morte de la femme d’Olivier, elle sut qu’on pouvait ne pas tuer son mari et être heureuse. » Laurent est dans un état d’hébétude : « Sa chair semblait morte, il ne songeait guère à Thérèse. Il pensait parfois à elle, comme on pense à une femme qu’on doit épouser plus tard, dans un avenir indéterminé. Il attendait l’heure de son mariage avec patience, oubliant la femme, rêvant à la nouvelle position qu’il aurait alors. Il quitterait son bureau, il peindrait en amateur, il flânerait. » Il prend pour maîtresse un modèle rencontré dans l’atelier d’un ami peintre : « Pendant près d’un an, il la garda pour maîtresse. La pauvre fille s’était mise à l’aimer, le trouvant bel homme. Le matin, elle partait, allait poser tout le jour, et revenait régulièrement chaque soir à la même heure ; elle se nourrissait, s’habillait, s’entretenait avec l’argent qu’elle gagnait, ne coûtant ainsi pas un sou à Laurent, qui ne s’inquiétait nullement d’où elle venait ni de ce qu’elle avait pu faire. Cette femme mit un équilibre de plus dans sa vie ; il l’accepta comme un objet utile et nécessaire qui maintient son corps en paix et en santé ; il ne sut jamais s’il l’aimait et jamais il ne lui vint à la pensée qu’il était infidèle à Thérèse. Il se sentait plus gras et plus heureux. Voilà tout. » Quand « le deuil de Thérèse était fini » […] « Laurent pensa à ne pas se marier du tout, à planter là Thérèse, et à garder le modèle, dont l’amour complaisant et à bon marché lui suffisait. » Mais il est attiré par Thérèse, et lui propose de la retrouver dans sa chambre. Elle réplique : « — Marions-nous, je serai à toi. »
Chapitre XVII. Laurent fait des cauchemars : « Le cadavre lui tendait les bras, avec un rire ignoble, en montrant un bout de langue noirâtre dans la blancheur des dents. » Le jour n’est pas plus clément, car la cicatrice obsède le meurtrier : « Laurent, en distinguant la marque des dents de sa victime, éprouva une certaine émotion, le sang lui monta à la tête, et il s’aperçut alors d’un étrange phénomène. La cicatrice fut empourprée par le flot qui montait, elle devint vive et sanglante, elle se détacha, toute rouge, sur le cou gras et blanc. »
Chapitre XVIII. Zola fait de la psychologie ad hoc, évoque un « détraquement nerveux », « une parenté de sang et de volupté » : « Cette communauté, cette pénétration mutuelle est un fait de psychologie et de physiologie qui a souvent lieu chez les êtres que de grandes secousses nerveuses heurtent violemment l’un à l’autre. » Soit ! Les deux complices « arrêtèrent un plan fort sage qui consistait à se faire offrir ce qu’ils n’osaient demander, par Mme Raquin elle-même et par les invités du jeudi. » Non que Camille aime toujours Thérèse, mais « il avait cherché à assurer, par un assassinat, le calme et l’oisiveté de sa vie, le contentement durable de ses appétits ».
Chapitre XIX. Le plan est mis à exécution : « la jeune femme joua son rôle de veuve inconsolée avec une habileté exquise » […] « avec cette hypocrisie parfaite que son éducation lui avait donnée ». Consulté par la mère, Michaud conclut : « Elle a besoin d’un mari ; cela se voit dans ses yeux. » De son côté, « Laurent avait pris le rôle d’homme sensible et serviable. » […] « lui seul mettait un peu de gaieté au fond de ce trou noir. » […] « lui seul se souvenait de son fils, lui seul en parlait encore d’une voix tremblante et émue. » Quand on finit par leur demander leur avis, ils prétendent s’aimer « comme une sœur » ; « comme un frère ». Laurent ne recule devant aucune infamie : « Lorsque Camille est tombé à l’eau, il m’a crié : « Sauve ma femme, je te la confie. » Je crois accomplir ses derniers vœux en épousant Thérèse. » Son père n’est pas très chaud, mais peu leur chaut : « Le vieux paysan de Jeufosse, qui avait presque oublié qu’il eût un fils à Paris, lui répondit, en quatre lignes, qu’il pouvait se marier et se faire pendre, s’il voulait ». Pas folle ni balzacienne, la vieille Raquin met tout son grisbi au nom de Thérèse, comptant se faire dorloter en échange.
Chapitre XX. La cérémonie a lieu, mais « Quand ils remontèrent en voiture, il leur sembla qu’ils étaient plus étrangers l’un à l’autre qu’auparavant. » Pendant le repas, « un abîme les séparait ». Bel éloge du mariage !
Chapitre XXI. Voici le moment de la nuit nuptiale. Laurent veut jouer son rôle : « Il semblait hésiter. Puis il aperçut le bout d’épaule, et il se baissa en frémissant pour coller ses lèvres à ce morceau de peau nue. La jeune femme retira son épaule en se retournant brusquement. Elle fixa sur Laurent un regard si étrange de répugnance et d’effroi, qu’il recula, troublé et mal à l’aise, comme pris lui-même de terreur et de dégoût. » La scène oscille entre réalisme et fantastique : « Ils se regardaient sans désir, avec un embarras peureux, souffrant de rester ainsi silencieux et froids. Leurs rêves brûlants aboutissaient à une étrange réalité : il suffisait qu’il eussent réussi à tuer Camille et à se marier ensemble, il suffisait que la bouche de Laurent eût effleuré l’épaule de Thérèse, pour que leur luxure fût contentée jusqu’à l’écœurement et à l’épouvante. » […] « Le spectre de Camille évoqué venait de s’asseoir entre les nouveaux époux, en face du feu qui flambait. » Thérèse découvre la blessure au cou de Laurent, et celui-ci « désirait que Thérèse le baisât sur la cicatrice, il comptait que le baiser de cette femme apaiserait les mille piqûres qui lui déchiraient la chair. » Mais elle refuse. « Tous deux s’avouaient avec terreur que leur passion était morte, qu’ils avaient tué leurs désirs en tuant Camille ». Laurent croit voir « Camille dans un coin plein d’ombre, entre la cheminée et l’armoire à glace. La face de sa victime était verdâtre et convulsionnée, telle qu’il l’avait aperçue sur une dalle de la Morgue. », mais il s’agit en fait du portrait. Puis c’est le chat qui l’effraie : « Camille est entré dans ce chat, pensa-t-il. Il faudra que je tue cette bête… » Ils ne parviennent pas à dormir, et Laurent conclut : « je ne me suis pas marié pour passer des nuits blanches… »
Chapitres XXII à XXXII : du mariage au suicide
Chapitre XXII. Hélas, « Les nuits suivantes furent encore plus cruelles ». Laurent et Thérèse éprouvent des sentiments que Zola cerne en trois mots : « Ses remords étaient purement physiques. Son corps, ses nerfs irrités et sa chair tremblante avaient seuls peur du noyé. » […] « elle se montrait plus femme que son nouveau mari ; elle avait de vagues remords, des regrets inavoués ; il lui prenait des envies de se jeter à genoux et d’implorer le spectre de Camille, de lui demander grâce en lui jurant de l’apaiser par son repentir. » Remords, regrets, repentirs : voilà l’affaire ! « Les premières nuits, ils ne purent se coucher. » Progressivement, ils tâchent de faire couple sans se toucher, mais « Il y avait entre eux une large place. Là couchait le cadavre de Camille. Lorsque les deux meurtriers étaient allongés sous le même drap, et qu’ils fermaient les yeux, ils croyaient sentir le corps de leur victime, couché au milieu du lit, qui leur glaçait la chair. » Manifestation fantastique du ménage à trois du début, qui jette un sacré trouple dans le mariage : « Il l’avait jeté à l’eau, et voilà qu’il n’était pas assez mort, qu’il revenait toutes les nuits se coucher dans le lit de Thérèse. Lorsque les meurtriers croyaient avoir achevé l’assassinat et pouvoir se livrer en paix aux douceurs de leurs tendresses, leur victime ressuscitait pour glacer leur couche. Thérèse n’était pas veuve, Laurent se trouvait être l’époux d’une femme qui avait déjà pour mari un noyé. »
Chapitre XXIII. Zola provoque la critique par une scène d’amour furieux : « Thérèse chercha des lèvres la morsure de Camille sur le cou gonflé et roidi de Laurent, et elle y colla sa bouche avec emportement. Là était la plaie vive ; cette blessure guérie, les meurtriers dormiraient en paix. La jeune femme comprenait cela, elle tentait de cautériser le mal sous le feu de ses caresses. Mais elle se brûla les lèvres, et Laurent la repoussa violemment, en jetant une plainte sourde ; il lui semblait qu’on lui appliquait un fer rouge sur le cou. Thérèse, affolée, revint, voulut baiser encore la cicatrice ; elle éprouvait une volupté âcre à poser sa bouche sur cette peau où s’étaient enfoncées les dents de Camille. Un instant, elle eut la pensée de mordre son mari à cet endroit, d’arracher un large morceau de chair, de faire une nouvelle blessure, plus profonde, qui emporterait les marques de l’ancienne. » C’est l’échec : « il leur sembla entendre les rires de triomphe du noyé, qui se glissait de nouveau sous le drap avec des ricanements. Ils n’avaient pu le chasser du lit ; ils étaient vaincus. Camille s’étendit doucement entre eux »
Chapitre XXIV. Les époux cherchent à échapper à leur trouble par le divertissement des soirées, que ce soit avec la mère, ou avec les habitués du jeudi : « Pendant la journée, lorsqu’ils ne se trouvaient pas face à face, ils goûtaient des heures délicieuses de repos ; le soir, dès qu’ils étaient réunis, un malaise poignant les envahissait. » Un événement survient : « La paralysie gagnait peu à peu Mme Raquin, et ils prévirent le jour où elle serait clouée dans son fauteuil, impotente et hébétée. […] Thérèse et Laurent voyaient avec effroi s’en aller cet être qui les séparait encore et dont la voix les tirait de leurs mauvais rêves. […] ils se trouveraient seuls ; le soir, ils ne pourraient plus échapper à un tête-à-tête redoutable. Alors leur épouvante commencerait à six heures, au lieu de commencer à minuit ; ils en deviendraient fous. » À nouveau les témoins du couple se trompent sur toute la ligne : « Thérèse et Laurent furent donnés comme un ménage modèle. »
Chapitre XXV. Dégoûté des joies physiques du mariage, Camille songe à jouir de la vie, or « la vieille mercière, conseillée par Michaud, avait eu la prudence de sauvegarder dans le contrat les intérêts de sa nièce. Laurent se trouvait ainsi attaché à Thérèse par un lien puissant. » On apprécie l’ironie zolienne ! La situation est résumée en une phrase-choc : « À ce prix seul, il consentait à coucher avec le cadavre du noyé. » Laurent démissionne de son emploi de commis, et annonce qu’il va louer un atelier pour se remettre à la peinture, mais Thérèse s’inquiète qu’il veuille la dépouiller. La vieille intercède, et on convient d’un arrangement permettant de vivre de la boutique sans toucher au capital : « Laurent ne pouvait s’emparer des quarante mille francs sans avoir sa signature, et elle se promettait bien de ne signer aucun papier. » Laurent interdit à Thérèse l’entrée de son atelier (où il paresse longuement plutôt que de peindre) : « Il craignait que Thérèse n’introduisît avec elle le spectre de Camille. » S’étant enfin mis à dessiner sans modèle, il rencontre son ancien ami peintre à qui il fait voir son atelier. Celui-ci s’étonne du changement physique de son camarade, mais encore plus de la qualité des « esquisses qui me serviront pour un grand tableau que je prépare. » Zola nous sert alors un délire très fin de siècle sur le génie, qu’il faut citer en entier : « Il ne pouvait deviner l’effroyable secousse qui avait changé cet homme, en développant en lui des nerfs de femme, des sensations aiguës et délicates. Sans doute un phénomène étrange s’était accompli dans l’organisme du meurtrier de Camille. Il est difficile à l’analyse de pénétrer à de telles profondeurs. Laurent était peut-être devenu artiste comme il était devenu peureux, à la suite du grand détraquement qui avait bouleversé sa chair et son esprit. Auparavant, il étouffait sous le poids lourd de son sang, il restait aveuglé par l’épaisse vapeur de santé qui l’entourait ; maintenant, maigri, frissonnant, il avait la verve inquiète, les sensations vives et poignantes des tempéraments nerveux. Dans la vie de terreur qu’il menait, sa pensée délirait et montait jusqu’à l’extase du génie ; la maladie en quelque sorte morale, la névrose dont tout son être était secoué, développait en lui un sens artistique d’une lucidité étrange ; depuis qu’il avait tué, sa chair s’était comme allégée, son cerveau éperdu lui semblait immense, et, dans ce brusque agrandissement de sa pensée, il voyait passer des créations exquises, des rêveries de poëte. » Cependant l’ami fait remarquer à Camille que les visages de ses portraits se ressemblent trop, et celui-ci comprend « qu’il avait trop regardé Camille à la Morgue. L’image du cadavre s’était gravée profondément en lui. Maintenant, sa main, sans qu’il en eût conscience, traçait toujours les lignes de ce visage atroce dont le souvenir le suivait partout. » Dans une crise à la Claude Lantier, « Il finit par dessiner des animaux, des chiens et des chats ; les chiens et les chats ressemblaient vaguement à Camille. » […] « Il creva la toile d’un coup de poing, en songeant avec désespoir à son grand tableau. » Conclusion : « Ainsi il n’oserait plus travailler, il redouterait toujours de ressusciter sa victime au moindre coup de pinceau. […] Il lui semblait que cette main ne lui appartenait plus. » Ces phrases annoncent le chapitre IX de L’Œuvre, quand Claude crève la toile de son grand œuvre.
Chapitre XXVI. La paralysie de la mère s’aggrave brusquement : « ils n’avaient plus qu’un cadavre devant eux, un cadavre vivant à moitié qui les voyait et les entendait, mais qui ne pouvait leur parler. » Dans les premiers temps, les époux sont aux petits soins pour l’impotente, ainsi que les habitués du jeudi, car cela leur fait toujours une compagnie. Mais insensiblement, « ils laissaient échapper malgré eux des aveux, des phrases qui finirent par tout révéler à Mme Raquin. […] Brusquement, la paralytique comprit. » On retombe dans le roman gothique ; la vieille ne peut s’exprimer autrement que par le regard : « Ses sensations ressemblaient à celles d’un homme tombé en léthargie qu’on enterrerait et qui, bâillonné par les liens de sa chair, entendrait sur sa tête le bruit sourd des pelletées de sable. » On glisse des petits soins à la maltraitance : « Et il la jeta brutalement sur le lit. L’impotente y tomba évanouie. Sa dernière pensée avait été une pensée de terreur et de dégoût. Désormais, il lui faudrait, matin et soir, subir l’étreinte immonde des bras de Laurent. »
Chapitre XXVII. Zola nous amuse : la vieille paralytique accomplit un suprême effort, lors d’un jeudi, pour accuser les meurtrier, mais ayant gaspillé de l’énergie pour attirer l’attention sur sa main, elle ne parvient qu’à commencer à écrire une phrase sur la toile cirée, que l’un des convives a tôt fait de terminer à la gloire de ses hôtes : « Thérèse et Laurent ont bien soin de moi. »
Chapitre XXVIII. La « haine atroce » s’installe entre les époux meurtriers, haine dont ils prennent à témoin la mère paralytique : « ils imposaient à Mme Raquin des souffrances indicibles, parce qu’ils avaient besoin de sa présence pour se protéger contre leurs hallucinations. » Ils tentent de rejeter la responsabilité sur l’autre : « Écoute, lui dit-il d’une voix qu’il s’efforçait de rendre calme, il y a de la lâcheté à refuser ta part du crime. Tu sais parfaitement que nous l’avons commis ensemble, tu sais que tu es aussi coupable que moi. »
Chapitre XXIX. Thérèse joue une « comédie du remords » : « La paralytique lui devint d’un usage journalier ; elle lui servait en quelque sorte de prie-Dieu, de meuble devant lequel elle pouvait sans crainte avouer ses fautes et en demander le pardon. » […] « Elle était obligée de subir les caresses immondes de la misérable qui avait trahi et tué son fils ; elle ne pouvait même essuyer de la main les baisers que cette femme laissait sur ses joues. » La haine utilise tous les détours : « Thérèse finissait toujours par faire le panégyrique de Camille ». Zola nous donne à nous les hommes la recette pour combler une dame : « Et Laurent, fouetté par ces paroles, la secouait avec rage, la battait, meurtrissait son corps de son poing fermé. À deux reprises, il faillit l’étrangler. Thérèse mollissait sous les coups ; elle goûtait une volupté âpre à être frappée ; elle s’abandonnait, elle s’offrait, elle provoquait son mari pour qu’il l’assommât davantage. C’était encore là un remède contre les souffrances de sa vie ; elle dormait mieux la nuit, quand elle avait été bien battue le soir. » Comme dirait l’autre, « Fais-moi mal Johnny » !
Chapitre XXX. La mère tente la grève de la faim, mais comme Thérèse veut la nourrir de force tandis que Laurent veut la laisser mourir, elle change d’avis : « Elle se dit qu’elle était lâche de mourir, qu’elle n’avait pas le droit de s’en aller avant d’avoir assisté au dénouement de la sinistre aventure. » La boutique périclite, Thérèse « mit en fuite les clientes » ; d’ailleurs, « Parfois, Thérèse sortait pendant des après-midi entières. Personne ne savait où elle allait. » Quand elle se trouve enceinte, « Elle ne dit rien à son mari, et, un jour, après l’avoir cruellement provoqué, comme il levait le pied contre elle, elle présenta le ventre. Elle se laissa frapper ainsi à en mourir. Le lendemain, elle faisait une fausse couche. » La vie rêvée de Laurent ne la satisfait pas : « La paresse, cette existence de brute qu’il avait rêvée, était son châtiment. […] À la vérité, il ne goûtait quelque soulagement que lorsqu’il battait Thérèse, le soir. Cela le faisait sortir de sa douleur engourdie. » Thérèse n’a que la ressource d’utiliser la terreur de Laurent à propos de sa cicatrice : « Toute la vengeance qu’elle tirait de ses brutalités, était de le martyriser à l’aide de cette morsure. » Laurent finit par tuer le chat dont il ne supporte plus le regard accusateur.
Chapitre XXXI. Laurent s’imagine que Thérèse veut les dénoncer à la police, et il la suit lors de ses étranges sorties. Il découvre « qu’elle s’habillait comme une fille, avec une robe à longue traîne ; elle se dandinait sur le trottoir d’une façon provocante, regardant les hommes ». Il la voit monter avec un homme, mais n’en est pas jaloux : « Comme ça, elle a une occupation, elle ne songe pas à mal… » […] « Ce qui l’étonnait, c’était de ne pas avoir eu le premier l’idée de se jeter dans le vice. Il pouvait y trouver un remède contre la terreur. Il n’y avait pas pensé, parce que sa chair était morte ». Pour se livrer au vice, Laurent exige 5000 francs sur la dot de Thérèse, et doit la menacer de se dénoncer à la police pour les obtenir. Détail amusant, lors de leur énième dispute, alors que Zola nous en a fait voir des vertes et des pas mûres, le narrateur éprouve une étrange pudeur devant une insulte : « Monsieur ne fait rien, monsieur s’est arrangé de façon à vivre à mes dépens, les bras croisés… Non, tu n’auras rien, pas un sou… Veux-tu que je te le dise, eh bien ! tu es un… Et elle dit le mot. Laurent se mit à rire en haussant les épaules. Il se contenta de répondre : — Tu apprends de jolis mots dans le monde où tu vis maintenant. Ce fut la seule allusion qu’il se permit de faire aux amours de Thérèse. Celle-ci redressa vivement la tête et dit d’un ton aigre : — En tout cas, je ne vis pas avec des assassins. » La tentative de débauche de Laurent, qui aurait pu nous valoir un chapitre de pur Zola, est évacuée en un paragraphe : « Dès que Laurent eut de l’or dans ses poches, il se grisa, fréquenta les filles, se traîna au milieu d’une vie bruyante et affolée. Il découchait, dormait le jour, courait la nuit, recherchait les émotions fortes, tâchait d’échapper au réel. Mais il ne réussit qu’à s’affaisser davantage. Lorsqu’on criait autour de lui, il entendait le grand silence terrible qui était en lui ; lorsqu’une maîtresse l’embrassait, lorsqu’il vidait son verre, il ne trouvait au fond de l’assouvissement qu’une tristesse lourde. Il n’était plus fait pour la luxure et la gloutonnerie ; son être, refroidi, comme rigide à l’intérieur, s’énervait sous les baisers et dans les repas. Écœuré à l’avance, il ne parvenait point à se monter l’imagination, à exciter ses sens et son estomac. Il souffrait un peu plus en se forçant à la débauche, et c’était tout. Puis, quand il rentrait, quand il revoyait Mme Raquin et Thérèse, sa lassitude le livrait à des crises affreuses de terreur ; il jurait alors de ne plus sortir, de rester dans sa souffrance pour s’y habituer et la vaincre. » Les deux amants en arrivent à la même conclusion logique en même temps : « Laurent décida qu’il tuerait Thérèse, parce que Thérèse le gênait, qu’elle pouvait le perdre d’un mot et qu’elle lui causait des souffrances insupportables ; Thérèse décida qu’elle tuerait Laurent, pour les mêmes raisons. »
Chapitre XXXII. Le dénouement attendu par la mère sinon par le lecteur, arrive après une banale soirée de jeudi, dont les habitués sont toujours aussi naïfs : « ils étaient convaincus que le ménage de leurs hôtes était un ménage modèle, tout de douceur et d’amour. » Ils ne peuvent pas savoir que les amants ont par un hasard extraordinaire, décidé d’en finir avec leur conjoint le même soir. Mais l’un et l’autre se surprennent réciproquement, qui versant le poison, qui préparant la lame affilée. Et c’est le finale extraordinaire, parodie d’Hernani de Victor Hugo, où les amants séparés partagent la même fiole de poison, pour une mort tout sauf exemplaire.
– Les adaptations au cinéma sont nombreuses, et vous en trouverez une liste dans l’article de Wikipédia. Moins connu, il existe aussi un opéra éponyme de Tobias Picker (2001), et une comédie musicale américaine, Thou Shalt Not de David Thompson et Harry Connick Jr. Mais je trouve que la scène du meurtre déguisé en accident sur un lac et de ses suites, même si la passion n’est pas l’amour mais l’arrivisme, a un rapport avec les adaptations du roman de Theodore Dreiser, Une tragédie américaine, surtout le film éponyme de Sternberg, ainsi que Une place au soleil de George Stevens, dans lequel le crime raté aboutit à une vraie noyade accidentelle, mais le résultat est le même. Il a été dit que Match Point de Woody Allen s’inspirait de ces films. Pour le motif de la paralytique martyrisée, Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? (1962), de Robert Aldrich, fournira quelques points de comparaison.
Voir en ligne : Thérèse Raquin sur Wikisource
© altersexualite.com, 2017.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com