Accueil > Zola pour les nuls > Au Bonheur des Dames, d’Émile Zola
Ma petite entreprise, à partir de la 3e
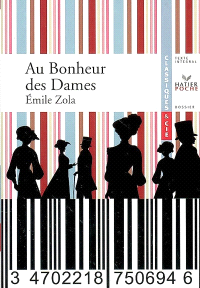 Au Bonheur des Dames, d’Émile Zola
Au Bonheur des Dames, d’Émile Zola
La Pléiade, 1883 (édition de 1964).
mercredi 1er février 2017
J’ai utilisé l’édition Pléiade d’Henri Mitterand (1964), complétée par une édition scolaire Hatier « Classiques & Cie » d’Anna Cassou-Noguès (2011). Cette édition scolaire a un petit défaut pour un des romans les plus longs de Zola : les notes de vocabulaire en bas de page sont répétitives, là où un glossaire aurait été plus adapté (et aurait économisé du papier). Par exemple, « phalanstère » est expliqué en note aux pages 162 et 324, là où une seule définition dans un lexique aurait suffi, car l’élève qui retrouve le même mot dix pages plus loin à sa 3e occurrence, ne sait plus où chercher la définition… Sinon, le dossier est relativement correct. Au Bonheur des Dames est à la fois le moins intéressant des Rougon-Macquart que j’ai lus jusqu’à présent, et le plus intéressant au second degré. Tout l’aspect documentaire sur le grand magasin est impeccable, sauf que Zola noircit le tableau du petit commerce pour défendre son point de vue. Or les grands magasins n’ont pas tué le petit commerce sous le Second Empire, mais après, comme l’explique le dossier Pléiade. Ce qui ne marche pas, c’est l’histoire à l’eau de rose entre la petite vendeuse et le chef d’entreprise, où Zola a voulu prendre un virage à 180 degrés par rapport à ses histoires d’amour déprimantes des volumes précédents. Et puis pour les esthètes, les étalages de tissus du Bonheur ne peuvent rivaliser avec les peintures flamandes du Ventre de Paris. Or si l’on prend le Bonheur des Dames comme une allégorie de l’entreprise littéraire, on comprend que ce livre est une gigantesque mise en abyme de l’œuvre zolienne, du grand magasin que Zola construit et agrandit pierre à pierre en faisant de l’ombre aux romanciers à la pièce. Enfin, cette modeste Denise qui fait chuter le grand homme, Zola ne sait pas encore que c’est la lingère de province dont il va tomber amoureux six ans plus tard.
– aller à la fin de l’article
– chapitre I
– chapitre VII
– chapitre XIV
Genèse
Ce livre complète le diptyque entamé avec Pot-Bouille, où a été disons formaté le personnage d’Octave Mouret, sauf que si Pot-Bouille a été improvisé, Au Bonheur des Dames faisait partie depuis 1868 du projet initial consigné sur la fameuse liste de dix romans. Le manche de la plume qui a écrit Pot-Bouille était encore tiède quand Zola le reprend en main pour se mettre au Bonheur, dont le manuscrit est précisément daté « Commencé le dimanche de la Pentecôte, 28 mai 1882 ; Fini le jeudi 25 janvier 1883 ». Avant d’être terminé, le roman commence à paraître en 75 livraisons dans le nouveau quotidien Gil Blas, du 17 décembre 1882 au 1er mars 1883. Il sort en librairie dès le lendemain, tiré à 60 000 exemplaires. Selon Mitterand, la prospérité de la maison Mouret est une fiction qui synthétise de façon harmonieuse un demi-siècle chaotique de progrès du grand commerce parisien. Zola a commencé par relire les deux romans de son maître Honoré de Balzac qui traitent du commerce, La Maison du chat-qui-pelote (1830) et Grandeur et décadence de César Birotteau (1837). Si Pot-Bouille fut marqué par l’hypocondrie de Zola en cette année où il perdit beaucoup de ses proches, au contraire, le titre du nouvel opus révèle une volonté – comme dirait François Hollande – d’inverser la courbe. Lyrisme & poésie seront donc de la partie. La réalité est dramatisée, car en fait, le développement des grands magasins n’a pas entravé le petit commerce, du moins au début, dans la période envisagée par Zola. Trois articles parus récemment ont été annotés par Zola dans son dossier (dont l’intégralité a été conservé dans les archives, fait rare qui nous permet de suivre pas à pas la démarche de Zola au travail). Un article du Figaro du 23 mars 1881 proposait une analyse sociologique de la mutation du commerce : « Au contraire, la petite boutique serrait le marchand contre la marchande. La triade fondamentale de la société : l’homme trois, c’est-à-dire le trio composé de l’homme, la femme et l’enfant, n’est pas détruit par le grand bazar, mais à coup sûr il y est fort mal à l’aise… Certes, l’employé et l’employée peuvent être mariés — quelques-uns le sont. Mais, en dehors du dimanche, où est la vie commune ? ». Un article de Gil Blas du 21 novembre 1881 évoque la figure du « calicot » : « Le calicot d’aujourd’hui, c’est un engagé volontaire dans cette grande armée du négoce et de la spéculation modernes où l’on peut conquérir tous les grades à la pointe de son activité, de son intelligence, de son audace… ». Enfin le même journal publiait le 16 janvier 1882 un article signé Colombine sur « les demoiselles de magasin » rapportant une anecdote sur « un richissime chef de maison, qui voulait se marier et autour duquel papillonnaient les plus beaux partis de la finance et du commerce parisiens. Un beau jour, il se décida. Pour qui ? Pour une de ses premières. ».
Dans son ébauche, Zola expose explicitement son projet : « Je veux dans Au Bonheur des Dames faire le poème de l’activité moderne. Donc, changement complet de philosophie : plus de pessimisme d’abord, ne pas conclure à la bêtise et à la mélancolie de la vie, conclure au contraire à son continuel labeur, à la puissance et à la gaieté de son enfantement. En un mot, aller avec le siècle, exprimer le siècle qui est un siècle d’action et de conquête, d’efforts dans tous les sens. Ensuite, comme conséquence, montrer la joie de l’action et le plaisir de l’existence ; il y a certainement des gens heureux de vivre, dont les jouissances ne ratent pas et qui se gorgent de bonheur et de succès : ce sont ces gens-là que je veux peindre, pour avoir l’autre face de la vérité, et pour être ainsi complet ; car Pot-Bouille et les autres suffisent pour montrer les médiocrités et les avortements de l’existence ». Il reprend cependant son Octave tel qu’il l’a laissé dans Pot-Bouille : « Mais lui laisser surtout son côté femme, sa science de la femme, qui l’a poussé à spéculer sur la coquetterie de la femme. » Le roman sera avant tout un hymne à la femme, et Zola veille à l’équilibre de l’ensemble des Rougon-Macquart : « Là apparaît le côté poème du livre : une vaste entreprise sur la femme ; il faut que la femme soit reine dans le magasin, qu’elle s’y rende comme dans un temple élevé à sa gloire, pour sa jouissance et pour son triomphe. La toute-puissance de la femme, l’odeur de la femme domine tout le magasin. — Et l’idée commerciale d’Octave est là, plus ou moins consciente et affichée. Pourtant, je ne voudrais pas d’épisodes trop sensuels. Éviter les scènes trop vives qui finiraient par me spécialiser. Certes, laisser le grouillement féminin nécessaire ; mais choisir comme élément de passion central une figure d’honnêteté, luttant. » On voit très bien comment, selon le mot de Maupassant dans la préface de Pierre et Jean, Zola entend « nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même » : « Comme intrigue d’argent, j’ai mon idée première d’un grand magasin absorbant, écrasant tout le petit commerce d’un quartier. Je prendrai les parents de Mme Hédouin, un mercier, une lingère, un bonnetier, et je les montrerai ruinés, conduits à la faillite. Mais je ne pleurerai pas sur eux, au contraire : car je veux montrer le triomphe de l’activité moderne ; ils ne sont plus de leur temps, tant pis ! ils sont écrasés par le colosse. Trouver une figure grande d’homme ou plutôt de femme, dans lequel je personnifierai le petit commerce agonisant. Une boutique qui ira en agonisant, absorbée par le grand magasin ; même je puis mettre cette boutique dans le pâté de maisons et la faire absorber ; ce qui donnerait le drame d’un immeuble longtemps convoité et enfin conquis : une histoire de bail, qui m’est absolument nécessaire, dans le développement de mon colosse. On pourrait peut-être, dans ce cas mettre un lien (?) entre cette boutique et ma demoiselle de magasin. »
Quand il établit la liste des personnages, Zola évoque des clientes, mais au lieu d’en profiter pour faire passer des personnages des autres volumes, comme aurait fait Balzac, il veut des anonymes : « Je ne les montrerai qu’au magasin, de tout âge, avec des enfants, et je ne les montrerai jamais au dehors, je laisserai leur vie ignorée : ce qui est la vérité du moment où mon point de centre est dans le magasin. On pourra deviner leur vie, faire des conjectures, etc. ». L’idée précise du roman fait son chemin : « Le double mouvement : Octave faisant sa fortune par les femmes, exploitant la femme, spéculant sur sa coquetterie, et à la fin, quand il triomphe, se trouvant lui-même conquis par une femme, qui n’y a mis aucun calcul, qui l’a conquis par sa force de femme » […] « Je lui donne une parenté avec la boutique rivale, pour serrer l’action » […] « Mais surtout ne pas en faire une rouée, une femme à calcul ; il ne faut pas qu’elle travaille à son mariage avec Octave, que ce mariage soit une conséquence et non un but » […] « Octave au-dessus, l’a vue une fois, et lui a fichu un galop, puis comme elle pleure a paru étonné ».
Zola est aidé dans son travail par divers informateurs, soit de son réseau amical, soit des personnes qu’il a contactées au cours de ses visites notamment des magasins Louvre & Le Bon marché ; jusqu’à sa femme Alexandrine, sollicitée en tant que cliente, pour compiler d’anciens catalogues ! « Pour aucun de ses romans antérieurs, Zola n’avait bénéficié d’une collaboration aussi diverse, aussi dévouée, et aussi bien informée ». Son avoué Émile Collet par exemple, lui fournit des idées pour la faillite de Bourras (lettre citée en notes La Pléiade, p. 1724, à voir sur le site de la BNF). Une note de la p. 707 de la Pléiade cite même une lettre de Léon Carbonnaux à Zola du 19 juin 1882, où il lui dit : « On sait que le Figaro est inféodé au Louvre et on peut assurer que ce livre a été commandé et bâclé dès que votre intention de traiter le même sujet a été connue ». Il faudra donc vérifier, pour les volumes suivants, si Zola a la sagesse de passer sous silence ses sujets, ou s’il les rend publics. De ce fait, le roman est le plus long depuis le début de la série. Selon H. Mitterand, le génie de Zola transcende la masse documentaire lors de la phase d’écriture : « À ce stade — mais à ce stade seulement — la charge métaphorique du vocabulaire de Zola atteint son paroxysme. C’est le moment où l’écrivain se sent à la fois assez pénétré et assez libéré de ses « documents » pour les dévouer à son intuition primitive retrouvée — celle même qui affleurait sous les premières lignes de l’Ébauche —, et en faire les matériaux d’un langage ambigu, imposant au lecteur l’illusion de la réalité vécue en même temps qu’il lui en propose une interprétation symbolique ». Bien qu’il ait « cessé toute collaboration aux journaux », Zola « n’avait pas changé pour autant son rythme de composition » : « Je travaille trois heures et demie tous les matins, posément ». Cela « le défendait contre les crises d’incertitude ». Même la visite de Cézanne ne l’interrompt pas : « Mon roman marche bien, du moins je n’ai pas perdu un jour et j’arriverai à la date que je me suis fixée » ! Pour une fois, vu l’optimisme du ton, « la critique se montrait agréablement surprise, et rassurée, par une œuvre où la mise à nu lucide des tares et des contradictions de la société contemporaine se trouvait désamorcée par l’ingénuité de l’intrigue et de la philosophie ». Voici l’appréciation de Louis Desprez (lettre du 4 mars 1883) : « On vous a reproché, non sans raison parfois, de donner trop de relief aux laideurs ; je trouve aujourd’hui votre Denise trop idéale, trop lumineuse, je voudrais qu’elle eût, comme toute créature humaine, quelques ombres. Elle est, il me semble, plutôt née de la logique que de l’observation ; c’est une idée incarnée, bien plus qu’un type pris dans la rue ; et par suite, elle paraît vivre plutôt qu’elle ne vit. » La critique actuelle, au contraire, se montre réticente, à l’image d’un Henri Guillemin : « la fille sage et pauvre devient tout à coup la femme du patron — récompense de la vertu ; sa belle petite âme, éprise de bienfaisance, achèvera de décorer d’un badigeon paternaliste le capitalisme triomphant ». Armand Lanoux juge que « Les descriptions en mouvement du Bonheur des Dames, véritables travellings dans l’immense magasin, sont des exemples étonnants de la prémonition du cinéma ».
Chapitre I
Selon H. Mitterand, « l’action de Pot-Bouille s’étend entre octobre 1861 et novembre 1863 ; celle de Au Bonheur des Dames durera d’octobre 1864 à février 1869 ». Denise débarque sans prévenir de Valognes à la gare Saint-Lazare, avec ses deux frères, Pépé, 5 ans, et Jean, 16 ans, pour se faire embaucher dans la boutique de l’oncle Baudu, qui leur avait écrit une lettre engageante suite au « double deuil » de leur mère, puis de leur père. Dès les premières pages, Zola impose son titre à l’admiration du lecteur par une habile mise en abyme, car ce titre est aussi celui du magasin, inscrit en italique dans le texte : « — Au Bonheur des Dames, lut Jean avec son rire tendre de bel adolescent, qui avait eu déjà une histoire de femme à Valognes. Hein ? c’est gentil, c’est ça qui doit faire courir le monde ! » Ce procédé avait déjà été utilisé au début de Thérèse Raquin. Jean a un profil fréquent chez Zola : « Il avait la beauté d’une fille, une beauté qu’il semblait avoir volée à sa sœur, la peau éclatante, les cheveux roux et frisés, les lèvres et les yeux mouillés de tendresse. » L’oncle ne connaît même plus ses neveux : « il en était parti tout jeune, pour entrer comme petit commis chez le drapier Hauchecorne, dont il avait fini par épouser la fille. », motif connu, le même que dans « Une partie de campagne » (1881) de Guy de Maupassant : « C’était l’habitude patriarcale de la maison. Le fondateur Aristide Finet, avait donné sa fille Désirée à son premier commis Hauchecorne ; lui, Baudu, débarqué rue de la Michodière avec sept francs dans sa poche, avait épousé la fille du père Hauchecorne, Élisabeth : et il entendait à son tour céder sa fille Geneviève et la maison à Colomban, dès que les affaires reprendraient ». L’amour se soumet à l’intérêt : « La certitude de l’avoir l’empêchait de la désirer ». L’oncle n’a pas eu de chance dans sa descendance : « ils avaient dû élever cinq garçons, dont trois étaient morts à vingt ans ; le quatrième avait mal tourné, le cinquième venait de partir pour le Mexique, comme capitaine. Il ne leur restait que Geneviève ». Ces garçons seront d’ailleurs oubliés jusqu’à la fin du roman. Le motif du départ de Denise est tu : « Ce qu’elle taisait, c’était l’escapade amoureuse de Jean, des lettres écrites à une fillette noble de la ville, des baisers échangés par-dessus un mur, tout un scandale qui l’avait déterminée au départ ». Avant même d’entrer Au vieil Elbeuf, la boutique avunculaire, Denise subit la tentation du Bonheur des Dames dont elle admire la boutique : « Ce magasin, si vaste pour elle, où elle voyait entrer en une heure plus de monde qu’il n’en venait chez Cornaille en six mois, l’étourdissait et l’attirait ; et il y avait, dans son désir d’y pénétrer, une peur vague qui achevait de la séduire. » On fait déjà connaissance avec quelques figures des marchands à la papa menacés par le succès du Bonheur. Il y a « Bourras [qui] était un grand vieillard à tête de prophète, chevelu et barbu, avec des yeux perçants sous de gros sourcils embroussaillés. » […] « je vous jure que, moi vivant, il n’en aura pas une pierre ». Boudu livre à Denise et donc au lecteur novice, une mise en abyme de Pot-Bouille : « Par phrases coupées, il conta l’histoire de cet Octave Mouret. Toutes les chances ! Un garçon tombé du Midi à Paris, avec l’audace aimable d’un aventurier ; et, dès le lendemain, des histoires de femme, une continuelle exploitation de la femme, le scandale d’un flagrant délit, dont le quartier parlait encore ; puis, la conquête brusque et inexplicable de Mme Hédouin, qui lui avait apporté le Bonheur des Dames. » Celle-ci meurt accidentellement, et Mouret se retrouve à la tête d’une fortune : « lorsque Caroline avait laissé ses os dans les fondations, ce Mouret était resté seul héritier, seul propriétaire du Bonheur. » Dès ce chapitre initial, la métaphore de la machine à vapeur fonctionne à plein régime : « La machine ronflait toujours, encore en activité, lâchant sa vapeur ». Une note de l’édition Pléiade nous apprend que Zola noircit la réalité, et que « la part des grands magasins dans la circulation des marchandises était plus modeste que ne le laisse penser la lecture du Bonheur des Dames ».
Chapitre II
Denise se propose timidement à l’embauche, ce qui permet une première présentation du magasin et de son patron : « c’était Octave Mouret en personne. Il n’avait pas dormi, cette nuit-là, car au sortir d’une soirée chez un agent de change, il était allé souper avec un ami et deux femmes, ramassées dans les coulisses d’un petit théâtre. » Mouret est fidèle cependant au portrait de sa feue femme exposé dans son bureau : « N’était-ce pas toujours devant elle qu’il revenait travailler, après ses échappées de jeune veuf, au sortir des alcôves où le besoin du plaisir l’égarait ? » Son goût des femmes mélange intérêt et sentiment : « Mouret, au contraire, affectait des extases, restait devant les femmes ravi et câlin, emporté continuellement dans de nouveaux amours ; et ses coups de cœur étaient comme une réclame à sa vente, on eût dit qu’il enveloppait tout le sexe de la même caresse, pour mieux l’étourdir et le garder à sa merci. » Son adjoint Bourdoncle livre cette prophétie un peu téléphonée : « Elles se vengeront… Il y en aura une qui vengera les autres, c’est fatal. » Zola fait de son héros un collègue de bureau : « les bruits du quartier avaient un fond de vérité, Mouret se jetait en poète dans la spéculation ». C’est à peine s’il rappelle le fil héréditaire qui tient Octave, par ses parents morts fous dans La Conquête de Plassans, à la double lignée Rougon (par sa mère) et Macquart (par son père) : « il déclara qu’il était au fond plus juif que tous les juifs du monde : il tenait de son père, auquel il ressemblait physiquement et moralement, un gaillard qui connaissait le prix des sous ; et, s’il avait de sa mère ce brin de fantaisie nerveuse, c’était là peut-être le plus clair de sa chance, car il sentait la force invincible de sa grâce à tout oser ». Signalons au passage que le terme « juif » avec sa connotation méprisante typique de l’époque, reviendra une seule fois, au chapitre III : « Sous la grâce même de sa galanterie, Mouret laissait ainsi passer la brutalité d’un juif vendant de la femme à la livre ». Un bilan initial est établi au fil de la discussion : « une maison de nouveautés où il y avait dix-neuf rayons, et qui comptait quatre cent trois employés ! » Mouret expose sa stratégie de vendre à perte une soie dont il s’est assuré l’exclusivité, pour noyer la concurrence : « Enterrés, tous ces brocanteurs qui crèvent de rhumatismes, dans leurs caves ! » C’est à ce moment que Zola nous amène de la façon la plus téléphonée qui soit, la rencontre entre le patron et la petite-employée-qui-deviendra-sa-femme : Denise, qui ne sait comment se présenter à l’embauche, bute sur l’étalage de cette soie juste au moment où Mouret passe inspecter les travaux, et celui-ci la voit, « les joues subitement rouges, elle s’oubliait à regarder flamber l’incendie des soies » […] « Mouret […] était flatté au fond du saisissement de cette fille pauvre, de même qu’une marquise est remuée par le désir brutal d’un charretier qui passe. » Tout est dit : on va avoir droit au conte du prince et de la bergère sur fond de fanfreluches ! D’ailleurs Octave intervient pour l’embauche de Denise, à titre vraiment exceptionnel, foi de romancier naturaliste : « Jamais d’habitude, il n’intervenait dans cet embauchage des employés, les chefs de rayon ayant la responsabilité de leur personnel. Mais, avec son sens délicat de la femme, il sentait chez cette jeune fille un charme caché, une force de grâce et de tendresse, ignorée d’elle-même. » On vous le dit, ce drôle de capitaliste-là vous a l’étoffe d’un romancier !
Chapitre III
C’est le thé du samedi chez Henriette Desforges. Octave doit y rencontrer entre poire & fromage, l’amant en titre de sa belle, le baron Hartmann. Mais il a d’abord la surprise de tomber sur Paul de Vallagnosc, un condisciple du collège de Plassans. Zola en profite pour régler ses comptes avec les fils de, lui qui a échoué au baccalauréat : il fait l’éloge de la débrouillardise des sans-diplôme : « Il est de fait que ton diplôme de bachelier ne doit pas te servir à grand-chose pour vendre de la toile. » Quand son ancien camarade lui demande s’il s’amuse, on croirait entendre Zola soi-même : « Puis, ce ne sont pas encore les femmes, dont je me moque après tout. Vois-tu, c’est de vouloir et d’agir, c’est de créer enfin… Tu as une idée, tu te bats pour elle, tu l’enfonces à coups de marteau dans la tête des gens, tu la vois grandir et triompher… Ah ! oui, mon vieux, je m’amuse ! » Ce n’est pas du Bonheur des Dames qu’il est question, bien sûr, mais des Rougon-Macquart ! Le mélange des genres entre affaires de cœur et de portefeuille est prémédité : « Sans doute, il aurait pu voir le financier dans son cabinet, pour causer à l’aise de la grosse affaire qu’il voulait lui proposer. Mais il se sentait plus fort chez Henriette, il savait combien la possession commune d’une maîtresse rapproche et attendrit. » Octave règne sur les femmes par sa séduction permanente : « Il était femme, elles se sentaient pénétrées et possédées par ce sens délicat qu’il avait de leur être secret, et elles s’abandonnaient, séduites ; tandis que lui, certain dès lors de les avoir à sa merci, apparaissait, trônant brutalement au-dessus d’elles, comme le roi despotique du chiffon. »
Chapitre IV
Denise emménage Au Bonheur des Dames, juste le jour crucial où doit être lancée la nouveauté du « Paris-Bonheur » : « C’était une étroite cellule mansardée, ouvrant sur le toit par une fenêtre à tabatière, meublée d’un petit lit, d’une armoire de noyer, d’une table de toilette et de deux chaises. Vingt chambres pareilles s’alignaient le long d’un corridor de couvent, peint en jaune ; et, sur les trente-cinq demoiselles de la maison, les vingt qui n’avaient pas de famille à Paris couchaient là, tandis que les quinze autres logeaient au-dehors, quelques-unes chez des tantes ou des cousines d’emprunt. » Ce décor ressemble aux chambres de bonnes de Pot-Bouille, à ceci près qu’une surveillance constante empêche l’intrusion de tout élément mâle. Denise fait connaissance avec les mœurs locales, notamment en matière de drague : « Il y avait, entre lui et le gantier, une rivalité de jolis hommes, qui tous deux affectaient de coqueter avec les clientes. » Par contre entre vendeurs et vendeuses, les informations du narrateur sont contradictoires : « C’était une lutte sourde, où elles-mêmes apportaient une égale âpreté ; et, dans leur fatigue commune, toujours sur pied, la chair morte, les sexes disparaissaient, il ne restait plus face à face que des intérêts contraires, irrités par la fièvre du négoce. » Pourtant plus loin, Denise va se faire dûment draguer. Les clientes sont aussi parfois attentives à ces sexes qui ne disparaissent pas tant que ça : « Mme Marty […] se pencha pour murmurer à l’oreille de Mme Desforges : — Hein ? n’aimez-vous pas mieux être servie par des hommes ?… On est plus à l’aise. » Zola trouve une manière téléphonée digne d’un mauvais roman feuilleton, de réunir son héroïne Denise avec son héros Octave et l’amante de celui-ci, Henriette. Elle veut acheter une robe pour sa bonne, et on demande à Denise de poser avec le modèle envisagé, ce qui entraîne des moqueries contre sa gaucherie et sa mise peu élégante, mais, en héros de roman photo, Mouret témoigne un intérêt de prince pour cette mendiante : « Et elle [Henriette] jetait à Mouret le regard moqueur d’une Parisienne, que l’attifement ridicule d’une provinciale égayait. Celui-ci sentit la caresse amoureuse de ce coup d’œil, le triomphe de la femme heureuse de sa beauté et de son art. Aussi, par gratitude d’homme adoré, crut-il devoir railler à son tour, malgré la bienveillance qu’il éprouvait pour Denise, dont sa nature galante subissait le charme secret. » Décidément en veine galante, le narrateur estime que « tout le colossal approvisionnement du Paris-Bonheur venait d’être déchiqueté, balayé, comme sous un vol de sauterelles dévorantes ».
Chapitre V
Contre la vraisemblance, Mouret convoque la vendeuse novice dans son bureau et tente de domestiquer ses cheveux rebelles, tout en se félicitant qu’elle se soit déjà relookée depuis la scène de la veille : « Il s’était levé, il vint corriger sa coiffure, du même geste familier dont Mme Aurélie avait essayé de le faire la veille. » Vient une péripétie là aussi un peu téléphonée : la première d’une série d’exigences de Jean, le frère de Denise, qui invente chaque semaine une histoire de cœur qui a mal tourné pour lui soutirer ses économies, la pousser même à faire des dettes. La pauvresse gobe naïvement toutes ses histoires à dormir debout, alors qu’elle montre au contraire une force de caractère peu commune pour éconduire les dragueurs les plus sincères. On n’est plus dans le roman naturaliste, mais dans le mélo à grosses ficelles. Denise connaît « la misère en robe de soie », empêchée qu’elle est par les autres vendeuses, d’atteindre les clientes les plus dépensières. Comme Hélène, l’héroïne de Une Page d’amour, et sa bonne Rosalie, Denise demeure une provinciale ignorante de Paris : « Que pouvait-elle faire sur les trottoirs, sans un sou, avec sa sauvagerie, et toujours inquiétée par la grande ville, où elle ne connaissait que les rues voisines du magasin ? » Pauline, une vendeuse du rayon lainages, se prend d’affection pour elle, et lui fait la causette, la tire d’embarras en lui prêtant trois sous. Elle lui conseille — en vain — de prendre un amoureux, comme toutes, elle y compris, mais avec modération : « Jamais qu’un à la fois, du reste. Elle était honnête, elle s’indignait, lorsqu’on parlait de ces filles qui se donnent au premier venu. » Denise refuse, mais du coup, s’intéresse aux histoires d’amour du rayon, et effectivement, ces dames ne semblent pas trouver chaussure à leur pied parmi le personnel, mais plutôt au dehors : « En dehors des heures de gros travail, on y vivait dans une préoccupation constante de l’homme. Des commérages couraient, des aventures égayaient ces demoiselles pendant huit jours. » […] « Puis, venait le troupeau, la débandade du soir, neuf sur dix que des amants attendaient à la porte ; c’était, sur la place Gaillon, le long de la rue de la Michodière et de la rue Neuve-Saint-Augustin, toute une faction d’hommes immobiles, guettant du coin de l’œil ; et, quand le défilé commençait, chacun tendait le bras, emmenait la sienne, disparaissait en causant, avec une tranquillité maritale. » Une note de la p. 484 de la Pléiade indique que Zola avait noté dans son étude, « le côté sexuel nul » de la relation cliente / vendeur, laquelle le considère comme un rouage. Ses informations sur la vie sexuelle des vendeurs proviennent soit des conversations avec Mlle Dulit (une employée du magasin Saint-Joseph), soit de sa documentation sur le magasin Le Louvre, mais il insiste démesurément sur l’absence d’histoires entre vendeurs et vendeuses, de façon à en faire la conséquence des pratiques de management de Mouret, opposées à celles du Bon Marché, où ces histoires seraient fréquentes : « Une maison où l’on fait des mariages, merci ! ». En tout cas, cette fois, il s’agit bien d’un roman naturaliste et non d’un roman photo : « Dans le magasin, sous l’écrasement des treize heures de besogne, on ne pensait guère à des tendresses, entre vendeurs et vendeuses. Si la bataille continuelle de l’argent n’avait effacé les sexes, il aurait suffi, pour tuer le désir, de la bousculade de chaque minute, qui occupait la tête et rompait les membres. […] Tous n’étaient plus que des rouages, se trouvaient emportés par le branle de la machine, abdiquant leur personnalité, additionnant simplement leurs forces, dans ce total banal et puissant de phalanstère. » À force d’observer, Denise découvre le secret de Colomban, amoureux de Clara, la plus coureuse de toutes les vendeuses : « Était-ce donc si bête, l’amour ? Quoi ! ce garçon qui avait tout un bonheur sous la main, et qui gâtait sa vie, et qui adorait une gueuse comme un saint-sacrement ! » Denise est cependant troublée par Hutin, un vendeur, tout simplement parce qu’il s’est montré aimable avec elle lors de son embauche. Elle le cherche des yeux dans le magasin, et c’est là qu’à nouveau Zola nous sert son roman-photo : « Un après-midi, elle y trouva Mouret qui semblait la suivre d’un sourire. Il ne s’occupait plus d’elle, ne lui adressait de loin en loin une parole que pour la conseiller sur sa toilette et la plaisanter, en fille manquée, en sauvage qui tenait du garçon et dont il ne tirerait jamais une coquette, malgré sa science d’homme à bonnes fortunes ; même il en riait, il descendait jusqu’à des taquineries, sans vouloir s’avouer le trouble que lui causait cette petite vendeuse, avec ses cheveux si drôles. » Hutin se fiche pas mal de la vendeuse, et Zola nous donne, en bon naturaliste, la clé de ce comportement qui semble général : « Ces demoiselles n’étaient pas son genre, il affectait de les mépriser, en se vantant plus que jamais d’aventures extraordinaires avec des clientes : à son comptoir, une baronne avait eu le coup de foudre, et la femme d’un architecte lui était tombée entre les bras, un jour qu’il allait chez elle pour une erreur de métrage. Sous cette hâblerie normande, il cachait simplement des filles ramassées au fond des brasseries et des cafés-concerts. Comme tous les jeunes messieurs des nouveautés, il avait une rage de dépense, se battant la semaine entière à son rayon, avec une âpreté d’avare, dans le seul désir de jeter le dimanche son argent à la volée, sur les champs de courses, au travers des restaurants et des bals ; jamais une économie, pas une avance, le gain aussitôt dévoré que touché, l’insouciance absolue du lendemain. » Une autre clé est la rivalité entre les rayons, qui prend une couleur épique, à l’instar de la bataille des Gras et des Maigres dans Le Ventre de Paris : « D’ailleurs, un soulèvement général se produisit contre Denise. Le comptoir avait fini par découvrir son amitié avec Pauline, et il voyait une bravade dans cette affection donnée à une vendeuse d’un comptoir ennemi. Ces demoiselles parlaient de trahison, l’accusaient d’aller répéter à côté leurs moindres paroles. La guerre de la lingerie et des confections en prit une violence nouvelle, jamais elle n’avait soufflé si rudement : des mots furent échangés, raides comme des balles, et il y eut même une gifle, un soir, derrière les cartons de chemises. » Mlle Aurélie, la première (chef de rayon), a l’idée d’inviter toutes ses vendeuses sauf Denise un dimanche dans sa maison de campagne. Du coup Pauline finit par convaincre Denise de se joindre à elle et à son amant de cœur, dans une partie en guinguette à Joinville. Denise a le cœur brisé en y rencontrant Hutin avec des poules. Elle accepte de faire un bout de chemin de retour avec Deloche, un brave garçon, donc timide, qu’elle rebute pourtant : « les ténèbres aidant, après bien des paroles embarrassées, il osa dire qu’il l’aimait. Depuis longtemps, il voulait le lui écrire ; et jamais elle ne l’aurait su peut-être, sans cette belle nuit complice, sans cette eau qui chantait et ces arbres qui les couvraient du rideau de leurs ombrages. » Denise a honte : « des sanglots venaient de l’étouffer, en pensant que, si Hutin se trouvait à la place de Deloche et lui disait ainsi des tendresses, elle serait sans force. Cet aveu qu’elle se faisait enfin, l’emplissait de confusion. Une honte lui brûlait la face, comme si elle fût tombée sous ces arbres, aux bras de ce garçon qui s’étalait avec des filles », et du coup, elle qui reprochait à Colomban de préférer une coureuse à une fille aimante, elle éconduit ce garçon sincère parce qu’elle s’en veut de lui avoir préféré un coureur : « Non, écoutez, dit-elle d’une voix encore tremblante, je n’ai aucune colère contre vous. Seulement, je vous en prie, ne me parlez plus comme vous venez de le faire… Ce que vous demandez est impossible. Oh ! vous êtes un bon garçon, je veux bien être votre amie, mais pas davantage… » Le pauvre gars n’a plus qu’à se lamenter sur son tas de fumier : « Oh ! soyez tranquille, je ne vous tourmenterai plus. Quant à vous aimer, vous ne pouvez m’en empêcher, n’est-ce pas ? Je vous aimerai pour rien, comme une bête… Voilà ! tout fiche le camp, c’est ma part dans la vie. » Denise accompagne son amie Pauline chez son amant, où elle a obtenu le droit de découcher, en « donn[ant] cinq francs à Mme Cabin » (la gardienne du « phalanstère ») : « Elle avait vu son amie se mettre en jupon et en corset, elle la regardait préparer le lit, l’ouvrir, taper les oreillers de ses bras nus ; et ce petit ménage d’une nuit d’amour, fait devant elle, la troublait, lui causait une honte, en éveillant de nouveau, dans son cœur blessé, le souvenir de Hutin. » Quant à Deloche, il couche au magasin, comme les vendeurs au pair, mais pas dans une chambre, à même le rayon ! En rentrant tard au magasin, Denise croise comme par hasard Mouret, dont les sentiments insensiblement évoluent : « Et lui qui, depuis six mois, la traitait en enfant, qui la conseillait parfois, cédant à des idées d’expérience, à des envies méchantes de savoir comment une femme poussait et se perdait dans Paris, il ne riait plus, il éprouvait un sentiment indéfinissable de surprise et de crainte, mêlé de tendresse. Sans doute, c’était un amant qui l’embellissait ainsi. À cette pensée, il lui sembla qu’un oiseau favori, dont il jouait, venait de le piquer au sang. » On ne reconnaît guère l’amant si entreprenant de Pot-Bouille, maintenant que justement, Octave jouit de la fortune qui lui faisait défaut.
Chapitre VI
Pendant la morte-saison d’été, on pratique les « renvois en masse », sous tous les prétextes, comme « Vous avez une sale figure ». Rien ne va plus : « L’usine chômait, on supprimait le pain aux ouvriers ; et cela passait dans le branle indifférent de la machine, le rouage inutile était tranquillement jeté de côté ». Denise en est victime à son tour suite à un concours de circonstances : comme son frère Jean vient la relancer ou lui envoie des lettres pour lui demander de l’argent, et qu’on a vu Pépé, on croit que c’est son amant et son mioche. Elle se ruine et s’abîme la santé pour Jean, en consacrant ses nuits à un travail supplémentaire interdit. L’action se resserre autour d’un repas au réfectoire, ce qui permet une belle scène. « Les femmes mangeaient à part, dans deux salles réservées. […] La direction avait trouvé cela plus décent. ». Denise est serrée par le père Jouve, « un ancien capitaine » chargé de surveiller à la fois les voleuses et les employés (il y aurait eu de quoi faire deux ou trois rôles !), et qui harcèle les vendeuses à son goût : « des vendeuses terrorisées par le père Jouve, achetant sa bienveillance. Au magasin, d’ailleurs, il se contentait de petites privautés, claquait doucement de ses doigts enflés les joues des demoiselles complaisantes, leur prenait les mains, puis les gardait, comme s’il les avait oubliées dans les siennes. Cela restait paternel, et il ne lâchait le taureau que dehors, lorsqu’on voulait bien accepter des tartines de beurre, chez lui, rue des Moineaux. » Comme elle le rebute, Jouve a tôt fait de la surprendre avec son frère, et elle est renvoyée. Sa principale crainte est par rapport à Mouret : « un besoin ardent de le voir, de ne point quitter la maison, sans lui jurer qu’elle n’avait pas appartenu à un autre ». De son côté, Mouret se fâche de ne pas avoir été consulté pour cette fille dont chacun sait qu’il s’y est attaché : « D’habitude, il s’occupait fort peu du personnel ; mais il affecta cette fois de voir là un empiétement de pouvoir, une tentative d’échapper à son autorité. […] Puis, quand il eut fait une enquête personnelle, dans un tourment nerveux qu’il ne pouvait cacher, il se fâcha de nouveau. Elle ne mentait pas, cette pauvre fille : c’était bien son frère […]. Alors, pourquoi la renvoyer ? Il parla même de la reprendre. » Deloche lui reste fidèle : « je voudrais qu’elle rentrât ici, pour leur mettre le pied sur la gorge, à toutes ces pas grand-chose ! »
Chapitre VII
C’est la période la plus dure pour Denise, mais au moins bénéficie-t-elle de soutiens loyaux. C’est d’abord le vieux Bourras, chez qui elle loge dans une petite chambre qu’il loue pour survivre. Il est impossible de trouver du travail à cette saison où « plus de cinq mille employés de commerce, congédiés comme elle, battaient le pavé ». Le quartier semble être un bordel à ciel ouvert où l’on ne pense qu’au sexe. C’est son voisin « le boulanger » [qui] « ne rentrait que le matin, la guettait, quand elle allait chercher son eau ; il faisait même des trous dans la cloison, la regardait se débarbouiller, ce qui la forçait à pendre ses vêtements le long du mur. » Mais c’est surtout « la continuelle obsession des passants. Elle ne pouvait descendre acheter une bougie, sur ces trottoirs boueux où rôdait la débauche des vieux quartiers, sans entendre derrière elle un souffle ardent, des paroles crues de convoitise ; et les hommes la poursuivaient jusqu’au fond de l’allée noire, encouragés par l’aspect sordide de la maison. » Quand elle se prive de repas pour nourrir Pépé, elle remâche de sombres pensées : « Cependant, elle n’aurait eu qu’à consentir. Sa misère finissait, elle avait de l’argent, des robes, une belle chambre. C’était facile, on disait que toutes en arrivaient là, puisqu’une femme, à Paris, ne pouvait vivre de son travail. » Colomban vient la voir toute honte bue, « il voulait simplement causer de Clara ». Bourras, le vieux bourru, a pitié de sa locataire et du gamin pour qui il s’est pris d’une passion paternelle ; il propose du travail à Denise alors qu’il n’a quasiment plus d’activité, prétexte pour la nourrir. Enfin à l’automne, Denise est embauchée par Robineau, qui vient de racheter « le fonds de Vinçart », espérant concurrencer Le Bonheur des Dames, alors que Vinçart n’en revient pas d’avoir réussi à se débarrasser de son affaire périclitante pour acheter un restaurant. Robineau engage toute la fortune de sa femme dans un duel désespéré avec le grand magasin, sur la proposition de Gaujean, un fabricant de Lyon qui se plaint des pratiques de Mouret et espère réveiller la concurrence grâce à une « soie noire ». Mais malgré un premier succès, il suffit à Mouret de baisser un peu son prix pour récupérer sa clientèle, et Robineau & Gaujean sont vite étouffés. De son côté, Bourras, au lieu de saisir les offres alléchantes de Mouret qui veut lui racheter son bail et a même acheté ses murs, s’entête également à concurrencer le Bonheur dans son domaine, le parapluie. En se promenant aux Tuileries, Denise rencontre Mouret, lequel lui fait « des excuses » sur son renvoi : « je voulais seulement vous apprendre que tout le monde, chez nous, connaît aujourd’hui votre tendresse pour vos frères… » Denise est satisfaite : « une joie inondait son cœur. Il savait donc qu’elle ne s’était donnée à personne ! » Mouret s’étonne d’être touché par cette jeune femme : « Et il avait reporté ses regards sur Denise, il la voyait bien, dans le pâle crépuscule : elle était toute chétive auprès d’Henriette, pourquoi dont lui chauffait-elle ainsi le cœur ? » Le chapitre se ferme sur une réconciliation de Denise avec son oncle.
Chapitre VIII
L’oncle Baudu continue à vitupérer contre les travaux du Bonheur, qui prospère : « en moins de quatre ans, ils avaient quintuplé ce chiffre : leur recette annuelle, autrefois de huit millions, atteignait le chiffre de quarante, d’après le dernier inventaire. […] Toujours ils s’engraissaient, ils étaient maintenant mille employés, ils annonçaient vingt-huit rayons. » Denise s’intéresse à sa cousine, qui dépérit à cause de l’attitude de Colomban. C’est le sort des mariages arrangés : « Si vous saviez, depuis dix ans je suis accoutumée à l’idée de ce mariage. Je portais encore des robes courtes, que déjà Colomban était pour moi… Alors, je ne me souviens plus comment les choses ont tourné. De vivre toujours ensemble, de rester ici enfermés l’un contre l’autre, sans qu’il y eût jamais de distraction entre nous, j’ai dû finir par le croire mon mari, avant le temps. J’ignorais si je l’aimais, j’étais sa femme, voilà tout… » La maman demande au papa de hâter les choses, mais quand celui-ci s’adresse à Colomban pour lui dire que le mariage doit être reculé à cause de la mauvaise situation de la boutique, au lieu de protester, ce qu’attend le boutiquier, le gendre putatif accepte ce délai avec soulagement. « Notre fille en mourra », conclut la mère. Denise « rentrait au Bonheur avec mille francs d’appointements ». Manquant de tact, Deloche lui apprend une nouvelle : « À propos, vous vous souvenez de Clara Prunaire. Eh bien ! il paraît que le patron l’aurait… Vous comprenez ? […] Un drôle de goût, n’est-ce pas ? reprit-il. Une femme qui ressemble à un cheval… La petite lingère qu’il avait eue deux fois, l’an passé, était gentille au moins. » Denise s’empresse de faire la leçon à Colomban en lui apprenant la nouvelle, mais celui-ci « bégaya » quand même « Je l’aime ».
Chapitre IX
Grande scène des « nouveautés d’été », en mars. Zola apporte un grand soin à continuer son apologie de l’architecture moderne, timidement entamée au chapitre I du Ventre de Paris : « On avait vitré les cours, transformées en halls ; et des escaliers de fer s’élevaient du rez-de-chaussée, des ponts de fer étaient jetés d’un bout à l’autre, aux deux étages. L’architecte, par hasard intelligent, un jeune homme amoureux des temps nouveaux, ne s’était servi de la pierre que pour les sous-sols et les piles d’angle, puis avait monté toute l’ossature en fer, des colonnes supportant l’assemblage des poutres et des solives. Les voûtins des planchers, les cloisons des distributions intérieures, étaient en briques. Partout on avait gagné de l’espace, l’air et la lumière entraient librement, le public circulait à l’aise, sous le jet hardi des fermes à longue portée. C’était la cathédrale du commerce moderne solide et légère, faite pour un peuple de clientes. » Le dossier des éditions consultées ne le précise pas, mais ma petite idée est que le modèle de cette description est le siège central du Crédit lyonnais à Paris, situé exactement à l’endroit du Bonheur des Dames.

Le dossier Pléiade nous apprend que Frantz Jourdain, homme de lettres et architecte, conseilla Zola sur l’architecture à donner au magasin, alors qu’il était en train de travailler à l’aménagement de La Samaritaine, un magasin développé sur le modèle du Bonheur, pour le compte d’Ernest Cognacq, ancien calicot. Zola note la progression de l’entreprise : « À cette heure, le nombre des rayons était de trente-neuf, et l’on comptait dix-huit cents employés, dont deux cents femmes. » L’innovation publicitaire est aussi au rendez-vous, avec les ballons distribués aux enfants, et les « rendus », possibilité de faire reprendre un article après l’avoir essayé chez soi. Mme Guibal en abuse, empruntant des portières pour une réception, qu’elle rend sans vergogne après en avoir fait usage, car « les vendeurs avaient ordre de reprendre les marchandises, même s’ils s’apercevaient qu’on s’en fût servi ». Denise est mieux considérée depuis qu’on la sait protégée par le patron. Bourdoncle s’en inquiète : « Méfiez-vous, ça finira par être sérieux ! Vivement, Mouret se défendit, cachant son émotion sous un air d’insouciance supérieure. — Laissez donc, une plaisanterie ! La femme qui me prendra n’est pas née, mon cher ! » Bourdoncle « la traitait en ennemie ». Dès l’ouverture des portes, Zola nous sert une métaphore aussi poétique que ses sauterelles du ch. IV : « Comme les fleuves tirent à eux les eaux errantes d’une vallée, il semblait que le flot des clientes, coulant à plein vestibule, buvait les passants de la rue ». Mouret fait visiter son magasin à son ami Vallagnosc, bon moyen narratif. Paul lui fait remarquer le manège de Mme Guibal & M. de Boves, qui utilisent le nouveau « salon de lecture » proposé pour le repos des clients, comme lieu de rencontre adultère : « Eh bien ! il se passe de jolies choses chez toi ! » Mouret assume son idée : « Sans doute, il les connaissait, les filles qui battaient les comptoirs, les dames qui, par hasard, y rencontraient un ami ; mais si elles n’achetaient pas, elles faisaient nombre, elles chauffaient les magasins. » Une seconde description complète l’éloge de l’architecture moderne : « Les escaliers de fer, à double révolution, développaient des courbes hardies, multipliaient les paliers ; les ponts de fer, jetés sur le vide, filaient droit, très haut ; et tout ce fer mettait là, sous la lumière blanche des vitrages, une architecture légère, une dentelle compliquée où passait le jour, la réalisation moderne d’un palais du rêve, d’une Babel entassant des étages, élargissant des salles, ouvrant des échappées sur d’autres étages et d’autres salles, à l’infini. Du reste, le fer régnait partout, le jeune architecte avait eu l’honnêteté et le courage de ne pas le déguiser sous une couche de badigeon, imitant la pierre ou le bois. » Henriette est venue dans une intention particulière, à cause de Bouthemont, chef de comptoir qu’Octave a pris comme complice de ses amours et a fait venir au salon de son amante, dont il commence à se lasser : « il lui avait conté carrément les amours de Mouret et de Clara, sans calcul, par bêtise de gros garçon aimant à rire ; et, mordue de jalousie, cachant sa blessure sous des airs de dédain, elle venait pour tâcher de découvrir cette fille » Le naturaliste à la Claude Bernard nous livre un exposé sur le vol : « Puis, venaient les voleuses par manie, une perversion du désir, une névrose nouvelle qu’un aliéniste avait classée, en y constatant le résultat aigu de la tension exercée par les grands magasins. Enfin, il y avait les femmes enceintes, dont les vols se spécialisaient : ainsi, chez une d’elles, le commissaire de police avait découvert deux cent quarante-huit paires de gants roses, volées dans tous les comptoirs de Paris. » Jouve soupçonne Mme de Boves, mais il se fait rouler par une femme enceinte et le flagrant délit est remis à plus tard. Henriette a tôt fait de soupçonner Denise aux regards que lui lance Mouret, bien qu’il ne s’agisse que de Clara. Au terme de cette belle journée, profitant d’une démission, Octave nomme Denise « seconde », ce qu’en fille modeste elle trouve immérité, mais elle comprend ce qui se passe en elle comme en lui : « Il l’aimait donc ? Brusquement, elle comprenait, elle sentait la flamme croissante du coup de désir dont il l’enveloppait, depuis qu’elle était de retour aux confections. Ce qui la bouleversait davantage, c’était de sentir son cœur battre à se rompre. Pourquoi la blessait-il avec tout cet argent, lorsqu’elle débordait de gratitude et qu’il l’eût fait défaillir d’une seule parole amie ? »
Chapitre X
Denise connaît désormais une certaine aisance : « D’ailleurs, à titre de seconde, Denise avait une des plus grandes chambres, dont les deux fenêtres mansardées ouvraient sur la rue. Riche à présent, elle se donnait du luxe ». Zola voit les choses de haut : « les vendeuses ne s’y rencontraient plus, sans en arriver tout de suite aux mots désagréables. C’était une éducation à faire, la petite cité phalanstérienne manquait de concorde ». Denise ressent pour Octave un amour qui ne serait guère politiquement correct à l’heure actuelle : « Elle ne raisonnait pas, elle sentait seulement qu’elle l’avait toujours aimé, depuis l’heure où elle avait frémi et balbutié devant lui. Elle l’aimait lorsqu’elle le redoutait comme un maître sans pitié, elle l’aimait lorsque son cœur éperdu rêvait de Hutin, inconscient, cédant à un besoin d’affection. » Il lui envoie une invitation à dîner, ce qui met Denise dans l’embarras : « Clara avait dîné, d’autres aussi, toutes celles que le patron remarquait. Après le dîner, comme disaient les commis farceurs, il y avait le dessert. » Elle se confie à son amie Pauline, qui tente de la convaincre de sauter sur l’occasion : « D’abord, il ne voyait plus Clara. On disait bien qu’il allait chez une dame au-dehors, mais ce n’était pas prouvé. Puis, elle expliqua qu’on ne pouvait être jalouse d’un homme dans une pareille position. Il avait trop d’argent, il était le maître après tout. Denise l’écoutait ; et, si elle avait encore ignoré son amour, elle n’en aurait plus douté à la souffrance dont le nom de Clara et l’allusion à Mme Desforges lui tordirent le cœur. » Mais Denise réfléchit autrement : « Est-ce que M. Mouret peut épouser ses vendeuses ? — Oh ! non, oh ! non, cria la jeune fille révoltée par l’absurdité de la question, et c’est pourquoi il n’aurait pas dû m’écrire. » Suite à une indiscrétion involontaire de Pauline, « chaque vendeur savait déjà que Mouret avait écrit le matin, pour inviter Denise à dîner », ce qui en étonne beaucoup car « Ça semblait déjà un vieux collage. », à cause des ragots. Fidèle à sa technique éprouvée, Zola nous a placé cette journée clé au beau milieu de l’inventaire, et la guerre entre employés continue entre les ragots, avec « une sournoiserie affable », selon un oxymore comme les aime notre ami Émile. Hutin participe à sa façon aux ragots : « Vous a-t-on raconté que la seconde des confections a eu une toquade pour vous ? Le jeune homme parut très surpris. — Tiens ! comment ça ? […] Depuis qu’il était second, Hutin avait lâché les chanteuses de café-concert et affichait des institutrices. Très flatté au fond, il répondit d’un air de mépris : — Je les aime plus étoffées, mon cher, et puis on ne va pas avec tout le monde, comme le patron. » Le magasin poursuit sa croissance : « Chaque saison, les affaires du comptoir augmentaient, les vendeurs y montaient en grade et y doublaient leurs soldes, comme des officiers en temps de campagne. » On visite la nouvelle « cuisine de phalanstère », qui nourrit désormais « deux mille » employés. La leçon a été tirée de la révolte des employés : « Mouret […] dirigeait aussi la cuisine, il en avait fait un service organisé comme un de ses rayons […] et, s’il déboursait davantage, il obtenait plus de travail d’un personnel mieux nourri, calcul d’une humanitairerie pratique ». Cela contribue au « meilleur genre » des employés : « Près de la moitié, à présent, parlaient l’allemand ou l’anglais. Le chic n’était plus […] de rouler les café-concerts pour y siffler les chanteuses laides. Non, on se réunissait une vingtaine, on fondait un cercle. » Mouret trouve un prétexte pour convoquer Denise dans son rayon même, dans une petite salle, dont « Mme Aurélie ne savait comment sortir à son tour, d’une façon décente ». Il se déclare sans fard : « Je vous aime, Denise… », mais se heurte au refus farouche de sa belle : « Non, non, merci, répondait-elle chaque fois, sans une défaillance » ; mais elle glisse pourtant sa raison : « Et puis, monsieur, vous aimez une personne, oui, cette dame qui vient ici… Restez avec elle. Moi, je ne partage pas. » L’inventaire terminé donne un « chiffre d’affaires réalisées dans l’année, un chiffre que les additions des divers rayons donnaient à l’instant. Le total était de quatre-vingts millions, dix millions de plus que l’année précédente. » Pourtant, Mouret est furieux et broie du noir.
Chapitre XI
Mouret relève le défi de quitter Henriette, ce qui donne un beau chapitre chez cette dernière, dont la jalousie méchante facilite la rupture d’« une liaison dont il se fatiguait ». On apprend que « depuis près de trois mois, il menait une vie terrible de plaisirs, semant l’argent avec une prodigalité dont on causait : il avait acheté un hôtel à une rouleuse de coulisses, il était mangé par deux ou trois autres coquines à la fois, qui semblaient lutter de caprices coûteux et bêtes. » Zola consacre un paragraphe à excuser cette garce du bout de la plume : « C’était vrai, elle adorait Mouret pour sa jeunesse et ses triomphes, jamais un homme ne l’avait ainsi prise tout entière, dans un frisson de sa chair et de son orgueil ; mais, à la pensée de le perdre, elle entendait aussi sonner le glas de la quarantaine, elle se demandait avec terreur comment remplacer ce grand amour. » C’est une scène de dépit amoureux observée au scalpel : « Pourquoi ne venait-il pas seul ? Il devait être allé chercher son ami, dans la crainte d’un tête-à-tête possible. » […] « Son désespoir était de grossir, elle se serrait dans des toilettes de soie noire, afin de dissimuler l’embonpoint qui montait. » Henriette a fait venir Denise sous prétexte d’essayer une robe, mais dans le but de l’humilier et de confondre Octave. Elle fait donc dériver la conversation sur les vendeuses, et Zola y glisse son grain de sel moraliste : « Le niveau de leur moralité montait, d’ailleurs. Autrefois, on n’avait guère que les déclassées du commerce, les filles vagues et pauvres tombaient dans les nouveautés ; tandis que, maintenant, des familles de la rue de Sèvres, par exemple, élevaient positivement leurs gamines pour le Bon Marché. » […] « Ainsi jetées dans le luxe, souvent sans instruction première, elles formaient une classe à part, innommée. Leurs misères et leurs vices venaient de là. » Après avoir fait faire antichambre à Denise, Henriette essaie le manteau, et se lance dans sa grande scène en appelant Mouret à la rescousse : « Cette fille est une sotte qui n’a pas une idée… » Denise tient bon sous l’affront, jusqu’à ce que ce soit Henriette qui craque : « C’est bien, monsieur, s’il faut que je souffre chez moi les insolences de vos maîtresses !… Une fille ramassée dans quelque ruisseau. » Mais Mouret ne lâche pas Denise, et Henriette subit sa défaite. Face au cynisme de Vallagnosc, Mouret défend sa conception : « Tâche donc d’en désirer une et de la tenir enfin : cela paye en une minute toutes les misères. » Henriette demande des nouvelles de la marquise déchue qu’elle a fait embaucher par Mouret. Celui-ci au contraire, célèbre « ce qu’il appelait l’aristocratie du travail ». Comme Octave vient de congédier Bouthemont, Henriette le soutient pour se venger, et le présente au baron Hartmann.
Chapitre XII
Les affaires reprennent. Pauline « avait épousé Baugé, une vraie sottise, disait-elle gaiement. Le terrible Bourdoncle la traitait maintenant en sabot, en femme perdue pour le commerce. Sa frayeur était qu’on ne les envoyât un beau matin s’aimer dehors, car ces messieurs de la direction décrétaient l’amour exécrable et mortel à la vente. » Denise ne sait plus où se mettre, car la façon dont elle tient la dragée haute à Mouret ne peut que lui attirer une mauvaise réputation : « Une rouée, une fille de vice savant, n’aurait pas agi d’une autre façon que cette innocente. » Zola se projette dans Mouret, car il le voit en expérimentateur, entendez naturaliste : « Mouret, cependant, vivait dans l’angoisse. Était-ce possible ? Cet enfant le torturait à ce point ! Toujours il la revoyait arrivant au Bonheur, avec ses gros souliers, sa mince robe noire, son air sauvage. Elle bégayait, tous se moquaient d’elle, lui-même l’avait trouvée laide d’abord. Laide ! et, maintenant, elle l’aurait fait mettre à genoux d’un regard, il ne l’apercevait plus que dans un rayonnement ! Puis, elle était restée la dernière de la maison, rebutée, plaisantée, traitée par lui en bête curieuse. Pendant des mois, il avait voulu voir comment une fille poussait, il s’était amusé à cette expérience, sans comprendre qu’il y jouait son cœur. » L’idéal féminin de l’auteur transparaît : « Elle apportait tout ce qu’on trouve de bon chez la femme, le courage, la gaieté, la simplicité ; et, de sa douceur, montait un charme, d’une subtilité pénétrante de parfum. » En une phrase subtile de cadence mineure, Zola souligne le contraste entre le succès commercial et le refus de la modeste vendeuse : « Les commandes de l’Europe entière affluaient, il fallait une voiture des Postes spéciale pour apporter la correspondance ; et elle disait non, toujours non. » On fait le point chiffré : « il y avait quinze cents vendeurs, mille autres employés de toute espèce, dont quarante inspecteurs et soixante-dix caissiers ; les cuisines seules occupaient trente-deux hommes ; on comptait dix commis pour la publicité, trois cent cinquante garçons de magasin portant la livrée, vingt-quatre pompiers à demeure. Et, dans les écuries royales, installées rue Monsigny, en face des magasins, se trouvaient cent quarante-cinq chevaux, tout un luxe d’attelage déjà célèbre. » Les notes de la Pléiade (p. 710) précisent que Zola se sert des chiffres qui lui ont été communiqués pour le Louvre & le Bon marché. Bourdoncle prétend qu’« elle a des amants ici même », ce que Mouret croit à moitié, mais la jalousie ternit son caractère : « son tourment le rendit terrible, la maison entière trembla. » C’est à ce moment qu’un réseau de vol organisé autour de Mignot et d’Albert Lhomme est découvert, ce qui fait licencier le fils de Mme Aurélie. Hutin, objet d’une remarque injuste de Mouret, cherche à se venger bassement en atteignant Denise : « Est-ce ma faute, à moi, si cette grue des confections le fait tourner en bourrique !… Voyez-vous, mon cher, le coup vient de là. Il sait que j’ai couché avec, et ça ne lui est pas agréable ». Un jour, il la dénonce, l’ayant vue causer avec son ami Deloche, mais cela ne sert qu’à forcer une déclaration d’Octave : « Mon Dieu ! je vous aime, je vous aime… Pourquoi prenez-vous plaisir à me martyriser ainsi ? […] Ne vous ai-je pas préférée, chez cette dame ? n’ai-je pas rompu pour être à vous seule ? J’attends encore un remerciement, un peu de gratitude… » Le narrateur creuse dans le cœur de Denise les raisons pourtant si peu plausibles de son refus : « Quand il lui parlait ainsi, quand elle le voyait si ému, si bouleversé, elle ne savait plus pourquoi elle se refusait ; et elle ne retrouvait qu’ensuite, au fond même de sa nature de fille bien portante, la fierté et la raison qui la tenaient debout, dans son obstination de vierge. C’était par un instinct du bonheur qu’elle s’entêtait, pour satisfaire son besoin d’une vie tranquille, et non pour obéir à l’idée de la vertu. Elle serait tombée aux bras de cet homme, la chair prise, le cœur séduit, si elle n’avait éprouvé une révolte, presque une répulsion devant le don définitif de son être, jeté à l’inconnu du lendemain. L’amant lui faisait peur, cette peur folle qui blêmit la femme à l’approche du mâle. » Résultat : « Le lendemain, Denise était nommée première » ; on crée pour elle un nouveau rayon pour les enfants, et l’on croit voir, derrière Denise, Zola et son désir d’avoir un enfant (qu’il réalisera seulement en 1889 avec Jeanne Rozerot) : « Elle adorait les enfants, on ne pouvait la mieux placer. Parfois, on comptait là une cinquantaine de fillettes, autant de garçons, tout un pensionnat turbulent, lâché dans les désirs de la coquetterie naissante. […] quand il y avait dans le tas une gamine rose, dont le joli museau la tentait, elle voulait la servir elle-même, apportait la robe, l’essayait sur les épaules potelées, avec des précautions tendres de grande sœur. » Mais Denise a aussi un rôle social, elle influence Mouret pour humaniser l’entreprise : « elle était surtout blessée par le sort précaire des commis ; les renvois brusques la soulevaient, elle les trouvait maladroits et iniques, nuisibles à tous, autant à la maison qu’au personnel. […] Et elle plaidait la cause des rouages de la machine, non par des raisons sentimentales, mais par des arguments tirés de l’intérêt même des patrons. Quand on veut une machine solide, on emploie du bon fer ; si le fer casse ou si on le casse, il y a un arrêt de travail, des frais répétés de mise en train, toute une déperdition de force. Parfois, elle s’animait, elle voyait l’immense bazar idéal, le phalanstère du négoce, où chacun aurait sa part exacte des bénéfices, selon ses mérites, avec la certitude du lendemain, assurée à l’aide d’un contrat. Mouret […] l’accusait de socialisme, l’embarrassait en lui montrant des difficultés d’exécution […] cependant, il était ébranlé, séduit, par cette voix jeune, […] et il l’écoutait en la plaisantant, le sort des vendeurs était amélioré peu à peu, on remplaçait les renvois en masse par un système de congés accordés aux mortes-saisons, enfin on allait créer une caisse de secours mutuels, qui mettrait les employés à l’abri des chômages forcés, et leur assurerait une retraite. C’était l’embryon des vastes sociétés ouvrières du vingtième siècle. » […] « Le Bonheur des Dames se suffisait, plaisirs et besoins, au milieu du grand Paris, occupé de ce tintamarre, de cette cité du travail qui poussait si largement dans le fumier des vieilles rues, ouvertes enfin au plein soleil. » Encore une fois, on se demande s’il est question du roman ou du magasin. Denise règle également le cas des femmes enceintes congédiées, lorsque c’est le tour de son amie Pauline : « Pompeusement, il fut décidé que toute vendeuse mariée qui deviendrait enceinte, serait mise chez une sage-femme spéciale, dès que sa présence au comptoir blesserait les bonnes mœurs. » Une note de la Pléiade (p. 728) nous apprend que Zola s’inspire de l’influence de Marguerite Boucicaut sur son mari. Plus le magasin prospère, plus Mouret souffre : « Mouret venait de sentir plus amèrement que jamais la vanité de sa fortune. La pensée de Denise lui avait brusquement serré la poitrine, cette pensée qui, sans relâche, le traversait d’une flamme, comme l’élancement d’un mal inguérissable. […] Que voulait-elle donc ? il n’osait plus lui offrir de l’argent, l’idée confuse d’un mariage se levait, au milieu de ses révoltes de jeune veuf. » Réécrivez la phrase précédente en remplaçant Mouret par Zola, Denise par Jeanne…
Chapitre XIII
Il faut régler le sort des Baudu, grâce au lâchage de Colomban, « cédant à la folie de désir des garçons sournois et chastes », qui devient « le chien obéissant » de Clara. Cela sera fatal à Geneviève : « son pauvre visage, où agonisait la dégénérescence dernière d’une longue famille poussée à l’ombre, dans cette cave du vieux commerce parisien. » Ce chapitre synthétise la vision pessimiste du petit commerce : « Tout le vieux quartier suait l’humidité, exhalait son odeur moisie de cave, avec sa continuelle bousculade de passants sur le pavé boueux. » La boutique de Bourras est également bien traitée dans le tableau : « la maison tenait toujours, entêtée, collée au flanc du Bonheur des Dames, comme une verrue déshonorante, qui, bien que gercée et pourrie, refusait d’en tomber. » Bourras fait le constat du succès de son ennemi : « On dit que vous êtes deux mille sept cents employés et que le chiffre d’affaires atteindra cent millions cette année… » Il envoie balader Denise, qui cherche à l’aider dans sa défaite cuisante face à Mouret. Celui-ci se justifie, appuyé par le narrateur : « le triomphe des cités ouvrières et industrielles était semé par le coup de vent du siècle, qui emportait l’édifice croulant des vieux âges. […] On ne gardait pas ses morts, il fallait bien les enterrer ; et, d’un geste, il envoyait dans la terre, il balayait et jetait à la fosse commune le cadavre de l’antique négoce, dont les restes verdis et empestés devenaient la honte des rues ensoleillées du nouveau Paris. Non, non, il n’avait aucun remords, il faisait simplement la besogne de son âge, et elle le savait bien, elle qui aimait la vie, qui avait la passion des affaires larges, conclues au plein jour de la publicité. » Ce discours schopenhauerien empêche Denise de dormir : « Il lui semblait qu’elle était toute petite, et elle éclatait en larmes, au fond de leur jardin de Valognes, en voyant les fauvettes manger les araignées, qui elles-mêmes mangeaient les mouches. » Denise triomphe de Mouret : « Mais elle se sentait sans rancune, aujourd’hui qu’il souffrait par elle. Cette souffrance l’avait grandi. Quand elle le voyait torturé, expiant si durement son dédain de la femme, il lui semblait racheté de ses fautes. » Les mouches mangées, ce sera le suicide raté de Robineau, puis la défaite définitive de Bourras : « le vieillard entêté s’était laissé prendre pour cinq cents francs ce qu’il n’avait pas voulu lâcher pour cent mille. » Conclusion philosophique : « Jusqu’au bout, il lui fallut assister à l’œuvre invincible de la vie, qui veut la mort pour continuelle semence. Elle ne se débattait plus, elle acceptait cette loi de la lutte ; mais son âme de femme s’emplissait d’une bonté en pleurs, d’une tendresse fraternelle, à l’idée de l’humanité souffrante. Depuis des années, elle-même était prise entre les rouages de la machine. »
Chapitre XIV
Ce chapitre est de loin le plus long, ce qui n’empêche pas que sa fin soit en queue de poisson. Le magasin atteint son plein développement : « la plaie laissée à son flanc par la démolition de la masure de Bourras, se trouvait si bien cicatrisée, qu’on aurait vainement cherché la place de cette verrue ancienne ; les quatre façades filaient le long des quatre rues, sans une lacune, dans leur isolement superbe. » L’incendie de son concurrent, le magasin créé par Bouthemont, soutenu également par le baron Hartmann et surtout par le dépit d’Henriette, consolide le succès de Mouret. La scène se passe à nouveau un jour crucial : « l’inauguration avait lieu ce lundi-là, à l’occasion de la grande exposition de blanc ». Tous les personnages se retrouvent, y compris Henriette, révoltée à l’idée du mariage d’un Joseph « avec [s]a protégée, Mlle de Fontenailles… » […] « Je le connais, il a voulu dire que nos filles du monde ne sont bonnes qu’à épouser ses garçons de magasin. » On atteint cinquante rayons et « trois mille quarante-cinq employés », parmi lesquels le narrateur distingue encore des maigres et des gras, réminiscence du Le Ventre de Paris : « Un grand maigre s’étonnait : ça se faisait donc, ce mariage du patron avec la première des costumes ? tandis qu’un petit gras répondait qu’on n’avait jamais su, mais que les fleurs tout de même étaient achetées. » Les cancans vont bon train : « les uns comme les autres, tombaient d’accord que cette petite vendeuse avait mené l’affaire avec la science d’une rouée de génie, et qu’elle jouait la partie suprême, en lui mettant ainsi le marché à la main. Épouse-moi, ou je m’en vais. » Denise est désemparée : « elle se demandait avec désespoir comment faire, pour n’avoir pas l’air d’être une coureuse de maris. » Mais Mouret aussi en perd son latin de séducteur : « le directeur d’une grande maison de nouveautés devait être célibataire, s’il voulait garder sa royauté de mâle sur les désirs épandus de son peuple de clientes : une femme introduite changeait l’air, chassait les autres, en apportant son odeur. Et il résistait à l’invincible logique des faits, il préférait en mourir que de céder, pris de soudaines colères contre Denise, sentant bien qu’elle était la revanche, craignant de tomber vaincu sur ses millions, brisé comme une paille par l’éternel féminin, le jour où il l’épouserait. » Bourdoncle espère tirer les marrons du feu, et change d’attitude ; il encourage Denise, espérant la chute de Mouret : « Il était emporté par le jeu de la machine, pris de l’appétit des autres, de la voracité qui, de bas en haut, jetait les maigres à l’extermination des gras. » Dernier portrait de « Jean, carré des épaules, la dominant de toute la tête, gardait sa beauté de femme, avec sa chevelure blonde, envolée sous le coup de vent des ouvriers artistes. » Quant à Mme Aurélie, elle « avait recommencé ses parties fines entre femmes », et la fin de son règne approche. Dernier regard sur un personnage secondaire, la cliente de province, et son mari jaloux : « Et M. Boutarel, quand il avait compris, s’était fâché carrément, criant qu’il voulait sa femme, qu’il entendait savoir ce qu’on lui faisait, qu’il ne la laisserait certainement pas se déshabiller sans lui. Vainement, on tâchait de le calmer : il semblait croire qu’il se passait là-dedans des choses inconvenantes. » Henriette est jalouse du succès de Denise, à laquelle est subordonnée sa protégée : « N’est-ce pas blessant ? une marquise ! Et il la force à suivre comme un chien les créatures ramassées par lui sur le trottoir ! » L’anecdote de l’arrestation de Mme de Boves pour vol est bien développée comme une scène de genre : « Les crises empiraient, grandissaient, jusqu’à être une volupté nécessaire à son existence, emportant tous les raisonnements de prudence, se satisfaisant avec une jouissance d’autant plus âpre, qu’elle risquait, sous les yeux d’une foule, son nom, son orgueil, la haute situation de son mari ». On arrange l’affaire, mais Mouret gamberge : « Tout un rapport vague s’élevait dans son esprit : le vol de cette malheureuse, cette folie dernière de la clientèle conquise, abattue aux pieds du tentateur, évoquait l’image fière et vengeresse de Denise, dont il sentait sur sa gorge le talon victorieux. » Zola ne recule pas devant l’anachronisme de mettre l’électricité : « la grande exposition de blanc prenait une splendeur féerique d’apothéose, sous cet éclairage nouveau. » La métaphore religieuse est filée : « Sa création apportait une religion nouvelle, les églises que désertait peu à peu la foi chancelante étaient remplacées par son bazar, dans les âmes inoccupées désormais. » Mouret a soumis la femme : « il les tenait à ses pieds, sous l’éblouissement des feux électriques, ainsi qu’un bétail dont il avait tiré sa fortune. » Mais il se reconnaît enfin soumis à une femme : « C’était un besoin irraisonnable d’être vaincu, dans sa victoire, le non-sens d’un homme de guerre pliant sous le caprice d’un enfant, au lendemain de ses conquêtes. Lui qui se débattait depuis des mois, qui le matin encore jurait d’étouffer sa passion, cédait tout d’un coup, saisi du vertige des hauteurs, heureux de faire ce qu’il croyait être une sottise. Sa décision, si rapide, avait pris d’une minute à l’autre une telle énergie, qu’il ne voyait plus qu’elle d’utile et de nécessaire dans le monde. » Il est insensible au chiffre pharamineux enfin atteint par la recette : « — Un million, deux cent quarante-sept francs, quatre-vingt-quinze centimes ! Enfin, c’était le million, le million ramassé en un jour, le chiffre dont Mouret avait longtemps rêvé ! Mais il eut un geste de colère, il dit avec impatience, de l’air déçu d’un homme dérangé dans son attente par un importun : — Un million, eh bien ! mettez-le là. » Il renonce à son renoncement au mariage face à Bourdoncle : « nous étions stupides, avec cette superstition que le mariage devait nous couler. Est-ce qu’il n’est pas la santé nécessaire, la force et l’ordre mêmes de la vie !… » Le happy-end précipité en un paragraphe a de quoi étonner. L’auteur aurait-il eu peur d’étaler ses fantasmes extra-conjugaux ? Aurait-il eu honte, pour une fois, de laisser ses personnages dans la joie ?
– Le livre connaît au moins deux adaptations cinématographiques notoires, de Julien Duvivier en 1930 et d’André Cayatte en 1943.
– Lire la fiche consacrée à Octave Mouret sur le site Rougon&Macquart.
– Lire un sympathique TPE sur la genèse du roman, avec des manuscrits de l’ébauche.
– Si vous avez aimé Octave Mouret, vous aimerez l’autre grand entrepreneur des Rougon-Macquart, Aristide Saccard, dans L’Argent.
Voir en ligne : Au Bonheur des Dames sur Wikisource
© altersexualite.com, 2016.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com