Accueil > Zola pour les nuls > La Conquête de Plassans, d’Émile Zola
Madame Bovary version bigote, pour lycéens
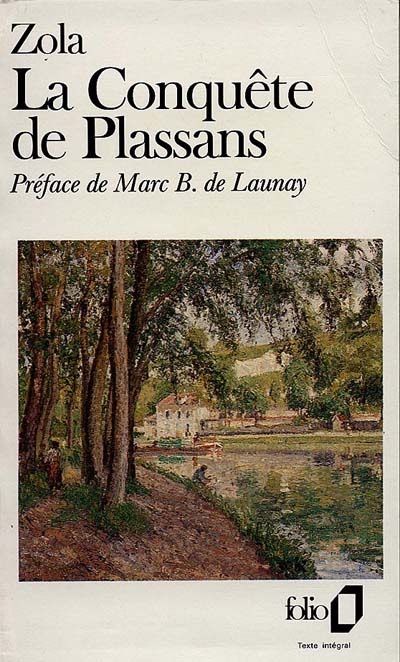 La Conquête de Plassans, d’Émile Zola
La Conquête de Plassans, d’Émile Zola
La Pléiade, 1874 (éd. 1960).
mardi 1er septembre 2015
Après le diptyque parisien que constituent La Curée et Le Ventre de Paris, Zola renoue avec l’atmosphère de La Fortune des Rougon, avec un roman psychologique proche de Thérèse Raquin. Zola y songe et le prépare pendant l’écriture du précédent, le rédige fin 1873, et le publie en feuilleton dans Le Siècle, entre février et avril 1874, avant de le publier en volume chez Charpentier. La Fortune des Rougon avait été modifié fin 1872 pour créer deux enfants de plus à Marthe Rougon et François Mouret, Désirée et Serge. Dès la première liste de dix romans de 1868, Zola avait prévu « un roman sur les prêtres (Province) ». L’édition de la Pléiade d’Henri Mitterand que j’ai utilisée pour ce volume propose un dossier assez mince pour La Conquête de Plassans, présenté comme le livre le moins lu depuis sa parution. Une nouvelle publiée trois fois par Zola entre 1868 et 1872 (selon la formule d’une lettre à Flaubert, Zola qui n’a pas encore connu un grand succès, fait « bouillir la marmite » en multipliant les articles) dans trois journaux, « Histoire d’un fou », préfigure le motif du trio amoureux, avec un mari qu’on fait devenir fou pour s’en débarrasser, en simulant une folie qui devient contagieuse. Le texte intégral en est donné dans le dossier de la Pléiade, et nous la reproduisons en fin d’article. Dans le roman, grâce à une documentation sur la folie, Zola ne fait pas de la femme une simulatrice, mais une vraie « folle lucide », car pour lui à cette époque de sa vie, la dévotion constitue « un cas de détraquement » (p. 1647). L’action du roman se situe entre 1858 et 1864, et Zola plaque sur l’Empire ses considérations sur la situation politique de l’année 1873. En effet, l’Ordre moral s’installe, après la démission d’Adolphe Thiers le 24 mai. C’est la politique souhaitée par le gouvernement d’Albert de Broglie formé sous la présidence du maréchal Patrice de Mac Mahon à partir du 27 mai 1873. Zola, qui avait prévu cette arrivée au pouvoir des partis monarchiques et cléricaux, ce qui lui avait valu la publicité de l’interdiction du Corsaire à cause d’un de ses articles en 1872, se déchaîne dans une satire anticléricale qu’il faut comprendre au regard des événements contemporains de la rédaction. Si le roman est le moins lu des Rougon-Macquart, la critique ne sera pas négative, et dans le cercle amical, Flaubert sera dithyrambique. On comprend pourquoi : ce livre ressemble étrangement à Madame Bovary par sa chronique d’une petite ville de province, et surtout par sa façon de raconter comment un couple a priori heureux sombre dans le malheur conjugal par la folie d’une femme, ici emportée par l’extase religieuse. Et comme Flaubert s’y était ingénié, Zola peaufine les transitions, s’attache à mettre en lumière les changements dans le comportement de la femme et du mari.
– aller à la fin de l’article
Chapitre I
Le livre est divisé en 23 chapitres courts. Dans le chapitre initial, la famille Mouret est présentée un soir de septembre, Marthe et François, les parents, Désirée la petite de quatorze ans, Octave et Serge, « deux grands garçons de dix-sept et dix-huit ans » (Octave sera le fondateur du Bonheur des Dames), la bonne bougonne Rose, et c’est immédiatement l’arrivée de l’abbé Faujas, qui a loué le premier étage, sur la recommandation de l’abbé Bourrette. François ne le connaît pas, ce que lui reproche Marthe, mais son anticléricalisme se réjouit de loger un prêtre : « un prêtre, ce n’est pas bien gênant. Il vivra chez lui, et nous chez nous. Ces robes noires, ça se cache pour avaler un verre d’eau… Tu sais si je les aime, moi ! Des fainéants, la plupart… Eh bien ! ce qui m’a décidé à louer, c’est que justement j’ai trouvé un prêtre. Il n’y a rien à craindre pour l’argent avec eux, et on ne les entend pas même mettre leur clef dans la serrure. ».
Chapitre II L’abbé arrive donc plus tôt que prévu, le soir même en fait, et Mouret est contrarié de n’avoir pas même eu le temps de débarrasser l’étage des fruits qu’on y entrepose, et puis suite à un malentendu avec l’abbé Bourrette, Faujas arrive sans meubles, avec juste une petite valise et sa mère, et en est à son tour contrarié, mais tout s’arrange vite grâce à l’énergie déployée par la mère de l’abbé, une femme dans la soixantaine, et ce couple bizarre s’installe dans une grande discrétion. Mouret remarque la pauvreté de l’abbé : « Avez-vous vu le derrière de sa soutane, quand il s’est tourné ?… Ça m’étonnerait beaucoup, si les dévotes couraient après celui-là. Il est trop râpé ; les dévotes aiment les jolis curés. ». Au contraire, la première impression de Marthe est bonne : « Sa voix a de la douceur, dit Marthe, qui était indulgente ». Quant au curé, il contemple Plassans depuis son premier étage, et défie la ville dans une scène qui semble déjà une parodie zolienne, puisqu’on dirait la réduction de la scène de Saccart défiant Paris depuis Montmartre : « L’abbé Faujas tendit les bras d’un air de défi ironique, comme s’il voulait prendre Plassans pour l’étouffer d’un effort contre sa poitrine robuste. Il murmura : — Et ces imbéciles qui souriaient, ce soir, en me voyant traverser leurs rues ! »
Chapitre III Mouret, qui « était d’esprit fin, sous son épaisseur de commerçant retiré », « Bien qu’il fît l’esprit fort, qu’il se déclarât voltairien, avait en face de l’abbé tout un étonnement, un frisson de bourgeois, où perçait une pointe de curiosité gaillarde. » Il se met à épier le fort discret abbé, ordonne même à ses garçons de le suivre en ville, à sa bonne d’espionner, à sa fille de lancer sa balle par la fenêtre, n’apprend rien, et s’apaise en apprenant que la mère de l’abbé a payé six mois d’avance.
Chapitre IV Un jour enfin Faujas demande à son logeur de venir constater une fuite, et Mouret en profite pour causer (alors que l’abbé se contente de répondre par gestes). Il jouit de voir enfin cette « chambre [qui] avait pour lui, esprit fort, une odeur particulière. Elle sentait le prêtre, pensait-il ; elle sentait un homme autrement fait que les autres, qui souffle sa bougie pour changer de chemise, qui ne laisse traîner ni ses caleçons ni ses rasoirs. » Accoudés à la fenêtre, ils assistent à l’arrivée des invités du traditionnel repas du mardi soir du riche voisin M. Rastoil, que des personnalités locales, ainsi qu’à une réception à la sous-préfecture, la maison Mouret étant située entre les deux (raison du choix de Faujas, comme on l’apprendra plus tard). « Nous ne recevons personne », se vante Mouret tout en présentant les invités du sous-préfet Péqueur des Saulaies et en expliquant la politique locale au curé, lequel, fidèle à son habitude, se contente d’écouter et de relancer les confidences. « Imaginez-vous qu’à tort ou à raison je passe pour un républicain. Je cours beaucoup les campagnes, à cause de mes affaires ; je suis l’ami des paysans ; on a même parlé de moi pour le conseil général ; enfin, mon nom est connu… Eh bien ! j’ai là, à droite, chez les Rastoil, la fine fleur de la légitimité, et là, à gauche, chez le sous-préfet, les gros bonnets de l’empire. Hein ! est-ce assez drôle ? […] J’ai toujours peur qu’ils ne se jettent des pierres par-dessus mes murs… […] Plassans est fort curieux, au point de vue politique. Le coup d’État a réussi ici, parce que la ville est conservatrice. Mais, avant tout, elle est légitimiste et orléaniste, si bien que, dès le lendemain de l’empire, elle a voulu dicter ses conditions. Comme on ne l’a pas écoutée, elle s’est fâchée, elle est passée à l’opposition. […] L’année dernière, nous avons nommé député le marquis de Lagrifoul, un vieux gentilhomme d’une intelligence médiocre, mais dont l’élection a joliment embêté la sous-préfecture… »
Chapitre V Félicité, la mère de Marthe, 66 ans, fait une visite inopinée. Elle ne s’entend guère avec Mouret, son ancien commis enrichi, et ils s’échangent des piques. Elle s’efforce d’être aimable et de l’engager à se joindre à ses soirées où l’on ne parle politique que dans les coins : « Mon salon est un terrain neutre ». En fait, Félicité est surtout venu à propos de l’abbé Faujas, qu’elle souhaite inviter. L’oncle Macquart, le vieil alcoolique, rend visite par hasard en même temps, ce qui contrarie Félicité qui craint les médisances. Il donne des nouvelles d’Adélaïde, « la mère de Rougon et de Macquart, enfermée depuis plusieurs années comme folle, à la maison des aliénés des Tulettes », à côté de chez lui. Mouret se dit que « Ce curé-là n’est pas venu pour rien de Besançon à Plassans. Il y a quelque manigance là-dessous. », ce en quoi il a raison, mais ne s’en doute pas. Le narrateur omniscient par contre, vend la mèche, de sorte que le lecteur en sait plus que les personnages. Mouret dresse un portrait peu flatteur des Rougon-Macquart : « Vois-tu, mon père avait raison de dire que la famille de ma mère, ces Rougon, ces Macquart, ne valaient pas la corde pour les pendre. […] Ils ont fait fortune aujourd’hui, mais ça ne les a pas décrottés, au contraire. » L’abbé Bourrette croit naïvement que Faujas est bête, et se fait manipuler. Il obtient que Faujas accepte l’invitation de Félicité à son salon.
Chapitre VI L’apparition de Faujas dans le salon de Félicité se solde par un fiasco complet ; il est « trait[é] en paria ». Zola sous-traite à un personnage anonyme entendu par l’abbé enfoui dans un fauteuil, le récit de l’ascension de Félicité, que le lecteur de La Fortune des Rougon connaît déjà : « Elle la [la maison] couvait des yeux depuis près de dix ans, prise d’une envie furieuse de femme grosse, se rendant malade à regarder les rideaux riches qui pendaient derrière les glaces des fenêtres. » « envie furieuse de femme grosse » est en effet une expression typiquement zolienne ! L’anonyme est en fait M. de Condamin, et Faujas se compromet en lui prêtant l’oreille : « Cet abbé nouvellement arrivé à Plassans lui semblait un excellent auditeur ; d’autant plus qu’il avait une vilaine mine, une mine d’homme bon à tout entendre, et qu’il portait une soutane vraiment trop usée pour que les confidences qu’on se permettrait avec lui pussent tirer à conséquence. » Condamin décrit Plassans ainsi : « Voyez-vous, à Plassans, le peuple n’existe pas, la noblesse est indécrottable ; il n’y a de tolérable que quelques parvenus, des gens charmants qui font beaucoup de frais pour les hommes en place. Notre petit monde de fonctionnaires est très heureux. Nous vivons entre nous, à notre guise, sans nous soucier des habitants, comme si nous avions planté notre tente en pays conquis. » Cette mauvaise langue apprend à l’abbé et au lecteur les cancans de Plassans ; l’ancienne liaison de Mme Rastoil avec M. Delangre, leurs enfants adultérins. Le lecteur est informé à la fin du chapitre de la véritable mission de l’abbé, par Félicité : « Lorsque la personne que vous savez m’a écrit de Paris, j’ai cru vous être utile en vous invitant ». Elle lui donne quelques conseils, qui paraissent évidents au lecteur, surtout que l’abbé est censé déjà bénéficier du soutien de sa mère, qui aurait pu lui dire ces choses : changer de soutane, et réussir par les femmes.
Chapitre VII Faujas et sa mère s’humanisent. Le don accepté de « deux poires » symbolise ironiquement le dégel des relations de voisinage, puis on accepte de passer la soirée ensemble, au chaud. Faujas étrenne une soutane neuve, et Mouret joue au piquet avec Mme mère, qui est plus forte que lui, ce qui soulage Marthe qui détestait ce jeu, et Marthe cause avec l’abbé. Cela devient une habitude. Zola en profite pour rappeler l’ascendance de Marthe et François : « — Mais vous êtes cousin et cousine ? demanda le prêtre.
— En effet, dit-elle en rougissant légèrement, mon mari est un Macquart, moi je suis une Rougon. » […] Les Macquart étaient une branche bâtarde des Rougon. « — Le plus singulier, reprit-elle pour cacher son embarras, c’est que nous ressemblons tous les deux à notre grand-mère. La mère de mon mari lui a transmis cette ressemblance, tandis que, chez moi, elle s’est reproduite à distance. On dirait qu’elle a sauté par-dessus mon père. ». À propos de la grand-mère, tante Dide, Marthe a peur de l’hérédité de la folie, au sujet de sa fille Désirée (mais non pour elle-même, évidemment !) : « Et elle reparlait souvent des Tulettes, avec une peur sourde de la folie. » Très vite, lors d’une de ces soirées, Faujas profite d’une discussion sur un fait divers pour glisser la grande idée qui va lui permettre de conquérir Plassans : « une bande de toutes jeunes filles, presque des enfants, avaient glissé à la débauche en galopinant dans les rues ». L’abbé suggère d’édifier « une maison pieuse, sur le modèle de celle qui existe à Besançon », permettant aux « pauvres enfants » de grandir « loin du vice ».
Chapitre VIII Sans perdre de temps, Marthe déploie une énergie formidable pour la maison de la Vierge, malgré quelques réticences, par exemple le juge Paloque : « Des petites coquines ! s’écria-t-il, lorsque Marthe eut parlé des filles du vieux quartier. […] Ce sont elles qui ont provoqué à la débauche des gens très honorables… Vous avez tort, madame, de vous intéresser à cette vermine-là. » Faujas, au lieu de la féliciter, la rabroue pour un détail : « Pour tout prêtre, la femme, c’est l’ennemie » conclut le narrateur. Faujas, qui n’est « qu’un humble vicaire de Saint-Saturnin » marque des points contre « l’abbé Fenil, […] le grand vicaire » ; tous les deux se disputent la préférence de l’évêque, l’un soutenu par Paris, l’autre par Rome. On salue désormais Faujas depuis les deux propriétés voisines et rivales.
Chapitre IX Marthe délaisse sa maison et ses enfants, et Mouret lui en fait le reproche : « Ah ! tu es bien bête ! t’éreinter pour un tas de gueuses qui se moquent de toi, qui ont des rendez-vous dans tous les coins des remparts ! Va donc te promener, un soir, du côté du Mail, tu les verras avec leur jupon sur la tête, ces coquines que tu mets sous la protection de la Vierge… » Sans que l’abbé se mette en peine de parler religion, l’extase religieuse la gagne progressivement, par l’architecture d’abord, façon Bovary lors de ses retours de foi : « les ombres, montant le long des piliers comme des housses de serge, prenaient pour elle des délicatesses de soie changeante, tout un évanouissement exquis qui la gagnait, au fond duquel elle sentait son être se fondre et mourir ». Un jour, c’est la « conversion », Marthe se confesse à l’abbé Bourrette. Faujas a refusé d’être lui-même son confesseur : « Plus tard, je vous donnerai peut-être une autre réponse. » À la maison, les parties de piquet cessent, et Mouret formule de vagues sarcasmes sur les abbés qui fréquentent les maisons voisines, que Marthe et Faujas n’entendent pas, concentrés sur leurs conciliabules.
Chapitre X L’Œuvre de la Vierge est inaugurée, et c’est le triomphe de Faujas, qui a gagné les dames, à l’exception de Mme Paloque, que l’évêque a oubliée dans ses remerciements. Arrivée de la sœur de l’abbé et de son mari, qui se font loger à l’étage, assignés à résidence par l’abbé, qui ne les porte guère dans son cœur chrétien : « Trouche est un garnement, et Olympe, une sans-cœur ». Le déclassement de Mouret s’accélère. Au début du chapitre il semble lucide, mais bizarrement, n’en tire aucune conclusion, pas plus qu’aucun personnage parmi l’élite de Plassans : « — On n’est plus chez soi, murmurait-il. Je ne puis lever les yeux, maintenant, sans apercevoir cette soutane… Il est comme les corbeaux, ce gaillard-là ; il a un œil rond qui semble guetter et attendre quelque chose. Je ne me fie pas à ses grands airs de désintéressement. » Et puis « Rose était devenue toute-puissante au logis. Elle bousculait Mouret, le grondait, parce qu’il salissait trop de linge, le faisait manger quand le dîner était prêt. Elle entreprit même de travailler à son salut. — Madame a bien raison de vivre en chrétienne, lui disait-elle. Vous serez damné, vous, monsieur, et ce sera bien fait, parce qu’au fond vous n’êtes pas bon ; non, vous n’êtes pas bon !… […] Mouret haussait les épaules. Il laissait les choses aller, se mettant lui-même au ménage, donnant un coup de balai, quand la salle à manger lui paraissait trop sale. » Le coup de balai dans la maison commence par le départ d’Octave : « Octave est insupportable. Jamais il ne sera bachelier. Il vaut mieux lui apprendre tout de suite à gagner sa vie que de le laisser flâner avec un tas de gueux. » Son père le place dans « une maison de commerce de Marseille », puis prévoit que les deux autres enfants suivront, et annonce avec lucidité le désastre à venir : « il faut faire de la place pour tout ce monde qui vit dans notre maison. Elle n’est plus assez grande, notre maison. Ce sera heureux, si l’on ne nous met pas à la porte nous-mêmes. » Malgré ces reproches, ce sera la dernière note d’amour entre les deux époux, superbe instantanné de l’incommunicabilité du couple : « Sa voix s’attendrissait, il était près lui-même de sangloter. Marthe, navrée, touchée au cœur par ses dernières paroles, allait se jeter dans ses bras. Mais ils eurent peur d’être vus, ils sentirent comme un obstacle entre eux. Alors, ils se séparèrent ».
Chapitre XI La mort de l’abbé Compans est l’occasion d’une grande scène qui pose enfin Faujas en affairiste sans scrupule. Dans l’intimité de l’évêque, il arrache sa nomination comme successeur de l’abbé disgracié qui était la bête noire de l’abbé Fénil. Tous deux sont parfaitement au courant des ambitions de Faujas : « Fenil vous déteste ; le succès de l’œuvre de la Vierge l’a rendu tout à fait furieux ; il jure qu’il vous empêchera de conquérir Plassans ». L’évêque, qui ne s’intéresse plus qu’aux humanités, est ennuyé par cette rivalité, mais se doute que Paris, que Faujas représente officieusement, l’emportera sur Rome et sur Fénil dans cette partie de poker. Zola glisse entre les lignes une de ses innombrables sorties sur l’efféminement des faibles, en évoquant l’« aisance toute féminine avec laquelle monseigneur Rousselot changeait de maître et se livrait au plus fort ». Faujas fait son retour triomphal dans le salon Rougon, félicité hautement par l’abbé Bourrette qu’il vient de rouler, et que l’évêque a berné en lui faisant croire que s’il avait nommé Faujas abbé à sa place, c’était pour vexer Fénil, et qu’il lui réservait une meilleure promotion.
Chapitre XII Le rapprochement entre les deux partis antagonistes de part et d’autre du jardin de Mouret continue grâce à une seconde occasion qui va permettre à Faujas, après avoir gagné ces dames, de se gagner la jeunesse mâle. « Le docteur était dans un grand souci : son garnement de fils venait d’être surpris, avec une bande d’autres vauriens, dans une maison suspecte, derrière les prisons. » Le juge a eu des mots vexants, et le docteur demande à Faujas d’intervenir. Faujas traverse donc le jardin non seulement pour réconcilier les deux partis, mais pour proposer l’idée d’un « cercle de la Jeunesse », et doit préciser ses vues : « je compte bien laisser la religion à la porte. Nous voulons distraire honnêtement la jeunesse, la gagner à notre cause, rien de plus. » La fondation se fait aussitôt dans le même chapitre, et c’est un deuxième succès. Nouvelle étape : pour recevoir les félicitations des deux partis en terrain neutre, l’abbé décloue symboliquement la porte du jardin sur l’impasse qui relie les trois propriétés, ce que Mouret, désormais impuissant à détourner le cours des choses, commente laconiquement : « — Eh bien ! les voilà chez moi maintenant, murmura-t-il. Il ne manque plus que le curé amène ici les deux bandes ! »
Chapitre XIII Le sort de Serge, dix-neuf ans, occupe le chapitre. Il vit cloîtré, lit trop au goût de son père, est choyé par l’abbé Faujas, et cela ne vous étonnera pas que Zola nous l’effémine : « le jeune homme était d’un tempérament si nerveux, qu’il avait, à la moindre imprudence, des indispositions de fille, des bobos qui le retenaient dans sa chambre pendant deux ou trois jours ». Rose le chouchoute et le qualifie de « mignon », face à son père exaspéré : « J’aimerais mieux qu’il allât voir les femmes ! […] Et je l’y mènerai moi-même, si vous me poussez à bout avec votre prêtraille ! ». Mouret se fait déposséder de sa parentalité, et ce sont les pages les plus émouvantes du livre, qui font de Mouret le jumeau de Charles Bovary : « Tant que son fils fut en danger, Mouret, assombri, les yeux rouges de larmes, rôda silencieusement dans la maison. Il montait rarement, piétinait dans le vestibule, à attendre le médecin à sa sortie. Quand il sut que Serge était sauvé, il se glissa dans la chambre, offrant ses services. Mais Rose le mit à la porte. On n’avait pas besoin de lui ; l’enfant n’était pas encore assez fort pour supporter ses brutalités ; il ferait bien mieux d’aller à ses affaires, que d’encombrer ainsi le plancher. Alors, Mouret resta tout seul au rez-de-chaussée, plus triste et plus désoeuvré ; il n’avait de goût à rien, disait-il. Quand il traversait le vestibule, il entendait souvent, au second, la voix de l’abbé Faujas, qui passait les après-midi entières au chevet de Serge convalescent. — Comment va-t-il aujourd’hui, monsieur le curé ? demandait Mouret au prêtre timidement, lorsque ce dernier descendait au jardin. » Puis lors de la guérison de son fils, superbe scène brève et puissante : « Serge lui-même l’inquiétait. Il ressemblait à une fille, dans ses linges blancs. Ses yeux s’étaient agrandis ; son sourire était une extase douce des lèvres, qu’il gardait même au milieu des plus cruelles souffrances. Mouret n’osait plus parler de Paris, tant le cher malade lui paraissait féminin et pudique. Une après-midi, il était monté en étouffant le bruit de ses pas. Par la porte entre-bâillée, il aperçut Serge au soleil, dans un fauteuil.
Le jeune homme pleurait, les yeux au ciel, tandis que sa mère, devant lui, sanglotait également. Ils se tournèrent tous les deux, au bruit de la porte, sans essuyer leurs larmes. Et, tout de suite, de sa voix faible de convalescent :
— Mon père, dit Serge, j’ai une grâce à vous demander. Ma mère prétend que vous vous fâcherez, que vous me refuserez une autorisation qui me comblerait de joie… Je voudrais entrer au séminaire.
Il avait joint les mains avec une sorte de dévotion fiévreuse.
— Toi ! toi ! murmura Mouret.
Et il regarda Marthe qui détournait la tête. Il n’ajouta rien, alla à la fenêtre, revint s’asseoir au pied du lit, machinalement, comme assommé sous le coup.
— Mon père, reprit Serge au bout d’un long silence, j’ai vu Dieu, si près de la mort ; j’ai juré d’être à lui. Je vous assure que toute ma joie est là. Croyez-moi, ne me désolez point.
Mouret, la face morne, les yeux à terre, ne prononçait toujours pas une parole. Il fit un geste de suprême découragement, en murmurant :
— Si j’avais le moindre courage, je mettrais deux chemises dans un mouchoir et je m’en irais. Puis, il se leva, vint battre contre les vitres du bout des doigts.
Comme Serge allait l’implorer de nouveau :
— Non, non ; c’est entendu, dit-il simplement. Fais-toi curé, mon garçon. »
Pas un mot de trop ! Et si c’était là la « scène centrale », dont Flaubert regrette l’absence ? (cf. ci-dessous) Faujas renforce son emprise sur les femmes : « Elles le trouvaient bien un peu rude par moments ; mais cette brutalité ne leur déplaisait pas, surtout dans le confessionnal, où elles aimaient à sentir cette main de fer s’abattre sur leur nuque. » Mais en même temps, les Trouche se rebellent, et défient leur frère, apitoient Marthe et obtiennent de s’installer dans la chambre de Serge. À la fin du chapitre, comme d’habitude, une avanie nouvelle scande la dépossession de Mouret, qui oubliant la présence des Trouche, s’excuse d’être entré dans « leur » chambre.
Chapitre XIV Mme Paloque reste en retrait et fait sa mauvaise langue, qui parfois dit la vérité sans le savoir : « On prétend que l’abbé Faujas est un agent politique. » Une longue et belle scène sera l’occasion du rapprochement décisif entre les deux factions rivales, dans l’impasse entre les trois propriétés. C’est la partie de volant entre le jeune abbé Surin et les filles Rastoil. Comme d’habitude, Zola fait de l’abbé une vraie caricature homophobe, ce qui disqualifie tant soit peu son anticléricalisme : « L’abbé Surin, rose comme une fille, s’essuyait délicatement le front, à petites tapes, avec un fin mouchoir. Il rejetait ses cheveux blonds derrière les oreilles, les yeux luisants, la taille souple, se servant de sa raquette comme d’un éventail. Dans le feu du plaisir, son rabat avait légèrement tourné. […] L’abbé Surin, les cheveux au vent, les manches de la soutane retroussées, montrant ses poignets blancs et minces comme ceux d’une femme ». Un malaise de l’abbé efféminé est l’occasion de la réconciliation finale, et de l’installation des deux partis dans le jardin Mouret. Rose va chercher des chaises, et les voilà dans le jardin dont le propriétaire se cache.
Chapitre XV Marthe s’enfonce dans l’extase religieuse, jouissant d’être maltraitée par l’abbé : « Elle était heureuse de ces coups. La main de fer qui la pliait, la main qui la retenait au bord de cette adoration continue, au fond de laquelle elle aurait voulu s’anéantir, la fouettait d’un désir sans cesse renaissant. […] Ce grand repos qu’elle avait d’abord goûté dans l’église, cet oubli du dehors et d’elle-même, se changeait en une jouissance active […]. C’était le bonheur dont elle avait vaguement senti le désir depuis sa jeunesse, et qu’elle trouvait enfin à quarante ans ». Mouret continue sa descente. Au début du chapitre, il « tenait les deux femmes par l’argent », et l’avarice sordide dont il fait preuve noircit son portrait. Marthe, grâce à une scène, aura tôt fait d’obtenir la clé du secrétaire où Mouret serre son argent. Olympe Trouche, flairant l’occasion, invente une histoire abracadabrante de maître chanteur de Besançon qui en voudrait à elle et à son mari, et quand elle dit que la réputation de Faujas pourrait en pâtir, elle obtient de Marthe le don de plus que tout ce qu’elle possède. C’est donc pour Olympe, et pour Faujas, que Marthe fait une scène et obtient de son mari de pouvoir dilapider l’argent du ménage. Avant cela, une idée sombre lui avait traversé son peu de cervelle : « Les yeux fixes, elle pensait qu’il lui faudrait attendre la mort de Mouret, pour disposer d’une pareille somme. » Faujas accepte enfin de confesser Marthe, mais en prenant des dispositions, comme le choix d’une chapelle particulière, au décor moins austère, pour éviter d’encourager ses tendances morbides : « Là, il la dominerait, il en ferait une esclave soumise, sans avoir à craindre un scandale possible. D’ailleurs, pour couper court à tous les mauvais bruits, il voulut que sa mère accompagnât Marthe. » Mme Paloque s’imagine pouvoir surprendre un scandale, et exige d’entrer dans la chapelle, ce qui donne lieu à un quiproquo, car la mère Faujas, qui de son côté avait imaginé la même chose, défend de son corps l’entrée de la chapelle, au risque d’entretenir l’erreur de Paloque. L’abbé sort au tapage, et a beau jeu de détromper la cancanière, et fait la leçon à sa mère, dont il découvre, comme le dit Flaubert, qu’elle serait prête à faire la maquerelle pour lui : « Vous vous trompez, mère… Les hommes chastes sont les seuls forts. »
Chapitre XVI La déchéance de Mouret et du ménage se poursuit. Comme Désirée, délaissée, joue dans le jardin, elle se salit. « Mouret, un jour, dut prendre une aiguille ; la robe fendue par derrière, du haut en bas, montrait sa peau. Marthe finit par avoir une sorte de dégoût. » Mouret finit par emmener Désirée chez sa nourrice, et menace de s’en aller bientôt, ce qui n’apitoie guère Marthe, l’excite plutôt : « Dans cette nature si longtemps soumise, des colères inconnues soufflaient ; une haine grandissait contre cet homme qui rôdait sans cesse autour d’elle, pareil à un remords. » Nouvelle étape, Rose propose à Mme Faujas de faire cuisine commune, et en quelques jours, on a tôt fait de ne plus seulement partager les instruments de cuisson, mais on prépare un seul repas, et on offre à l’abbé la meilleure place à table, celle de Mouret, qu’on prive des meilleurs morceaux au profit de l’abbé, qui ne peut plus même voir son jardin en mangeant, et n’ose plus boire son vin. Trouche retombe dans l’ivrognerie, mais Faujas négocie un arrangement avec lui, qu’il utilise ses beuveries pour aller « dans le vieux quartier faire de la propagande pour l’abbé ». Tandis que les deux sociétés désormais s’installent à demeure dans le jardin sur des chaises neuves achetées tout exprès, Mouret se claquemure dans son cabinet, où il demeure « les bras ballants ».
Chapitre XVII Sur le conseil de son médecin, inquiet de sa toux, Marthe fait des promenades. Un jour elle tombe par hasard sur l’oncle Macquart (où l’on voit l’utilité des personnages secondaires appartenant au cycle), qui l’inquiète en lui montrant la chambre de tante Dide aux Tulettes : « toute la clique y viendra peut-être un jour, puisque la maman y est… ». Elle cesse ses promenades, et sa santé mentale en prend un coup. Elle exprime son amour pour l’abbé en termes clairs : « — Qui me donnera des ailes pour voler vers vous ? Mon âme, éloignée de vous, impatiente d’être remplie de vous, languit sans vous, vous souhaite avec ardeur, et soupire après vous, ô mon Dieu, ô mon unique bien, ma consolation, ma douceur, mon trésor, mon bonheur et ma vie, mon Dieu et mon tout… » Faujas en profite : « À partir de ce jour, il la mania ainsi qu’une cire molle. […] Il ne prenait même plus aucune précaution avec elle, lui faisait crûment sa leçon, se servait d’elle comme d’une pure machine. » Pourtant il la méprise et la hait en tant que femme. Il refuse de se servir d’une douzaine de mouchoirs qu’elle a brodés pour lui, en disant à sa mère : « Ce sont des mouchoirs de femme. Ils ont une odeur qui m’est insupportable. » Évidemment, ce genre de trait caricatural est à lire avec le prisme de la haine de Zola pour les curés et l’actualité politique de 1873. Marthe repousse de plus en plus son mari : « sa haine grandissait surtout contre son mari. Le vieux levain de rancune des Rougon s’éveillait en face de ce fils d’une Macquart ». C’est dans ce chapitre que Zola reprend sa nouvelle sur le trio amoureux, mais en changeant la donne. Dans sa nouvelle, la femme simulait la folie pour faire interner son mari en prétendant qu’il la bat, alors que dans le roman, Marthe a réellement des accès de « folie lucide », elle se frappe et se blesse elle-même et en a honte, mais les autres habitants croient que c’est son mari qui la bat, et par haine ou par intérêt, colportent ce bruit, et Marthe ne les détrompe que mollement. Trouche déclare que « Monsieur Mouret est fou », puis Félicité le croit et veut protéger sa fille : « Les fous, on les enferme ! »
Le Chapitre XVIII commence par une scène invraisemblable où Mouret, qui sort un dimanche comme tous les dimanches, constate un jour que tout le monde médit derrière lui, et sa présence déchaîne de véritables mouvements de foule, jusqu’à des garnements qui le poursuivent et le harcèlent. Même ses amis commerçants le prennent pour un fou. Ce qui est peu vraisemblable est qu’on passe de l’itératif à une scène où toute la ville, qui le connaît pourtant bien, le harcèle brusquement. Il se pose là un problème de transition. En tout cas l’effet boule de neige fonctionne : « À partir de ce dimanche, tout Plassans fut convaincu que Mouret était fou à lier. » En fait Zola reprend le principe du roman précédent, où le bouche à oreille enfle les faits, et crée de toute pièce à l’inoffensif Florent une réputation de meurtrier sanguinaire. Le dossier de la Pléiade transcrit une note de régie de Zola dans son ébauche, qui prouve que ces effets sont voulus : « Un grand morceau d’analyse, mais d’analyse en action, pour montrer que rien n’a plus l’air d’un fou qu’un homme possédant tout son bon sens. Multiplier les faits. Prendre le cadre d’une journée, peut-être. Faire voir que la logique devient de la folie pour certains bourgeois de province. Cette partie, la plus originale, doit avoir du développement. Il faut la mêler intimement au récit, aux autres personnages ». Zola va plus loin, il fait en sorte que le docteur Porquier lui-même appuie la thèse de la « folie lucide » de Mouret, et non de Marthe. Mieux, M. de Condamin a lui aussi lu l’ouvrage de médecine sur la « folie lucide » que Zola a utilisé, et l’a lu « comme un roman » ; on a là une sorte de mise en abyme d’une documentation mal maîtrisée, ou utilisée à mauvais dessein. Comme M. de Condamin s’obstine à soutenir Mouret, sa femme le remet à l’endroit en appuyant sur son point faible, son goût pour les petites filles (motif que Zola a déjà utilisé dans La Curée pour un sénateur) : « Madame de Condamin n’ignorait pas qu’il avait des tendresses pour une petite fille, du côté de Saint-Eutrope. Mais elle était tolérante ». Très belle scène cinématographique où « les deux sociétés convinrent de veiller un soir, jusqu’à minuit » et surprennent Mouret inspectant ses salades avec une bougie en main. Ils font de la bougie un cierge, et de Mouret un fou fieffé, alors que M. Rastoil, qui n’a pas compris le but de la manœuvre, explique qu’il s’agit de simples limaces, et « qu’on ne les détruit bien que la nuit ». Cela me fait penser à une scène du film L’Arbre aux sabots où un vieil homme soigne ses tomates de nuit pour les avoir mûres avant ses voisins. Cela finit par l’internement de Mouret pendant que Marthe est alitée, et toute la maisonnée conspire à cette infamie.
Chapitre XIX Les élections avancent, et l’évêque, qui est allé prendre ses ordres à Paris, a compris qu’il fallait soutenir Faujas dont il a appris l’histoire : « Il avait eu des difficultés à Besançon… Il était à Paris, très pauvre, dans un hôtel garni. C’est lui qui est allé s’offrir. Le ministre cherchait justement des prêtres dévoués au gouvernement. » Pour enfoncer le clou anticlérical, Zola nous place à nouveau « la voix féminine du jeune abbé [Surin] qui scandait amoureusement des strophes d’Anacréon ». Faujas ratisse l’opinion publique en faisant feu de toute bois. Trouche répand ainsi le bruit que « le pauvre Mouret » aurait été interné « dans le but de priver le parti démocratique d’un de ses chefs les plus honorables ». De son côté l’abbé multiplie ses sorties dans le Cercle de la jeunesse et l’œuvre de la Vierge, pour séduire les jeunes des deux sexes à la façon dont Chirac vous tâte au salon de l’agriculture le cul des vaches ou Sarkozy celui des homos aux Bains douches. L’alliée la plus puissante de l’abbé est Mme de Condamin (et c’est Félicité, qui se tient à l’écart, qui le lui signale). Grâce à des amitiés parisiennes, elle peut obtenir des places et des rubans rouges. Elle retourne Mme Paloque comme une crêpe par la promesse d’une légion d’honneur et d’une promotion pour son mari, et solidifie le retournement de M. Rastoil par l’avancement de son fils, c’est-à-dire le pardon tant attendu d’avoir jadis soutenu l’opposition. Les faux-ennemis se retrouvent toujours à l’arrière des propriétés chez les Mouret : « On se serrait la main, sur le derrière des maisons, dans les jardins, tout en se dévorant, sur les façades. ». La stratégie de l’abbé est complexe : primo, le sous-préfet ne présente aucun candidat officiel, ce qui laisse croire que Plassans choisira son candidat elle-même. Secundo, trois candidats (qu’on appellerait maintenant « sous-marins ») se présentent, de façon à noyer le poisson : « Le marquis de Lagrifoul, M. de Bourdeu, le chapelier Mourin, semblaient devoir se partager les voix en trois tiers à peu près égaux ; il y aurait certainement ballottage, et Dieu savait quel nom sortirait au second tour ! » Tertio, Faujas a trouvé l’oiseau rare qui sortira du chapeau au dernier moment, et voilà sur quel critère cynique : « Ce qui m’a décidé, enfin, ce sont les histoires qu’on m’a contées de sa fortune. Il aurait repris trois fois sa femme, trouvée en flagrant délit, après s’être fait donner cent mille francs chaque fois par son bonhomme de beau-père. S’il a réellement battu monnaie de cette façon, c’est un gaillard qui sera très utile à Paris pour certaines besognes… ». Il s’agit du maire Delangre, qui « devenait le Messie attendu, le sauveur ignoré la veille, révélé le matin et adoré le soir. » La victoire est écrasante : « La ville crut qu’elle venait de faire un rêve héroïque, qu’une main puissante avait dû frapper le sol pour en tirer ces trente-trois mille électeurs, cette armée légèrement effrayante, dont personne jusque là n’avait soupçonné la force. »
Chapitre XX Après son triomphe, Faujas est gêné par Marthe. Il manigance de l’envoyer prendre l’air à Nice, mais pour la première fois elle se rebelle : « Elle refusait de quitter Plassans, avec une énergie si désespérée, que le prêtre lui-même comprit le danger d’insister sur ce projet. Elle commençait à l’embarrasser terriblement dans son triomphe. » On ne comprend vraiment pas pourquoi Faujas décide de rester dans cette maison, qui ne lui sert plus à rien. Olympe et son mari prennent pleinement possession de la maison Mouret. Olympe se livre à un véritable pillage : « À cet effet, elle avait cousu de grandes poches de toile, qu’elle attachait sous sa jupe et qu’elle mettait un bon quart d’heure à vider chaque soir. ». À tel point que la mère Faujas en fait autant, et que l’abbé la sermonne et lui fait tout rendre : « — Quelle honte ! cria-t-il. Vous voilà voleuse, maintenant ! Et qu’arriverait-il, si l’on vous surprenait ? Je serais la fable de la ville. » Le personnage continue d’être extraordinaire, car on a du mal à comprendre qu’il laisse piller sa sœur, ce qui l’arrange donc. Il laisse même pire : les deux époux aiment la compagnie de la jeunesse : « Guillaume Porquier vint avec des bandes de tout jeunes gens. Olympe, malgré ses trente-sept ans, minaudait, et plus d’un collégien échappé la serra de fort près, ce qui lui donnait des rires de femme chatouillée et heureuse. […] La vérité était que Trouche avait failli compromettre cette vie de cocagne par une escapade trop forte. Une religieuse l’avait surpris en compagnie de la fille d’un tanneur, de cette grande gamine blonde qu’il couvait des yeux depuis longtemps. La petite raconta qu’elle n’était pas la seule, que d’autres aussi avaient reçu des bonbons. » Faujas évince officieusement l’évêque et se néglige, redevient aussi sauvage qu’à ses débuts : « Sa face redevenue terreuse avait des regards d’aigle ; ses grosses mains se levaient, pleines de menaces et de châtiments. La ville fut positivement terrifiée, en voyant le maître qu’elle s’était donné grandir ainsi démesurément, avec la défroque immonde, l’odeur forte, le poil roussi d’un diable. La peur sourde des femmes affermit encore son pouvoir. Il fut cruel pour ses pénitentes, et pas une n’osa le quitter ; elles venaient a lui avec des frissons dont elles goûtaient la fièvre. — Ma chère, avouait madame de Condamin à Marthe, j’avais tort en voulant qu’il se parfumât ; je m’habitue, je trouve même qu’il est beaucoup mieux… Voilà un homme ! » Marthe s’enfonce dans la folie religieuse : « Marthe quittait l’église avec la colère d’une femme dédaignée. Elle rêvait des supplices pour offrir son sang […]. Puis, rentrée chez elle, elle n’avait d’espoir qu’en l’abbé Faujas. Lui seul pouvait la donner à Dieu ; il lui avait ouvert les joies de l’initiation, il devait maintenant déchirer le voile entier. » La vieille Félicité intervient auprès de l’abbé comme s’il était son gendre : « Je vous ai aidé, non pas pour vos beaux yeux, mais pour être agréable à nos amis de Paris. On m’écrivait de vous piloter, je vous pilotais… Seulement, retenez bien ceci : je ne souffrirai pas que vous veniez faire le maître chez moi. […] Mon mari a conquis Plassans avant vous, et nous garderons Plassans. » Les Rougon songent à « évincer l’abbé pour bénéficier de son succès. Maintenant que la ville votait correctement […] ». Comme elle n’obtient rien de l’abbé, Marthe fait le constat que « Votre ciel est fermé. Vous m’avez menée jusque-là pour me heurter contre ce mur… ». Elle désire reprendre sa vie d’avant, et reconnaît sa faute à l’égard de son mari : « Jamais il ne m’a battue, le malheureux ! C’était moi qui étais folle. » Elle finit par avouer clairement son désir, ce qui fait exprimer à Faujas clairement sa conception de la femme : « Nous n’avons rien dit tout haut, c’est vrai. Mais mon amour parlait et votre silence répondait. […] Je vous aime, Ovide, je vous aime, et j’en meurs. Elle sanglotait. L’abbé Faujas avait redressé sa haute taille, il s’approcha de Marthe, laissa tomber sur elle son mépris de la femme. — Ah ! misérable chair ! dit-il. Je comptais que vous seriez raisonnable, que jamais vous n’en viendriez à cette honte de dire tout haut ces ordures… Oui, c’est l’éternelle lutte du mal contre les volontés fortes. Vous êtes la tentation d’en bas, la lâcheté, la chute finale. Le prêtre n’a pas d’autre adversaire que vous, et l’on devrait vous chasser des églises, comme impures et maudites. » Marthe a l’idée de faire revenir François, et qu’il chasse tous les intrus.
Chapitre XXI Marthe part séance tenante avec Rose, sans dire où elle va. Elle abandonne la maison aux Trouche, qui s’en réjouissent. Elle va aux Tulettes, ce dont Rose est furieuse, car elle est toujours persuadée que « Monsieur » s’apprête à tuer toute la maisonnée. Grâce à l’oncle Macquart, Marthe peut voir François, qui d’abord lui parle très raisonnablement, avant d’être pris d’une crise de folie furieuse. Elle constate qu’il a pris sa maladie : « C’était elle qui avait fait ce misérable ». Elle-même est saisie d’une sorte de catalepsie en rentrant chez Macquart. Celui-ci dîne avec Rose, qui croît l’avoir vu dans l’ombre discuter avec un curé en soutane. Marthe se réveille de sa torpeur et exige qu’il la raccompagne en voiture immédiatement. Il est bien obligé, et la ramène sous la pluie, ce qui n’améliore pas son état. Arrivés tard, ils trouvent les verrous de la maison tirés, et tapent en vain à la porte. On raccompagne donc Marthe chez ses parents, où elle est mourante.
Chapitre XXII Retour aux Tulettes. François se réveille de sa crise de folie, et trouve la porte de son cabanon ouverte. On comprend que c’est le résultat de ce conciliabule entre l’oncle Macquart et l’abbé Fenil, son voisin, qui ont manigancé de se venger ainsi de Faujas. Il fait à pied le chemin vers Plassans, et parvient à sa maison, qu’il trouve fermée. Il entre par le jardin, qu’il trouve tout changé, ses buis ôtés. Il écoute aux portes les Trouche, qui envisagent de chasser « la propriétaire », quitte à inventer que l’abbé couche avec elle. Trouche a cette réflexion : « Je crois que l’abbé aurait déjà changé de logement, s’il ne craignait que la propriétaire fît un scandale, en se voyant lâchée… » C’est un peu facile, et cela ne suffit pas à justifier cette fin de roman qui patine. En effet, vu le caractère de l’abbé, son mépris pour les femmes et Marthe, sa crainte réitérée que Marthe ne lui créât des problèmes, on ne comprend pas qu’il ne quitte pas la maison Mouret pour le logement de sa cure auquel il a droit, une fois qu’il n’a plus besoin de cette maison qui lui a permis de manipuler les deux sociétés ennemies de Plassans. La fin paraît artificielle, et fait passer l’ouvrage du roman politique à la nouvelle naturaliste, l’histoire d’un fou. Les notes nous apprennent d’ailleurs que dans son ébauche, Zola avait prévu de faire l’élection de Delangre après le drame, avant de changer son fusil d’épaule. Le dilemme était sans doute impossible à résoudre s’il voulait faire périr tous ses protagonistes en même temps. Le naturalisme a bon dos ! Bref, constatant l’absence de Marthe, François décide de mettre le feu à sa maison, et il le fait en fou, méthodiquement. Il assiste au spectacle, et quand la mère Faujas tente d’ôter l’abbé des flammes, il périt avec l’abbé.
Chapitre XXIII Le docteur Porquier appelé au chevet de Marthe, déclare que c’est « la phthisie […] compliqu[ée] d’une maladie nerveuse », et veille la mourante auprès de sa mère. Félicité envoie Rose chercher Serge au séminaire, tout en s’inquiétant des allures bizarres de l’oncle Macquart. Quand on apprend que la maison est incendiée et qu’on a vu François allumer l’incendie, elle saisit tout de suite ce qui s’est passé : « Combien l’abbé Fenil vous a-t-il donné pour ouvrir la porte à François ? » La scène de l’incendie est à grand spectacle : « En effet, l’incendie devenait superbe ». Les Rastoil, qui craignent que leur maison ne soit contaminée, sortent les meubles et sauvent l’argenterie, et l’on finit par s’asseoir dans les fauteuils pour assister aux efforts de la pompe toute neuve et des pompiers. Quand on comprend que c’est l’œuvre du fou échappé, c’est le comble : « Les yeux clignant d’une terreur délicieuse, se fixaient sur le brasier, avec le rêve du drame qui avait dû se passer là. » Le drame se mâtine de comédie : « M. Maffre venait de partir ; il avait aperçu, au milieu de la foule, ses deux fils, en compagnie de Guillaume Porquier, accourus tous les trois, sans cravate, d’une maison des remparts, pour voir le feu. Le juge de paix, qui était certain de les avoir enfermés à double tour dans leur chambre, emmena Alphonse et Ambroise par les oreilles. » L’épitaphe de Faujas est vite tirée par Mme Paloque : « personne ne le pleurera, si ce n’est cette grosse bête de Bourrette. Il était devenu insupportable, nous étions tous esclaves. Monseigneur doit rire à l’heure qu’il est. Enfin, Plassans est délivré ! » Quant à Macquart, il est dépité que les Rougon soient « enchantés » du mauvais tour qu’il avait cru leur jouer. Marthe expire, les yeux sur la soutane de son fils, ce qui annonce l’opus suivant, La Faute de l’abbé Mouret.
– Pour terminer, voici la lettre du 3 juin 1874 de Gustave Flaubert à Zola, où s’exprime l’admiration de l’auteur de Madame Bovary pour ce roman jumeau.
« Croisset près Rouen, 3 juin [1874].
Je l’ai lue, la Conquête de Plassans, lue tout d’une haleine, comme on avale un bon verre de vin, puis ruminée, et maintenant, mon cher ami, j’en peux causer décemment. J’avais peur, après le Ventre de Paris, que vous ne vous enfouissiez dans le système, dans le parti pris. Mais non ! Allons, vous êtes un gaillard ! Et votre dernier livre est un crâne bouquin !
Peut-être manque-t-il d’un milieu proéminent, d’une scène centrale (chose qui n’arrive jamais dans la nature), et peut-être aussi y a-t-il un peu trop de dialogues, dans les parties accessoires ! Voilà, en vous épluchant bien, tout ce que je trouve à dire de défavorable. Mais quelle observation ! quelle profondeur ! quelle poigne !
Ce qui me frappe, c’est d’abord le ton général du livre, cette férocité de passion sous une surface bonhomme. Cela est fort, mon vieux, très fort, râblé et bien portant.
Quel joli bourgeois que Mouret, avec sa curiosité, son avarice, sa résignation (p. 183-184) et son aplatissement ! L’abbé Faujas est sinistre et grand – un vrai directeur ! Comme il manie bien la femme, comme il s’empare habilement de celle-là, en la prenant par la charité, puis en la brutalisant !
Quant à elle (Marthe), je ne saurais vous dire combien elle me semble réussie, et l’art que je trouve au développement de son caractère, ou plutôt de sa maladie. J’ai surtout remarqué les pages 194, 215 et 227, 261, 264, 267. Son état hystérique, son aveu final (p. 350 et sq.) est une merveille. Comme le ménage se dissout bien ! Comme elle se détache de tout et en même temps son moi, son fond ! Il y a là une science de dissolution profonde.
J’oublie de vous parler des Trouche, qui sont adorables comme canailles, et de l’abbé Bouvelle (sic), exquis avec sa peur et sa sensibilité.
La vie de province, les jardins qui se regardent, le ménage Paloque, le Rastoil et les parties de raquette, parfait, parfait.
Vous avez des détails excellents, des phrases, des mots qui sont des bonheurs : page 17, "… la tonsure comme une cicatrice" ; 181, "j’aimerais mieux qu’il allât voir les femmes" ; 89, "Mouret avait bourré le poêle", etc.
Et le Cercle de la jeunesse ! Voilà une invention vraie. J’ai noté en marge bien d’autres endroits.
Les détails physiques qu’Olympe donne sur son frère, la fraise, la mère de l’abbé prête à devenir sa maquerelle (152), et son coffre ! (338).
L’âpreté du prêtre qui repousse les mouchoirs de sa pauvre amante, parce que cela sent "une odeur de femme".
"Au fond des sacristies, le nom de M. Delangre…" et toute la phrase qui est un bijou.
Mais ce qui écrase tout, ce qui couronne l’œuvre, c’est la fin. Je ne connais rien de plus empoignant que ce dénouement. La visite de Marthe chez son oncle, le retour de Mouret et l’inspection qu’il fait de sa maison ! La peur vous prend, comme à la lecture d’un conte fantastique, et vous arrivez à cet effet-là par l’excès de la réalité, par l’intensité du vrai ! Le lecteur sent que la tête lui tourne comme à Mouret lui-même.
L’insensibilité des bourgeois qui contemplent l’incendie, assis sur des fauteuils, est charmante, et vous finissez par un trait sublime : l’apparition de la soutane de l’abbé Serge au chevet de sa mère mourante, comme une consolation ou comme un châtiment !
Une chicane, cependant. Le lecteur (qui n’a pas de mémoire) ne sait pas quel instinct pousse à agir comme ils font Me Rougon et l’oncle Macquart. Deux paragraphes d’explication eussent été suffisants. N’importe, ça y est, et je vous remercie du plaisir que vous m’avez fait.
Dormez sur vos deux oreilles, c’est une œuvre.
Mettez de côté pour moi toutes les bêtises qu’elle inspirera. Ce genre de documents m’intéresse.
Je vous serre la main très fort, et suis (vous n’en doutez pas) vôtre. »
Histoire d’un fou
Voici le texte de cette nouvelle publiée dans L’Événement illustré du 8 juin 1868, puis dans deux autres revues et 1869 et 1872.
« Le drame de la rue des Écoles, dont je je parlais hier, m’a remis en mémoire une étrange histoire d’adultère. Je la raconterai pour l’édification des dames qui n’aiment pas les coups de couteau, et qui cherchent un moyen honnête de se débarrasser de leurs maris.
Isidore-Jean-Louis Maurin était un digne bourgeois, propriétaire de plusieurs immeubles, habitant à Belleville le premier étage d’une de ses maisons. Il avait grandi au fond de ce vieux logis, s’occupant de son jardin, vivant dans une oisiveté de Parisien badaud et flâneur. À quarante ans, il commit la sottise d’épouser la fille d’un de ses locataires, une blonde enfant de dix-huit ans, dont les yeux gris, semés d’étincelles vives, avaient le regard doux et luisant d’une chatte.
Six mois plus tard, Henriette montait chez un jeune médecin qui occupait le second étage. Cela arriva le plus naturellement du monde, un soir d’orage, pendant une promenade que Maurin était allé faire aux fortifications. Les amants furent pris d’une fièvre de passion, et bientôt les quelques minutes qu’ils pouvaient se donner à la dérobée ne leur suffirent plus ; ils rêvèrent de vivre ensemble maritalement. Leur vie presque commune, ce simple plancher qui les séparait, aiguisait encore leurs désirs. La nuit, l’amant entendait tousser le mari dans son lit.
Certes, Maurin était un bonhomme ; on le citait dans te quartier comme le modèle des maris ; il ne voyait rien, se montrait d’une douceur et d’une complaisance exemplaires. Mais c’était justement là l’obstacle exaspérant, la bonhomie de Maurin qui le retenait au logis, la vie simple qui cloîtrait la jeune femme. Au bout de quelques semaines, elle ne savait plus quelle histoire inventer pour monter au second étage. Alors les amants décidèrent qu’il fallait se débarrasser du bonhomme.
Ils reculèrent devant un crime brutal. Ils ne pouvaient égorger un pareil mouton ; puis ils craignaient d’être pris et d’avoir le cou tranché. D’ailleurs, le médecin, qui était un homme d’imagination, trouva un expédient moins dangereux, et dont le côté romanesque passionna Henriette.
Une nuit, toute la maison fut réveillée par des cris terribles qui venaient de l’appartement du propriétaire. On enfonça la porte, et on trouva la jeune femme dans un état affreux, à genoux sur le tapis, échevelée, hurlante, les épaules rouges de coups. En face d’elle, Maurin se tenait hébété, frissonnant. Il balbutia comme un homme ivre, il ne put répondre aux questions pressantes qu’on lui adressa.
— Je ne sais pas, murmurait-il… Je ne lui ai rien fait, elle s’est mise à crier tout d’un coup.
Quand Henriette se fut un peu calmée, elle balbutia à son tour, en regardant son mari d’un air étrange, avec une sorte de pitié effrayée. Les voisins se retirèrent, très intrigués, un peu épouvantés même, en se disant entre eux que « tout cela n’était pas clair ».
De pareilles scènes se renouvelèrent fréquemment. La maison vivait dans des alarmes continuelles. Chaque fois que les cris se faisaient entendre et qu’on pénétrait dans l’appartement, le même spectacle s’offrait aux regards des voisins : Henriette, vautrée à terre, affaissée et frémissante, comme une personne qu’on vient de rouer de coups, et Maurin, courant dans la pièce, effaré, ne pouvant rien expliquer.
Le bonhomme devint soucieux. Le soir, il ne se couchait plus qu’en tremblant, avec la peur sourde d’être réveillé pendant la nuit par les hurlements d’Henriette. II ne comprenait rien à ses crises. Elle sautait brutalement du lit, se donnait de violentes tapes sur les épaules, s’échevelait, se roulait sans qu’il fût encore parvenu à découvrir ce qui la jetait ainsi par terre. Elle ne pouvait être que folle, et il se promit de ne jamais répondre aux questions, de rester muet sur ce drame intime. Mais sa tranquillité de badaud était morte ; il maigrissait, il jaunissait ; il n’avait plus son large rire d’imbécile satisfait.
Cependant le bruit, un bruit qui venait on ne savait d’où, se répandait dans le quartier que le bonhomme avait presque chaque nuit des accès de fièvre chaude, pendant lesquels il battait la malheureuse Henriette comme plâtre. Son visage pâle et défait, ses réponses évasives, toute son attitude gênée et triste, confirmèrent singulièrement cette histoire.
Maurin ne put dès lors faire un geste, sans que ce geste parût être l’acte d’un fou. Dès qu’il sortait, les yeux de tout un quartier étaient braqués sur lui, interrogeant chacun de ses pas, donnant des explications étranges à ses moindres paroles. Rien ne ressemble plus à un fou qu’un homme sain d’esprit. Si son pied glissait, s’il levait les yeux au ciel, s’il se mouchait, on riait, on haussait les épaules de pitié. Des gamins le suivaient comme ils auraient suivi une bête curieuse. Au bout d’un mois, il devint notoire dans Belleville que Maurin était fou, mais fou à lier.
On racontait à voix basse des faits inouïs. Une femme disait l’avoir rencontré sans chapeau sur le boulevard extérieur, un jour de pluie. C’était vrai : un coup vent avait emporté le chapeau du bonhomme. Une autre femme affirmait qu’il se promenait dans son jardin chaque nuit, à minuit sonnant, avec une bougie qu’il tenait comme un cierge, en chantant l’office des Morts. Cela parut très effrayant. La vérité était que cette femme avait vu une seule fois Maurin cherchant avec une lanterne les limaces qui mangeaient ses salades. Peu à peu, on collectionna les traits de folie du bonhomme, on lui composa un dossier écrasant. Les cancans allaient leur train : « Un si brave homme, si doux, si bon ! Quel malheur ! Ce que c’est que de nous !… Il faudra pourtant qu’on finisse par l’enfermer… Il la massacre, sa pauvre petite femme, une femme si distinguée, une si excellente personne… »
Le commissaire fut prévenu. Un beau matin, à la suite d’une scène épouvantable qu’Henriette joua en actrice consommée, Maurin fut mis dans un fiacre, sous un prétexte quelconque, et conduit à Charenton. Là, quand il comprit ce dont il s’agissait, il entra dans une telle rage, que d’un coup de dent il coupa net le pouce d’un gardien. On lui mit la camisole de force, on le parqua avec les fous furieux.
Le jeune médecin s’était arrangé de façon à ce qu’on gardât le plus longtemps possible le bonhomme dans son cabanon. Il prétendait avoir suivi la maladie de Maurin et avoir observé chez lui des phénomènes d’une telle étrangeté que ses confrères se crurent en face d’un cas nouveau. D’ailleurs, tout Belleville était là pour grossir le dossier. Il y eut des réunions d’aliénistes et des mémoires furent écrits. Les amants s’envolèrent, allèrent jouir de leur lune de miel dans un trou de feuillages, en Touraine. Henriette mit onze mois à se lasser du jeune médecin. Souvent, entre deux baisers, elle songeait à ce misérable qui hurlait dans un cabanon. Et elle se prenait à l’aimer, maintenant qu’il était tragique, qu’il n’allait plus regarder pousser ses salades ni promener sa flânerie aux fortifications. Les femmes aux yeux gris, aux regards de chattes, ont de ces caprices. Elle se sauva de chez son amant, elle courut à Charenton, décidée à tout avouer.
Ce qui l’avait souvent surprise, c’était le temps que les médecins mettaient à reconnaître que Maurin n’était pas fou. Elle avait compté au plus sur quelques semaines de liberté. Quand on l’eut conduite au cabanon de son mari, elle vit un spectre se dresser lentement d’un coin d’ombre, une bête sale, maigre, blafarde, qui la regarda de ses yeux creux, pleins d’un effarement stupide. Le bonhomme ne la reconnut pas. Et comme elle restait là, terrifiée, il se mit à se balancer, avec un rire idiot. Brusquement, il éclata en sanglot, balbutiant :
— Je ne sais pas, je ne sais pas… je ne lui ai rien fait.
Puis il se jeta à plat ventre, comme Henriette autrefois sur le tapis, et il se donna des tapes sur les épaules, il se vautra en poussant des cris perçants.
— Il recommence ce jeu-là vingt fois par jour, dit le gardien qui accompagnait la jeune femme.
Celle-ci, défaillante, les dents claquant de peur, se cacha les yeux pour ne plus voir le bonhomme dont elle avait fait une telle brute. »
Voir en ligne : La Conquête de Plassans sur Wikisource
© altersexualite.com, 2015
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com