Accueil > Zola pour les nuls > La Faute de l’abbé Mouret, d’Émile Zola
Éros & Thanatos au Paradou, pour lycéens
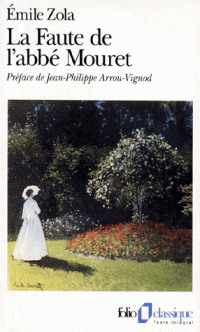 La Faute de l’abbé Mouret, d’Émile Zola
La Faute de l’abbé Mouret, d’Émile Zola
Folio classique, 1875 (éd. 1991).
jeudi 1er octobre 2015
La Faute de l’abbé Mouret prend directement la suite du précédent volume des Rougon-Macquart, La Conquête de Plassans, qui se terminait sur la mort de Marthe sous les yeux de son fils Serge et de sa soutane. Voilà donc une couple de romans de la province et de la prêtrise, après deux romans parisiens. Dès la première liste de dix romans de 1868, Zola avait prévu « un roman sur les prêtres (Province) » ; il a simplement doublé la mise. J’ai utilisé l’édition Folio classique, dont le dossier d’Henri Mitterand et la préface de Jean-Philippe Arrou-Vignod datent de 1991. Attention : bien que le dossier ne donne aucun précision sur l’édition utilisée, le texte disponible sur Wikisource présente des variantes importantes (cf. par exemple le ch. 4 du livre premier), peut-être des différences entre la prépublication et le texte en volume ? Ou simplement des erreurs sur le fichier de Wikisource, qui seront déjà rectifiées quand vous lirez ces lignes ! Jean-Philippe Arrou-Vignod commence par qualifier la saga : « Bâtie comme un ouvrage d’art, avec ses superstructures, ses poutrelles, ses flèches, l’histoire des Rougon-Macquart est le premier monument de l’ère des constructions métalliques ». Une phrase qui conviendrait aussi bien au Ventre de Paris ! En effet, La Faute de l’abbé Mouret serait plutôt, comme le préfacier l’explique également, un triptyque médiéval.
Le dossier
Zola reprend un thème courant, celui du prêtre marié, mais aux dires même de Zola critique, le thème a mal été traité, et devrait l’être « sans parti pris ». Le premier titre envisagé, « La Sottise de l’abbé Mouret », laisse place à un titre qui souligne le combat métaphysique d’Éros & Thanatos, d’où selon le préfacier, une structure en « panneaux d’un triptyque : le Sacerdoce, la Faute, l’Expiation ». Le roman fait aussi partie des dix pour lesquels Zola avait rédigé un scénario pour son éditeur Lacroix en 1869 : « Un roman qui aura pour cadre les fièvres religieuses du moment, et pour héros Lucien, le fils d’Octave Camoins, frère de Silvère, et d’une demoiselle Goiraud, Sophie. C’est dans ce Lucien que les deux branches de la famille se mêlent. Le produit est un prêtre. J’étudierai dans Lucien la grande lutte de la nature et de la religion. Le prêtre amoureux n’a jamais, selon moi, été étudié humainement. Il y a là un fort beau sujet de drame, surtout en plaçant le prêtre sous des influences héréditaires ». On se rappelle dans le volume précédent l’aspect efféminé de Serge enfant, à l’instar de plusieurs prêtres, qui reprend celui du Maxime de La Curée : « Comme Maxime, le prêtre est pour lui le produit malsain d’une société pervertie, un être contre nature » […] « l’anticléricalisme de Zola, quelque fondement rationnel qu’il lui donne, repose d’abord sur une instinctive répulsion pour la confusion des sexes ». Résumons : l’homophobie sert de levier à la prêtrophobie. Le registre n’est pas celui du réalisme, ce que confirme la lecture du dossier laissé par Zola (cf. infra). Flaubert, qui avait adoré l’opus précédent, est moins enthousiaste : « N’est-ce pas que l’Abbé Mouret est curieux ? Mais le Paradou est tout simplement raté ! Il aurait fallu pour l’écrire un autre écrivain que mon ami Zola. N’importe ! Il y a dans ce livre des parties de génie, d’abord tout le caractère d’Archangias et la fin, le retour au Paradou. » Quant au préfacier, il n’est guère moins sévère : « Là où il fallait un poème, Zola fait un herbier aux pages boursouflées, mais dont il s’échappe parfois, comme de ceux de l’enfance, cette poussière d’étamines séchées tombant en pluie d’or qui est la magie des leçons de chose ». Pour ma part je serais moins sévère pour le Paradou, et plus enthousiaste pour la « tempête dans un crâne » finale ; pour l’analyse de l’état d’esprit d’un séminariste et d’un prêtre hétérosexuel, quand il ne tombe pas dans les facilités ancillaires du bon Ponosse de Clochemerle. Et puis les amoureux des arbres trouveront dans ce roman des pages sublimes.
Le dossier de Mitterand commence par une biographie exhaustive de Zola, la même qu’on trouve en tête de chaque volume en Folio, ce qui n’est pas du gaspillage pour les scolaires. À l’âge de 18 ans, Zola contracte la fièvre typhoïde, dont le souvenir inspirera le présent roman. L’étape suivante de l’inspiration de Zola date du tout début de création des Rougon-Macquart, en 1869 : « J’étudierai dans Lucien la grande lutte de la nature et de la religion. Le prêtre amoureux n’a jamais, selon moi, été étudié humainement. Il y a là un fort beau sujet de drame, surtout en plaçant le prêtre sous des influences héréditaires » (p. 436). Selon Mitterand, « C’est un roman biblique et romantique, quasi hugolien. […] La mort d’Albine par overdose de senteurs florales verse dans le surnaturel » Il souligne l’originalité des deux prêtres de Zola, Faujas et Mouret, qui tranchent par rapport aux prêtres de Balzac et Stendhal, « ensoutanés à force de vouloir satiriser les soutanes ». L’ébauche, et même le plan de La Faute seraient antérieurs à la préparation de La Conquête de Plassans, en tout cas il est clair que ces deux romans ont été conçus de concert. Mitterand pense que « Zola a toujours été amoureux de ses héroïnes, surtout les plus sensuellement femmes, Renée, Albine, Hélène, Séverine, et même Nana… ; et l’arrivée de Jeanne Rozerot dans son existence n’a peut-être été qu’une manière d’arracher à l’écran de la fiction l’archétype de toutes ces figures, et de lui donner la présence et la chair de la vie réelle » (p. 443). Le roman est un de ceux qui contiennent le moins de personnages. Si, bien avant La Terre, on rencontre des paysans, ils constituent une sorte de « fond gris, innommé, une masse de brutes travailleuses et courbées sur laquelle je détacherais mon drame humain. Je les montrerais toujours dans le fond de la scène ; le sommeil, la nuit au village, le cimetière » L’ébauche nous montre d’autres secrets de fabrication, par exemple le cynisme de Zola prévoyant ses effets macabres : « Trouver un suicide pas trop bête. Un empoisonnement par les fleurs serait bien peut-être […]. Cela me permettrait de la promener une dernière fois dans le jardin, et d’avoir une description de mort originale. » Il se surpassera avec la combustion de l’oncle Macquart dans Le Docteur Pascal. Au stade de l’ébauche, bizarrement, Zola n’a pas encore trouvé ce qu’il ferait d’Octave Mouret, car pour lui la consanguinité des parents fait des trois enfants des « dégénérescences ». Le roman, tout romantique soit-il, reste naturaliste dans sa méthode. En plus de ses lectures encyclopédiques sur la religion, le séminaire, il utilise le Grand Larousse en 15 volumes qui vient de s’achever, et se sacrifie jusqu’à suivre « plusieurs fois la messe, crayon en main » ! Il relit aussi la Genèse, dont il propose pas moins qu’une réécriture, en plus d’une réécriture de la scène de la serre dans La Curée. Des ouvrages de botanique lui fournissent des listes alphabétiques de plantes diverses, dont il raye scrupuleusement les noms au fur et à mesure qu’il les utilise. La Faute de l’abbé Mouret fut le premier succès de librairie de Zola, et connut même, grâce à l’amitié de Tourgueniev, le succès en Russie (en traduction). Les cléricaux étrillèrent dûment le roman, comme Barbey d’Aurevilly qui se surpasse : « C’est le naturalisme de la bête, mis sans honte et sans vergogne, au-dessus du noble spiritualisme chrétien ! […] Tous ces gens qui ne comprennent rien au catholicisme, qu’ils ne savent pas et qu’ils n’ont point étudié, n’ont qu’une seule façon de procéder contre lui, mais cette façon ne manque jamais son coup sur les imbéciles. […] Ainsi, première cause du succès de M. Zola : le déshonneur d’un prêtre catholique, qui jette sa soutane aux rosiers et fait l’amour comme les satyres le faisaient autrefois avec les nymphes, dans les mythologies… […] Je ne crois point que, dans ce temps de choses basses, on ait encore rien écrit de plus bas dans l’ensemble, les détails et la langue, que La Faute de l’abbé Mouret. C’est l’apothéose du rut universel dans la création. C’est la divinisation dans l’homme de la bête, c’est l’accouplement des animaux sur toute la ligne ». Dans La Revue bleue, se trouve une jolie formule : « Il y a un animal mâle lâché au milieu des bois avec un animal femelle ». Au contraire, ce roman marquera le début de l’amitié de Huysmans pour Zola, et quelques années plus tard, un beau panégyrique : « En dépit des objections multiples qu’il pourrait soulever, en dépit des invraisemblances dont il regorge, en dépit de cette outrance de sève qui fait craquer le tronc du livre, l’Abbé Mouret contient des pages qui sont véritablement sublimes. » Quant à Maupassant, dans une lettre privée, il va plus loin et semble avoir lu l’œuvre d’une seule main ! : « J’ai éprouvé d’un bout à l’autre de ce livre, une singulière sensation ; en même temps que je voyais ce que vous décrivez, je le respirais ; il se dégage de chaque page comme une odeur forte et continue ; vous nous faites tellement sentir la terre, les arbres, les fermentations et les germes, vous nous plongez dans un tel débordement de reproduction que cela finit par monter à la tête, et j’avoue qu’en terminant, après avoir aspiré coup sur coup et « les arômes puissants de dormeuse en sueur… de cette campagne de passion séchée, pâmée au soleil dans un vautrement de femme ardente et stérile » et l’Ève du Paradou qui était « comme un grand bouquet d’une odeur forte » et les senteurs du parc « Solitude nuptiale toute peuplée d’êtres embrassés » et jusqu’au Magnifique frère Archangias « puant lui-même l’odeur d’un bouc qui ne serait jamais satisfait », je me suis aperçu que votre livre m’avait absolument grisé et, de plus, fortement excité ! » Cette courte lettre se termine d’ailleurs par l’évocation du vertigineux « plaisir de vous voir dimanche chez Gustave Flaubert » : Maupassant, Flaubert & Zola réunis autour d’un bon repas : quel beau sujet d’invention !
Livre premier
Tout ce premier volet du triptyque est consacré à une seule journée de l’abbé, qui est à la fois la journée type, présentation des personnages principaux, la première rencontre avec Albine, et l’exposition de la vocation de l’abbé sous forme de réminiscence. L’ouverture se fait en pleine église, au beau soleil matinal de mai. On découvre progressivement la Teuse, la vieille servante, son jeune abbé Mouret qu’elle chérit autant qu’elle le rudoie : « Ça n’a pas vingt-six ans, et ça n’en fait qu’à sa tête. Bien sûr, il en remontrerait pour la sainteté à un homme de soixante ans ; mais il n’a point vécu, il ne sait rien, il n’a pas de peine à être sage comme un chérubin, ce mignon-là », Désirée, sa sœur attardée : « une belle fille de vingt-deux ans, l’air enfant » […] « Elle est sans malice aucune. Elle n’a pas dix ans d’âge, bien qu’elle soit une des plus fortes filles du pays… » et Vincent, le galopin qui sert la messe devant des bancs vides. Zola accentue le contraste entre le soleil de mai et la vie qui envahissent l’église vide de fidèles de cette « cure la plus pauvre du département », et le cérémonial vide de sens de l’abbé. Quand Désirée paraît, c’est les bras chargés d’« une couvée de poussins qui grouillaient » : « — Il y en a treize ! cria-t-elle. Tous les œufs étaient bons ! » [1] Treize, comme les apôtres, sans doute. Les courts chapitres se concluent souvent par un épiphonème : « Les murailles badigeonnées, la grande Vierge, le grand Christ lui-même, prenaient un frisson de sève, comme si la mort était vaincue par l’éternelle jeunesse de la terre ». Le hameau des Artaud provient du lignage d’un ancêtre unique : « Ils se mariaient entre eux, dans une promiscuité éhontée » (phrase qui ne figure pas dans la version Wikisource consultée en septembre 2015). Conformément à une habitude déjà bien ancrée dans le cycle, Zola brosse rapidement l’origine du personnage présenté dans un volume précédent : « C’était un élan d’amour pur, une horreur de la sensation physique. Là, mourant à lui-même, le dos tourné à la lumière, il aurait attendu de n’être plus, de se perdre dans la souveraine blancheur des âmes. » […] « il avait laissé à un frère aîné toute la fortune ». L’usage du mot « mourant » suggère un jeu de mots qui préside au choix du nom « Mouret » pour cette branche abâtardie dans la consanguinité. Bien que tout les oppose, Serge s’apparente au Florent du Ventre de Paris par son fanatisme et son mépris des biens terrestres : « il n’envisageait que les biens célestes, ne pouvant comprendre qu’on mît en balance une éternité de félicité avec quelques heures d’une joie périssable. ». Le chapitre IV se clôt sur ce jugement : « On avait tué l’homme en lui, il le sentait, il était heureux de se savoir à part, créature châtrée, déviée, marquée de la tonsure ainsi qu’une brebis du Seigneur. » Au chapitre V, on fait connaissance avec le frère Archangias, grand vitupérateur de l’époque et du lieu : « Voyez-vous, ces Artaud, c’est comme ces ronces qui mangent les rocs, ici. il a suffi d’une souche pour que le pays fût empoisonné ! Ça se cramponne, ça se multiplie, ça vit quand même. il faudra le feu du ciel, comme à Gomorrhe, pour nettoyer ça. » […] « Ça serait un fameux débarras si l’on étranglait toutes les filles à leur naissance ». L’abbé va tenter d’arranger en mariage la grossesse de Rosalie, la fille du maire, le père Bambousse. Sa vision des paysans au travail, ou plutôt celle du narrateur d’accord avec Archangias, est déjà celle que développera La Terre : « Les Artaud, en plein soleil, forniquaient avec la terre, selon le mot de Frère Archangias. C’étaient des fronts suants apparaissant derrière les buissons, des poitrines haletantes se redressant lentement, un effort ardent de fécondation, au milieu duquel il marchait de son pas si calme d’ignorance. » Le père de la donzelle est pour le moins arrangeant : « Si je te trouve avec ton mâle, je vous attache ensemble, je vous amène comme ça devant le monde… Tu ne veux pas te taire ? Attends, coquine ! » […] « On voit bien que vous ne connaissez pas les filles. Elles sont joliment dures. Je tremperais celle-là au fond de notre puits, je lui casserais les os à coups de trique, qu’elle n’en irait pas moins à ses saletés ! » C’est toujours au cours de cette première journée banale, que l’abbé rencontre le docteur Pascal, son oncle, qui l’emmène soi-disant administrer le vieux Jeanbernat, qui aurait pris un coup de sang. Chemin faisant, Pascal dévide un peu ses théories, prend des nouvelles de l’abbé, et lui parle de sa « tante Félicité », ce qui constitue une erreur restée dans l’édition définitive (c’est sa grand-mère). Il lui annonce que le vieux « a avec lui une nièce qui lui est tombée sur les bras, une drôle de fille, une sauvage… », première mention d’Albine, seize ans (logiquement plutôt petite-nièce que nièce). Finalement, Jeanbernat s’est saigné tout seul, et propose à l’abbé de reprendre avec lui les controverses matérialistes dont il tympanisait son prédécesseur à l’aide de la bibliothèque du Paradou, ce vieil et immense domaine abandonné dont il est le gardien : « quelques milliers de volumes sauvés de l’incendie du Paradou, tous les philosophes du dix-huitième siècle, un tas de bouquins sur la religion » C’est un vrai festival face au jeune prêtre, et Pascal s’amuse à pousser le vieillard : « Il n’y a rien, rien, rien… Quand on soufflera sur le soleil, ça sera fini. » […] « Docteur, reprit-il, si vous me trouviez mort, un de ces quatre matins, rendez-moi donc le service de me jeter dans le trou au fumier, là, derrière mes salades… » L’abbé se contente pour cette première visite, de voir de loin la végétation du Paradou, et d’entendre les rires de la drôlesse, qui promet de venir voir sa sœur : « Seulement, vous ne me parlerez pas de Dieu. Mon oncle ne veut pas. ». De retour au presbytère, l’abbé qui est en retard se fait engueuler par la bonne, puis Désirée l’oblige à voir ses bêtes, dans la basse-cour qui est une espèce d’arche de Noé dont elle est la déesse Cybèle : « Des tas de fumier, des bêtes accouplées, se dégageait un flot de génération, au milieu duquel elle goûtait les joies de la fécondité. Quelque chose d’elle se contentait dans la ponte des poules ; elle portait ses lapines au mâle, avec des rires de belle fille calmée ; elle éprouvait des bonheurs de femme grosse à traire sa chèvre. Rien n’était plus sain. Elle s’emplissait innocemment de l’odeur, de la chaleur de la vie. Aucune curiosité dépravée ne la poussait à ce souci de la reproduction, en face des coqs battant des ailes, des femelles en couches, du bouc empoisonnant l’étroite écurie. » Le frère Archangias étonne l’abbé en donnant raison au père de Rosalie : « Ces Artaud poussent dans la bâtardise, comme dans leur fumier naturel. Il n’y aurait qu’un remède, je vous l’ai dit, tordre le cou aux femelles ». Quant à Albine, les imprécations du frère sont prémonitoires : « Elle a des miaulements de gueuse en chaleur. Si jamais un homme lui tombait dans les griffes, à celle-là, elle ne lui laisserait certainement pas un morceau de peau sur les os. » La bonne se charge d’encadrer les filles venues décorer la Vierge pour le mois de Marie, et tente de chasser Rosalie, mais les autres ne valent guère mieux : « Toutes des gourgandines qui sont venues ce soir, avec leurs fagots, histoire de rire et de se faire embrasser par les garçons, à la sortie ! » Resté seul dans l’église, l’abbé mène durant presque quarante pages ses réflexions, habilement mêlées de réminiscences permettant au narrateur de rappeler les étapes de sa vocation. Sa dévotion exclusive à Marie est l’objet principal de la méditation ; il se rappelle comment il a tempéré cet amour, s’est tenu « en garde […] de succomber à sa douceur de séductrice ». Il la contemplait de façon pure, mais « il cachait à sa mère elle-même qu’il l’aimât si fort » (elle-même lui cachant qu’elle aimait si fort l’abbé Faujas, le lecteur de La Conquête de Plassans fait le lien). Ses Ave qu’il psalmodie sont « pareil[s] au "Je t’aime" des amants », quand il les adresse à « sa chère maîtresse » Marie. Au séminaire, il avait renoncé à la science : « Le mépris de la science lui venait ; il voulait rester ignorant, afin de garder l’humilité de sa foi ». La vocation de Serge utilise le thème de l’efféminement de façon plus subtile que dans la Conquête : « Il se sentait féminisé, rapproché de l’ange, lavé de son sexe, de son odeur d’homme. Cela le rendait presque fier, de ne plus tenir à l’espèce, d’avoir été élevé pour Dieu, soigneusement purgé des ordures humaines par une éducation jalouse. […] Certains de ses organes avaient disparu, dissous peu à peu ; ses membres, son cerveau, s’étaient appauvris de matière pour s’emplir d’âme, […] il montrait des peurs, des ignorances, des candeurs de fille cloîtrée ». Cette régression enfantine est troublée à la fin de son séminaire par la lecture obligée pour devenir prêtre, du « De rebus venereis ad usum confessariorum. Il était sorti épouvanté, sanglotant, de cette lecture. Cette casuistique savante du vice, étalant l’abomination de l’homme, descendant jusqu’aux cas les plus monstrueux des passions hors nature, violait brutalement sa virginité de corps et d’esprit. il restait à jamais sali, comme une épousée, initiée d’une heure à l’autre aux violences de l’amour. Et […] il gardait malgré lui l’ébranlement charnel de ces saletés qu’il devait remuer, il avait conscience d’une tache ineffaçable, quelque part, au fond de son être, qui pouvait grandir un jour et le couvrir de boue ». L’abbé se remémore sa journée pour savoir ce qui l’a tant troublé, et parvient à la vision d’Albine. Il se lance alors dans une longue prière d’anéantissement à Marie : « Votre race a poussé sur un rayon ainsi qu’un arbre merveilleux qu’aucun germe n’a planté […] je veux croire que cette virginité remonte ainsi d’âge en âge dans une ignorance sans fin de la chair. Oh ! vivre, grandir, en dehors de la honte des sens ! Oh ! multiplier, enfanter, sans la nécessité abominable du sexe » […] « Vous régnez au ciel, rien ne vous est plus facile que de me foudroyer, que de sécher mes organes, de me laisser sans sexe, incapable du mal, si dépouillé de toute force, que je ne puisse même plus lever le petit doigt sans votre consentement. […] Je ne veux plus sentir mes nerfs, ni mes muscles, ni le battement de mon cœur, ni le travail de mes désirs. » […] « Oui, je nie la vie, je dis que la mort de l’espèce est préférable à l’abomination continue qui la propage. La faute souille tout. C’est une puanteur universelle gâtant l’amour, empoisonnant la chambre des époux, le berceau des nouveau-nés, et jusqu’aux fleurs pâmées sous le soleil, et jusqu’aux arbres laissant éclater leurs bourgeons. La terre baigne dans cette impureté dont les moindres gouttes jaillissent en végétations honteuses ». […] « O Marie, Vase d’élection, châtrez en moi l’humanité, faites-moi eunuque parmi les hommes, afin de me livrer sans peur le trésor de votre virginité !.
Livre deuxième
Une ellipse nous fait passer brusquement à l’étape de la convalescence de Serge, après une longue maladie dont on apprendra sommairement le détail par des analepses. Le scénario est cousu de fil blanc, tant il est difficile de gober, dans un registre réaliste, que dans un hameau, on laisse un curé certes convalescent, aux mains d’une adolescente, sans que dans toute la durée de cette convalescence, ni la bonne, ni le maire, ni le Frère Archangias, ni Désirée, ni même l’oncle de la petite si inquiet qu’elle ne soit évangélisée par le cureton, enfin aucun des rares personnages de ce tome atypique, ne tente de prendre des nouvelles. Albine le veille, seule, dans une chambre du château en ruines. Lui est changé : « Pendant sa maladie, ses cheveux s’étaient allongés, sa barbe avait poussé. il était très blanc, les yeux meurtris de bleu, les lèvres pâles ; il avait une grâce de fille convalescente ». En se remettant à parler, Serge évoque un rêve : « Toujours le même cauchemar me faisait ramper, le long d’un souterrain interminable. À certaines grosses douleurs, le souterrain, brusquement, se murait ; un amas de cailloux tombait de la voûte, les parois se resserraient, je restais haletant, pris de la rage de vouloir passer outre ; et j’entrais dans l’obstacle, je travaillais des pieds, des poings, du crâne, en désespérant de pouvoir jamais traverser cet éboulement de plus en plus considérable… » C’est un rêve familier de Zola, qu’on retrouvera dans Germinal lors de l’effondrement du Voreux, et dans d’autres textes (voir cet article). En annexe du dossier de l’édition Folio, on trouve un inédit des années 1865-67 intitulé Printemps, Journal d’un convalescent, qui donne le germe et peut-être une explicitation de ce fantasme : À certains moments, lorsque le mal qui me déchirait devenait plus aigu, il me semblait que le souterrain se resserrait devant moi, qu’il se fermait tout à fait, et alors je souffrais horriblement à vouloir passer outre ; je m’entêtais, j’entrais dans l’obstacle qui m’étouffait, je me débattais jusqu’à ce que mon corps me parût avoir traversé, en se meurtrissant, la masse énorme de terre qui l’arrêtait. […] Je sens profondément en moi les anxiétés dernières du germe, la joie vague qu’il éprouve lorsqu’il devine qu’il n’y a plus qu’une mince couche de terre entre lui et la chaude clarté ». Albine est devenue amoureuse de Serge, et l’exprime avec simplicité, alors que lui semble avoir subi un lavage de cerveau ; il ne fait aucune allusion à la religion : « C’est à nous. Personne ne viendra. Quand tu seras guéri, nous nous promènerons. Nous aurons de quoi marcher toute notre vie ». Serge fait une rechute : « il fut pris d’une stupeur des sens qui le ramena à la vie végétative d’un pauvre être né de la veille. Il n’était qu’une plante, ayant la seule impression de l’air où il baignait. Il restait replié sur lui-même, encore trop pauvre de sang pour se dépenser au-dehors, tenant au sol, laissant boire toute la sève de son corps. C’était une seconde conception, une lente éclosion, dans l’œuf chaud du printemps. » À sa première sortie, elle le trouve soudain beau ; elle a envie de l’embrasser pendant son sommeil. Il lui fait de jolis serments : « Tu seras dans ma chair comme je serai dans la tienne. Si je t’abandonnais un jour, que je sois maudit, que mon corps se sèche ainsi qu’une herbe inutile et mauvaise ! » Albine est un peu la Vénus de Botticelli : « Tout riait, dans ce rire de femme naissant à la beauté et à l’amour, les roses, le bois odorant, le Paradou entier ». Le rêve de cette seconde partie est assimilé au fantasme de la Vierge du livre premier grâce à des échos lexicaux : « C’est toi, n’est-ce pas, qui m’as tiré de la terre ? Je devais être sous ce jardin. Ce que j’entendais, c’étaient tes pas roulant les petits cailloux du sentier. » Quant à Albine, son fantasme très romantique est de retrouver une clairière où jouissaient sous un grand arbre les amants de la fondation du château, et d’y mourir : « Moi, je mourrais volontiers ainsi. Nous nous coucherions aux bras l’un de l’autre ; nous serions morts, personne ne nous trouverait plus ». Cela donne le leitmotiv aux résonnances tragiques et bibliques : « Tu sais bien que je cherche mon arbre ». Dans ce Paradou si peu réaliste, tous les fruits sont mûrs en même temps, des fraises aux poires, et l’on s’amuse de quelques précautions de Zola pour faire passer cela : « Qu’est-ce que tu aimes, toi ? les poires, les abricots, les cerises, les groseilles ?… Je te préviens que les poires sont encore vertes ; mais elles sont joliment bonnes tout de même. » […] « Et quand ils furent las des abricotiers, des pruniers, des cerisiers, ils coururent sous les amandiers grêles, mangeant les amandes vertes, à peine grosses comme des pois, cherchant les fraises parmi le tapis d’herbe, se fâchant de ce que les pastèques et les melons n’étaient pas mûrs ». Cela me fait penser aux tableaux de Joachim Beuckelaer, où les choux cohabitent avec les pêches…

Certaines tournures font songer au mythe d’Orphée raconté par Ovide : « Le sainfoin dressait ses longs cheveux grêles, le trèfle découpait ses feuilles nettes, le plantain brandissait des forêts de lances ». L’amour est un jeu : « Veux-tu être mon mari ? Je serai ta femme. » […] « C’était l’amour avant le sexe, l’instinct d’aimer qui plante les petits hommes de dix ans sur le passage des bambines en robes blanches. » Les tentatives se succèdent : « « Prends-moi », dit-elle d’une voix mourante. […] Mais c’était une approche si pleine d’angoisse, qu’ils se relevèrent presque aussitôt, exaspérés, ne pouvant aller plus loin dans le contentement de leurs désirs ». Dans la chambre de Serge, les peintures effacées se révèlent à leurs yeux déniaisés : « « Tu as donc repeint toute la chambre ? s’écria-t-elle, en sautant de la table. On dirait que ce monde-là se réveille. » Ils se mirent à rire, mais d’un rire inquiet, avec des coups d’œil jetés aux Amours qui polissonnaient et aux grandes nudités étalant des corps presque entiers. Ils voulurent tout revoir, par bravade, s’étonnant à chaque panneau, s’appelant pour se montrer des membres de personnages qui n’étaient certainement pas là le mois passé ». Telle une Ève moderne, Albine persuade Serge de trouver l’arbre interdit : « C’est un mensonge, ce n’est pas défendu, murmura-t-elle. » […] « C’est un arbre de vie, un arbre sous lequel nous serons plus forts, plus sains, plus parfaits ». Et voilà l’arbre enfin trouvé : « Il avait une taille géante, un tronc qui respirait comme une poitrine, des branches qu’il étendait au loin, pareilles à des membres protecteurs. Il semblait bon, robuste, puissant, fécond ; il était le doyen du jardin, le père de la forêt, l’orgueil des herbes, l’ami du soleil qui se levait et se couchait chaque jour sur sa cime. » Le jardin joue le rôle du serpent de la Genèse : « C’était le jardin qui avait voulu la faute. Pendant des semaines, il s’était prêté au lent apprentissage de leur tendresse. Puis, au dernier jour, il venait de les conduire dans l’alcôve verte. Maintenant, il était le tentateur, dont toutes les voix enseignaient l’amour. » La scène tant attendue arrive : « Les parcelles de vie invisibles qui peuplent la matière, les atomes de la matière eux-mêmes, aimaient, s’accouplaient, donnaient au sol un branle voluptueux, faisaient du parc une grande fornication. Alors, Albine et Serge entendirent. Il ne dit rien, il la lia de ses bras, toujours plus étroitement. La fatalité de la génération les entourait. Ils cédèrent aux exigences du jardin. Ce fut l’arbre qui confia à l’oreille d’Albine ce que les mères murmurent aux épousées, le soir des noces.
Albine se livra. Serge la posséda ».
Zola chausse à nouveau ses gros sabots orthosexuels : « Serge venait, dans la possession d’Albine, de trouver enfin son sexe d’homme, l’énergie de ses muscles, le courage de son cœur, la santé dernière qui avait jusque-là manqué à sa longue adolescence. Maintenant, il se sentait complet. Il avait des sens plus nets, une intelligence plus large. » Mais pour suivre le script biblique, Albine connaît la honte : « — Cachons-nous, cachons-nous », répétait-elle d’un ton suppliant. Et elle devenait toute rose. C’était une pudeur naissante, une honte qui la prenait comme un mal, qui tachait la candeur de sa peau, où jusque-là pas un trouble du sang n’était monté » […] « elle lui jeta les feuillages qu’elle continuait de cueillir. Elle lui dit à voix basse, d’un air d’alarme : “Ne vois-tu pas que nous sommes nus ?” ». Aussitôt la Faute consommée, patatras, ils découvrent un trou dans l’enceinte (si je puis me permettre !) du Paradou, par lequel en voyant le village et en entendant la cloche, Serge retrouve la mémoire, ce qui nous donne un emploi inoubliable de l’interjection « Mon dieu » : « “ Mon Dieu ! ” cria Serge, tombé à genoux, renversé par les petits souffles de la cloche ». En même temps, le Dieu jaloux pénètre par ce trou sous l’espèce de Frère Archangias : « quelqu’un était là, troublant la paix des taillis d’une haleine jalouse ». Le verdict ne se fait pas attendre : « Je vous vois, je sais que vous êtes nus… C’est une abomination. Êtes-vous une bête, pour courir les bois avec cette femelle ? Elle vous a mené loin, dites ! elle vous a traîné dans la pourriture, et vous voilà tout couvert de poils comme un bouc… Arrachez donc une branche pour la lui casser sur les reins ! » […] « Au nom de Dieu, sortez de ce jardin ! »
Livre troisième
Une nouvelle ellipse nous fait commencer la dernière partie du triptyque au moment où Serge célèbre le mariage de Rosalie et Fortuné, dont l’enfant vient de naître. Mariage expédié bon enfant tôt le matin pour raison pratique : « le grand Fortuné pourra encore aller à son champ, et la Rosalie n’aura pas perdu sa journée de vendange ». La réputation de l’abbé n’a pas pâti de son incartade. Les filles l’apprécient tel qu’il est : « il n’est pas vilain homme. La maladie l’a un peu vieilli ; mais ça lui va bien. Il a des yeux plus grands, avec deux plis aux coins de la bouche qui lui donnent l’air d’un homme… Avant sa fièvre, il était trop fille » L’abbé improvise un discours enflammé sur le mariage : « Ma chère sœur, soyez soumise à votre mari, comme l’Église est soumise à Jésus. Rappelez-vous que vous devez tout quitter pour le suivre, en servante fidèle. Vous abandonnerez votre père et votre mère, vous vous attacherez à votre époux, vous lui obéirez, afin d’obéir à Dieu lui-même. Et votre joug sera un joug d’amour et de paix. » Quant à l’homme, il a aussi son lot : « c’est Dieu qui vous accorde aujourd’hui une compagne ; car il n’a pas voulu que l’homme vécût solitaire. Mais, s’il a décidé qu’elle serait votre servante, il exige de vous que vous soyez un maître plein de douceur et d’affection. Vous l’aimerez, parce qu’elle est votre chair elle-même, votre sang et vos os. Vous la protégerez, parce que Dieu ne vous a donné vos bras forts que pour les étendre au-dessus de sa tête, aux heures de danger. Rappelez-vous qu’elle vous est confiée ; elle est la soumission et la faiblesse dont vous ne sauriez abuser sans crime. » Voilà qui ravirait les Femen ! Désirée n’a pas changé, et ne se préoccupe pas de son frère qui est pourtant déprimé, ne mange rien ; son absence lui a permis d’obtenir la vache dont elle rêvait, et elle raconte avec innocence comment elle l’a menée au taureau : « Il est monté sur elle, il l’a prise entre ses pattes… ». La Teuse non plus n’a pas changé, et Zola tente de faire passer la légèreté scénaristique du livre deuxième de façon assez maladroite, par une analepse dans un dialogue avec l’abbé : « Quand l’abbé Guyot, de Saint-Eutrope, qui vous a remplacé pendant votre absence, venait dire sa messe ici, le dimanche, je lui racontais des histoires, je lui jurais que vous étiez en Suisse. » La bonne semble en savoir plus qu’elle ne veut en dire, et tâte le terrain en obligeant l’abbé à entendre l’histoire de son prédécesseur, nommé aux Artaud suite à un scandale : « Eh bien, l’abbé Caffin, dans notre pays, à Canteleu, avait eu des ennuis. […] une demoiselle rôdait autour de lui, la fille d’un meunier que ses parents avaient mise en pension. Bref, il arriva ce qui devait arriver ». On voit où elle veut en venir, en trouvant toutes les excuses à l’abbé : « Ce bon M. Caffin ! Il n’était pas fier avec moi, il me parlait souvent de son péché. Ça ne l’empêche pas d’être dans le ciel, je vous en réponds ! Il peut dormir tranquille, là, à côté, sous l’herbe, car il n’a jamais fait de tort à personne… Moi, je ne comprends pas qu’on en veuille tant à un prêtre quand il se dérange. C’est si naturel ! Ce n’est pas beau, sans doute, c’est une saleté qui doit mettre Dieu en colère ; mais il vaut encore mieux faire ça que d’aller voler. On se confesse, donc, et on est quitte ! » Elle embraye sur des nouvelles que l’abbé refuse d’entendre : « Oui, oui, continua-t-elle, j’ai des nouvelles de là-bas, très souvent même, et je vous les donnerai… D’abord, la personne n’est pas plus heureuse que vous. » Serge se réfugie dans le travail manuel, en retapant l’église avec les moyens du bord et à ses frais. La Teuse admire son travail (qu’on sent inspiré de la contemplation des boudoirs du Paradou), mais remarque que l’abbé n’a pas repeint « l’autel de la Vierge », qui jure maintenant que le reste est tout neuf : « Vous ne savez pas ce qu’on dira, monsieur le curé ? On dira que vous n’aimez pas la sainte Vierge, voilà tout ». Frère Archangias « entourait [Serge] d’un espionnage de toutes les heures », avec « une âpreté de vieille fille jalouse », car Serge l’a aussi trompé, « rapportant sur lui des caresses défendues, dont la senteur lointaine suffisait à exaspérer sa continence de bouc qui ne s’était jamais satisfait ». (Eh oui, même hyper viril, un religieux est toujours féminisé pour Zola !) Les deux religieux se rendent chez les jeunes mariés pour la bénédiction nuptiale du soir, mais voilà que Jeanbernat, qui va chercher le Dr Pascal pour Albine, croise leur chemin. S’ensuit une altercation très violente entre le vieux athée et le Frère intransigeant, avec insultes et jets de pierre : « Oui, tu l’as fourrée dans son lit, répétait le Frère affolé ! Et tu avais mis un Christ sous le matelas pour que l’ordure tombât sur lui… Ha ! ha ! tu es étonné que je sache tout. Tu attends quelque monstre de cet accouplement-là. Tu fais chaque matin les treize signes de l’enfer sur le ventre de ta gueuse, pour qu’elle accouche de l’Antéchrist. Tu veux l’Antéchrist, bandit !… Tiens, que ce caillou t’éborgne ! » Jeanbernat propose à Serge de passer voir Albine, qui va mal. Archangias aussitôt voit l’enfer : « « Prenez garde ! Vous retournez au péché… Il a suffi que cet homme passât pour que toute votre chair eût un tressaillement. Je vous ai vu sous la lune, pâle comme une fille… Prenez garde, entendez-vous ! Cette fois Dieu ne pardonnerait pas. Vous tomberiez dans la pourriture dernière… Ah ! misérable boue, c’est la saleté qui vous emporte ! » Alors, le prêtre leva enfin la face. Il pleurait à grosses larmes, silencieusement. Il dit avec une douceur navrée : « Pourquoi me parlez-vous ainsi ?… Vous êtes toujours là, vous connaissez mes luttes de chaque heure. Ne doutez pas de moi, laissez-moi la force de me vaincre. » » L’abbé peut enfin bénir le jeune ménage : « L’usage voulait que le curé y bût le vin qu’on lui avait versé : c’est là ce qu’on appelait bénir la chambre. Ça portait bonheur, ça empêchait le ménage de se battre. Du temps de M. Caffin, les choses se passaient joyeusement, le vieux prêtre aimant à rire ; il était même réputé pour la façon dont il vidait le verre, sans laisser une goutte au fond ; d’autant plus que les femmes, aux Artaud, prétendaient que chaque goutte laissée était une année d’amour en moins pour les époux. » Au chapitre VI, l’abbé recouvre toute sa santé en adorant la Sainte-Croix au détriment de la Vierge : « Il s’était pris d’une dévotion extraordinaire pour la Croix, il avait remplacé dans sa chambre la statuette de l’Immaculée-Conception par un grand crucifix de bois noir, devant lequel il passait de longues heures d’adoration ». L’oncle Pascal vient à son tour voir Serge, se plaignant d’avoir à supporter une messe. Il essaie d’obtenir qu’il accepte de voir Albine juste une fois avant qu’elle ne parte. Mais Serge refuse, il ne veut même pas prononcer son nom : « Je ne puis que prier pour la personne dont vous parlez ». Pascal reconnaît qu’il a voulu tenter une expérience, et qu’elle a en partie échoué : « Tu restais un mois en convalescence. L’ombre des arbres, le souffle frais de l’enfant, toute cette jeunesse te remettait sur pied. D’un autre côté, l’enfant perdait sa sauvagerie, tu l’humanisais, nous en faisions à nous deux une demoiselle que nous aurions mariée quelque part. » Pascal est toujours une sorte de mise en abyme du romancier expérimental. Il bougonne ce que Zola n’ose peut-être pas prendre à son compte : « De vrais Rougon et de vrais Macquart, ces enfants-là ! La queue de la bande, la dégénérescence finale. » Albine grimpe incognito en passant par le gouffre, pour rejoindre Serge par surprise dans l’église. C’est le morceau de bravoure, les chapitres VIII & IX, une véritable « Tempête sous un crâne », que dans son ébauche Zola nomme sobrement « lutte de la nature contre le catholicisme ». Face à la détermination d’Albine qui vient tout simplement le chercher pour vivre avec lui : « Je ne puis vivre ailleurs qu’à ton cou », Serge, qui s’est « arm[é] des épées flamboyantes de la foi », est soumis à des alternances d’aspirations contraires, tiraillé entre Albine et la foi, entre la nature et la mort, et faites confiance à Zola pour forcer le trait, mais honnêtement, c’est-à-dire qu’il ne ridiculise pas la religion ; il se contente de souligner qu’elle est une aspiration à la mort. Il faudrait citer tout le chapitre, douche écossaise d’Éros et de Thanatos, car sans doute là réside l’essentiel de ce qu’a voulu exprimer Zola contre le catholicisme. Contentons-nous de quelques phrases : « Était-ce donc là le garçon aux muscles forts, le col dénoué montrant le duvet de la poitrine, la peau épanouie par le soleil, les reins vibrants de vie, dans l’étreinte duquel elle avait vécu une saison ? À cette heure, il ne semblait plus avoir de chair, le poil lui était honteusement tombé, toute sa virilité se séchait sous cette robe de femme qui le laissait sans sexe. » […] « Et le prêtre, tout enveloppé de son odeur passionnée de femme faite, prenait une joie amère à braver la caresse de sa bouche rouge, le rire de ses yeux, l’appel de sa gorge, l’ivresse qui coulait d’elle au moindre mouvement. Il poussait la témérité jusqu’à chercher sur elle les places qu’il avait baisées follement, autrefois, les coins des yeux, les coins des lèvres, les tempes étroites, douces comme du satin, la nuque d’ambre, soyeuse comme du velours. Jamais, même au cou d’Albine, il n’avait goûté les félicités qu’il éprouvait à se martyriser, en regardant en face cette passion qu’il refusait. » Serge « prit la main d’Albine, il la tutoya comme une sœur, il l’emmena devant les images douloureuses du chemin de la Croix. » Et devant ces tableaux (on s’étonne d’ailleurs de ce qu’une minuscule église perdue possède ce qui, d’après les descriptions, ressemble à des chefs-d’œuvres baroques !) le narrateur alterne les pulsions de vie d’Albine et celles de mort de Serge et du Christ : « Il était tombé à genoux, la voix coupée par les sanglots, les yeux sur les trois croix du Calvaire, où se tordaient des corps blafards de suppliciés que le dessin grossier décharnait affreusement. Albine se mit devant les images pour qu’il ne les vît plus. — Un soir, dit-elle, par un long crépuscule, j’avais posé ma tête sur tes genoux… C’était dans la forêt, au bout de cette grande allée de châtaigniers que le soleil couchant enfilait d’un dernier rayon. Ah ! quel adieu caressant ! Le soleil s’attardait à nos pieds, avec un bon sourire ami nous disant au revoir. » » Le bon abbé s’exalte : « « Jésus qui êtes mort pour nous, cria-t-il, dites-lui donc notre néant ! Dites-lui que nous sommes poussière, ordure, damnation ! Ah tenez ! permettez que je couvre ma tête d’un cilice, que je pose mon front à vos pieds, que je reste là, immobile, jusqu’à ce que la mort me pourrisse. La terre n’existera plus. Le soleil sera éteint. Je ne verrai plus, je ne sentirai plus, je n’entendrai plus. Rien de ce monde misérable ne viendra déranger mon âme de votre adoration. » Il s’exaltait de plus en plus. Il marcha vers Albine, les mains levées. « Tu avais raison, c’est la mort qui est ici, c’est la mort que je veux, la mort qui délivre, qui sauve de toutes les pourritures… Entends-tu ! je nie la vie, je la refuse, je crache sur elle. Tes fleurs puent, ton soleil aveugle, ton herbe donne la lèpre à qui s’y couche, ton jardin est un charnier où se décomposent les cadavres des choses. La terre sue l’abomination. Tu mens quand tu parles d’amour, de lumière, de vie bienheureuse au fond de ton palais de verdure. » Au chapitre suivant, resté seul, Serge continue à gamberger. Belle méditation où Jésus remplace la Vierge dans une relation presque homoérotique : « Alors, il entama avec Jésus une de ces conversations intérieures, pendant lesquelles il était ravi à la terre, causant bouche à bouche avec son Dieu. Il balbutiait le verset du cantique : « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ; il repose entre les lis, jusqu’à ce que l’aurore se lève et que les ombres déclinent » » Malheureusement pour Serge, Jésus se révèle impuissant à lui faire oublier la nudité d’Albine, et il fait un long cauchemar : « il ne sentait plus Dieu ; sa chair, échappée, se soulevait de désir ; les prières, s’embarrassant sur ses lèvres, s’achevaient en un balbutiement ordurier. Agonie lente de la tentation, où les armes de la foi tombaient, une à une, de ses mains défaillantes, où il n’était plus qu’une chose inerte aux griffes des passions, où il assistait, épouvanté à sa propre ignominie, sans avoir le courage de lever le petit doigt pour chasser le péché ». Il continue à rêver à ce qu’il a fait et dit : « Le matin, il avait bien marié le grand Fortuné à la Rosalie, L’Église ne défendait pas le mariage. […] Il disait au grand Fortuné que Dieu lui envoyait une compagne, parce qu’il n’a pas voulu que l’homme vécût solitaire. Il disait à la Rosalie qu’elle devait s’attacher à son mari, ne le quitter jamais, être sa servante soumise. Mais il disait aussi ces choses pour lui et pour Albine. N’était-elle pas sa compagne, sa servante soumise, celle que Dieu lui envoyait afin que sa virilité ne se séchât pas dans la solitude ? » Le cauchemar de Serge s’intensifie : « Le village, les bêtes, toute cette marée de vie qui débordait engloutit un instant l’église sous une rage de corps faisant ployer les poutres. Les femelles, dans la mêlée, lâchaient de leurs entrailles un enfantement continu de nouveaux combattants. Cette fois, l’église eut un pan de muraille abattu ; le plafond fléchissait, les boiseries des fenêtres étaient emportées, la fumée du crépuscule, de plus en plus noire, entrait par les brèches bâillant affreusement. Sur la croix, le grand Christ ne tenait plus que par le clou de sa main gauche. » On aboutit à une ekphrasis de l’arbre fantastique, qu’il faut citer en entier, en se demandant si Zola pense à son fameux arbre généalogique des Rougon-Macquart : « Le sorbier, dont les hautes branches pénétraient déjà sous la voûte, par les carreaux cassés, entra violemment, d’un jet de verdure formidable, il se planta au milieu de la nef. Là, il grandit démesurément ; son tronc devint colossal, au point de faire éclater l’église, ainsi qu’une ceinture trop étroite. Les branches allongèrent de toutes parts des nœuds énormes, dont chacun emportait un morceau de muraille, un lambeau de toiture ; et elles se multipliaient toujours, chaque branche se ramifiant à l’infini, un arbre nouveau poussant de chaque nœud, avec une telle fureur de croissance, que les débris de l’église, trouée comme un crible, volèrent en éclats en semant aux quatre coins du ciel une cendre fine. Maintenant, l’arbre géant touchait aux étoiles. Sa forêt de branches était une forêt de membres, de jambes, de bras, de torses, de ventres, qui suaient la sève ; des chevelures de femmes pendaient ; des têtes d’hommes faisaient éclater l’écorce, avec des rires de bourgeons naissants ; tout en haut, les couples d’amants, pâmés au bord de leurs nids, emplissaient l’air de la musique de leur jouissance et de l’odeur de leur fécondité. Un dernier souffle de l’ouragan qui s’était rué sur l’église, en balaya la poussière, la chaire et le confessionnal en poudre, les images saintes lacérées, les vases sacrés fondus, tous ces décombres que piquait avidement la bande des moineaux, autrefois logée sous les tuiles. Le grand Christ, arraché de la croix, resta pendu un moment à une des chevelures de femme flottantes, fut emporté, roulé, perdu, dans la nuit noire, au fond de laquelle il tomba avec un retentissement. L’arbre de vie venait de crever le ciel. Et il dépassait les étoiles. »
On finit par retourner à la réalité. Archangias, qui a espionné la sortie d’Albine de l’église, est fou de joie de l’avoir vue déconfite. Il révèle un aspect grotesque de sa personnalité qu’on pourrait reprocher à Zola de faire arriver comme un cheveu sur la soupe car rien dans les précédentes interventions de ce personnage ne laissait présager ce comportement : « Quand le Frère était gai, il allongeait des coups de poing dans les côtes de la Teuse, qui lui rendait des soufflets à toute volée. Cela les faisait rire, d’un rire dont les plafonds tremblaient. Puis, il inventait des farces extraordinaires : il cassait avec son nez des assiettes posées à plat, il pariait de fendre à coups de derrière la porte de la salle à manger, il jetait tout le tabac de sa tabatière dans le café de la vieille servante ou bien apportait une poignée de cailloux qu’il lui glissait dans la gorge, en les enfonçant avec la main jusqu’à la ceinture. Ces débordements de joie sanguine éclataient pour un rien, au milieu de ses colères accoutumées ; souvent, un fait dont personne ne riait lui donnait une véritable attaque de folie bruyante, tapant des pieds, tournant comme une toupie, se tenant le ventre. » La Teuse étonne le Frère en lui révélant qu’elle a bien vu entrer Albine, et qu’elle a laissé faire : « Mais du moment qu’elle est la santé de M. le Curé… elle peut bien venir à toutes les heures du jour et de la nuit. Je les enfermerai ensemble, s’ils veulent. » Serge fait un plan d’enlèvement, mais « Il ignorait la vie », et ne sait comment faire. C’est la pensée des enfants qui, par un détour subtil, le décide : « Mais non, il n’aurait point d’enfant, il s’éviterait cette horreur qu’il éprouvait, à l’idée de voir ses membres repousser et revivre éternellement. Alors, l’espoir d’être impuissant lui fut très doux. Sans doute, toute sa virilité s’en était allée pendant sa longue adolescence. Cela le détermina. Dès le soir, il fuirait avec Albine. » Pourtant, la procrastination veille, et Serge n’est plus très motivé : « il était parti pour le Paradou, par bêtise, obsédé, se résignant, allant là comme à une corvée qu’il ne savait de quelle façon éviter. L’image d’Albine s’était encore effacée ; il ne la voyait plus, il obéissait à d’anciennes volontés, mortes en lui à cette heure, mais dont la poussée persistait dans le grand silence de son être. » Extraite de son contexte, cette phrase pourrait concerner bien des couples ! Pour entrer au Paradou, il doit enjamber Archangias qui ronfle devant la brèche. Albine se rend compte que le cœur n’y est plus, malgré les dénégations de Serge, et cela donne un joli Je t’aime, moi non plus ! : « Je t’aime, je t’aime, dit-il de sa voix égale. Si je ne t’aimais pas, je ne serais pas venu… C’est vrai, je suis las. J’ignore pourquoi. J’aurais cru retrouver ici cette bonne chaleur dont le souvenir seul était une caresse. Et j’ai froid, le jardin me semble noir, je n’y vois rien de ce que j’y ai laissé. Mais ce n’est point ma faute. Je m’efforce d’être comme toi, je voudrais te contenter. — Tu ne m’aimes plus, répéta encore Albine » Albine a la mauvaise idée de parler d’enfants, et Serge de botter en touche, en se comparant à un saint de pierre : « C’est cet embaumement qui fait ma sérénité, la mort tranquille de ma chair, la paix que je goûte à ne pas vivre… Ah ! que rien ne me dérange de mon immobilité ! Je resterai froid, rigide, avec le sourire sans fin de mes lèvres de granit, impuissant à descendre parmi les hommes ». Albine chasse Serge, au grand plaisir d’Archangias, et « le jardin n’était plus qu’un grand cercueil d’ombre ». Celui-ci est mu par la jalousie : « Il avait arrêté l’abbé Mouret au milieu de la route, en le regardant avec des yeux luisants d’une terrible jalousie. Les délices entrevues du Paradou le torturaient. Depuis des semaines, il était resté sur le seuil, flairant de loin les jouissances damnables ». La fin est précipitée. Albine cherche à mourir dans un acte panthéiste : « Elle aurait voulu être utile aux herbes qui végétaient sur le bord des allées, se tuer là, pour qu’une verdure poussât d’elle, superbe, grasse, pleine d’oiseaux en mai et ardemment caressée du soleil ». Elle amasse des quantités de fleurs pour s’en asphyxier dans son lit, une des deux morts extraordinaires des Rougon-Macquart, avec celle de l’oncle Macquart dans Le Docteur Pascal : « Elle ouvrait la bouche, cherchant le baiser qui devait l’étouffer, quand les jacinthes et les tubéreuses fumèrent, l’enveloppèrent d’un dernier soupir, si profond, qu’il couvrit le chœur des roses. Albine était morte dans le hoquet suprême des fleurs ». Pascal, appelé par Jeanbernat, avant même d’avoir pu vérifier si la défunte est bien morte, fait un détour par la cure pour hurler la nouvelle à Serge, et d’ajouter : « Dites-lui aussi de ma part qu’elle était enceinte ! », chose dont on se demande comment il aurait bien pu le savoir, et dans ce cas pourquoi le narrateur ne l’a pas exprimé lors de la scène précédente… Jeanbernat, peu ému, creuse un trou dans le jardin, mais Pascal le convainc « qu’il n’était pas permis de garder ainsi les morts » « Le trou sera pour moi » répond le vieillard. Avant l’enterrement, nous avons droit à une scène où l’on tue le cochon pendant que naît le veau, ce qui réjouit grandement Désirée : « Personne comme elle ne tranchait la tête d’une oie d’un seul coup de hachette ou n’ouvrait le gosier d’une poule avec une paire de ciseaux. Son amour des bêtes acceptait très gaillardement ce massacre. C’était nécessaire, disait-elle ; ça faisait de la place aux petits qui poussaient. » Zola lui-même n’est pas chiche, et comme il venait de terminer La Conquête de Plassans par un petit massacre de 5 personnages, il ajoute à l’enterrement d’Albine celui du petit de Rosalie, et comme plus tard l’enterrement du vieux Fouan dans La Terre, nous montre des paysans incapables d’émotion, qui s’amusent et pensent à tout autre chose qu’au mort. Le père Bambousse n’a pas voulu venir, parce qu’il prétend « qu’on l’avait volé, qu’il aurait donné un de ses champs de blé pour que le petit mourût trois jours avant la noce. » Dernière note grotesque, Jeanbernat arrive sournoisement, et essorille Archangias d’une oreille devant le caveau de sa nièce, comme si Zola éprouvait le besoin de ridiculiser in fine ce beau personnage de libre-penseur par une cruauté imbécile.
– Lire un article de Sylvain Perrot : « Le sentiment de culpabilité chez Racine et Zola » ; une séquence pédagogique d’Estelle Plaisant-Soler, contenant la critique intégrale de Barbey d’Aurevilly.
Voir en ligne : La Faute de l’abbé Mouret sur Wikisource
© altersexualite.com, 2015
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Désirée préfigure la Pauline de La Joie de vivre.
 altersexualite.com
altersexualite.com