Accueil > Zola pour les nuls > Pot-Bouille, d’Émile Zola
Le vit, mode d’emploi, pour lycéens et adultes
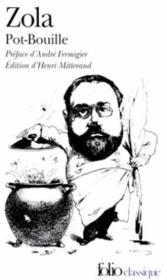 Pot-Bouille, d’Émile Zola
Pot-Bouille, d’Émile Zola
GF Flammarion, 1882 (éd. 2000).
vendredi 1er juillet 2016
J’ai utilisé une édition GF Flammarion de 1979, munie d’une courte préface de Colette Becker, mais dépourvue de notes (442 p.). Le titre « Pot-Bouille » m’était resté mystérieux jusqu’à cette lecture tardive, et j’ignorais qu’il désignât, selon Wikipédia, « la cuisine ordinaire des ménages, en gros synonyme de popote ». Ce dixième volume des Rougon-Macquart est jusqu’à présent celui qui m’a le moins intéressé à la lecture. Certes, Zola y crée le sous-genre du roman d’immeuble qui connaîtra un grand succès après lui, culminant avec La Vie mode d’emploi (1978) de Georges Perec (dans notre sélection, voir Escalier C, d’Elvire Murail) ; il s’agit donc, encore plus que Le Ventre de Paris, d’un roman choral, qui ne présente pas de protagonistes, mais seulement un certain nombre de personnages ayant pour point commun d’habiter ou avoir habité le même immeuble parisien. Ce livre n’était pas prévu dans la liste de dix romans de 1868, ni sur les listes suivantes ; Zola semble l’avoir conçu juste après la publication de Nana, comme une transition vers Au Bonheur des Dames, lui permettant de raconter l’arrivée à Paris d’Octave Mouret, et les débuts de son ascension sociale. Pot-Bouille a été publié dans Le Gaulois entre le 23 janvier et le 14 avril 1882, juste avant de sortir en volume.
Les frasques sexuelles de la petite bourgeoisie constituent le sujet principal, raison pour laquelle je me suis un peu ennuyé avec ce roman qui sent le réchauffé. Dans les volumes précédents, Zola n’avait eu de cesse qu’il n’eût dénoncé les frasques sexuelles de tous les milieux sociaux, alors nous voilà dans la petite bourgeoisie, certes, mais « So what ? » pourrait-on dire. Et quand on sait que Zola himself va connaître à partir de 1888, une relation ancillaire & fertile avec la jeune Jeanne Rozerot, on se demande quelle est la part de la jalousie dans cette dénonciation des turpitudes bourgeoises. Allons-y nonobstant, et nous avons du grain à moudre pour un site qui se nommons « altersexualité », car les turpitudes inventées par Zola recoupent bien le sens large de ce mot. Mais nous sommes sévères, car si l’ensemble ne nous séduit guère, il faut reconnaître au maître une patte extraordinaire dans l’analyse psychologique des tourments de la sexualité, et un chic pour les scènes doubles bien croquées où un fait scabreux résonne avec un autre, comme une paire de cymbales.
Dans son ébauche du roman qui date d’avril 1881, Zola concentre ses réflexions sur « l’adultère dans la bourgeoisie ». Voici la conclusion de Colette Becker dans sa préface : « Zola qui voulait faire de Pot-Bouille son Éducation sentimentale, avait en effet décidé d’éviter tout lyrisme, toute description de plus de cinq lignes. Les personnages agissent, parlent comme sur une scène ; chaque chapitre (il y en a 18) se referme sur lui-même comme un acte dans une pièce de théâtre. Le roman en tire un accent qui est très particulier dans l’œuvre de l’écrivain ». À noter une anecdote amusante : un avocat qui portait le même nom que celui du roman et habitait non loin, avait obtenu de Zola la modification du patronyme de l’avocat de fiction, de Duverdy en Duveyrier ! Mais par la suite, Zola refusa de se plier à d’autres demandes du même ordre, en imposant le droit de l’écrivain de choisir ses noms de personnages dans la réalité.
Genèse
Ce livre n’est donc guère prémédité, mais un paragraphe du Roman expérimental (1880) justifie la démarche : « Si nous sommes curieux, si nous regardons par les fentes, je soupçonne que nous verrons, dans les classes distinguées, ce que nous avons vu dans le peuple, car la bête humaine est la même partout, le vêtement seul diffère. » Il s’agit clairement de montrer que la bourgeoisie est « plus abominable » que le peuple. La même année, Alexandre Dumas fils avait publié un essai intitulé Les Femmes qui tuent et les femmes qui votent, qui posait la question des droits des femmes et de leur éducation.
Chapitre I
Octave Mouret, vingt-deux ans (fils de François Mouret et de Marthe Rougon, frère de Serge et de Désirée, les protagonistes de La Faute de l’abbé Mouret, petit-fils de Pierre et Félicité Rougon, arrière-petit-fils d’Adélaïde Fouque), arrive avec ses malles rue de Choiseul, où il sera logé par M. Campardon, architecte dont la femme est une connaissance de Plassans. « Eau et gaz à tous les étages », vante l’architecte, qui fait visiter l’immeuble à Octave et au lecteur. Au second étage loge un écrivain très suspect, dont on ne saura quasiment rien sauf sa réputation détestable : « Le monsieur fait des livres, je crois. » Octave est prévenu d’entrée : « pas de tapage ici, surtout pas de femme !… ». Il découvre avec surprise que « Campardon, qu’il avait connu très farceur à Plassans », est devenu bigot par arrivisme, ayant « été nommé architecte diocésain ». Comme souvent chez Zola, Octave est d’un sexe ambigu : « Avec ses larges épaules, il était femme, il avait un sens des femmes qui, tout de suite, le mettait dans leur cœur. Aussi, au bout de dix minutes, tous deux causaient-ils déjà comme de vieilles amies. » Octave est une sorte de Guillaume Gallienne avant la lettre : « Le commerce le passionnait, le commerce du luxe de la femme, où il entre une séduction, une possession lente par des paroles dorées et des regards adulateurs. » On lui propose illico presto une situation dans un magasin qui deviendra fameux : « C’était, à l’encoignure des rues Neuve-Saint-Augustin et de la Michodière, un magasin de nouveautés dont la porte ouvrait sur le triangle étroit de la place Gaillon. Barrant deux fenêtres de l’entresol, une enseigne portait, en grandes lettres dédorées : Au Bonheur des Dames, maison fondée en 1822 ; tandis que, sur les glaces sans tain des vitrines, on lisait, peinte en rouge, la raison sociale : Deleuze, Hédouin et Cie. » Octave découvre qu’en réalité, le chaste Campardon a son amante Au Bonheur des Dames, la cousine Gasparine, aussi sèche que l’épouse officielle est grasse, dans une sorte de reprise de la « bataille des Gras et des Maigres » du Ventre de Paris. Octave est plutôt désabusé et prêt à tout question femmes : « Toujours il avait rêvé cela, des dames qui le prendraient par la main et qui l’aideraient dans ses affaires. Mais celles-là revenaient, se mêlaient avec une obstination fatigante. Il ne savait laquelle choisir, il s’efforçait de garder sa voix tendre, ses gestes câlins. Et, brusquement, accablé, exaspéré, il céda à son fond de brutalité, au dédain féroce qu’il avait de la femme, sous son air d’adoration amoureuse. – Vont-elles me laisser dormir à la fin ! dit-il à voix haute, en se remettant violemment sur le dos. La première qui voudra, je m’en fiche ! et toutes à la fois, si ça leur plaît !… »
Chapitre II
Ce chapitre est assez burlesque, puisqu’on s’y amuse des efforts désespérés de la famille Josserand pour marier leurs deux filles : « Mais vous ne comprenez donc pas ! reprit Mme Josserand d’une voix aiguë, je vous dis que voilà encore un mariage à la rivière, et c’est le quatrième ! » On fait surtout des efforts pour Berthe, la cadette, car Hortense, l’aînée, s’est entichée d’un certain Verdier, qu’on ne verra jamais que de dos dans le roman : « Après avoir refusé avec mépris cinq ou six prétendants, un petit employé, le fils d’un tailleur, d’autres garçons qu’elle trouvait sans avenir, elle s’était décidée pour un avocat, rencontré chez les Dambreville et âgé déjà de quarante ans. Elle le jugeait très fort, destiné à une grande fortune. Mais le malheur était que Verdier vivait depuis quinze ans avec une maîtresse, qui passait même pour sa femme, dans leur quartier. Du reste, elle le savait et ne s’en montrait pas autrement inquiète. » Le dernier ratage de Berthe donne lieu à cette belle leçon maternelle :
« Comment as-tu encore raté ce mariage ?
Berthe comprit que son tour était venu.
– Je ne sais pas, maman, murmura-t-elle.
– Un sous-chef de bureau, continuait la mère ; pas trente ans, un avenir superbe. Tous les mois, ça vous apporte son argent ; c’est solide, il n’y a que ça… Tu as encore fait quelque bêtise, comme avec les autres ?
– Je t’assure que non, maman… Il se sera renseigné, il aura su que je n’avais pas le sou.
Mais Mme Josserand se récriait.
– Et la dot que ton oncle doit te donner ! Tout le monde la connaît, cette dot… Non, il y a autre chose, il a rompu trop brusquement… En dansant, vous avez passé dans le petit salon.
Berthe se troubla.
– Oui, maman… Et même, comme nous étions seuls, il a voulu de vilaines choses, il m’a embrassée, en m’empoignant comme ça. Alors, j’ai eu peur, je l’ai poussé contre un meuble…
Sa mère l’interrompit, reprise de fureur.
– Poussé contre un meuble, ah ! la malheureuse, poussé contre un meuble !
– Mais, maman, il me tenait…
– Après ?… Il vous tenait, la belle affaire ! Mettez donc ces cruches-là en pension ! Qu’est-ce qu’on vous apprend, dites !
Un flot de sang avait envahi les épaules et les joues de la jeune fille. Des larmes lui montaient aux yeux, dans une confusion de vierge violentée.
– Ce n’est pas ma faute, il avait l’air si méchant… Moi, j’ignore ce qu’il faut faire.
– Ce qu’il faut faire ! elle demande ce qu’il faut faire !… Eh ! ne vous ai-je pas dit cent fois le ridicule de vos effarouchements. Vous êtes appelée à vivre dans le monde. Quand un homme est brutal, c’est qu’il vous aime, et il y a toujours moyen de le remettre à sa place d’une façon gentille… Pour un baiser, derrière une porte ! en vérité, est-ce que vous devriez nous parler de ça, à nous, vos parents ? Et vous poussez les gens contre un meuble, et vous ratez des mariages !
Elle prit un air doctoral, elle continua :
– C’est fini, je désespère, vous êtes stupide, ma fille… Il faudrait tout vous seriner, et cela devient gênant. Puisque vous n’avez pas de fortune, comprenez donc que vous devez prendre les hommes par autre chose. On est aimable, on a des yeux tendres, on oublie sa main, on permet les enfantillages, sans en avoir l’air ; enfin, on pêche un mari… Si vous croyez que ça vous arrange les yeux, de pleurer comme une bête ! »
Chapitre III
On invite du monde en l’honneur de l’oncle Bachelard, ce vieux débauché sans héritier à qui on ne parviendra jamais à arracher la confirmation de sa velléité de doter ses nièces. C’est la foire aux filles : « Du monde arrivait, des mères fortes avec des filles maigres, des pères et des oncles à peine éveillés de la somnolence du bureau, poussant devant eux des troupeaux de demoiselles à marier. » Le vieux truc du piano (on apprend à jouer du piano pour pêcher un homme) est décortiqué : « Des mères faisaient visiblement le rêve quelles mariaient leurs filles, la bouche fendue, les dents féroces, dans un abandon inconscient ; c’était la rage de ce salon, un furieux appétit de gendres, qui dévorait ces bourgeoises, aux sons asthmatiques du piano. »
Chapitre IV
Octave ne perd pas de temps et « s’occupa de Valérie » : « Son plan était déjà fait, un plan hardi de séducteur habitué à mener cavalièrement la vertu des demoiselles de magasin. Il s’agissait simplement d’attirer Valérie dans sa chambre, au quatrième ; l’escalier restait désert et solennel, personne ne les découvrirait là-haut ; et il s’égayait, à l’idée des recommandations morales de l’architecte, car ce n’était pas amener des femmes, que d’en prendre une dans la maison. » Cela dit, il écoute les médisances : « Quant à Valérie, elle ne valait pas grand-chose, elle se serait tout aussi mal conduite, même si son mari l’avait contentée, tellement la nature l’emportait. Personne n’ignorait du reste que, deux mois après son mariage, désespérée de voir qu’elle n’aurait jamais d’enfant, et craignant de perdre sa part de l’héritage du vieux Vabre, si Théophile venait à mourir, elle s’était fait faire son petit Camille par un garçon boucher de la rue Sainte-Anne. » Par politique, Octave se lie d’amitié avec les Pichon, qui constituent encore une belle étude de cas. Voici les propos de la mère de Marie à son gendre Jules Pichon : « Aussi, rappelez-vous, Jules, ce que j’ai exigé, en vous donnant Marie : un enfant, pas plus, ou nous nous fâcherions !… Les ouvriers seuls pondent des petits comme les poules, sans s’inquiéter de ce que ça coûtera. Il est vrai qu’ils les lâchent sur le pavé, de vrais troupeaux de bêtes, qui m’écœurent dans les rues. » Zola soigne particulièrement le cas clinique de Marie, la femme frigide telle qu’en produit en quantité la répression sexuelle : « Elle, du reste, faisait ce que son mari voulait. Sans doute, elle aimait les enfants ; s’il avait pu en désirer d’autres, elle n’aurait pas dit non. Et, sous cette complaisance, qui se subordonnait aux ordres de sa mère, perçait une indifférence de femme dont la maternité ne s’était pas éveillée. Lilitte l’occupait comme son ménage, qu’elle tenait par devoir. Quand elle avait lavé la vaisselle et promené la petite, elle continuait son ancienne vie de jeune fille, d’un vide somnolent, bercée dans l’attente vague d’une joie qui ne venait point. Octave ayant dit qu’elle devait s’ennuyer, toujours seule, elle parut surprise : non, elle ne s’ennuyait jamais, les journées coulaient tout de même, sans qu’elle sût, en se couchant, à quelle besogne elle les avait passées ». Sa tentative se heurte à un grand froid : « Il allongea la main, effleura la sienne, se pencha pour voir un passage du livre, si près d’elle, que son haleine lui chauffait l’épaule, par l’écartement du peignoir ; et elle restait la chair morte. » La conquête de Valérie Vabre s’annonce difficile : « Malgré les regards de flamme dont il se croyait l’objet, elle gardait une réserve inexplicable ; et il voyait là un jeu de coquette. […] Aussi ne quittait-il plus l’escalier, épiant le moment de s’introduire chez elle, décidé à être brutal. » L’occasion se présente sous la forme d’un malaise de Valérie ; la bonne appelle à l’aide et Octave tente d’en profiter mais se fait remettre à sa place : « Elle n’aimait donc pas ça ? Il venait de la sentir indifférente, sans désir comme sans révolte, aussi peu commode que sa patronne, Mme Hédouin. Pourquoi Campardon la disait-il hystérique ? c’était inepte, de l’avoir trompé, en lui contant cette farce ; car jamais, sans le mensonge de l’architecte, il n’aurait risqué une telle aventure. Et il restait étourdi du dénouement, troublé dans ses idées sur l’hystérie, songeant aux histoires qui couraient. Le mot de Trublot lui revint : on ne savait pas, avec ces détraquées dont les yeux luisaient comme des braises. » En sortant de cet échec, Octave tombe sur Marie qui vient de finir un roman qu’il lui a passé, sans s’attendre à une réaction à la Bovary : « Quand elle était jeune, elle aurait voulu habiter au fond des bois. Elle rêvait toujours qu’elle rencontrait un chasseur, qui sonnait du cor. Il s’approchait, se mettait à genoux. Ça se passait dans un taillis, très loin, où des roses fleurissaient comme dans un parc. Puis, tout d’un coup, ils étaient mariés, et alors ils vivaient là, à se promener, éternellement. Elle, très heureuse, ne souhaitait plus rien. Lui, d’une tendresse et d’une soumission d’esclave, restait à ses pieds. » Octave nonobstant, pousse sa pointe en conquérant, et c’est un joli plan cul qu’on nous raconte : « Alors, il ne parla plus, ayant une revanche à prendre, se disant tout bas, crûment : « Toi, tu vas y passer ! » Comme elle refusait de le suivre dans la chambre, il la renversa brutalement au bord de la table ; et elle se soumit, il la posséda, entre l’assiette oubliée et le roman, qu’une secousse fit tomber par terre. La porte n’avait pas même été fermée, la solennité de l’escalier montait au milieu du silence. » L’aventure n’est guère satisfaisante : « c’était le mari qui montait. Octave, silencieux, la reprit et la baisa à son tour sur la bouche. Elle se soumit de nouveau, complaisante, les lèvres glacées comme auparavant. Lorsqu’il fut rentré sans bruit dans sa chambre, il se dit, en ôtant son paletot, que celle-là non plus n’avait pas l’air d’aimer ça. Alors, que demandait-elle ? et pourquoi tombait-elle aux bras du monde ? Décidément, les femmes étaient bien drôles. »
Chapitre V
Octave n’est pas fier de ce pis-aller : « Au moment où il mettait sa cravate blanche, la pensée de Marie Pichon venait de lui être insupportable : cinq mois de Paris, et rien que cette pauvre aventure ! Cela lui était pénible comme une honte, car il sentait profondément le vide et l’inutilité d’une telle liaison. » Lors du dîner chez les Duveyrier qui occupe ce chapitre, le débat tombe sur les romans, et comme d’habitude, Zola y va de son ironie : « – Avez-vous lu ce nouveau roman ? demanda Léon, en train de feuilleter un exemplaire de la Revue des Deux Mondes, traînant sur une table. Il est bien écrit ; mais encore un adultère, ça finit vraiment par être fastidieux ! […] Cependant, Duveyrier restait songeur. – Mon Dieu ! murmura-t-il enfin, ces auteurs exagèrent, l’adultère est très rare parmi les classes bien élevées… Une femme, lorsqu’elle est d’une bonne famille, a dans l’âme une fleur… » Octave apprend alors de Trublot que ledit Duveyrier entretient une femme. Mais la grande affaire de la soirée est qu’enfin Berthe est assez habile pour se faire flirter par Auguste Vabre, le beau-frère de Duveyrier, d’une façon suffisamment ostensible pour que ce mini-scandale rende le « mariage conclu ». Cela nous vaut une jolie transe de Mme Josserand : « Quand la famille, qui n’avait pas échangé une parole en montant, se retrouva dans la salle à manger, d’où elle était descendue désespérée, elle céda brusquement à un coup de joie folle, délirant, se prenant par les mains, dansant une danse de sauvages autour de la table ; le père lui-même obéit à la contagion, la mère battait des entrechats, les filles poussaient de petits cris inarticulés ; tandis que la bougie, au milieu, détachait leurs grandes ombres, qui cabriolaient le long des murs. – Enfin, c’est fait ! dit Mme Josserand, essoufflée, en tombant sur un siège. »
Chapitre VI
Encore un chapitre centré sur Octave, qui pose au protagoniste : « À quoi bon se presser ? Il se trouvait bien au Bonheur des Dames, il s’y décrassait de sa province, et une certitude profonde, absolue, lui venait d’avoir un jour Mme Hédouin, qui ferait sa fortune ; mais c’était une affaire de prudence, une longue tactique de galanterie, où se plaisait déjà son sens voluptueux de la femme. » Octave est du reste pragmatique : « l’image de Marie Pichon avait achevé de calmer ses impatiences. Une femme pareille était très commode ; il lui suffisait d’allonger le bras, quand il la voulait, et elle ne lui coûtait pas un sou. En attendant l’autre, certes, il ne pouvait demander mieux. » Une anecdote fil-rouge court dans ce chapitre : le concierge Gourd fait la chasse à une femme qui descend des chambres de bonnes : « – Nous ne voulons pas de femmes, entendez-vous ! On l’a déjà dit à l’homme qui vous amène… Si vous revenez coucher, j’irai chercher un sergent de ville, moi ! et nous verrons si vous ferez encore vos cochonneries dans une maison honnête. » C’est juste après ce scandale qu’Octave surprend justement Trublot en ancillaire compagnie : « – Vous couchez donc avec la cuisinière ! – Mais non ! répondit Trublot effaré. Puis, sentant la bêtise de ce mensonge, il se mit à rire de son air satisfait et convaincu. – Hein ! elle est drôle !… Je vous assure, mon cher, c’est très chic ! Quand il dînait en ville, il s’échappait du salon pour aller pincer les cuisinières devant leurs fourneaux ; et, lorsqu’une d’elles voulait bien lui donner sa clef, il filait avant minuit, il montait l’attendre patiemment dans sa chambre, assis sur une malle, en habit noir et en cravate blanche. Le lendemain, il descendait par le grand escalier, vers dix heures, et passait devant les concierges, comme s’il avait rendu une visite matinale à quelque locataire. » Petite note sociologique : « Et vous savez, maintenant, dans toutes les maisons, les cloisons des chambres de bonne sont ainsi minces comme des feuilles de papier. Je ne comprends pas les propriétaires. Ce n’est guère moral, on ne peut même remuer dans son lit… Je trouve ça très incommode. » Octave et Trublot entendent les cancans des bonnes dans le « puits humide » de la cour intérieure donnant sur les cuisines. On y apprend que la vertueuse Mme Valérie vient de passer un « déjeuner, la tête en bas et les jambes en l’air ! » Octave en est vexé : « pourquoi pas avec lui ? », alors de dépit, il tente sa chance avec Mme Juzeur, mais se heurte à la religion : « Oh ! ma main, tant qu’il vous plaira ! Il lui avait repris la main. Mais, cette fois, il l’ouvrait, la baisait sur la paume ; et, les yeux demi-clos, tournant le jeu en plaisanterie, elle écartait les doigts, comme une chatte qui détend ses griffes pour qu’on la chatouille sous les pattes. Elle ne lui permit pas d’aller au-dessus du poignet. Le premier jour, il y avait là une ligne sacrée, où le mal commençait. » Voici l’épilogue du scandale du concierge : « – C’est un scandale ! c’est une horreur… Jamais je ne permettrai ça chez moi ! Et, s’adressant à l’ouvrier, que sa présence parut intimider d’abord : – Renvoyez cette femme, tout de suite, tout de suite… Entendez-vous ! nous ne voulons pas de femmes dans la maison. – Mais c’est la mienne ! répondit l’ouvrier effaré. Elle est en place, elle vient une fois par mois, quand ses maîtres le permettent… En v’là une histoire ! Ce n’est pas vous qui m’empêcherez de coucher avec ma femme, peut-être ! » Cela n’empêche pas le propriétaire de congédier l’ouvrier : « Par exemple, je l’accepte volontiers, votre congé ! Plus souvent que je resterais dans cette baraque ! Il s’y passe de propres choses, on y rencontre du joli fumier. Ça ne veut pas de femmes chez soi, lorsque ça tolère, à chaque étage, des salopes bien mises qui mènent des vies de chien, derrière les portes… Tas de mufes ! tas de bourgeois ! » D’où la saillie de Gourd : « Quelle sale chose que le peuple ! Il suffisait d’un ouvrier dans une maison pour l’empester. », phrase qui fait écho à la dernière phrase du Le Ventre de Paris : « Quels gredins que les honnêtes gens ! ».
Chapitre VII
Chapitre consacré aux tractations sordides pour réaliser le mariage de Berthe Josserand et Auguste Vabre. Celui-ci tient le magasin de l’entresol, et voici les raisons très romantiques qui lui font aimer Berthe : « Actuellement, Auguste, après avoir acheté son magasin soixante mille francs, s’est lancé avec les quarante autres mille. Seulement, la somme devient insuffisante ; d’autre part, il est seul, il lui faut une femme ; c’est pourquoi il veut se marier… Berthe est jolie, il la voit déjà dans son comptoir ; et quant à la dot, cinquante mille francs sont une somme respectable qui l’a décidé. » Le problème est que l’oncle Bachelard a promis cinquante mille francs de dot, qu’il n’a aucune intention de donner, et que côté Vabre, le vieux propriétaire de l’immeuble a promis cent mille francs à chacun de ses enfants (Clotilde, épouse de Duveyrier, Auguste, et Théophile, époux de Valérie), mais ne donne rien non plus. M. Josserand se décide donc à consulter Duveyrier, pour voir ce qu’il en est, car il ne peut se résoudre, comme l’y pousse sa femme, à faire un faux pour entourlouper Auguste sur la dot de Bachelard. Ce dernier, bon enfant et complètement rond, emmène Josserand sur les traces de Duveyrier, c’est-à-dire chez sa poule, mais auparavant, conduit la troupe chez sa propre poule du moment. Scène cocasse où la tante de la jeune fille dévoile ses motivations : « – Je l’aurais mariée, n’est-ce pas ? Un ouvrier la battrait, un employé se mettrait à lui faire des enfants par-dessus la tête… Vaut mieux encore qu’elle se conduise bien avec M. Narcisse, qui a l’air d’un honnête homme. » Après cet intermède, la troupe tâche de trouver Duveyrier, non sans lui tailler un costard où Zola nous en apprend sur les mœurs de cette prostitution de petite bourgeoisie, une sorte de complément à Nana : « la conversation tomba sur Duveyrier. Était-ce malheureux, un homme riche, un magistrat, se laisser dindonner de cette façon par les femmes ! Toujours il lui en avait fallu, dans les quartiers excentriques, au bout des lignes d’omnibus : petites dames en chambre, modestes et jouant un rôle de veuve ; lingères ou mercières vagues, tenant des magasins sans clientèle ; filles tirées de la boue, nippées, cloîtrées, chez lesquelles il allait une fois par semaine, régulièrement, ainsi qu’un employé se rend à son bureau. » C’est que Duveyrier a un vice physique qui dégoûte sa légitime : « Dès la première nuit, disait-on, elle l’avait pris en horreur, dégoûtée par ses taches rouges. Aussi lui tolérait-elle volontiers des maîtresses, dont les complaisances la débarrassaient ; bien qu’elle acceptât encore parfois l’abominable corvée, avec une résignation de femme honnête qui était pour tous les devoirs. » Clarisse, sa maîtresse, n’est guère plus réjouie : « Mais elle n’a pas la ressource de l’envoyer dehors, comme sa femme ; autrement, si elle pouvait aussi le passer à sa bonne, je vous assure qu’elle se débarrasserait vite de la corvée. » Elle se console facilement : « Lorsqu’elle recevait, elle ne voulait plus être tutoyée. Ensuite, le monde parti, les portes closes, tous les amis d’Alphonse y passaient, sans compter les siens, des acteurs rasés, des peintres à fortes barbes. C’était une habitude ancienne, le besoin de se refaire un peu, derrière les talons de l’homme qui payait. De tout son salon, deux seulement n’avaient pas voulu : Gueulin, tourmenté par la peur des suites, et Trublot, dont les affections étaient ailleurs. » Duveyrier accepte le mariage, et tout le monde s’entend pour rouler Auguste Vabre, à qui on parle d’une prétendue assurance, sans en faire mention dans le contrat : « il n’y était pas question de l’assurance ; en outre, le premier versement de dix mille francs devait avoir lieu six mois après le mariage ».
Chapitre VIII
C’est le mariage, troublé par un gag à la Feydeau : Théophile découvre en s’habillant, un billet compromettant pour Valérie, et veut faire un scandale en pleine église. Tout le monde se ligue pour lui faire croire qu’il s’est trompé, « La lettre a été perdue par Françoise » (la bonne). Berthe enfin casée échange un regard prometteur avec Octave.

Chapitre IX
On retrouve les Campardon, et ce chapitre est consacré à un thème cher à Zola, l’installation d’un ménage à trois (déjà vu dans Nana et L’Assommoir, et bientôt à nouveau dans Germinal). Gasparine, la lointaine cousine de Plassans, rend une visite à l’hypocondriaque Rose : « – Parole d’honneur ! la bonne idée n’est pas de moi… C’est Rose qui a voulu se réconcilier. Tous les matins, voici plus de huit jours, elle me répétait : Va donc la chercher… Alors, moi, j’ai fini par aller vous chercher. Et, comme s’il eût senti le besoin de convaincre Octave, il l’emmena devant la fenêtre. – Hein ? les femmes sont les femmes… Moi, ça m’embêtait parce que j’ai peur des histoires. L’une à droite, l’autre à gauche, il n’y avait pas de tamponnement possible… Mais j’ai dû céder, Rose assure que nous serons tous plus contents. Enfin, nous essayerons. Ça dépend d’elles deux, maintenant, d’arranger ma vie. » La rencontre se passe au mieux : « Alors, l’architecte, emporté par l’attendrissement, les saisit toutes les deux dans une même étreinte, leur donna des baisers, en balbutiant : – Oui, oui, nous nous aimerons bien, nous t’aimerons bien, ma pauvre cocotte… Tu verras comme tout s’arrangera, à présent que nous sommes réunis. » L’affaire va bon train, Gasparine revient de plus en plus fréquemment, s’occupe d’Angèle, la fille des Campardon, au point que Rose la supplie de s’installer et qu’on lui installe une chambre. « Octave s’était écarté, en trouvant qu’on finissait par être trop tendre, dans cette maison. » Zola note ironiquement que pendant le déménagement « la Vierge au cœur saignant gisait contre le mur, calée par une cuvette neuve. » Octave apprend que Marie est enceinte, ce qui la fâche avec ses parents. Il calcule qu’il s’agit sans doute de ses œuvres ; heureusement le mari est naïf ou complaisant : « Est-ce qu’ils s’imaginent que ça m’amuse ! Je suis plus attrapé qu’eux, là-dedans. D’autant plus que, sapristi ! il n’y a pas de ma faute… N’est-ce pas ? Marie, si nous savons comment il a pu pousser, celui-là ! » Cela n’empêche pas l’entreprenant garçon de faire des plans auprès de Mme Hédouin qu’il compte séduire autant par son charme que par ses projets d’agrandissement : « Et il s’échauffait, se montrait plein de mépris pour l’ancien commerce, au fond de boutiques humides, noires, sans étalage, évoquait du geste un commerce nouveau, entassant tout le luxe de la femme dans des palais de cristal, remuant les millions au plein jour, flambant le soir ainsi qu’une fête de gala princier. » Quand il essaie de la culbuter comme une vulgaire vendeuse, Mme Hédouin le remet à sa place : « Je ne suis pas une femme ici, j’ai trop d’affaires… Voyons, vous qui êtes si bien organisé, comment n’avez-vous pas compris que jamais je ne ferai ça, parce que c’est bête d’abord, inutile ensuite, et que, heureusement pour moi, je n’en ai pas la moindre envie ! ». L’abbé Mauduit, qui a confié à l’architecte Campardon les travaux de l’église Saint-Roch, lui rend visite en présence de Rose et Gasparine et, loin de les chapitrer, « approuva beaucoup Gasparine de s’être fixée auprès d’une personne de sa famille. Les demoiselles seules, à Paris, couraient tant de risques ! Il disait ces choses avec son onction de bon prêtre, n’ignorant rien cependant. Ensuite, il causa des travaux, il proposa une modification heureuse. Et il semblait être venu pour bénir la bonne union de la famille et sauver ainsi une situation délicate, dont on pouvait causer dans le quartier. » En contrepoint, Zola brosse discrètement une idylle entre Lisa, la bonne des Campardon, et leur fille Angèle . Octave quitte les Campardon, et fait en don Juan de province le bilan de ses premiers pas à Paris : « il se retrouvait garçon : pas de femme, ni Valérie ni Mme Hédouin n’avaient voulu de son cœur, et il s’était trop pressé de rendre à Jules Marie, la seule qu’il eût conquise, encore sans avoir rien fait pour ça. Il tâchait d’en rire, mais il éprouvait une tristesse ; il se rappelait avec amertume ses succès de Marseille et voyait un mauvais présage, une véritable atteinte à sa fortune, dans la déroute de ses séductions. Un froid le glaçait, quand il n’avait pas des jupes autour de lui. Jusqu’à Mme Campardon qui le laissait partir sans larmes ! C’était une terrible revanche à prendre. Est-ce que Paris allait se refuser ? » Juste au moment où ces pensées le traversent, Berthe lui propose de venir travailler pour la boutique, ayant appris qu’il quittait Le Bonheur des Dames.
Chapitre X
Octave fréquente le salon des Duveyrier, dont la femme couvre sciemment les frasques de son magistrat de mari, avec des excuses dont l’ironie est affutée : « C’était un scandale qui passionnait Paris, toute une prostitution clandestine, des enfants de quatorze ans livrés à de hauts personnages. Clotilde ajouta : – Oui, ça lui donne beaucoup de mal. Depuis quinze jours, ses soirées sont prises. » [1] Or le vieux Vabre choisit ce moment pour décéder, et Mme Duveyrier de demander à Octave d’aller chercher son époux chez sa poule. Justement, la bande des bambocheurs cause femmes : « – Mais j’en ai eu, des maîtresses honnêtes ! cria Bachelard. Elles sont encore plus assommantes que les autres ; et salopes avec ça ! Des gaillardes qui, derrière votre dos, font une noce à vous flanquer des maladies !… ». Bachelard se vante de s’être trouvé « Une jeune fille, dit-il enfin, mais une vraie, parole d’honneur ! », et de faire des projets pour elle : « si je trouve un garçon bien sage, je la lui donne, oh ! en mariage, pas autrement. » La bande rend visite à Clarisse, la poule de Duveyrier, mais voilà ce qui les attend : « L’antichambre était vide, les patères elles-mêmes avaient disparu. Vide aussi le grand salon et vide le petit salon : plus un meuble, plus un rideau aux fenêtres, plus une tringle. » Lapoulamilébout, comme dirait Queneau ! Octave apprend à Duveyrier son second malheur, et le ramène la queue entre les jambes au domicile conjugal, où sa femme est doublement accablée : « Ce n’était pas assez de perdre son père, il fallait encore que ce malheur servît de prétexte à un rapprochement avec son mari ! Elle le connaissait bien, il serait toujours sur elle, maintenant que plus rien au-dehors ne la protégerait ; et, dans son respect de tous les devoirs, elle tremblait de ne pouvoir se refuser à l’abominable corvée. »
Chapitre XI
Une nouvelle tentative malheureuse d’Octave avec Mme Juzeur nous vaut une profonde analyse quasiment pré-freudienne de la psyché érotique contrariée par la religion : « Et il la violentait. Très souple, elle glissa. Puis, le reprenant elle-même dans ses bras, l’empêchant de faire un mouvement, elle murmura de sa voix caressante : – Tout ce que vous voudrez, mais pas ça !… Entendez-vous, ça, jamais ! jamais ! J’aimerais mieux mourir… C’est une idée à moi, mon Dieu ! J’ai juré au ciel, enfin vous n’avez pas besoin de savoir… Vous êtes donc brutal comme les autres hommes, que rien ne satisfait, tant qu’on leur refuse quelque chose. Pourtant, je vous aime bien. Tout ce que vous voudrez, mais pas ça, mon amour ! Elle se livrait, lui permettait les caresses les plus vives et les plus secrètes, ne le repoussant, d’un mouvement de brusque vigueur nerveuse, que s’il tentait le seul acte défendu. Et, dans son obstination, il y avait comme une réserve jésuitique, une peur du confessionnal, une certitude de se faire pardonner les petits péchés, tandis que le gros lui causerait trop d’ennuis avec son directeur. Puis, c’étaient encore d’autres sentiments inavoués, l’honneur et l’estime de soi-même mis en un seul point, la coquetterie de tenir toujours les hommes en ne les satisfaisant jamais, une savante jouissance personnelle à se faire manger de baisers partout, sans le coup de bâton de l’assouvissement final. Elle trouvait ça meilleur, elle s’y entêtait, pas un homme ne pouvait se flatter de l’avoir eue, depuis le lâche abandon de son mari. Et elle était une femme honnête ! – Non, monsieur, pas un ! Ah ! je puis aller la tête haute, moi ! Que de malheureuses, dans ma position, se seraient mal conduites ! » Gasparine est connue dans le quartier sous le nom de « l’autre Mme Campardon ». La mort de M. Vabre révèle que ce vieux Grigou avait dilapidé sa fortune au jeu. On doit vendre l’immeuble, et Duveyrier roule encore ses frère, beau-frère et sœur, pour s’adjuger l’immeuble à un prix dérisoire.
Chapitre XII
Nous voici chez les Vabre, Auguste et Berthe. La dissension du ménage est venue sur le chapitre ancillaire. Berthe congédie toutes les filles pour des vétilles, mais finit par accepter « une gaillarde qui semblait s’arranger pour rester. Elle se nommait Rachel, devait être juive, le niait et cachait son pays. […] Rachel, qui acceptait sans révolte les plus dures besognes, accompagnées de pain sec, prenait possession du ménage, les yeux ouverts, la bouche serrée, en servante de flair attendant l’heure fatale et prévue où madame n’aurait rien à lui refuser. » Comme Vabre s’avère pingre, Octave en profite pour acheter Berthe à coups de cadeaux, encouragé par Saturnin, le frère de Berthe, jaloux et fou à lier, que le couple héberge entre deux internements. Là encore Zola se livre à une analyse au scalpel des raisons de Berthe de haïr son mari : « Et elle en tenait un enfin, et comme le chasseur qui achève d’un coup de poing brutal le lièvre qu’il s’est essoufflé à poursuivre, elle se montrait sans douceur pour Auguste, elle le traitait en vaincu. ». Une occasion se présente enfin, mais Octave hésite : « Cependant, il n’osait pas ; son côté féminin, son sens de la femme s’affinait à cette minute de passion, au point de faire de lui la femme, dans leur approche. Alors, elle, comme si elle se fût souvenue d’anciennes leçons, laissa tomber son mouchoir. »
Chapitre XIII
La vie va son train dans l’immeuble, dans ce chapitre de transition. Le concierge en a après une ouvrière qui a remplacé l’ouvrier congédié dans une chambre de bonne, et dont le ventre s’arrondit. « Vas-y donc, pourris ta maison avec des ouvriers, loge du sale monde qui travaille !… Quand on a du peuple chez soi, monsieur, voilà ce qui vous pend au bout du nez ! » Mme Juzeur se prend pour la conseillère privée d’Octave : « Elle le traitait de grand nigaud, car il avait raté Valérie par sa faute ; elle la lui aurait fait avoir tout de suite, s’il était simplement entré demander un conseil. […] Et elle le renvoya, en exigeant de lui le serment solennel de venir se confesser souvent, sans rien cacher, s’il voulait qu’elle prît la direction de son cœur. » Berthe se révèle avide de gâteries coûteuses plus que de galanteries furieuses, et Octave se ruine pour peu de profit : « elle en était bientôt venue à être lasse de son amant comme de son mari », gêné de plus par les rondes du concierge : « M. Gourd, guettant les choses déshonnêtes dont frissonnaient les murs, filant sans bruit, hanté par des ventres de femmes enceintes. » Trublot l’informe sur les affaires du dernier étage : Duveyrier s’est mis aux bonnes : « Duveyrier […] s’est bien remis avec sa femme, qui se résigne de temps à autre ; seulement, elle le rationne, et il est tombé sur Adèle… » C’est qu’Octave avait convié Berthe à profiter de l’absence de sa bonne, mais elle ne vient qu’au petit matin, trop tard pour profiter de l’occasion, et les deux malheureux en sont pour devoir entendre les lazzi des domestiques dans la cour intérieure : « Eh ! Adèle, pas vrai que ta Mlle Berthe rigolait déjà toute seule, quand tu lavais encore ses jupons ? – Maintenant, dit Victoire, elle se fait donner un coup de plumeau par le commis de son homme… Pas de danger qu’il y ait de la poussière ! […] Son chameau de bonne n’est pas là, aujourd’hui… Une sournoise qui vous mangerait, quand on parle de sa maîtresse ! Vous savez qu’elle est juive et qu’elle a assassiné quelqu’un, chez elle… Peut-être bien que le bel Octave l’époussette aussi, dans les encoignures. Le patron a dû l’embaucher pour faire les enfants, ce grand serin-là ! » Les malheurs d’Adèle strausskahnisée par tous les mâles des étages bourgeois constituent les pages les plus mémorables du roman, de ses lamentations sur son job à la scène d’anthologie de son accouchement au chapitre XVIII : « elle restait sale exprès, afin de ne pas leur donner des idées. Ah ! ouiche ! ils s’enrageaient davantage, et continuellement c’était de l’ouvrage en plus. Elle en crevait, elle avait assez déjà de Mme Josserand sur le dos, à vouloir qu’on lavât la cuisine chaque matin. » Le concierge, aveugle aux frasques des bourgeois, jubile de congédier l’ouvrière enceinte : « Tout ça, c’étaient des bourgeois, ça ne le regardait pas, ni les jeunes gens surpris au sortir des chambres de bonne, ni les dames promenant, le long des marches, des peignoirs accusateurs. […] Au moment où [l’ouvrière] lui remit la clef, Duveyrier justement débouchait du vestibule, si brûlant de sa nuit, que les taches rouges de son front saignaient. Il affecta un air rogue, une sévérité d’implacable morale, lorsque le ventre de cette créature passa devant lui. […] M. Gourd triompha. […] Non, voyez-vous, monsieur, dans une maison qui se respecte, il ne faut pas de femmes, et surtout pas de ces femmes qui travaillent ! »
Chapitre XIV
Tandis que Berthe fait languir Octave à force de rendez-vous repoussés, il reçoit les confidences de Rose Campardon heureuse du ménage à trois : « Je puis vivre sans remuer les bras ni les jambes, elle a pris toutes les fatigues du ménage ». Voilà enfin le grand moment, Berthe arrive plusieurs heures en retard à un rendez-vous. Octave, qui s’est endormi en l’attendant, « la regardait, la trouvait beaucoup mieux que Marie ; mais il n’en avait plus envie, c’était une corvée. » Cerise sur le gâteau, v’là-t’y pas que Berthe lui fait une scène parce qu’il lui fait un cadeau ; elle lui reproche de croire qu’elle se vend. Et c’est là que Zola, en maître du vaudeville, introduit la grande scène du mari jaloux, prévenu par Rachel à qui Berthe a négligé de graisser la patte : « – Ouvrez, je vous entends bien faire vos saletés… Ouvrez ou j’enfonce tout ! » Terrorisée, Berthe à moitié nue frappe à toutes les portes pour demander secours. Elle tombe sur le trouple Campardon : « Tous trois se consultaient du coin de l’œil, sans cacher leur désapprobation pour une conduite à ce point coupable. » On expulse l’adultère, Campardon retourne se coucher avec sa seconde femme, tandis que la bonne se donne du plaisir à moquer les bourgeois avec la petite Angèle à qui on a cru devoir raconter une histoire pour justifier la présence d’une femme à demi-nue : « Et Lisa, qui, avant de monter, était rentrée dans la chambre d’Angèle, lui disait : – La dame a une entorse… Montrez un peu comment elle a pris son entorse. – Tiens ! comme ça ! répondait l’enfant, en se jetant au cou de la bonne, et en la baisant sur les lèvres. »
Chapitre XV
Après le vaudeville, la farce. Auguste est résolu à se battre, mais veut d’abord consulter son beau-frère Duveyrier. Or pour le trouver, c’est un road-movie tordant. Clotilde ne veut pas donner la nouvelle adresse de son mari qui a renoué avec Clarisse, et envoie Auguste chez Bachelard. On trouve un fiacre doté d’une monture des plus rétives, et quand on arrive chez l’oncle, celui-ci, bouleversé, ne laisse pas Auguste placer un mot, et lui apprend sa propre infortune : « J’arrive ici, ce matin, plus tôt que de coutume ; j’entre dans sa chambre avec mon sucre, du café et trois pièces de quatre sous, pour lui faire une surprise ; et je la trouve couchée avec ce cochon de Gueulin !… Non, là, franchement, qu’est-ce que vous diriez ? » Mais ledit Gueulin se plaint également : « Ah ! qu’est-ce que je vous ai toujours dit ? les voilà, les voilà, les embêtements du lendemain ! Vous voyez comme ça me réussit, pour une fois que j’ai la bêtise de profiter d’une occasion… Parbleu ! la nuit a été très agréable ; mais, après, va te promener ! on en a pour la vie à pleurer comme des veaux. » Et Bachelard en rajoute : « – Ingrat, je la gardais pour toi, parole d’honneur ! Je me disais : S’il est sage, je la lui donne… Oh ! proprement, avec cinquante mille francs de dot… Et, salaud ! tu n’attends pas, tu vas la prendre comme ça, tout d’un coup ! » Auguste finit par se faire entendre, et toute la compagnie grimpe dans le carrosse en quête du magistrat chez sa poule. Au terme de péripéties multiples, on le trouve enfin, mais c’est que Clarisse, pour renouer, a eu des exigences, elle a imposé sa famille de malotrus profiteurs, et refuse désormais les amis de son amant, interdit même qu’on fume : « Peu à peu, la solitude se faisait de nouveau autour de Duveyrier : plus d’intérieur amusant, un coin de bourgeoisie féroce, où il retrouvait tous les ennuis de son ménage, dans de l’ordure et du vacarme. » De son côté, Octave surprend Valérie sortant des bras de son amant, et cela nous vaut des confidences dignes de Freud : « Et si je vous avouais pourtant combien l’amour m’ennuie ! – Voyons, pas tant que ça, dit gaiement Octave. On est des fois moins bête que nous, hier… Il y a des moments heureux. Alors, elle se confessa. […] elle faisait ça sans le vouloir souvent, uniquement parce qu’il lui venait dans la tête des choses dont elle n’aurait pu expliquer le pourquoi. Tout se cassait, elle tombait malade, elle se serait tuée. Alors, comme rien ne la retenait, autant cette culbute-là qu’une autre. – Bien vrai, jamais de bons moments ? demanda de nouveau Octave, que ce point seul semblait intéresser. – Enfin, jamais ce qu’on raconte, répondit-elle. Je vous le jure ! […] il éprouvait surtout un soulagement d’amour-propre, car il souffrait toujours au fond de son ancien dédain. Voilà donc pourquoi elle s’était refusée, un soir ! » Et Octave de conclure sur cette trouvaille qui figure dans tous les dictionnaires de citations : « Décidément, on n’aime bien que les femmes qu’on n’a pas eues. » L’ardeur belliqueuse d’Auguste s’est émoussée au fil de la course, et le chapitre se termine sur une réconciliation des trois enfants Vabre, ainsi que sur un dénouement à l’adultère non consommé : Octave promet de quitter la maison, tandis qu’Auguste, en guise de duel, doit faire interner Saturnin qui pris d’une crise, menace de l’égorger.
Chapitre XVI
Berthe trouve enfin asile chez ses parents, où Mme Josserand lui fait la morale, tout en cachant au vieux père malade, la raison de la présence de leur fille. Autre scène de farce : voilà que Mme Dambreville, la femme mûre qui a pris Léon pour gigolo, est désespérée au point de venir se plaindre à la mère dudit gigolo que celui-ci veuille épouser sa jolie nièce : « – Taisez-vous, ma chère, vous me faites honte, répondait Mme Josserand, l’air fâché. J’ai des filles qui peuvent vous entendre… Moi, je ne sais rien, je ne veux rien savoir. Si vous avez des affaires avec mon fils, arrangez-vous ensemble. Jamais je n’accepterai un rôle équivoque. Pourtant, elle l’accabla de conseils. À son âge, on devait se résigner. Dieu lui serait d’un grand secours. Mais il fallait qu’elle livrât sa nièce, si elle voulait offrir au ciel son sacrifice comme une expiation. Du reste, la veuve ne convenait pas du tout à Léon, qui avait besoin d’une femme de visage aimable, pour donner des dîners. Et elle parla de son fils avec admiration, flattée dans son orgueil, le détaillant, le montrant digne des plus jolies personnes. » C’est évidemment ce moment précis qu’Auguste choisit pour venir faire un scandale, devant M. Josserand, qui comprend enfin la situation : « – En tout cas, reprit le gendre après un silence, je ne veux pas de salope dans mon ménage… Gardez votre argent et gardez votre fille. J’étais monté pour vous dire ça. […] Oui, quand on a fait une garce de sa fille, on ne la fourre pas à un honnête homme ! » Berthe se lâche face à la réprobation de sa mère : « Toute l’histoire de son mariage revenait, dans ses phrases courtes, lâchées par lambeaux : les trois hivers de chasse à l’homme, les garçons de tous poils aux bras desquels on la jetait, les insuccès de cette offre de son corps, sur les trottoirs autorisés des salons bourgeois ; puis, ce que les mères enseignent aux filles sans fortune, tout un cours de prostitution décente et permise, les attouchements de la danse, les mains abandonnées derrière une porte, les impudeurs de l’innocence spéculant sur les appétits des niais ; puis, le mari fait un beau soir, comme un homme est fait par une gueuse, le mari raccroché sous un rideau, excité et tombant au piège, dans la fièvre de son désir. »
Chapitre XVII
Côté Octave, ça s’arrange, il va épouser Mme Hédouin, et se comporte en chat échaudé : « encore irrité de ses amours imbéciles avec Berthe, il ne rêvait plus d’utiliser les femmes, il les redoutait même. Le mieux lui semblait de devenir tranquillement l’associé de Mme Hédouin, puis de commencer la danse des millions. Aussi, se rappelant son échec ridicule auprès d’elle, la traitait-il en homme, comme elle désirait être traitée. » Les bourgeois de l’immeuble recommencent à le saluer. La fureur d’Auguste s’émousse : « Au fond, elle lui manquait, il souffrait d’un vide, il était comme dépaysé, dans les nouveaux ennuis de son abandon, aussi graves que les ennuis du ménage. Rachel, qu’il avait gardée pour blesser Berthe, le volait et le querellait maintenant, avec la tranquille impudence d’une épouse ; et il finissait par regretter les petits bénéfices de la vie à deux, les soirées passées à s’ennuyer ensemble, puis les réconciliations coûteuses dans la chaleur des draps. » M. Josserand finit par casser sa pipe de douleur, mais trop vite au gré de sa femme : « Mme Josserand, au milieu des larmes, s’emporta contre Hortense, qu’elle avait chargée d’aller chercher Auguste, comptant elle aussi remettre Berthe sur les bras de ce dernier, dans la grosse douleur des derniers moments. – Tu ne songes donc à rien ! disait-elle en s’essuyant les yeux. – Mais, maman, répondait la jeune fille en larmes, est-ce qu’on pouvait croire que papa finirait si vite !… Tu m’avais dit de descendre prévenir Auguste à neuf heures seulement, pour être sûre de le garder jusqu’à la fin. » Duveyrier, à nouveau salement lâché par Clarisse qui s’est trouvé un protecteur plus riche, veut se suicider. Sa femme qu’il admire une dernière fois se méprend sur ses intentions, et nous décoche une nouvelle saillie zolienne sur le mariage : « Ça va donc recommencer, cette abomination ? Et elle avait le cœur soulevé d’un tel dégoût, qu’il recula. Sans dire une parole, il sortit, s’arrêta dans l’antichambre, hésita une seconde ; puis, comme une porte se trouvait devant lui, la porte des lieux d’aisances, il la poussa ; et, sans hâte, il s’assit au milieu du siège. C’était un endroit tranquille, personne ne viendrait l’y déranger. Il introduisit le canon du petit revolver dans sa bouche, il lâcha un coup. » Mais le bougre se rate, et cela n’attendrit pas sa tendre épouse : « – Comment ! c’est ce que vous venez faire là ! cria Clotilde hors d’elle. Eh ! tuez-vous dehors ! Elle était indignée. Ce spectacle, au lieu de l’attendrir, la jetait à une exaspération dernière. Elle le bourra, le souleva sans précaution aucune, voulut l’emporter pour qu’on ne le vît pas en un pareil endroit. Dans ce cabinet ! et il se manquait encore ! C’était le comble. » Zola continue sa manie, dans ce roman, de tricoter une scène sur une autre, et jumelle ce suicide raté avec une tentative du prêtre de convaincre les domestiques des Duveyrier Hippolyte et Louison, de régulariser leur liaison. Hélas, le pauvre abbé se ridiculise, car Hippolyte répond : « – Bien sûr, je ne dis pas, mais je suis marié. » Le concierge en a encore contre l’écrivain qu’on ne verra décidément jamais : « on était venu de la police, oui, de la police ! L’homme du second avait écrit un roman si sale, qu’on allait le mettre à Mazas. – Des horreurs ! continua-t-il, d’une voix écœurée. C’est plein de cochonneries sur les gens comme il faut. Même on dit que le propriétaire est dedans ; parfaitement, M. Duveyrier en personne ! Quel toupet ! […] Et, vous voyez, ça roule carrosse, ça vend leurs ordures au poids de l’or ! » Belle scène quand Berthe, rentrée au domicile, congédie Rachel : « Tout d’un coup, chez cette fille muette et respectueuse, dont les autres bonnes elles-mêmes ne pouvaient tirer la moindre indiscrétion, une débandade avait lieu, pareille à la débâcle d’un égout. Mise déjà hors d’elle-même par la rentrée de madame chez monsieur, qu’elle volait à l’aise depuis la séparation, elle était devenue terrible […] – tu ne me flanquais pas dehors, quand je cachais tes chemises, derrière le dos de ton cocu !… Et le soir où ton amant a dû remettre ses chaussettes au milieu de mes casseroles, pendant que j’empêchais ton cocu d’entrer, pour te donner le temps de te refroidir !… Salope, va ! » Les bonnes, témoins de la scène, sont outrées : « Ça finissait par dépasser les bornes. […] – Ah bien ! non, on bavarde, mais on ne tombe pas comme ça sur les maîtres. »
Chapitre XVIII
Voici enfin la scène de l’accouchement d’Adèle, qui n’a découvert sa grossesse que sur le tard, et l’a cachée par peur d’être renvoyée. La scène mérite d’être citée presque entière : « Même lorsque son ventre la laissait un peu respirer, elle souffrait là, sans arrêt, d’une souffrance fixe et têtue. Et, pour se soulager, elle s’était empoigné les fesses à pleines mains, elle se les soutenait, pendant qu’elle continuait à marcher en se dandinant, les jambes nues, couvertes jusqu’aux genoux de ses gros bas. Non, il n’y avait pas de bon Dieu ! Sa dévotion se révoltait, sa résignation de bête de somme qui lui avait fait accepter sa grossesse comme une corvée de plus, finissait par lui échapper. Ce n’était donc pas assez de ne jamais manger à sa faim, d’être le souillon sale et gauche, sur lequel la maison entière tapait : il fallait que les maîtres lui fissent un enfant ! Ah ! les salauds ! Elle n’aurait pu dire seulement si c’était du jeune ou du vieux, car le vieux l’avait encore assommée, après le mardi gras. L’un et l’autre, d’ailleurs, s’en fichaient pas mal, maintenant qu’ils avaient eu le plaisir et qu’elle avait la peine ! Elle devrait aller accoucher sur leur paillasson, pour voir leur tête. Mais sa terreur la reprenait : on la jetterait en prison, il valait mieux tout avaler. »
Voici la délivrance : « La gorge renversée, les jambes élargies, elle se cramponnait des deux mains au lit de fer, qu’elle ébranlait de ses secousses. C’étaient heureusement des couches superbes, une présentation franche du crâne. Par moments, la tête qui sortait, semblait vouloir rentrer, repoussée par l’élasticité des tissus, tendus à se rompre ; et des crampes atroces l’étreignaient à chaque reprise du travail, les grandes douleurs la bouclaient d’une ceinture de fer. Enfin, les os crièrent, tout lui parut se casser, elle eut la sensation épouvantée que son derrière et son devant éclataient, n’étaient plus qu’un trou par lequel coulait sa vie ; et l’enfant roula sur le lit, entre ses cuisses, au milieu d’une mare d’excréments et de glaires sanguinolentes.
Elle avait poussé un grand cri, le cri furieux et triomphant des mères. Aussitôt, on remua dans les chambres voisines, des voix empâtées de sommeil disaient : « Eh bien ! quoi donc ? on assassine !… Y en a une qu’on prend de force !… Rêvez donc pas tout haut ! » Inquiète, elle avait repris le drap entre les dents, elle serrait les jambes et ramenait la couverture en tas sur l’enfant, qui lâchait des miaulements de petit chat. Mais elle entendit Julie ronfler de nouveau, après s’être retournée ; pendant que Lisa, rendormie, ne sifflait même plus. Alors, elle goûta pendant un quart d’heure un soulagement immense, une douceur infinie de calme et de repos. Elle était comme morte, elle jouissait de ne plus être.
Puis, les coliques reparurent. Une peur l’éveillait : est-ce qu’elle allait en avoir un second ? Le pis était qu’en rouvrant les yeux, elle venait de se trouver en pleine obscurité. Pas même un bout de chandelle ! et être là, toute seule, dans du mouillé, avec quelque chose de gluant entre les cuisses, dont elle ne savait que faire ! Il y avait des médecins pour les chiens, mais il n’y en avait pas pour elle. Crève donc, toi et ton petit ! Elle se souvenait d’avoir donné un coup de main chez Mme Pichon, la dame d’en face, quand elle était accouchée. En prenait-on des précautions, de crainte de l’abîmer ! Cependant, l’enfant ne miaulait plus, elle allongea la main, chercha, rencontra un boyau qui lui sortait du ventre ; et l’idée lui revint qu’elle avait vu nouer et couper ça. Ses yeux s’accoutumaient aux ténèbres, la lune qui se levait éclairait vaguement la chambre. Alors, moitié à tâtons, moitié guidée par un instinct, elle fit, sans se lever, une besogne longue et pénible, décrocha derrière sa tête un tablier, en cassa un cordon, puis noua le boyau et le coupa avec des ciseaux pris dans la poche de sa jupe. Elle était en sueur, elle se recoucha. Ce pauvre petit, bien sûr, elle n’avait pas envie de le tuer.
Mais les coliques continuaient, c’était comme une affaire qui la gênait encore et que des contractions chassaient. Elle tira sur le boyau, d’abord doucement, puis très fort. Ça se détachait, tout un paquet finit par tomber, et elle s’en débarrassa en le jetant dans le pot. Cette fois, grâce à Dieu ! c’était bien fini, elle ne souffrait plus. Du sang tiède coulait seulement le long de ses jambes.
Pendant près d’une heure, elle dut sommeiller. Six heures sonnaient, lorsque la conscience de sa position l’éveilla de nouveau. Le temps pressait, elle se leva péniblement, exécuta des choses qui lui venaient à mesure, sans qu’elle les eût arrêtées d’avance. Une lune froide éclairait en plein la chambre. Après s’être habillée, elle enveloppa l’enfant de vieux linge, puis le plia dans deux journaux. Il ne disait rien, son petit cœur battait pourtant. Comme elle avait oublié de regarder si c’était un garçon ou une fille, elle déplia les papiers. C’était une fille. Encore une malheureuse ! de la viande à cocher ou à valet de chambre, comme cette Louise, trouvée sous une porte ! Pas une bonne ne remuait encore, et elle put sortir, se faire tirer en bas le cordon par M. Gourd endormi, aller poser son paquet dans le passage Choiseul dont on ouvrait les grilles, puis remonter tranquillement. Elle n’avait rencontré personne. Enfin, une fois dans sa vie, la chance était pour elle !
Tout de suite, elle arrangea la chambre. Elle roula la toile cirée sous le lit, alla vider le pot, revint donner un coup d’éponge par terre. Et, exténuée, d’une blancheur de cire, le sang coulant toujours entre ses cuisses, elle se recoucha, après s’être tamponnée avec une serviette. Ce fut ainsi que Mme Josserand la trouva, lorsqu’elle se décida à monter vers neuf heures, très surprise de ne pas la voir descendre. La bonne s’étant plainte d’une diarrhée affreuse qui l’avait épuisée toute la nuit, madame s’écria :
– Pardi ! vous aurez encore trop mangé ! Vous ne songez qu’à vous emplir. »
L’enfant expédié, on passe au dîner final chez les Duveyrier, où sont invités entre autres Mme Dambreville avec son Léon : « Celui-ci, après son mariage avec la nièce, était retombé aux bras de la tante, dont il avait encore besoin. On les voyait arriver ensemble dans tous les salons, et ils excusaient la jeune femme, qu’une grippe ou une paresse, disaient-ils, retenait chez elle. » Il y a aussi « Mme Octave Mouret », c’est-à-dire Mme Hédouin, le mariage ayant eu lieu après le deuil. On cause domestiques, et sur ce chapitre, « l’autre Mme Campardon […] comblait Lisa d’éloges : une perle, aucun reproche à lui faire, enfin une de ces bonnes méritantes auxquelles on donne des prix. – Maintenant, elle est de la famille, dit-elle. Notre petite Angèle suit des cours à l’Hôtel de Ville, et c’est Lisa qui l’accompagne… Oh ! elles pourraient bien rester ensemble des journées dehors, nous ne sommes pas inquiets. » Ces messieurs parlent morale, et Duveyrier, sans doute auteur des maux d’Adèle, avec « sa gueule de travers » et une voix changée, évoque avec horreur « une affaire dans laquelle on avait beaucoup remarqué son attitude. On allait même le nommer président de chambre et officier de la Légion d’honneur. Il s’agissait d’un infanticide remontant déjà à plus d’un an. La mère dénaturée, une véritable sauvagesse, comme il le disait, se trouvait être précisément la piqueuse de bottines, son ancienne locataire, cette grande fille pâle et désolée, dont le ventre énorme indignait M. Gourd. Et stupide avec ça ! car, sans même s’aviser que ce ventre la dénoncerait, elle s’était mise à couper son enfant en deux, pour le garder ensuite au fond d’une caisse à chapeau. Naturellement, elle avait raconté aux jurés tout un roman ridicule, l’abandon d’un séducteur, la misère, la faim, une crise folle de désespoir devant le petit qu’elle ne pouvait nourrir : en un mot, ce qu’elles disaient toutes. Mais il fallait un exemple. Duveyrier se félicitait d’avoir résumé les débats avec cette clarté saisissante, qui parfois déterminait le verdict du jury. – Et vous l’avez condamnée ? demanda le docteur. – À cinq ans, répondit le conseiller de sa voix nouvelle, comme enrhumée et sépulcrale. Il est temps d’opposer une digue à la débauche qui menace de submerger Paris. » Octave a peu de nostalgie pour ses anciennes conquêtes : « C’était le passé, et il revit ses amours, toute sa campagne de Paris : les complaisances de cette bonne petite Pichon, son échec auprès de Valérie dont il gardait un agréable souvenir, sa liaison imbécile avec Berthe qu’il regrettait comme du temps perdu. Maintenant, il avait fait son affaire, Paris était conquis ; et, galamment, il suivait celle qu’il nommait encore au fond de lui Mme Hédouin, il se baissait pour que la traîne de sa robe ne s’accrochât pas aux tringles des marches. » La conclusion est laissée au « puisard empesté » où les domestiques se soulagent : « Mon Dieu ! mademoiselle, celle-ci ou celle-là, toutes les baraques se ressemblent. Au jour d’aujourd’hui, qui a fait l’une a fait l’autre. C’est cochon et compagnie. »
– Le livre ne connaît qu’une adaptation cinématographique, par Julien Duvivier, en 1957. Je ne l’ai pas encore vue, mais la lecture de l’article de Wikipédia semble indiquer que le scénario a été recentré sur Octave, pour mettre en valeur, sans doute, l’acteur Gérard Philipe. L’affiche (ci-dessus) est édifiante. Il existe également une adaptation télévisée de 1972 par Yves-André Hubert, disponible sur le site de l’INA. Dans les premières minutes du premier épisode (l’ensemble fait plus de 6 heures !), sur la porte de l’écrivain mystérieux & sulfureux du 2e étage, figure le nom de Zola…
– Au chapitre X de La Joie de vivre, deux ans plus tard, Zola se surpassera dans le genre particulier de la scène d’accouchement.
Voir en ligne : Pot-Bouille sur Wikisource
© altersexualite.com, 2016.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Ce thème de la pédophilie des élites, s’est déjà rencontré dans La Curée, et on le retrouvera dans La Bête humaine.
 altersexualite.com
altersexualite.com